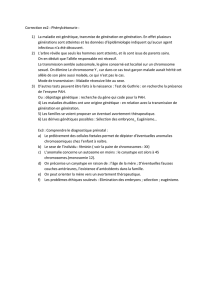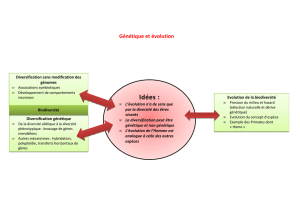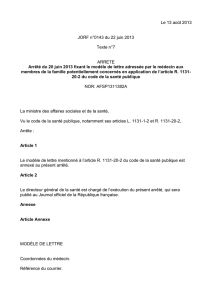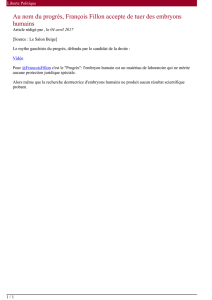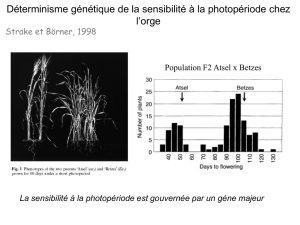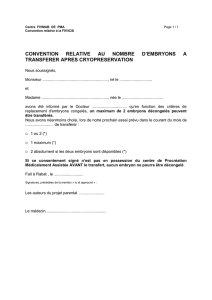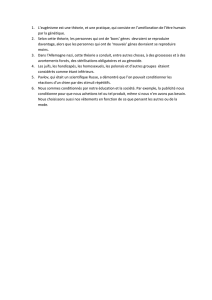Epreuve de francais - 1998

1998
I. S. F. A. 1998-1999
_________ _________
Concours d'Entrée
_______________
ÉPREUVE DE FRANÇAIS
_______________________
Durée : 4 heures
1ère PARTIE
CONTRACTION DE TEXTE
-------------------------------------
(Durée : 2 heures)
Vous résumerez en 250 mots (tolérance + ou - 10 %) ce texte de Jacques TESTART, extrait de son
livre Le désir du gène, «L’eugénisme est dans l’œuf», Editeur François Bourin.
NORME ET COMPETITION
Le vivant et le milieu ne sont pas normaux pris séparément,
mais c’est leur relation qui les rend tels l’un à l’autre.
Georges Canguilhem.
Rappelons la définition de l’eugénisme par Galton (1883) : «Donner aux meilleures races ou lignées
une plus grande probabilité de l’emporter sur les moins bonnes que cela n’aurait été possible autrement».
Cette perspective darwinienne engage simultanément à reconnaître les meilleurs et à les pousser dans la
grande compétition. Elle apparaît comme bien différente de la pratique d’eugénisme négatif que les
diagnostics génétiques ont rendu possibles, puisque ces diagnostics n’auraient pour but que d’identifier les
handicaps, non les avantages. Cependant, les états de normalité et santé étant ceux qu’on espère idéalement
du corps, et l’amélioration de tels états n’étant pas conceptualisée, le rejet du défaut équivaut alors à
l’élection de la qualité.
Pour la médecine, comme pour la plupart des parents, l’enfant d’apparence normale est aussi le
surhomme majoritaire, tant que l’existence ne vient pas discriminer plus finement : il ne saurait exister d’être
plus parfait que le nouveau-né qui ne manifeste aucun handicap dans sa stature, sa constitution, sa
physiologie, ce qui est le cas de la plupart des nourrissons, tant qu’une analyse policière du substrat
génétique ne vient pas révéler des défauts à apparition différée. La confrontation du message génétique avec
les facteurs du milieu prononce la différence et les risques dans le cours du développement et fait de chaque
vieillard un déviant médical puisqu’il n’est jamais indemne de troubles, séquelles, carences. C’est la rançon
de l’apparente perfection initiale que cette exposition aux décrépitudes variées mais inexorables avec le
temps de chaque vie car, écrit David Le Breton1, «de même que le porteur d’un handicap, le vieillard est
l’objet de son corps, et non plus sujet à part entière». Bien qu’il soit normal, au sens des statistiques comme
au bon sens, de perdre en santé quand l’usure gagne le corps, la tendance médicale et sociale est d’inscrire ce
devenir dans l’anormalité. Car l’idéal sanitaire se combine avec l’étrangeté de chaque cas : il n’est pas deux
façons identiques de souffrir, ou seulement de vieillir, et ces originalités appellent chaque fois la
dénomination de pathologies et les soins adaptés. Comme le dit Michel Foucault, «la maladie finalement,
c’est, à une époque donnée et dans une société donnée, ce qui se trouve pratiquement ou théoriquement
médicalisé2». Ce constat complète celui de Georges Canguilhem : «C’est d’abord parce que les hommes se
1 D. Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, P.U.F., 1991.
2 M. Foucault, Médecine de France, 1969, n° 200.

1998
2
sentent malades qu’il y a une médecine. Ce n’est que secondairement que les hommes, parce qu’il y a une
médecine, savent en quoi ils sont malades3». Il serait admirable que la médecine fût capable d’opposer des
parades à chaque déviance du corps, au moins pour en apaiser les souffrances, au mieux pour en guérir, mais
qu’on ne s’illusionne pas sur les issues individuelles : les appellations savantes des formes variées de la
vieillesse et les parades proposées ne nous protégeront jamais de la disparition.
Canguilhem prend soin de distinguer l’anomalie de l’anormalité. Le premier terme, descriptif, désigne
aussi bien les infirmités ou défauts chromosomiques que des écarts statistiques à un type normatif de vie.
«Dès que l’étiologie et la pathogénie d’une anomalie sont connues, l’anormal devient pathologique», mais
toute anomalie n’est pas pathologique. Au contraire de l’anormal, l’anomal est apprécié comme tel parce que
sa maladie «éclate dans la succession chronologique», venant rompre l’état précédant considéré comme
normal. Ce que nous impose la médecine prédictive est bien la confusion de l’anomalie avec la maladie,
l’une et l’autre étant représentées comme manquement, actuel ou potentiel, à un état de santé mythique.
Ainsi la norme médicale, qui est l’état de perfection sanitaire, s’épuise progressivement du nouveau-né
à l’enfant, de l’enfant à l’adulte puis au vieillard. Mais qu’advient-il quand la biomédecine vient détecter
l’anomalie en amont, chez le fœtus ou l’embryon ? Elle découvre simultanément des déviants qui eussent pu
naître et d’autres que la grossesse aurait éliminés, ces derniers devenant d’autant plus nombreux que le
diagnostic est plus précoce. Plus l’être est jeune, moins il manifeste son rapport à la norme, qu’on ne peut
alors dépister qu’au cœur des chromosomes, sous forme d’«anomalie». L’œuf fécondé atteint de trisomie et
celui qui ne l’est pas ne diffèrent en rien qui puisse se deviner du dehors, car les défauts ne se manifestent
qu’en progression du développement, de la fécondation vers la mort. Alors que la médecine de l’adulte
définit l’anormalité comme écart à l’état de santé, et même si cet écart concerne une majorité des individus,
la médecine de l’œuf désigne l’anormalité d’êtres non malades mais qui diffèrent potentiellement de la
majorité. C’est dire la nature différente de ces deux médecines et la nouveauté des enjeux qu’introduit la
médecine prédictive grâce aux techniques du diagnostic génétique. Car, malgré les promesses de prévenir
certains risques de handicap avant qu’ils ne se manifestent, la médecine prédictive appliquée à l’œuf sera
surtout euthanasique dans ses actes et eugénique dans sa fonction. «Si, chez un couple ayant produit dix
embryons, deux révèlent un marqueur génétique pour l’hypercholestérolémie ou l’hypertension, ne pas
transférer ces embryons constituerait un choix raisonnable4». Il est clair que les procès, de plus en plus
souvent intentés par les couples quand ils estiment le médecin responsable d’un préjudice (telle la naissance
d’un enfant anormal), vont accélérer l’élargissement du contrôle sur la qualité des enfants. «C’est donc sur le
terrain du droit et des assurances que risque désormais d’être tranchée la question des anormalités
néonatales, au moins autant que dans les instances éthiques […]. Le pragmatisme médical, et ce qu’il
pourrait revêtir d’arbitraire par rapport à d’autres critères (philosophiques, sociaux, subjectifs…), vient donc
se confronter, au fil des procès, à de la normativité sociale en train de se constituer à la frontière de la
médecine et du droit5».
Si nous avons jusqu’ici assimilé la perfection à la norme, ou à l’absence d’anomalies, il faut prévoir le
souci de dépassement du normal, la recherche de qualités rares, sous la pression conjuguée des victoires de
la cartographie génique et des aspirations sociales. Alors la norme pourrait s’établir quelque part entre le
handicap et l’exploit, puisque la qualité humaine prendrait place sur une échelle de mesure comme il arrive
déjà pour la vitesse à la course, le montant des revenus ou le classement scolaire. C’est peut-être l’abondance
partagée des bons gènes, dits «normaux», et l’absence apparente de gènes qui leur seraient supérieurs qui
nous amènent à considérer comme déviants, plutôt qu’inférieurs, les gènes mutants responsables de nos
maladies. La génétique moléculaire ignore encore la classification hiérarchique, elle reconnaît seulement des
gènes normaux et des gènes pathologiques. Mais s'attaquant depuis peu aux caractères à base polygénique,
elle va bien devoir affronter les combinatoires à gènes multiples qui privilégient ou défavorisent leurs
porteurs, sans les introduire automatiquement dans la pathologie. C’est alors que la norme génétique ne sera
plus définie par l’absence de tares mais par la qualité moyenne de l’équipement génique, en référence à sa
distribution statistique dans la population.
3 G. Canguilhem, le Normal et le Pathologique, P.U.F., 1966.
4 J.A. Robertson, Fertility and Sterility, 1992, t. 57, p. 1-11.
5 L. Gavarini, in le Magasin des enfants, Ed. François Bourin, 1990.

1998
3
Voit-on bien la révolution éthique qui s’annonce si les qualités humaines sont jaugées par l’analyse
des chairs, pourquoi pas par l’analyse de l’œuf avant l’ébauche des chairs ? Même si, à l’évidence,
l’expression de ces qualités chez l’enfant reste soumise à la forte influence du milieu, il deviendra possible
de hiérarchiser des potentiels d’humanité chez des personnes seulement potentielles. Car on peut tenir
comme hautement probable que, de même que certaines constitutions géniques favorisent le diabète ou
l’allergie, d’autres favorisent ou entravent les capacités physiques, manuelles, artistiques ou intellectuelles. Il
n’y a pas de gène de l’intelligence mais il existe certainement des assemblages complexes d’informations
génétiques, plus ou moins propices à l’éveil, en interaction avec les messages du dehors.
Il y a cent cinquante ans, Quételet, grâce à des mesures physiques réalisées sur des individus
nombreux, avait obtenu une courbe en cloche représentant la distribution normale du paramètre mesuré dans
la population. Il en avait conclu qu’il existe un «homme moyen», conçu comme parfait par le Créateur, et
que les écarts par rapport à cet individu de référence tenaient à des imperfections dans la réalisation du
modèle. Au contraire, l’élitisme revendiqué par les eugénistes depuis un siècle les a amenés à s’intéresser
aux franges plutôt qu’à la moyenne. «Galton portait son attention sur l’ordre des individus rangés selon leurs
aptitudes physiques ou intellectuelles. La perfection à atteindre n’était plus l’homme moyen, mais au
contraire, le génie, c’est-à-dire le cas extrême6». Un même déplacement du phénotype dans la représentation
sociale va bientôt atteindre le génotype.
L’ignorance instituait le privilège pour tout être humain de naître égal aux autres, privilège, ou
anomalie, unique dans un monde où tout se mesure. Nous faudra-t-il regretter le temps de l’ignorance si la
valeur de l’homme devient mesurable avant même qu’il ait respiré ? Alors il arrivera que la norme ploie sous
la revendication d’excellence, partageant parmi nos œufs les alpha et les oméga… Comme déjà exprimé,
nous ne désignons pas la modification du génome embryonnaire pour parvenir à ces fins car cette
perspective, crédible à long terme, est l’arbre redoutable qui cache la forêt des périls proches. L’amélioration
des humains par tri d’embryons labellisés demeure l’étape technique et éthique qu’il faudra franchir avant
d’oser la production d’embryons nobelisés.
«Il suffirait […] de redéfinir ce qu’est un embryon normal au plan chromosomique et donc de définir
des limites acceptables à l’eugénisme». C’est ce qu’écrit Michèle Plachot, biologiste de FIV7. Aura-t-on
jamais fini, à coups de programme Génome humain, de «redéfinir ce qu’est un embryon normal» ? Nous
avons signalé8 que le Japon dispose actuellement d’une loi eugénique énonçant cinquante-cinq maladies qui
justifient la stérilisation. Ce n’est certainement pas par hasard que les pays occidentaux se sont jusqu’ici
abstenus, hors l’épisode nazi, de désigner ceux des humains qui ne mériteraient pas de vivre : la publication
d’une liste instituant dans la loi une population de sous-hommes serait une violence inadmissible à
l’humanité, même si la carence d’une telle liste est propice à tous les abus.
Dans la mesure où seraient prédictibles les capacités d’un embryon à manifester la santé (mutations,
facteurs de risque) aussi bien que certaines caractéristiques ou certaines aptitudes (sexe, configuration
polygénique), on devrait s’attendre à une forte demande sociale pour que soit réalisé le tri des embryons
selon les techniques décrites plus haut. Et cette sélection ne devrait pas négliger, au-delà du pronostic de
«normalité», le pronostic de performance. Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser, comme l’a fait Laurence
Gavarini9, la mise en place du système de «prédiction scolaire» qui vise à évaluer le «handicap
socioculturel» chez les enfants avant même leur scolarisation et où on retrouve le vocabulaire de la
génétique : «prédiction», «risque d’échec», «enfant à risque», «dépistage»… Laurence Gavarini souligne que
la précocité manifestée par ces enfants «devient la normalité même, la ligne de partage entre les enfants
prometteurs et les enfants à difficultés potentielles». Ce déplacement de la normalité, conséquence
d’exigences nouvelles, n’est pas sans rappeler ce que nous évoquions concernant l’œuf ou le nouveau-né.
Surtout, Laurence Gavarini remarque que «l’usage actuel de cette valeur [la précocité] est explicitement
élitaire ou élitiste» : «l’enfant performant est […] mis en exergue pour renforcer en fait le niveau d’exigence,
le niveau de groupe, et exclure, à l’autre bout de la chaîne, les enfants qui accuseraient un retard relatif par
6 A. Desrosières, Hermès, 1988, p. 41-46
7 M. Plachot in C. Byk, Procréation artificielle. Où en sont l’éthique et le droit ?, Masson, 1989.
8 Voir, p. 62-63
9 L. Gavarini, Esprit, à paraître.

1998
4
rapport à cette normale-précocité"». En attendant qu’on s’attaque aux gènes putatifs de cette sacro-sainte
précocité, il faut considérer que la pression élitiste et exclusive dans la gestion des tout jeunes enfants est
aussi celle qui fait demander l’avortement d’un fœtus à six doigts, et qu’elle trouvera des conditions plus
favorables dans la gestion des embryons dénommés «préembryons».
La nouvelle exigence de «qualité» des enfants relève de leur rareté relative et aussi de la technicité qui
préside de plus en plus à leur conception et à leur naissance. Mais les parents ne peuvent extraire leur enfant
du monde réel, qui est celui de la compétition, plus nettement qu’au temps de Galton, lequel visait pour les
meilleurs «une plus grande probabilité de l’emporter»… La tentation élitiste dans la procréation appartient à
tous les temps, mais elle est aujourd’hui accentuée par la conjonction d’une volonté scientiste de maîtrise du
destin (médecine prédictive) et de la compétition exacerbée entre les personnes, entre les enfants, les
embryons et même les gènes.
Le souci de l’emporter contre les autres affecte les États, les entreprises et les laboratoires. Otant pour
une fois le masque trompeur de la «soif irrésistible de découvrir», une circulaire du ministère de la
Recherche et de la Technologie datée du 27 février 1992 recommande «un soutien exceptionnel des activités
de recherche nationales, compte tenu de l’intensité de la compétition internationale». Les découvertes
fondamentales se font plus rares que les dépôts de brevets, comme des accidents dans des parcours de
recherche bornés par la nécessité. La compétition est l’essence même du comportement responsable,
revendiquée sans pudeur par tout ce qui gagne, et donc s’exprime avec autorité, comme si la plus grande
gloire de l’humanité était de se soumettre au darwinisme. Les bonnes entreprises produisent des armées de
chômeurs, le tiers monde est asphyxié sous la dette et le cours imposé des matières premières, les enfants
affluent dans des classes dépotoirs. L’éthique aussi s’est mise du côté de l’efficacité et de la performance,
rejetant les oripeaux de la morale dans les poubelles de l’obscurantisme. Comment cette fièvre de gagner
n’atteindrait-elle pas les fœtus, les embryons, et même les gènes ? Le désir de maîtriser le devenir de
l’espèce est déguisé en désir de savoir10, lequel, «venu du fond des âges, n’est pas seulement culturel mais
sans doute génétique» selon Jacques Monod11. Alors il ne resterait plus qu’à mettre en œuvre, pour le bien
de l’espèce, la sélection génétique des porteurs du «gène du désir de savoir», afin qu’ils amplifient les
progrès de la génétique…
Vous indiquerez sur votre copie le nombre de mots employés, par tranches de 50, ainsi que le nombre
total.
Il convient de dégager les idées essentielles du texte dans l'ordre de leur présentation, en soulignant
l'articulation logique et sans ajouter de considérations personnelles.
Il est rappelé que tous les mots - typographiquement parlant - sont pris en compte : un article (le, l'),
une préposition (à, de, d') comptent pour un mot.
2ème PARTIE
DISSERTATION
----------------------
(Durée : 2 heures)
10 J. Testart, in le Magasin des enfants, op. cit.
11 J. Monod, le Hasard et la Nécessité, Seuil, 1970.

1998
5
Pouvez-vous représenter, selon la formule de Testart, la qualité humaine à l’aide d’une échelle de
mesure comme il arrive déjà pour la vitesse à la course, le montant des revenus ou le classement scolaire ?
(p. 260)
1
/
5
100%