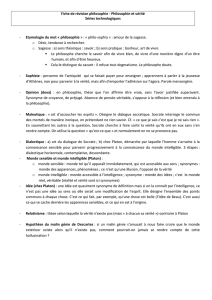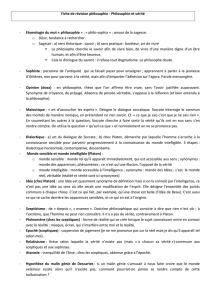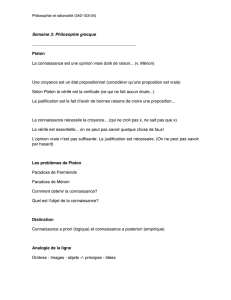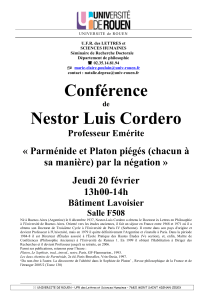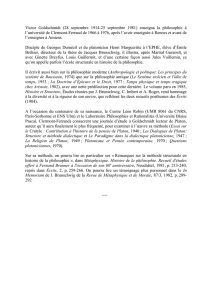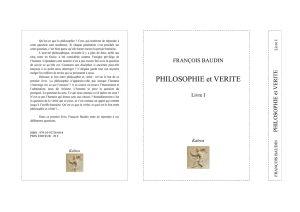Mémoire de maîtrise - Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke
Faculté des lettres et sciences humaines
Département de philosophie et d’éthique appliquée
LE PRAGMATISME :
VERS UN PLURALISME ÉPISTÉMOLOGIQUE
Par
Emile Bourdages-Perreault
Mémoire de maîtrise en philosophie (MA)
Sous la supervision de
M. Alain Létourneau
Avril, 2017
© Émile Bourdages-Perreault

1
RÉSUMÉ
Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la philosophie pragmatiste sous l'angle
particulier de l'épistémologie. Nous cherchons avant tout à rendre compte de l'apport historique
important du pragmatisme classique (James et Dewey) pour un tel chantier. Sur le fond, l'objectif
est cependant plus ambitieux: nous cherchons à étudier les conséquences épistémologiques des
principales thèses pragmatistes sur les plans métaphysique et anthropologique. Nous faisons
l’hypothèse que les positions métaphysiques et anthropologiques du pragmatisme ouvrent
ultimement sur une posture épistémologique dite «pluraliste» qui implique la reconnaissance
d'une pluralité de manières d'interpréter et d'expliquer le monde. Dans un premier temps, nous
étudions les fondements de la «théorie spéculaire de la connaissance» qui a été formalisée par
Platon et qui, en gros, est restée collée à la tradition philosophique occidentale, laquelle conçoit
l’esprit comme un «miroir» nous permettant de nous représenter exactement le monde extérieur
et la science comme la discipline par laquelle cette représentation est rendue possible. Dans notre
second chapitre, nous étudions le renversement qu’opère le pragmatisme sur ces questions en
fouillant les fondements métaphysiques, biologiques et psychologiques à partir desquels s’est
élaboré son projet critique et constructif. Nous rendons aussi compte de la «théorie pragmatiste
de la connaissance» afin d’expliciter clairement ce qui la caractérise et la différencie d’une
doctrine comme celle qui est défendue par la tradition rationaliste. Enfin, dans notre troisième et
dernier chapitre, nous répondons à notre question et notre hypothèse de recherche à partir d’une
explication «pragmatiste» du concept de vérité. Nous démontrons, en outre, que les résultats
obtenus approfondissent et fortifient l’hypothèse de départ. Nous concluons finalement en faisant
part de l’actualité que revêt encore pour nous aujourd’hui le pragmatisme.

2
REMERCIEMENTS
Je tiens d’abord à remercier ma mère et mon père pour leur soutien financier et moral,
sans lequel l’aboutissement de ce long et ardu travail de recherche, d’exploration et de rédaction
n’aurait été rendu possible. Ce travail leur est dédié.
Je tiens aussi à remercier du plus profond de mon cœur mon amie, ma partenaire, mon
amoureuse, Édith Jacques, qui a été à mes côtés du premier jusqu’au dernier jour. Merci
infiniment de m’avoir accompagné durant cette longue aventure. Tes conseils, tes
encouragements et ton énergie m’ont permis de me surpasser chaque jour.
Je tiens enfin à remercier mon directeur de recherche, M. Alain Létourneau, pour sa
grande générosité, sa disponibilité et ses conseils toujours très judicieux. Ce travail aurait été tout
simplement impossible sans sa présence. Je lui en suis donc profondément redevable.

3
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 4
1. Exposition de la problématique ............................................................................................. 5
2. Question de recherche et hypothèse ..................................................................................... 14
3. Méthodologie et plan du mémoire ....................................................................................... 15
CHAPITRE 1
LA THÉORIE SPÉCULAIRE DE LA CONNAISSANCE
1. Le mythe de la Caverne .......................................................................................................... 18
2. Monde, esprit et miroir ........................................................................................................... 33
3. Les méthodes «ophtalmo-logiques» ....................................................................................... 43
4. Le concept de vérité-correspondance ..................................................................................... 50
5. Le monisme épistémologique ................................................................................................. 56
CHAPITRE 2
LE PRAGMATISME
1. Les sources du pragmatisme ................................................................................................... 66
2. Expérience et interprétation .................................................................................................... 78
3. La méthode pragmatique ........................................................................................................ 84
CHAPITRE 3
VERS UN PLURALISME ÉPISTÉMOLOGIQUE
1. Nouvelle conception de la vérité ............................................................................................ 88
2. Le pluralisme épistémologique ............................................................................................... 93
3. Actualité du pragmatisme ..................................................................................................... 103
CONCLUSION ........................................................................................................................... 110
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................... 115

4
INTRODUCTION
«Mais qu’est-ce donc que la philosophie aujourd’hui
[…] si elle n’est pas le travail critique de la pensée sur
elle-même? Et si elle ne consiste pas, au lieu de
légitimer ce qu’on sait déjà, à entreprendre de savoir
comment et jusqu’où il serait possible de penser
autrement?»
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, vol. 2,
L’usage des plaisirs.
«L’histoire de la longue erreur, c’est l’histoire de la
représentation […].»
Gilles Deleuze, Différence et répétition.
«Renoncer à la représentation, c’est évidemment faire
violence à […] «une époque aussi longue que
l’Occident», à un mode apparemment coextensif à
l’humanité, à ce qui semble ne pas pouvoir finir.»
Aurélien Barrau, La cosmologie comme «manière de
faire un monde».
Grossièrement, la philosophie peut se ramener à diverses reprises et reformulations du
platonisme. Alfred North Whitehead disait de la philosophie qu’elle consistait «[…] en une
succession d’apostilles à Platon
1
.» C’est que Platon dresse, pour reprendre un terme deleuzien,
une «nouvelle image de la pensée» qui a redéfini de bonne heure ses ambitions et qui oriente
quelque deux mille ans de débats philosophiques. La «doctrine du représentationnalisme», ou
plutôt la «théorie spéculaire de la connaissance», formule qui nous est directement inspirée de
Richard Rorty
2
, a fait de l’esprit quelque chose comme un «miroir de la nature», une faculté qui
permettrait de nous «représenter adéquatement ce qui est en dehors de l’esprit»
3
. De là s’ensuivit
l’idée de la connaissance et de la vérité comme «représentation exacte» du réel. En fondant ainsi
1
A. N. WHITEHEAD. Procès et réalité. Essai de cosmologie, Paris, Gallimard, 1995, p. 98.
2
Voir en particulier Richard Rorty, L’Homme spéculaire, Paris, Éditions du Seuil, 1990.
3
R. RORTY. L’Homme spéculaire, Trad. de Thierry Marchaisse, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 13.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
1
/
122
100%