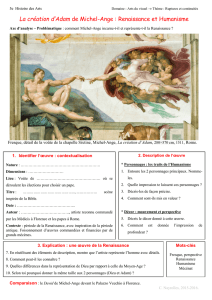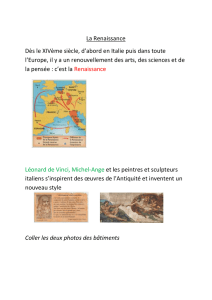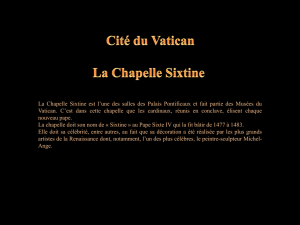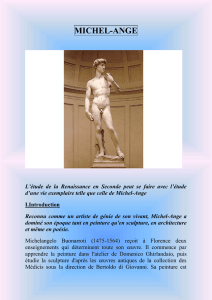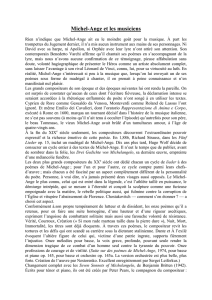Parle-leur de batailles, de rois et d`éléphants out d`abord, il est

Parle-leur de batailles, de rois et
d'éléphants
Ce roman de Mathias Enard, publié courant été 2010,
retrace le voyage de Michel-Ange en Turquie. Il
tangue entre fiction et réalité : en effet, certains
événements qui y sont relatés ont réellement eu lieu
(le voyage de Michel-Ange n'est pas pure invention),
et les noms des personnages n'ont pas été modifiés.
Toutefois, certains faits ne s'appuient que sur
l'imagination de Enard.
out d'abord, il est important de savoir que
Michel-Ange est un génie italien de la
Renaissance né en 1475 et mort en 1564.
Comme bon nombre d'artistes de l'époque, il avait
plusieurs vocations et talents. Il est notamment
connu en tant que peintre (il a participé à la
réalisation de la décoration de la Chapelle Sixtine)
et sculpteur (son David lui a valu sa renommée).
Mais il était également poète et architecte : c'est
d'ailleurs ses talents d'architecture qui sont mis
en relief dans ce roman.
En 1505, après avoir sculpté le David,
œuvre considérée comme le symbole même de
Florence à son apogée, Michel-Ange est appelé à
Rome par le Pape Jules II, ce dernier souhaitant
que l'artiste florentin se penche sur la réalisation
de son tombeau pontifical. Néanmoins, l'homme
colérique et exigeant qu'est le pape ne cesse de
rabaisser Michel-Ange, et ne le paie pas : en plus
de ne pas gagner d'argent, l'artiste se voit obligé
de payer lui-même certaines dépenses relatives au
chantier. Il fuit donc les caprices de Jules II, ne
supportant plus de voir son talent sous-estimé à
ce point.
Au début du XVI° siècle, le sultan de
Turquie, Bayezid II, décide de construire un pont
enjambant la Corne d'Or (un estuaire de Turquie).
Il a, dans un premier temps, sollicité Leonard de
Vinci, génie de la Renaissance, mais les idées du
l'artiste ne reçurent pas l'approbation du
souverain ottoman, et ce dernier eut donc recours
à Michel-Ange. Le florentin répond donc à cet
appel, et accepte de relever le défi, d'autant plus
que de Vinci était son plus grand rival. Il voyait
par conséquent dans cette opportunité l'occasion
de surpasser aux yeux du monde son concurrent,
et de prendre sa revanche sur le pape Jules II. Le
13 mai 1506, l'italien débarque donc à
Constantinople, capitale de l'Empire turc, prêt à
relever ce défi architectural avec brio.
ichel-Ange n'était pas très beau, le front
trop haut, le nez tordu, brisé lors d'une
rixe de jeunesse, les sourcils trop épais,
les oreilles un peu décollées. Il avait sa propre
face en horreur, dit-on. On ajoute souvent que s'il
recherchait la perfection du trait, la beauté dans
les visages, c'est que lui-même en était
totalement dépourvu. Seule la vieillesse et la
célébrité lui donneront, patine sur un objet, au
départ fort laid, une aura sans pareille. C'est
peut-être dans cette frustration qu'on pourrait
trouver l'énergie de son art ; dans la violence de
l'époque, dans l'humiliation des artistes, dans la
révolte contre la nature ; dans l'appât du gain, la
soif inextinguible d'argent et de gloire qui est le
plus puissant des moteurs.
L'extrait de ce roman peut-être mis en
rapport avec la thématique «
Renaissance et humanisme » car on y
décèle parfaitement l'essence-même de l'art. L'art
apporte à l'homme tout ce dont il manque :
Michel-Ange n'est pas beau, mais ses peintures et
dessins lui offrent cette beauté dont il est
dépourvu. L'art sert de conatus à l'être humain, il
lui permet de toucher à la complétude, et apporte
à l'artiste tout ce que la Nature lui refuse.
De plus, le lecteur comprend que la
motivation d'un artiste lui vient de l'époque dans
laquelle il vit et des événements qui ont lieu tout
autour de lui. Il s'en inspire pour imposer son avis
à travers des codes et subtilités que lui seul peut
comprendre, mais qui amènent chacun à
interpréter l'œuvre à sa manière si celle-ci n'est
pas assez explicite. C'est une façon de dénoncer
des pratiques ou faits contre lesquels l'artiste
désire s'élever : dans ce roman, il est évident que
Michel-Ange veut que la construction du pont lui
apporte avant tout la reconnaissance du Pape
romain, et que ce dernier cesse d'humilier le
florentin.
Il ne faut tout de même pas oublier que
l'art, même s'il est avant tout un moyen de
compléter son imperfection humaine et de faire
entendre sa voix, est aussi la seule ressource
pécuniaire de peintres, écrivains et sculpteurs : ils
désirent donc que leurs œuvres leur rapporte le
succès escompté, et leur permettent de vivre en
bonne condition.
Cet extrait de roman reflète donc l'art tel
que Michel-Ange le percevait : on peut même
deviner que cet état d'esprit était commun à la
majorité des artistes de la Renaissance, hommes
en quête perpétuelle de perfection.
T
M
1
/
1
100%