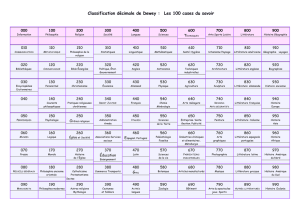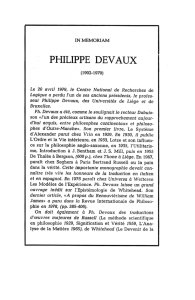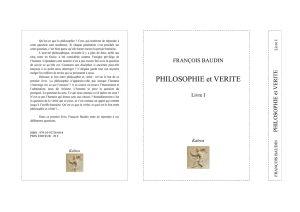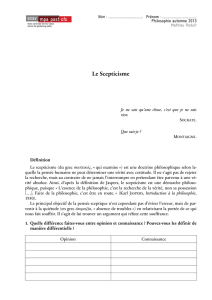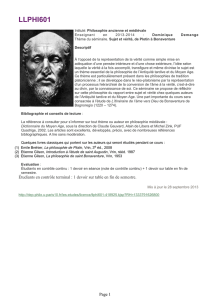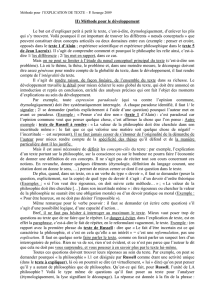Télécharger le fichier - Fichier


Les Hérétiques – créateurs de livrels indépendants
http://heretiques-ebooks.net

Cette édition de
ESSAIS SCEPTIQUES
de
BERTRAND RUSSELL
lauréat 1950
(GRANDE-BRETAGNE)
réalisée par
LES PRESSES DU COMPAGNONNAGE
est une sélection des
ÉDITIONS ROMBALDI
réservée à
LA GUILDE DES BIBLIOPHILES

LA
"PETITE HISTOIRE"
DE L’ATTRIBUTION
DU PRIX NOBEL
À
BERTRAND RUSSELL
*
PAR LE DR. KJELL STRÖMBERG
Ancien conseiller culturel à l’Ambassade de Suède à Paris

EN 1950, tout le monde s’attendait que l’un des deux Prix Nobel dont disposait l’Académie suédoise cette année-là – celui de 1949 ayant été
réservé – allât à sir Winston Churchill. L’ancien premier ministre de Grande-Bretagne venait de publier le troisième tome de sa magistrale épopée
de la seconde grande guerre dont il avait été le héros principal, et il avait plusieurs avocats passionnés au sein même de l’Académie. Celle-ci –
on peut le supposer sans grand risque de se tromper – a voulu attendre que l’entreprise gigantesque fût menée à bonne fin.
Autre candidat très en vue : Pär Lagerkvist, poète, dramaturge et romancier suédois, proposé cette année par toutes les Sociétés des gens de
lettres scandinaves. Il paraîtrait qu’un propos imprudent de son éditeur qui, en arrivant à New York, l’avait donné comme vainqueur certain devant
la presse américaine, l’ait écarté momentanément de la compétition.
Il ne manquait pas d’autres candidats de marque : anglais, français et américains, dont quelques-uns remportèrent plus tard la précieuse palme.
L’Académie suédoise a préféré faire un mouvement tournant – après s’être concertée sur William Faulkner pour le Prix de 1949 – en attribuant
son prix de 1950 à un outsider proposé cette année pour la première fois : lord Bertrand Russell, philosophe et sociologue anglais, troisième earl
portant ce nom déjà illustre au temps des luttes – célébrées par Shakespeare – entre les familles Tudor et Plantagenet pour le trône d’Angleterre.
La surprise fut générale, sans être cependant teintée de trop d’amertume. Depuis 1928, année où Henri Bergson reçut le Prix Nobel, aucun
philosophe n’avait figuré au palmarès, et le vieux lord anglais – il approchait de quatre-vingts ans – n’était ni un rénovateur de la pensée, ni doué
d’une imagination d’artiste dans sa manière d’écrire comme son prédécesseur français. Mais il était très connu et même assez populaire comme
continuateur et vulgarisateur élégant et spirituel de la philosophie empirique et humaniste des grands penseurs anglais du XVIIIe siècle, les Locke,
Berkeley et Hume, et non sans affinité avec les non moins influents utilitaristes du XIXe siècle, les Jeremy Bentham, Stuart Mill et Herbert Spencer.
On sait que ce dernier était particulièrement apprécié par Alfred Nobel qui aurait certainement vu avec plaisir Herbert Spencer recevoir le
premier Prix Nobel de littérature auquel il était d’ailleurs candidat, et un candidat très en vue. Sans doute l’Académie suédoise, en pleine
connaissance de cause, a-t-elle voulu marquer le cinquantenaire des Institutions Nobel en rendant un hommage tardif et discret au monde des
idées que représentait Russell aussi bien que Spencer, et dont le donateur des Prix était également un familier.
Faut-il rappeler, dans cet ordre d’idées, que Stuart Mill, ami de son père, fut aussi le parrain du jeune Bertrand Russell ? Malgré ses
ascendances aristocratiques, celui-ci fut élevé dans une atmosphère fortement empreinte par le libéralisme traditionnel de sa famille qui s’est
toujours trouvée dans l’opposition, et dont plusieurs membres ont dû payer de leur tête leur fidélité aux idées plus ou moins révolutionnaires de
l’époque. Aussi l’actuel lord Russell dut-il faire six mois de prison pour agitation pacifiste pendant la première guerre mondiale. Plus tard, sa
carrière universitaire fut interrompue plusieurs fois aussi bien en Angleterre qu’aux États-Unis – où il avait élu domicile pendant la seconde guerre
– à cause de ses idées peu conformistes en différentes matières, politiques et autres, notamment celles concernant le mariage et le contrôle des
naissances (birth-control). Mais lorsqu’il reçut le grand Prix, il avait fait la paix – du moins provisoirement – avec la Couronne, à cette époque
conseillée par un gouvernement du Labour Party. Comme un signe visible de cette réconciliation, le collier de l’Order of Merit – qui n’a que vingt-
quatre titulaires au maximum – lui avait été décerné par le roi George VI en 1949. L’ancien révolutionnaire en était aussi fier que du Prix Nobel, à
en croire les confidences qu’il fit aux journalistes en arrivant à Stockholm, où il le portait avec une grande distinction à toutes les solennités.
Le Prix Nobel de 1950 fut attribué à Bertrand Russell, selon le bref exposé des motifs rendu public, « en hommage à son œuvre philosophique
aussi riche qu’importante, qui fait de lui un défenseur de l’humanité et de la liberté de pensée ». Le rapporteur consulté, professeur de philosophie
à l’Université de Stockholm, après une analyse circonstanciée de sa vaste production philosophique, scientifique, historique, sociologique et
politique, arrive à la conclusion que Russell supporte bien la comparaison avec les deux ou trois écrivains « non littéraires » – Mommsen, Eucken
et Bergson – auparavant honorés du Prix Nobel de littérature. Si l’Académie suédoise voulait distinguer de la même façon la culture intellectuelle
de l’Angleterre, elle n’en pourrait trouver un représentant plus digne que Bertrand Russell. Il aurait été l’un des premiers d’une génération
d’écrivains – tels que G.B. Shaw, H.G. Wells et J.M. Keynes – qui avaient contribué à créer en Angleterre un climat nouveau succédant au
« victorianisme » suranné et pétrifié. Sur le plan philosophique il serait le représentant le plus remarquable, actuellement vivant, de sa longue
tradition empirique anglaise, une tradition de sens commun, d’idées claires et d’humanisme libéral. Grâce à lui, cette tradition commençait à
gagner du terrain aussi en dehors de son pays natal. Dans le monde anglo-saxon tout entier, il serait l’un des plus lus parmi les écrivains qui
étaient porteurs d’un message valable et qui savaient s’exprimer en une prose accessible à tout homme cultivé.
Aussi la presse, en Suède et ailleurs, salua le nouveau lauréat avec beaucoup de courtoisie. Par-ci par-là, on ne dissimula pas une vive
déception que « le plus grand des écrivains non littéraires contemporains » – c’est ainsi qu’un grand journal libéral de Stockholm, Dagens
Nyheter, appelait l’éminent historien sir Winston Churchill – eût dû céder le pas à un compatriote, certes assez haut en couleur et fort respectable,
mais qui aurait pu être aussi bien, sinon mieux encore, récompensé par un Prix Nobel de la Paix.
Dans la presse anglaise de gauche, la satisfaction est générale sans atteindre de hautes températures. Quant à l’officieux Times il enregistre le
fait sans commentaires, et pareillement The Daily Telegraph, principal organe conservateur.
Plus explicites sinon plus variées sont les réactions de la presse américaine. Ainsi le New York Herald Tribune fait une sorte de rapprochement
des deux lauréats de l’année. Le prix de Bertrand Russell représente peut-être – selon un éditorialiste de ce journal – une tentative de
contrebalancer celui de William Faulkner. « Mr. Russell, apôtre de la liberté et philosophe tourné vers l’actualité, continue ce commentateur, est un
des maîtres les plus brillants de la pensée anglaise. Bien qu’il ait senti la nécessité de nous avertir du désastre qui nous menace, il a offert à
l’humanité plus d’espoir que Mr. Faulkner. Mr. Russell a fait comprendre à ses lecteurs que l’homme moderne reste maître de son destin, même
dans un monde aujourd’hui non maîtrisé. Si l’homme est en proie à l’inquiétude et à la souffrance actuellement, c’est la conséquence de sa propre
stupidité et de sa mauvaise volonté. Là-dessus, le grand philosophe et le simple citoyen – même habitant la petite ville d’Oxford, celle de l’État de
Mississippi rendue célèbre par Mr. Faulkner – pourraient sans doute s’entendre. Sur cette base-là, au moins, il paraît tout à fait loisible
d’approuver les deux Prix Nobel décernés par l’Académie suédoise ».
Dans son discours prononcé à l’occasion de la remise du Prix au noble lord, M. Anders Österling, secrétaire perpétuel de l’Académie suédoise,
ne lui ménage pas les éloges. Il rappelle que, depuis un demi-siècle, Bertrand Russell est resté au centre du débat public par une œuvre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
1
/
95
100%