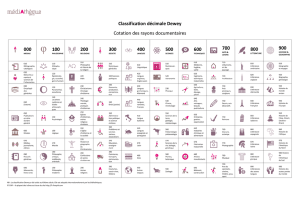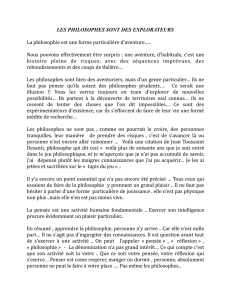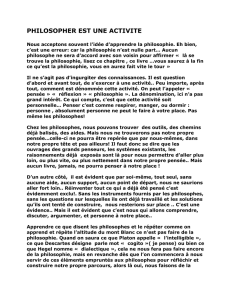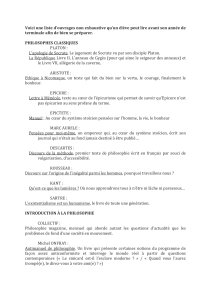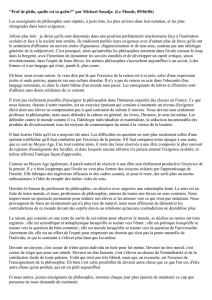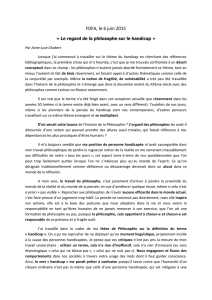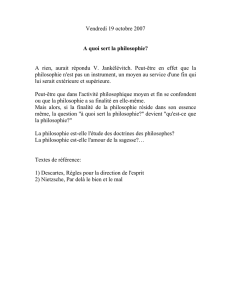Post-scriptum biographique un Entretien philosophique

Post-scriptum biographique à un Entretien philosophique
Henry Corbin
Cahier de l’Herne
En relisant le texte de mon entretien avec Philippe Némo, j’ai l’impression que la
plupart des questions essentielles qui ont occupé ma vie de chercheur, ont été
abordées au moins allusivement. Il n’y manque pas de fissures, certes, par lesquelles
auraient pu passer maints prolongements et explications non superflues. Mais alors
l’entretien durerait peut-être encore ;
Au nombre de ces fissures, il y a celles où auraient pu ou dû s’intercaler
quelques précisions sans lesquelles les étapes de l’itinéraire spirituel, les phases de la
« courbe de vie », n’apparaissent peut-être pas avec une clarté suffisante. J’ai fait
allusion à ma formation originelle de philosophe. Qu’un jeune étudiant en philosophie
rencontre la philosophie allemande, il n’y a là rien d’imprévu. Qu’il prenne le chemin
de la philosophie islamique, en arabe et en persan, c’est déjà beaucoup plus
inattendu. Qu’il conjugue les deux voies, le cas est cette fois assez rare. Comment
ces rencontres ont-elles eu lieu ?
Personne ne s’étonnera qu’un étudiant en philosophie, ayant
consciencieusement fait le tour des auteurs du programme de la licence, pût être
avide d’explorer des continents nouveaux, ne figurant pas aux programmes. Parmi
ces continents peu explorés, il y avait la philosophie médiévale, dont l’étude allait être
complètement renouvelée par les recherches et les publications d’Etienne Gilson. Une
aurore se levait sur ce continent oublié, dont la lueur suffisait à attirer un étudiant
avide d’amplifier son aventure philosophique. C’est avec l’année 1923-1924, si mes
souvenirs sont exacts, qu’Etienne Gilson commença son incomparable enseignement
à la Section des Sciences Religieuses de l’Ecole pratique des Hautes-Etudes. En tout
cas, c’est bien à partir de cette année-là que je fus son auditeur.
Je voudrais fixer une fois pour toutes le souvenir éblouissant que m’ont laissé les
cours d’Etienne Gilson, que j’ai suivis alors pendant plusieurs années. Sa méthode ne
consistait nullement à faire traduire quelques lignes de texte par un étudiant, à
demander l’avis des autres, pour finalement en donner un commentaire quelconque.
Loin de là ! C’était une époque où les étudiants venaient écouter le maître, non pas
leurs camarades, parce qu’ils ne mettaient pas en doute que le maître en sût un peu
plus qu’eux. Gilson lisait les textes latins, les traduisait lui-même et en faisait alors
sortir tout le contenu, explicite ou latent, dans un commentaire magistral allant au
fond des choses. Mon impression admirative fut telle que je résolus de le prendre
pour modèle, et que beaucoup plus tard je tâchai de faire, pour la philosophie et la
théologie islamiques, les cours que j’aurais voulu entendre à l’époque, mais que
personne ne faisait. Parmi les textes abordés par Etienne Gilson, au cours de ces
années fécondes, il y eut les textes traduits de l’arabe en latin par l’Ecole de Tolède,
au XIIe siècle, et en tête de ces textes le célèbre livre d’Avicenne : Liber sextus
Naturalium, auquel le commentaire de Gilson donnait une singulière ampleur. Ce fut
mon premier contact avec la philosophie islamique. J’y décelai une connivence entre
la cosmologie et l’angélologie, dont je me demandais s’il n’y aurait pas lieu de
l’approfondir sous d’autres aspects, et je crois que ce souci angélologique ne m’a plus
quitté tout au long de ma vie.
1

Mais en attendant, une première tâche se proposait comme inéluctable. Pour
aller plus loin, il fallait aller voir soi-même dans les textes. Pour aller y voir soi-même,
il fallait se mettre à l’étude de l’arabe. J’y fus d’ailleurs encouragé par Gilson lui-
même. C’est pourquoi, dès la rentrée 1926-1927, tournant le dos à l’agrégation, je
pris le chemin de l’Ecole Nationale des Langues Orientales. Celle-ci n’était pas du tout
alors la grande « machine » qu’elle est devenue de nos jours. Le petit immeuble de la
rue de Lille présentait l’état intime d’une Ecole, à peu près telle que l’avait laissée
Silvestre de Sacy. Pour chaque langue, nous n’étions qu’une poignée d’étudiants, et
avec mon collègue et ami Georges Vajda nous étions à peu près les seuls philosophes
égarés dans le vénérable établissement. Ce fut cette entrée à l’Ecole des Langues
Orientales qui prépara mon entrée à la Bibliothèque Nationale, où je fus appelé
comme orientaliste dès novembre 1928. Et ce fut ce passage par la Bibliothèque
Nationale qui devait déboucher paradoxalement sur mon échappée définitive vers
l’Orient.
Cependant, exactement au cours de ces mêmes années, il y avait un autre
enseignement capable de détourner un jeune et ardent philosophe de la voie
commune des programmes éprouvés. C’était l’enseignement d’Emile Bréhier. Même à
quelque cinquante ans de distance, on a l’impression que le rapprochement du nom
des deux maîtres produit des étincelles. Emile Bréhier, plus ou moins héritier sur ce
point des conceptions philosophiques de l’Aufklärung, professait qu’il n’y a pas de
philosophie chrétienne. Toute l’œuvre d’Et. Gilson lui infligeait un démenti, et il nous
était difficile de sortir d’un cours sur Duns Scot, Doctor subtilis, et d’accepter qu’il n’y
ait pas de philosophie chrétienne. Mais comment convertir un rationaliste parfait à
l’idée que les données des Livres saints puissent être le support de la méditation et de
la recherche philosophiques ? Si on refuse cela, il n’y aura plus ni philosophie juive ni
philosophie islamique. On ne sait même plus si Maître Eckhart et Jacob Boehme
tiendront encore dans l’histoire de la philosophie allemande. Le paradoxe va un peu
loin, mais il ne fait que traduire un de ces « modes d’être » dont nous disions dans
l’entretien qui précède, qu’aucune force humaine extérieure ne peut espérer les faire
céder.
Quoiqu’il en fût Emile Bréhier était alors plongé dans les Ennéades de Plotin, dont
il préparait l’édition et la traduction. En 1922-1923 il avait professé à la Sorbonne un
cours magistral sur Plotin et les Upanishads, et les cours des années suivantes en
recueillaient les retombées. De nouveau posons la question : comment un jeune
philosophe avide d’aventure métaphysique, aurait-il résisté à cet appel : approfondir
les influences ou les traces de la philosophie indienne sur l’œuvre du fondateur du
néoplatonisme ? Seulement pour cela il fallait « faire » du sanskrit. Mais on avait déjà
décidé de « faire » de l’arabe. Comment concilier les deux ? Il fallait choisir l’un ou
l’autre, c’est ce que conseillait impérativement chaque philologue ou linguiste
consulté. Seulement, le philosophe a ses raisons que le philologue ne comprend pas
toujours. Il incombait au philosophe d’opter, en cachette, bien entendu, pour la
solution héroïque : commencer à la fois l’étude de l’arabe et celle du sanskrit. Ce fut
une fameuse période d’ascétisme mental, je puis l’assurer. Elle ne put se prolonger
au-delà de deux années. J’en ai gardé ce bénéfice que, s’il m’arrive de lire aujourd’hui
un livre de philosophie indienne ou bouddhiste, les terme techniques sanskrits
interpolés ne me sont pas tout à fait étrangers. Mais au bout de deux années, je
devais rencontrer sur la voie de l’Orient la « borne signalétique » m’indiquant la
2

direction décisive d’une chemin sans retour ; désormais ma voie passerait par les
textes arabes et persans.
Il faut dire que le philosophe, devenu étudiant d’arabe égaré chez les
linguistes, pensa périr d’inanition en n’ayant pour toute nourriture que grammaires et
dictionnaires. Plus d’une fois, au souvenir des nourritures substantielles que
dispensait la philosophie, il se demanda : que fais-je ici ? Où me suis-je égaré ? Il y
avait cependant un refuge, où était d’ores et déjà dispensée la plus fine substance de
la spiritualité islamique. Ce refuge s’appelait Louis Massignon qui, à partir de 1928,
devait cumuler son enseignement au Collège de France avec la direction des études
d’Islamisme, à la Section des Sciences Religieuses de notre Ecole des Hautes-Etudes.
Je ne pouvais alors pressentir que je serais appelé à lui succéder un jour à cette
dernière chaire. Mais le contraste entre les cours méthodiques et rigoureux d’un
Etienne Gilson et ceux d’un Louis Massignon était « fabuleux ». Certes, le maître
distribuait bien au début de l’année un programme répartissant un thème général sur
un certain nombre de leçons. Mais à quoi bon les programmes ! Il arrivait qu’une
leçon commençât par quelques-unes de ces intuitions fulgurantes dont le grand
mystique Massignon était prodigue. Et puis une parenthèse s’ouvrait, puis une autre,
puis une autre… Finalement l’auditeur se retrouvait étourdi et égaré en plein démêlé
du maître avec la politique britannique en Palestine…
Mais il n’y fallait y voir, et nous n’y voyions tous, qu’un aspect nécessaire de la
passion dont brûlait Massignon. On n’échappait pas à son influence. Son âme de feu,
sa pénétration intrépide dans les arcanes de la vie mystique en Islam, où nul n’avait
encore pénétré de cette façon, la noblesse de ses indignations devant les lâchetés de
ce monde, tout cela marquait inévitablement de son empreinte l’esprit de ses jeunes
auditeurs. Certes, avec le long cours des années, il était impossible de ne pas
s’apercevoir de certains côtés vulnérables, de quelques brèches. Sur le tard, il fut
désolé quand ses amis ne purent le suivre dans ses options politiques. Mais cela
n’altère en rien la vénération avec laquelle j’évoque le souvenir de Massignon. Certes,
il réservait au philosophe des surprises, car sa formation originelle n’était nullement
philosophique, d’où parfois quelques vacillements dans le vocabulaire, quand ce
n’était pas dans certaines prises de position. J’ai connu certains jours un Massignon
ultra-shî’ite, et je lui ai dû beaucoup sur ce point ; ses études sur Salmân Pâk, sur la
Mobâhala, sur Fâtima, réservent encore des mines d’intuitions à explorer, en les
conjuguant avec les résultats des recherches menées depuis lors. Mais à d’autres
jours, je le trouvais vitupérant le shî’isme et les shî’ites, dont les grands textes lui
étaient d’ailleurs restés étrangers. Je prenais leur défense, en lui opposant que leur
conception de l’Imâmat n’était nullement « charnelle », mais que le lien de famille
terrestre entre les Imâms n’était que l’image de leur lien plérômatique éternel.
Massignon s’étonnait alors de « mon » ultra-shî’isme. N’abordais-je pas une vaste
étude des textes de gnose ismaélienne ? Mais il sut courageusement affirmer que
l’Islam iranien avait délivré l’Islam de toute attache raciale, ethnique ou nationale,
quoiqu’il m’avouât ne s’y être jamais tout à fait sentir « chez lui ». Aussi, lorsque je
suivais tout simplement la ligne inscrite dans le projet délibéré et les œuvres de
Sohravardî, « résurrecteur de la théosophie de la Lumière des sages de l’ancienne
Perse », Massignon s’alarmait-il. Ne « mazdéanisez » pas trop, me recommandait-il.
Que faire alors ? D’abord il ne fallait pas se tromper de jour quant au sujet que l’on
abordait. Ensuite il ne fallait pas oublier pourquoi on était venu le voir, et tenir
3

fermement en main le fil de l’entretien. Alors il y avait bien des chances pour que l’on
en revînt comblé.
C’est ainsi que certain jour, ce fut, je crois, en l’année 1927-1928, je lui parlais
des raisons qui m’avaient entraîné comme philosophe à l’étude de l’arabe, des
questions que je me posais sur les rapports entre la philosophie et la mystique, de ce
que je connaissais, par un assez pauvre résumé en allemand, d’un certain
Sohravardî… Alors Massignon eut une inspiration du Ciel. Il avait rapporté d’un
voyage en Iran une édition lithographiée de l’œuvre principale de Sohravardî, Hikmat
al-Ishrâq : « La Théosophie orientale ». Avec les commentaires, cela formait un gros
volume de plus de cinq cents pages. « Tenez, me dit-il, je crois qu’il y a dans ce livre
quelque chose pour vous ». Ce quelque chose, ce fut la compagnie du jeune shaykh
al-Ishrâq qui ne m’a plus quitté au cours de la vie. J’ai toujours été un platonicien (au
sens large du mot, bien entendu) ; je crois que l’on naît platonicien, comme on peut
naître athée, matérialiste, etc. Mystère insondable des choix préexistentiels. Le jeune
platonicien que j’étais alors ne pouvait que prendre feu au contact de celui fut
« l’Imâm des Platoniciens de Perse ». J’ai parlé tellement de lui dans mes livres, ou
en publiant et traduisant ses œuvres, que je n’ajouterai rien ici, sinon pour marquer
le trait décisif.
Car par ma rencontre avec Sohravardî, mon destin spirituel pour la traversée
de ce monde était scellé. Ce platonisme s’exprimait dans les termes de l’angélologie
zoroastrienne de l’ancienne Perse, illuminant la voie que je cherchais. Il n’y avait plus
à rester écartelé entre le sanskrit et l’arabe. La Perse se trouvait là au centre, monde
médian et médiateur, car la Perse, le vieil Iran, ce n’est pas seulement une nation ni
un empire, c’est tout un univers spirituel, un foyer de l’histoire des religions. Ce
monde était prêt à m’accueillir, et il m’accueillit. Dès lors le philosophe passait dans
les rangs des Orientalistes. Il dira plus tard, instruit par une longue expérience,
pourquoi il lui apparaît que ce sont désormais les philosophes, non pas les
orientalistes, qui sont les seuls à même de prendre en charge la « philosophie
orientale ».
La grande aventure commençait. Normalement, après la licence et le diplôme
d’études supérieures de philosophie, il eût fallu suivre les cours d’agrégation. C’était
la voie de la sagesse, sans imprévu, si normale qu’un vénérable professeur de la
Sorbonne que je rencontrai occasionnellement chez des amis et que j’informai du
cours de mes décisions, me demanda paternellement : « Mais avez-vous de la fortune
personnelle ou du temps à perdre ? » Je n’avais, Dieu merci, ni l’un ni l’autre. Mais
comment subir les cours et les perspectives de l’agrégation, lorsque l’on a en tête ce
grand dessein : faire pour cette philosophie iranienne dont les grands noms
apparaissaient à travers les commentateurs de Sohravardî, ce qu’Et. Gilson avait fait
pour « ressusciter » la philosophie médiévale de l’Occident ? Un pari, peut-être,
contre les aléas du Destin. Mais ce pari, je crois que le Ciel m’a accordé la faveur de
le tenir et de le gagner.
Voilà en bref, pour la « carrière » du philosophe orientaliste, sa rencontre
décisive avec la terre d’Iran « couleur du ciel », « patrie des philosophes et des
poètes ». Mais l’entretien avec Philippe Némo s’intéressait avant tout à la rencontre
en la même personne, du philosophe iranologue et du traducteur de Heidegger. Alors
ce post-scriptum doit évoquer une autre rencontre, la rencontre avec la vieille
Allemagne qui fut jadis, elle aussi, « patrie des philosophes et des poètes ». Deux
4

rencontres, essentiellement complémentaires l’une de l’autre. Comment s’est produite
cette dernière ?
Peut-être ne sommes-nous plus que quelques survivants parmi les amis du
couple fraternel, étonnant, inimitable, des frères Baruzi : Joseph, l’aîné, auteur de La
Volonté de métamorphose, du Rêve d’un siècle, le musicologue livrant régulièrement
à la revue Le Ménestrel des articles d’une profonde pensée musicale. Jean, le cadet,
qui passa vingt ans à produire son énorme thèse sur Saint Jean de la Croix, laquelle
eut ses admirateurs et ses critiques. Jean Baruzi qui suppléa Alfred Loisy au Collège
de France, avant d’y devenir lui-même titulaire de la chaire d’Histoire des religions.
Ses cours étaient suivis avec une fidélité passionnée par une pléiade d’étudiants,
comptant parmi eux un bon nombre d’élèves de la Faculté de théologie protestante de
l’époque. C’est lui qui nous révéla la théologie du jeune Luther, qui était alors à
l’ordre du jour des recherches théologiques en Allemagne : puis, à la suite, les grands
spirituels du protestantisme : Sebastian Franck, Caspar Schwenkfeld, Valentin Weigel,
Johann Arndt, etc. Le maître ne dissimulait aucune des difficultés que rencontrait son
exposé de première main, mais un flot de vie spirituelle les emportait toutes. C’était
tout neuf, captivant. Je commençai à percevoir certaines consonances, comme l’appel
d’un carillon lointain conviant à explorer les régions que couvre ce que je devais
appeler plus tard « le phénomène du Livre saint ». C’était la voie de l’herméneutique
qui déjà s’ouvrait dans les brumes matinales. Si j’avais résolu en entendant Avicenne
interprété par Et. Gilson, d’aller y voir moi-même en me mettant à l’étude de l’arabe,
il était impossible d’entendre la voie des Spirituels interprétés par Jean Baruzi, sans
prendre la décision d’aller voir sur place. Ce fut Jean Baruzi qui me montra le chemin
de l’Allemagne des philosophes et des « grands individus » de la spiritualité mystique.
Ma première étape fut Marburg.
C’est ainsi que l’Iran et l’Allemagne furent les points de repère géographique
d’une Quête qui se poursuivait en fait dans les régions spirituelles qui ne sont point
sur nos cartes. Je les rappelle ici, à l’appui de ce que je disais au début de mon
entretien avec Philippe Némo. Le philosophe poursuit sa Quête en répondant en toute
liberté à l’inspiration de l’Esprit. Mes amis iraniens savent fort bien que je ne puis
isoler mon amitié pour Sohravardî et les siens, de mon amitié pour un Jacob Boehme
et son Ecole. Je crois que c’est l’union de ce qu’ils symbolisent, qui a fait de moi ce
que je suis aujourd’hui.
Le cercle d’amis groupés autour des inséparables frères Baruzi était lui-même
une invite à tenter les aventures de l’Esprit. Par leur immense culture, leur sens des
valeurs les plus délicates, les plus subtiles, de l’art et de la vie, les deux frères étaient
les témoins d’un autre siècle, éminemment représentatifs d’une Europe et d’une
société européennes, disparues avec la première et la seconde guerre mondiale, et
que nous n’avons pas réussi à refaire, fût-ce de loin, tant est obstinée et profonde
l’emprise des démons et des possédés qu’a prophétisés Dostoïevsky. Il y avait chez
eux, place Victor Hugo, des réunions fréquentes, outre les séances de « séminaire »
que Jean Baruzi tenait chez lui et qui se prolongeaient fort tard dans la soirée. On
rencontrait au nombre des participants toutes sortes de personnalités européennes
inattendues. La présence de nos camarades allemands était toujours importante. Jean
Baruzi donnait aux entretiens la tournure qu’ils auraient eue, s’ils s’étaient tenus dans
le Weimar de Goethe. Il fut par excellence le professeur qui abolissait toute distance
officielle entre le maître et l’étudiant. Seule subsistait celle de l’amitié déférente, une
amitié qui allait grandissant d’année en année. Ceux qui, comme moi-même, ont eu
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%