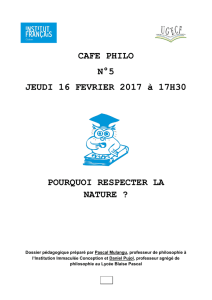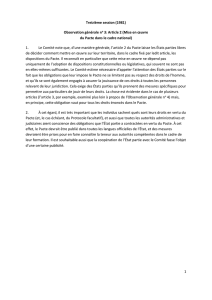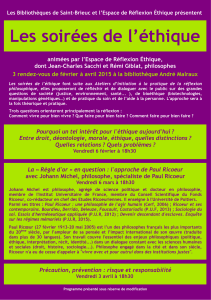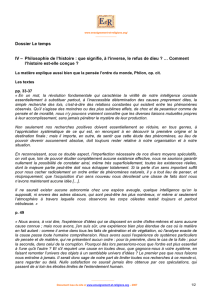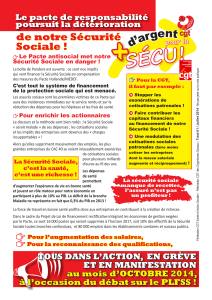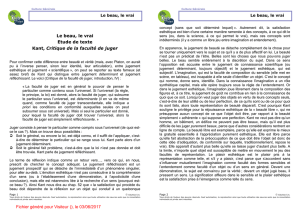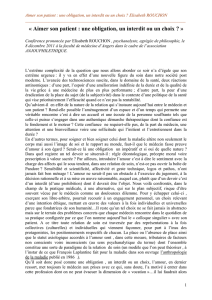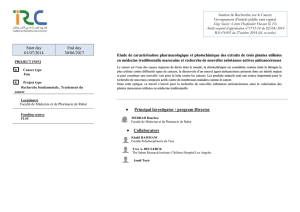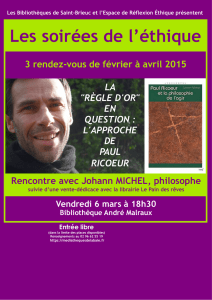Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins

Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins – E.ROUCHON
Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins ?
Elisabeth Rouchon, agrégée de philosophie, psychanalyste
(Conférence donnée le 15 janvier 2014, dans le cadre d’Anjouphilétique à Angers)
Pour aborder la question qui nous est proposée ce soir, je partirai de ce qui m’apparaît comme un
paradoxe :
La loi du 4 mars 2002 qui énonce les droits des patients semble avoir profondément modifié la relation
sur laquelle se fonde la praxis médicale. En témoigne la déclaration récente du professeur Christian
Hervé (directeur du laboratoire d’éthique médicale de l’université de Paris Descartes) : « la loi du 4 mars
2002 a renversé le rapport d’autorité qu’exerçait jusque là le médecin sur son patient ». Du patient
soumis à l’expertise et au pouvoir décisionnel du médecin on serait passé à l’ère du malade responsable
et acteur de son parcours thérapeutique, exerçant en sujet informé son pouvoir de s’auto déterminer.
Bref du paternalisme au partenariat, le soin aurait radicalement changé de paradigme dans le cadre
d’une véritable démocratie sanitaire fondée sur l’idée, empruntée au champ de la philosophie politique
et morale, qui est l’idée de « contrat ». Placés désormais sur un pied d’égalité, le malade et le médecin
seraient activement engagés dans le combat contre l’ennemi commun qu’est la maladie.
Cependant force est de constater (plus de dix ans après la promulgation de la loi), sur le terrain de la
pratique (qu’elle soit libérale ou hospitalière), qu’au cas par cas, dans les situations concrètes, la loi est
loin de résoudre tous les problèmes et que parfois elle en fait apparaître qui sont de plus en plus
complexes. Les progrès spectaculaires opérés depuis quelques années par les biotechnologies et les
applications auxquelles elles donnent lieu sur le terrain de la clinique ont généré chez les patients
« informés » des attentes et des demandes de plus en plus exorbitantes en même temps qu’elles
ouvraient pour les médecins des possibilités de plus en plus grandes (certains disent même infinies) de
réparation du corps humain et d’intervention sur les mécanismes de la vie… Par conséquent au patient
qui aspire à ce que TOUT soit fait pour lui permettre de recouvrer la santé (ou son intégrité corporelle),
le médecin est aujourd’hui sommé de répondre à la fois efficacement et raisonnablement . Le patient
revendique le respect de son droit à savoir ce qu’il en est de son état, de ce que la science médicale peut
accomplir dans le domaine de la pathologie qui est la sienne, des effets prévisibles (voire imprévisibles
mais potentiels de tel ou tel traitement), et cela afin (conformément à la loi) de faire un choix « éclairé »
et approprié à son projet de vie. Le « pacte d’alliance thérapeutique » (pour reprendre l’expression du
philosophe Paul Ricoeur), qui ne peut se légitimer que sur la base de la confiance entre les deux
partenaires , est alors fragilisé soit par la crainte que le médecin n’en fasse techniquement pas assez, soit
par la méfiance du patient qui craint un abus de pouvoir de l’expert fort de la puissance des outils dont il
dispose désormais (quel usage va-t-il en faire ? Jusqu’où peut-il aller lorsque, par exemple, se croisent les
impératifs de la recherche et ceux de la clinique ? Quel est l’espace réel de liberté et d’auto
détermination mis à la disposition le malade ?). Il l’est aussi, réciproquement, par la méfiance du
thérapeute qui peut redouter d’être mis en position d’incompétence ou d’incapacité répréhensibles
voire assigné en justice . Comment dans ce contexte envisager, théoriquement et pratiquement,
l’autonomie du patient qui constitue le levier de la loi du 4 mars 2002 ?

Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins – E.ROUCHON
Je me propose d’analyser la question selon trois axes successifs :
Sur le terrain des faits historiques, comment la technicisation de plus en plus poussée de la praxis
médicale (et pas seulement de la recherche) a-t-elle modifié le visage de la clinique et pour le patient et
pour le médecin ?
Sur le terrain du droit (ici de la déontologie) en quoi l’affirmation de l’autonomie du patient vise-t-elle à
corriger les risques inhérents à cette technicisation ? Ce qui suppose évidemment que nous donnions un
contenu à la notion même d’autonomie (en référence au champ philosophique d’où elle est issue).
Enfin sur le terrain des valeurs éthiques, comment l’expérience de la maladie et de la souffrance,
irréductible à toute tentative d’objectivation, nous oblige-t-elle à reconfigurer l’idée de l’autonomie
devenue une norme et à repenser le pacte de soins ? (comme le philosophe Hans Jonas essaie de
repenser l’idée de responsabilité à l’ère de la civilisation technologique dans son ouvrage « le principe
responsabilité –une éthique pour la civilisation technologique »)
Le sujet tel qu’il est formulé nous invite bien à une réflexion historiquement située : il s’agit de l’état
actuel de l’exercice de la médecine et de ce que l’on peut nommer l’émergence d’une nouvelle figure du
soin dans un monde de plus en plus technicisé . La médecine d’hier s’était déjà considérablement
transformée avec les techniques de l’imagerie et l’évolution de la pharmacopée ainsi que le recours à
des machines complexes dans le domaine de la réanimation par exemple . Aujourd’hui ce sont les
recherches sur les cellules souches, la fabrication de prothèses (comme le cœur artificiel Carnat conçu
par le professeur Carpentier qui a été implanté en décembre à l’hôpital George Pompidou) mais aussi les
nanotechnologies et l’arsenal de plus en plus sophistiqué des chimiothérapies qui ouvrent des
perspectives de plus en plus vastes non seulement au champ de la recherche mais à celui de
l’expérimentation et de la clinique. Les robots sont apparus dans les salles d’opération et la
télémédecine est devenue une réalité. Entre détection de plus en plus performante (l’actrice Angelina
Jolie a contribué à la médiatisation de la détection génétique du cancer du sein en optant pour une
double mastectomie préventive) et réparation de plus en plus efficace d’organes lésés ou en voie de
l’être, l’horizon du possible et la pratique effective semblent devoir se rencontrer très prochainement.
Nombre de maladies incurables hier ne le sont pas aujourd’hui et a fortiori d’autres, toujours plus
nombreuses, ne le seront plus demain : sous l’effet de l’accélération de la temporalité propre aux
technosciences, on en vient plutôt à se demander ce qui sera impossible dans un futur proche.
Le médecin est donc appelé à devenir un « expert » toujours plus performant, un mécanicien et un
gestionnaire d’outils de plus en plus pointus (dans une spécialisation elle-même croissante), soumis à des
obligations de résultats et pas seulement à un devoir général et vague d’œuvrer dans le sens de la
guérison du patient qui fait appel à lui. Les patients deviennent dans ce contexte de plus en plus
exigeants, portés par les annonces médiatisées des résultats de telle ou telle technique (ou traitement)
regroupés en associations (à l’instar des consommateurs), connectés (on parle d’e-patients) et influencés

Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins – E.ROUCHON
par les discours des techno-prophètes qui prédisent l’avenir radieux d’une médecine capable d’améliorer
la machine humaine au point de la faire un jour échapper à la maladie mais aussi à l’usure du
vieillissement et pourquoi pas à la mort… Un tel objectif est mis en avant par le courant de pensée qui
s’est développé aux États-Unis sous le nom de « transhumanisme ». De guérir les pathologies à les
prévenir et de prévenir à modifier les mécanismes du vivant il n’y aurait qu’un pas à franchir sous la
pression de ce que Hans Jonas qualifie (pour le dénoncer) d’impératif kantien inversé « Tu peux donc tu
dois » ! Ce qui est possible doit être tenté (à des fins de recherche et d’expérimentation pour améliorer
un jour la thérapeutique)…
On retrouve ici, poussé à la limite, le projet de la science moderne si bien énoncé dès le XVIIème siècle
par Descartes dans son « discours de la méthode ». En 1637, le philosophe souligne qu’il est désormais
possible de parvenir à « des connaissances qui soient fort utiles aux hommes et qui puissent en
particulier s’appliquer à la conservation de la santé , laquelle est le premier bien et le fondement de tous
les autres et finalement nous exempter d’une infinité de maladies tant du corps que de l’esprit et aussi
peut-être de l’affaiblissement de la vieillesse » … et, in fine , selon la formule devenue célèbre « nous
rendre comme maîtres et possesseurs de la nature »…Les techniques sophistiquées, issues de la
recherche scientifique de pointe dans le domaine médical, ouvrent ce champ d’une maîtrise de plus en
plus grande de ce qui jusqu’alors pouvait apparaître comme l’inéluctable de notre condition humaine : la
maladie, le vieillissement mais aussi la procréation, et la mort.
A quoi s’ajoutent pour le praticien, singulièrement en milieu hospitalier, les impératifs sociaux et
économiques de la gestion de la santé (comme bien public), les nouvelles techniques de management
calquées sur celle de l’entreprise bref la normalisation du soin soumis aux protocoles pensés par les
technocrates : parcellisation des tâches, temporalité elle-même découpée et accélérée, pour augmenter
la rentabilité et accroître l’efficacité parfois au détriment de la qualité humaine du soin. Les résultats à
atteindre sont déterminés et les méthodes pour y parvenir pensées elles aussi selon le modèle de la
rationalité pragmatique (technico-scientifique) dominante. Soumis à la double contrainte de la logique
du marché et des procédures d’évaluation de leurs résultats les établissements de soins et leurs
équipes sont mis en concurrence comme en témoignent les palmarès et autres hiérarchies publiés
régulièrement dans les médias, véritables guides Michelin de la santé. C’est sur l’autonomie du médecin
qu’on pourrait s’interroger ici.
En face, les patients sont mis en position de clients ou consommateurs, censés être « éclairés » par la
multiplicité des réseaux d’information non seulement sur leur pathologie mais aussi sur le type de
traitement qu’ils peuvent recevoir et dont ils sont en droit d’attendre les meilleures performances. On
remarquera au passage que, pour s’informer, le patient est implicitement invité à se distancier de la
maladie dont il est (ou se croit) porteur pour en faire entrer l’approche dans un cadre qui l’objective. Ce
n’est plus le regard et l’examen clinique pratiqué par le médecin croisé avec le récit des symptômes que
fait le malade qui sont ici le point de départ de la demande de soin et de la recherche du diagnostic mais,
souvent, un savoir présupposé du patient sur lui-même avec lequel le médecin aura à composer (fût-ce
sur le mode de la critique) pour instaurer un dialogue et une confiance. Le recours de plus en plus
systématique aux analyses biologiques et à l’imagerie qui de complément à l’examen clinique minutieux
devient premier renforce cette tentation de l’objectivation allant jusqu’à la réification du corps malade.

Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins – E.ROUCHON
Ce qui fait dire au professeur J-F Mattei dans son rapport sur l’éthique et les professions de santé : « ce
qui surgit ce n’est plus le corps dans son dépouillement ou sa misère , et la personne dans son intime et
son mystère, ce sont des chiffres et des images numérisées. »
La question initiale apparaît alors encore plus insistante : qu’est-ce donc que l’autonomie du patient, en
quoi consiste-t-elle dans le cadre d’un soin de plus en plus technicisé ?
Si l’on revient plus précisément au contenu de la loi de 2002, y sont énoncés les droits du patient : droit
à l’information sur sa santé, sur la nature de la pathologie dont il est affecté (accès libre à son dossier
médical), et sur les traitements qui lui sont proposés pour lutter contre elle (avec les bénéfices et les
risques attachés à la thérapeutique). L’information doit être donnée clairement et de manière
compréhensible pour que le malade puisse se l’approprier et accepter en toute lucidité ce que le
médecin lui prescrit ; c’est ce qui est qualifié de « consentement éclairé ». Cette liberté de donner son
assentiment est évidemment assortie de son contraire celle de refuser ou , au décours de la
thérapeutique, de décider de suspendre (ou d’arrêter) le traitement proposé. Ce droit à l’information est
la condition sine qua non du respect de son autonomie et inclut le droit à l’ignorance c’est-à-dire celui de
ne pas savoir par exemple la gravité de son état ou le caractère objectivement incurable d’une maladie
létale. Le pronostic étant entaché de trop d’incertitudes n’est pas inclus dans le contenu de ce qui est
nommé « information ». Ce principe fondamental de la reconnaissance de l’autonomie du patient est
historiquement fondé sur les lois de Nuremberg qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, ont
encadré l’expérimentation sur les sujets humains
Ainsi résumée cette charte des droits des patients semble légitime et reprend du point de vue de celui
qui reçoit le soin les obligations déontologiques et professionnelles de celui qui le dispense. Il n’est que
de rappeler les principales lignes de ces dernières : devoir de respect de toutes les personnes, de leur
autonomie et de leur volonté, sans discrimination …devoir de protéger celles et ceux qui sont affaiblis,
vulnérables ou menacés dans leur intégrité ou leur dignité…obligation d’informer le patient des décisions
envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences (sur fond bien sûr de confidentialité, secret
professionnel qu’on ne peut opposer au patient lui-même)…devoir de loyauté et de vérité pour fonder la
confiance… On a bien ici une stricte symétrie et même une réciprocité des droits et des devoirs, qui rend
possible et plus, souhaitable, une participation active du malade au projet de soin qui le concerne et
pour lequel il a adressé une demande au médecin. Le malade d’objet (« patient » évoquant la passivité ,
le fait de subir ) devient sujet, agent et acteur, donc partenaire à part entière dans le cadre d’ une
alliance thérapeutique susceptible d’être définie en termes de contrat.(Nous y reviendrons). La condition
nécessaire et semble-t-il suffisante (théoriquement) de ce partenariat c’est justement l’aptitude du
patient à exercer sa faculté de juger, à entendre et comprendre les informations transmises par le
médecin et le personnel soignant, à formuler ses propres demandes et à se déterminer (à choisir et à
décider) en connaissance de cause. En ce sens le patient est posé comme sujet de droit et non comme
objet , plus ou moins réifié voire instrumentalisé, on peut toujours le craindre, par celui qui aurait seul le
pouvoir : l’expert, le médecin.. Dans cette perspective apparaissent aussi d’emblée des limites (dont la
loi doit tenir compte) pour l’enfant (dont les parents ont à répondre tant qu’il n’est pas en capacité

Quelle autonomie pour le patient face au projet technique de soins – E.ROUCHON
d’utiliser, d’exercer son propre entendement), la personne dont le handicap physique ou mental altère la
faculté de juger (quel que soit son âge) et, a fortiori, celle qui est dans un état d’inconscience rendant
impossible cet usage. C’est là que le recours à la personne de confiance et/ou aux directives anticipées
(thème abordé dans d’autres conférences) peut permettre parfois de lever l’obstacle.
Cette référence centrale à l’autonomie de la personne malade est fondée dans notre culture sur une
conception philosophique du sujet et de ce qui le définit dans son essence : le libre-arbitre indissociable
(nous allons le voir) de la faculté de juger appelée encore raison ou « bon sens » qui est, selon, la
formule de Descartes « la chose du monde la mieux partagée » i-e universelle. Pour en préciser le
contenu nous essaierons d’en dégager les facettes, en laissant de côté la dimension physique celle qui
consiste à pouvoir se déplacer librement dans l’espace en utilisant les forces dont dispose son corps et à
accomplir un certain nombre de gestes sans le secours d’autrui. Bref ce qui peut être évalué et mesuré et
qu’on qualifie aussi bien d’indépendance. D’emblée si nous prenons en compte sa dimension
« intellectuelle », la définition de l’autonomie s’enracine dans la philosophie des Lumières et plus
particulièrement dans l’anthropologie morale de Kant. Dans son opuscule intitulé « Qu’est-ce que les
Lumières » (1784), l’auteur constate que la raison permet à tout homme (elle est universelle) de
conduire une réflexion cohérente, ordonnée, et personnelle pour peu qu’elle ait été éduquée à son
propre exercice (c’est la finalité de l’éducation au sens large du terme).La pensée libre est celle qui
parvient à s’affranchir de toute tutelle extérieure : celle des opinions étrangères, des préjugés, des
superstitions, mais aussi des passions et des intérêts, etc … et à s’appuyer sur le seul entendement du
sujet. Selon la formule de Kant c’est « la capacité à se servir de son propre entendement » ou encore « le
courage de penser par soi-même » (dont il fait la devise des Lumières : « sapere aude ! Ose penser par
toi-même ! ») On retrouve ici le sens étymologique du mot « autonomie » formé sur les deux mots
grecs : le pronom autos : soi-même et le nom nomos : la loi. L’autonomie c’est la capacité de se donner
sa propre loi, par opposition à l’hétéronomie, état d’une personne qui pense (et agit) sous la conduite
d’un autre, qui est soumise à une règle étrangère. Le défaut de discernement est la principale cause de
l’hétéronomie mais parfois aussi la paresse ou la lâcheté (Kant remarque par exemple ,dans le texte cité
qu’ « Il est commode d’être sous tutelle…si j’ai un livre qui a de l’entendement à ma place, un directeur
de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place…je n’ai alors pas moi-
même à fournir d’efforts…Il n’est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer ; d’autres
assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne . »)
Il reste que c’est pourtant cela, l’effort de penser par soi même, qui permet à la personne de réfléchir à
ses objectifs et de préciser ce qu’elle pense être bon pour elle. Le médecin n’est pas seul juge (malgré
son savoir et son savoir-faire) de ce qui convient à son patient dans le cadre d’un projet thérapeutique
dont il maîtrise les dimensions scientifique et technique , c’est-à-dire celles qui (dans des conditions
données, à préciser) sont applicables à tous les sujets porteurs d’une même pathologie . L’autonomie de
la pensée conditionne celle de la volonté qui n’est autre que la faculté du sujet à s’auto-déterminer c’est-
à-dire à choisir en son nom .En ce sens, c’est au patient de s’engager activement dans le processus du
soin en disant ce qui lui apparaît raisonnable, convenable ou préférable pour lui, dans la situation
singulière qui est la sienne. A sa charge d’énoncer aussi le cas échéant ce qu’il souhaite ne pas assumer,
ce qu’il pense ne pas pouvoir supporter dans le cadre du projet de vie qui est le sien. C’est dans cet
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%