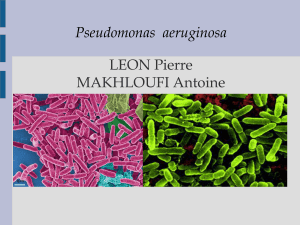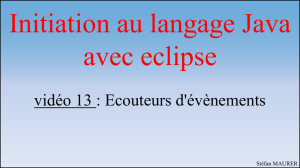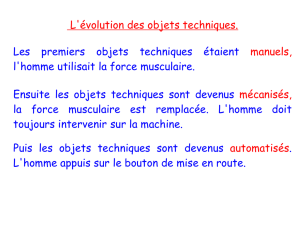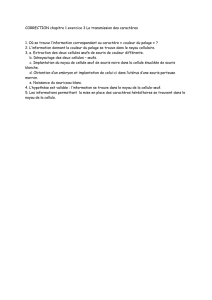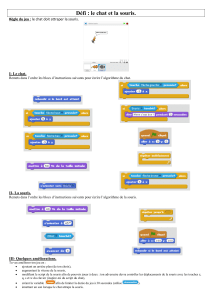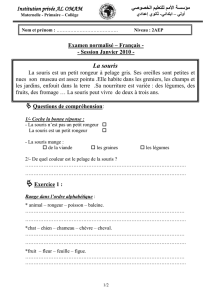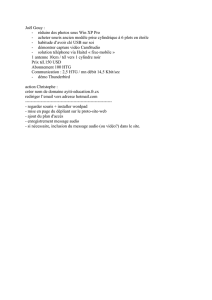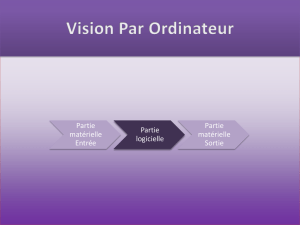INFORMATION TO USERS
publicité

INFORMATION TO USERS
This manuscript has been reproduced from the- microfilm master. UMI films
the text directly from the original or copy submitted. Thus,some thesis and
dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of
computer printer.
The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the
cOPY submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations
and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper
alignment can adversely affect reproduction.
ln the unlikely event that the author did not sand UMI a complete manuscr.pt
and there are missing pages, these will be noted.
Also, if unauthorizad
copyright material had to be removed. a note will indicate the deletion.
Oversize materials (a.g., maps, drawings, ch arts) are reproduced by
sectioning the original, beginning at the upper laft-hand camer and continuing
from left to right in equal sections with small overlaps.
Photographs included in the original manuscript have been reproduced
xerographically in this copy.
Higher quality 6" x 9" black and white
photographie prints are available for any photographs or illustrations appearing
in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to arder.
Bell & Howellinformatian and Leaming
300 North Zeeb Raad, Ann Arbor, MI 481œ-1346 USA
800-521-0600
NOTE TO USERS
This reproduction is the best copy available.
•
Comparaison du profil inflammatoire des souris résistantes
et sensibles à une infection endobronchique
à Pseudomonas aeruginosa
Caroline Francoeur, M.Sc.
Département de Médecine Expérimentale
Université McGill, Montréal
Septembre 1999
•
Mémoire soumis à la Faculté des Études Supérieures et de la Recherche
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise ès Science
Cl Caroline Francoeur, 1999
•
1+1
National Library
of Canada
Bibliothèque nationale
du Canada
Acquisitions and
Bibliographie Services
Acquisitions et
services bibliographiques
395 Wellington Street
395. rue Wellington
Ottawa ON K1A ON4
Ottawa ON K1A ON4
canada
Canada
Your file VOIIlt ,.ftirenœ
Our file Notre reférencs
The author has granted a nonexclusive licence a1lowing the
National Library of Canada to
reproduce, loan, distribute or sell
copies of this thesis in microfonn,
paper or electronic formats.
L'auteur a accordé une licence non
exclusive pennettant à la
Bibliothèque nationale du Canada de
reproduire, prêter, distribuer ou
vendre des copies de cette thèse sous
la fonne de microfiche/film, de
reproduction sur papier ou sur fonnat
électronique.
The author retains ownership of the
copyright in this thesis. Neither the
thesis nor substantial extracts frOID it
may be printed or otherwise
reproduced without the author' s
penmSSlon.
L'auteur conserve la propriété du
droit d'auteur qui protège cette thèse.
Ni la thèse ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent être imprimés
ou autrement reproduits sans son
autorisation.
0_612-55058-3
Canada
•
•
•
À la mémoire de Marie Curie.
À cette femme de caractère
qui a ouvert les portes
du monde scientifique
auxfemmes des générations
présentes etfutures.
•
11
TABLE DES MATIÈRES
RÉS~ABSTRACT
v
LISTE DES ABBRÉVIATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vi
I. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1. 1 Caractéristiques de la bactérie Pseudomonas aeruginosa
. . . . . . . . ..
1.2 Infections pulmonaires à Pseudomonas aeruginosa
1.3 Modèle murin d'infection pulmonaire à Pseudomonas
1
1
2
3
Tableau 1 Étude du taux de mortalité et de la prévalence de l'infection chez
les souris BALBlc et DBA/2 suite à une infection pulmonaire à P.
aenlginosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Résistance génétique aux infections à Pseudomonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Réponse inflammatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8
1.6 Hypothèses de travail
•
II. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2. 1 Animaux
2.2 Bactérie
2.3 Purification des macrophages interstitiels résidants et inflanunatoires
12
12
12
13
Figure 1. Courbe néphélémétrique du tsmPA dans un bouillon TSB. " 14
2.4 Isolation des macrophages péritonéaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.5 Essai de bactéricidie in vitro
2.6 Élimination systémique de P. aeruginosa
"
2.7 Instillation intra-trachéale de Pseudomonas aeruginosa
2.8 Détermination de la population bactérienne dans les poumons
2.9 Lavage broncho-alvéolaire et numération cellulaire
"
2.10 Purification des sumageants d'homogénats
2.11 Quantification de l'IFNy par ELISA
2. 12 Quantification du TNFex par ELISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13 Quantification de l'IL-Ip, IL-4, IL-6, IL-I0, MCP-l et GM-CSF
2. 14 Mesure du nitrite/nitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 15 Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . .
•
nI. RÉSULTATS
3. 1 Implication des cellules mononucléaires
15
16
17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
•
üi
3.2 Élimination de P. aeruginosa lors d'infections systémiques et pulmonaires . 26
Figure 2 Étude in vitro de l'implication des macrophages dans la défense
27
contre Pseudomonas aeruginosa.
Figure 3. Clairance du tsmPA dans les tissus spléniques et hépatiques après
une infection systémique par voie mtra-veineuse. . . . . . . . . . . . . 29
Figure 4. Étude in vivo de la réponse bactéricide des macrophages
pulmonaires résidants suite à une infection endobronchique à tsmP A.
... '
30
3.3 Étude du profil de la défense cellulaire lors d'une infection endobronchique
...................................................... 31
Figure 5. Étude du profil de la défense cellulaire lors d'une infection
32
endobronchique à tsmPA
3.4 Effet du TNP a sur la réponse inflammatoire chez les souris sensibles infectées
...................................................... 33
•
Tableau 2. Effet du traitement au TNFa sur l'infection endobronchique à P.
aeruginosa chez les souris sensibles DBA/2
34
3.5 Production du TNFa dans les tissus pulmonaires
35
Figure 6. Production du TNFa dans les tissus pulmonaires des souris
résistantes et sensibles infectées par le tsmP A. . . . . . . . . . . . . . . 36
3.6 Étude de la production des médiateurs impliqués dans la cascade du TNF . 37
3.6.1 Production de monoxyde d'azote dans les tissus pulmonaires .... 37
Figure 7. Production de nitrite/nitrate dans le tissu pulmonaire suite à une
infection endobronchique à tsmP A.
. . . . . . . . 38
3.6.2 Production d'IFNy dans les tissus pulmonaires
3.6.3 Production d'IL-lP dans les tissus pulmonaires
39
40
Figure 8. Production d'IL-lp dans les tissus pulmonaires de souris résistantes
et sensibles infectées par le tsrnP A par voie intra-trachéale. .... 41
3.6.4 Production d'IL-6 dans les tissus pulmonaires
•
42
Figure 9. Production d'IL-6 dans le tissu pulmonaire de souris résistantes et
sensibles suite à une infection endobronchique avec le tsmPA. . . 43
•
iv
3.6.5 Production d'IL-4 dans les tissus pulmonaires
44
Figure 10. Production d'IL-4 dans les tissus pulmonaires des souris
résistantes et sensibles infectées par voie intra-trachéale avec le
tsmPA.
45
3.6.6 Production d'IL.. 10 dans les tissus pulmonaires
3.6.ï Production de MCP-I dans les tissus puJrnonaires
46
46
Figure II. Production d'IL-IO dans les tissus pulmonaires des souris
résistantes et sensibles infectées par voie intra-trachéaIe avec le
tsmPA.
47
Figure 12. Production de MCP-I dans les tissus pulmonaires de souris
résistantes et sensibles infectées avec le tsmPA. . . . . . . . . . . . . . 49
3.6.8 Production de GM-CSF dans les tissus pulmonaires
•
50
Figure 13. Production de GM-CSF dans les tissus pulmonaires de souris
résistantes et sensibles suite à une infection intra-trachéale avec le
tsmPA
51
Tableau 3 Comparaison du profil inflammatoire des souris résistantes et
sensibles en réponse à une infection endobronchique au tsmP A . 52
IV DISCUSSION
53
V CONCLUSION
75
Figure 14. Représentation schematique du mécanisme de défense pulmonaire contre Pseudomonas aeroginosa.
77
•
RE~RCIEMENTS
78
BIBLIOGRAPInE
79
•
•
•
v
RÉsUMÉ
Dans un modèle murin de résistance et de sensibilité à une infection pulmonaire à
Pseudomonas aeruginosa (PA), nous avons étudié le profil inflammatoire induit par la
bactérie au cours de la phase précoce de l'infection. Cette étude nous a permis d'identifier
certains mécanismes pouvant être responsables du phénotype de résistance à une infection
endobronchique. Nous avons d'abord démontré que le recrutement neutrophilique dans
l'espace alvéolaire joue un rôle crucial dans la défense contre PA. Cet influx de neutrophiles
se produit plus rapidement chez les souris résistantes (BALB/c) que chez les souris sensibles
(DBAJ2) et coïncide avec le début de la clairance de l'infection. De plus, la production de
TNFa est plus grande chez les souris BALB/c que chez les souris DBAJ2 et semble médier
l'expression de chirniokines responsables du recrutement des neutrophiles. Lorsque les souris
sensibles sont traitées au TNF au moment de l'infection, on observe un recrutement accru de
neutrophiles sans changement dans l'éradication bactérieJUle. La prduetion d'IL-IO et de
GM-CSF semble aussi être augmentée dans les poumons des souris résistantes. Ces cytokines
pourraient induire une meilleure activation des neutrophiles en les protégeant contre l'effet
cytotoxique des exotoxines bactériennes et en retardant l'activation des gènes apoptotiques
(voie de Fas). Le TNFct, Pa-lO et le GM-CSF pourraient devenir des cibles thérapeutiques
intéressantes pour le traitement des infections à PA chez les patients répondant mal aux
antibiotiques.
ABSTRACr
A mouse model of resistance and susceptibility to a pulmonary infection with
Pseudomonas aeruginosa cP A), was used to study the inflammatory profile early foUowing
infection. Tlûs study allowed the identification ofthe mechanisms responsible for the resistant
phenotype. We have tirst determined the pivotai raIe of the neutrophil recruitment in the
alveolar space in the hast defense against PA. This influx occurred earlier in the resistant
BALB/c mice than in susceptible DBA/2 mice and occurred concommitantly with the
beginning of the bacterial clearance. Furthermore, leveIs ofTNFa were found to be higher in BALB/c mice than in DBAl2 mice. TNFa appears ta mediate the production of
chemokines responsible for neutrophil recruitment in the lungs. However, treatment of
susceptible mice with TNPa Ied to an increase of neutrophil recruitment without any
improvement in bacterial clearance. Lung homogenates from resistant mice also showed an
increase in IL-IO and GM-CSF content. This was not seen in susceptible mice. This may
lead to a more efficient neutrophil activation due to their effect on bacterial exotoxins and
apoptotic gene regulation (via Fas pathway). TNFa, IL-IO and GM-CSF may represent
valuable targets for treatment of Jung infection with PA in patients unresponsibe to
antibiotherapy.
•
VI
LISTE DES ABBRÉVIATIONS
BSA:
CFTR:
CFU:
ELISA~
PK:
FLBA:
GM..CSF:
IFN:
IL:
LBA:
MCP:
MIP:
•
•
NO:
PBS:
PlvlN:
SVF:
TNF:
TSA:
TSB:
tsmPA:
bovine serum albumin
cystic fibrosis transmembrane conductance regu/ator
colonyfonning unit
enzyme-linlœd immunosorbenl assay
~ucoviscidose ou fibrose kystique pulmonaire
fluide des lavages broncho-alvéolaires
granu/ocyte-macrophages-colony stimulatingfactor
interféron
interleukine
lavage broncho-alvéolaire
monocyte chemotactic protein
macrophage inflammatory protein
monoxyde d'azote
phosphate buffered saline
cellule polymorphonucléaire
sérum de veau foetal
tumor necrosisjactor
trypticase soy agar
trypticase soy broth
souche mutante thermosensible de Pseudomonas aeruginosa
•
l INTRODUCTION
1.1 Caractéristiques de la bactérie Pseudomonas aeruginosa
Pseudomor.as aerugino5a Q1; une bactérie gram négative dénitrifiante de la famille des
Enterobacteriacea. On la retrouve généralement dans le sol et eUe joue un rôle important
dans la fixation de l'azote atmosphérique.
Toutefois, il s'agit aussi d'un pathogène
opportuniste pouvant être à l'origine d'infections sévères chez des sujets immuno·supprimés.
Dans le milieu hospitalier, Pseudomonos aeruginosa peut être la cause de pneumonies
nosocomiales (BRYAN etaI 1984, HORAN etaI 1984, BODEY etaI 1993, FABEGAS et
•
al 1996).
De plus, cette même bactérie est hautement problématique chez les patients
atteints de mucoviscidose.
La colonisation des voies respiratoires par Pseudomonas
aeruginosa est presque toujours secondaire à une infection à Staphylococcus aureus. Chez
ces patients, les infections à Pseudomonas sont récurrentes pendant les premières années de
la maladie, Le. que les infections semblent clisparalùe puis réapparaissent périodiquement. Or,
la colonisation par P. aeruginosa devient éventuellement chronique et le patient subit des
périodes d'exacerbation sans jamais pouvoir éradiquer complètement l'infection.
n faut
préciser que l'infection est généralement non-mucoïde et qu'eUe est possiblement accélérée
par des infections croisées, soit virales, soit bactériennes.
La mauvaise clairance est
partiellement due à la conversion phénotypique de P. aeroginosa de sa forme non-mucoïde
•
à sa forme mucoïde
(M.~TIN
et al, 1993). Ce caractère mucoïde est associé à une
diminution des facteurs de virulence classiques produits par P. aeruginosa. (ORNa et al
•
2
1992, PEDERSEN etai 1992, WOODS et al 1991). Toutefois, cela permet à la bactérie de
croître, de se multiplier, et de persister en micro-colonies, enveloppées dans un biofilm
d'alginate. (KOCH et al 1993) La présence de Pseudomonas aenlginosa dans les voies
respiratoires entraîne une intense réaction inflammatoire chez les patients atteints de
mucoviscidose. Les hauts degrés de mortalité et de morbidité semblent être dus à la
bronchiectasie associée au relargage de protéases et d'oxydants par les neutrophiles lors des
processus d'activation et de phagocytose (BERGER 1991).
1.2 Infections pulmonaires à Pseudomonas aeruginosa
Toutefois, chez ces patients, il semble que la propension à l'établissement d'une
•
infection chronique par Pseudomonas soit indépendante de la nature de la mutation du gène
CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) responsable de la
mucoviscidose. En effet, si certains enfants développent une infection chronique dès l'âge de
deux ans, d'autres ne la développent que plus tardivement, vers l'âge de dix ans. Chez les
patients plus âgés et résistants à l'infection chronique à Pseudomonas aeruginosa, on a
rapporté la présence d'anticorps dirigés contre l'exopolysaccharide mucoïde. Ceci favorise
la phagoCYtose par le neutrophile en opsonisant P. aeruginosa (pIER et al 1987). Cependant,
la protection par les anticorps opsoniques ou non opsoniques n'a pas été démontrée
clairement.
La sensibilité croissante à Pseudomonas aeruginosa
fi' est
pas liée à une
déficience du système immunitaire. Toutefois, il semble que des facteurs localisés dans les
•
•
3
poumons~
soit prédisposent ces patients à une infection particulière, soit empêchent
l'éradication complète du pathogène des voies respiratoires (KONSTAN et 011993).
1.3 Modèle murio d'infection pulmonaire à Pseudomonas
Des travaux de recherche effectués dans notre laboratoire par MORISSETTE et al
(1995) ont montré qu'une telle dichotomie quant au phénotype de résistance ou de sensibilité
aux infections à Pseudomonas existait chez la souris.
Le modèle murin est apparu comme un
excellent modèle pour l'étude des facteurs génétiques régulant la résistance naturelle à
Pseudomonas aeruginosa dans les cas d'infections péritonéales et cornéennes (BERK et al
1983, BERl< et al 1979, PENNINGTON et al 1992). En effet, les lignées de souris
•
génétiquement définies sont sélectionnées selon la qualité et l'amplitude de leur réponse à un
pathogène donné. En réduisant le nombre de variables, il devient plus facile d'identifier le ou
les gènes responsables de la résistance ou de la sensibilité à l'infection.
D'autres études ont été menées en induisant une infection pulmonaire à Pseudomonas
aeruginosa en utilisant une bactérie libre en aérosol ou en pratiquant une infection intra-
trachéale chez la souris (CERQUETTI et al 1986, SORDELLI et al 1987, SORDELLI et al
1985). Un modèle d'infection pulmonaire chronique avec une souche de P. aeruginosa
enrobée d'agar a également été développée par le groupe de BAKER (ST ARIŒ et al 1987).
Par ailleurs~ ce modèle a été utilisé pour l'étude de la protection conférée par l'immunisation
(PIER et al 1990).
•
•
4
Nous avons donc utilisé ce modèle d'infection endobronchique en utilisant des billes
d'agar contenant une souche de Pseudomonas aeroginosa 508 afin d'étudier la réponse
inflammatoire à Pseudomonas chez différentes lignées de souris. L'enrobage de la bactérie
dans l'agar présente l'avantage de réduire la rapidité de la clairance de la bactérie et ainsi
pernlettre l'étude des interactions bactérie/bôte suivant rinfeetion d'un animal
immunocompétent (MORISSETTE et al 1995).
Quatre lignées murines ont été soumises à une infection endobronchique à
Pseudomonas aeruginosa 508 enrobé dans des billes d'agar. Chaque souris a reçu une dose
initiale de 1 X 104 à 3 X 10 bactéries. Après trois jours d'infection, les lignées AlJ et
C57BL/6 n'ont montré aucune modification notable de la population bactérienne dans les
•
poumons. Toutefois, les souris BALB/c ont montré une diminution significative de la
population bactérienne alors que les souris de la lignée DBAl2 ont, au contraire, montré une
augmentation appréciable de la charge bactérienne. Tel que le démontre le tableau 1, l'étude
de la mortalité et de la prévalence de l'infection a démontré que le taux de mortalité imputable
à l'infection à Pseudomonas est supérieur chez les souris de la lignée DBAl2 que chez les
souris BALB/c et ce dès le troisième jour d'infection. De plus, après une semaine d'infection,
le pourcentage d'individus montrant une infection persistante est significativement supérieur
chez les souris DBAl2 que chez les souris BALB/c.
•
•
5
Tableau 1
Étude du taux de mortalité et de la prévalence de l'infection
chez les souris BALB/c et DBAl2 suite à une infection pulmonaire à P. aeruginosa
Lignée
% mortalité
% individus montrant une
infection persistante
7 jours
14 jours
3 jours d'infection
BALBlc
1,7% (1/60)*
6% (1I16)t
13% (2115)
DBAl2
38% (38/101)
44% (7116)
11% (1/9)
* Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de souris mortes sur le nombre de souris
infectées.
.
t Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de souris infectées sur le nombre de
souris testées.
1.4 Résistance génétique aux infections à Pseudomonas
•
De tels résultats permettent alors de concevoir un modèle murin de résistance
génétique à Pseudomonas aeruginosa puisque les souris de la lignée BALBlc se sont avérées
résistantes à l'infection alors que les souris de la lignée DBAl2 se sont avérées sensibles. La
différence est notable au cours de la première semaine d'infection.
n s'agit donc d'un
excellent modèle d'étude pour la phase précoce de ('infection présentant une inflammation aiguë. Une différence génétique importante entre ces deux lignées est ('absence du facteur
C5 du complément chez les souris DBAJ2. Cette lignée possède une mutation récessive
autosomale du gène contrôlant l'activité hémolytique du sérum résultant ainsi en une
déficience au niveau de la production du CS. Ce complément est connu pour participer à la
défense de l'hôte contre les infections ainsi que dans la réponse inflammatoire en médiant
•
plusieurs activités biologiques telles que le chimiotactisme, la stimulation de la phagocytose,
•
6
le relargage de cytokines (notamment le TNF (tumor necrosisfactor) et l'interleukine-l), le
relargage d'enzymes granulaires des neutrophiles et d'oxydants, de même que l'augmentation
de la formation d'anticorps (JOHNSTON et a/1993).
Les effets de la déficience du facteur CS sur la morbidité et la mortalité lors
d) infections à Pseudomonas aeruginosa ont été rapportés chez des lignées de souris
congéniques BI0.D2. La déficience du facteur CS entraînait une diminution de la clairance
bactérienne et influençait le recrutement neutrophilique (CERQUETTI et a/ 1986, LARSON
et a/1982). Cependant, chez la souris, l'effet du fàcteur CS sur la réponse de l'hôte peut être
modulé par le bagage génétique. En effet, CERQUETTI et coUaborateurs (1986) ont montré,
en utilisant des lignées de souris présentant un certain profil génétique DBA/2, que la
•
clairance du Pseudomonas en phase précoce était similaire chez les souris DBN2 CSdéficientes et chez les souris CS-compétentes de la lignée DBAJI (CERQUETTI et al 1986).
Ces résultats appuient l'importance de l'implication de gènes contrôlant les mécanismes de
défense lors d'une infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa chez la souris DBAl2.
De plus, dans un modèle d'infection à Listeria monocytogenes lorsque l'on compare une
lignée AlJ C5-déficiente avec une lignée AlJ CS-compétente, aucune différence ne peut être
observée quant à l'issue de l'infection (GERVAIS et al 1984). Ces résultats indiquent que
si le facteur CS peut jouer un rôle majeur dans la clairance de Pseudomonas aeruginosa du
tissu pulmonaire, d'autres mécanismes de défense sont impliqués dans le processus
d'éradication.
•
Outre l'implication du facteur CS, il s'agÎt d'identifier les mécanismes responsables
de la résistance ou de la sensibilité à Pseudomonas aerugïllosa afin de cibler les gènes
•
7
responsables de l'éradication de l'infection. Le problème peut être étudié suivant deux
aspects: la défense cellulaire dans un premier temps, puis le profil d'expression des médiateurs
inflammatoires impliqués dans l'activation des phagocytes.
1.5 Réponse inflammatoire
Il a été démontré que la présence de Pseudomonas aeroginosa dans les voies
respiratoires des patients atteints de mucoviscidose induit une forte réponse inflammatoire
soutenue.
Cette réponse est caractérisée par un fort recrutement de cellules
polymorphonucléaires (PMNs) dans l'espace broncho-alvéolaire (BERGER 1991). En
utilisant le modèle murin d'infection endobronchique, nous avons démontré que la résistance
•
des souris BALBlc et la sensibilité des souris DBAJ2 à l'établissement de l'infection à
Pseudomonas aeruginosa correlait avec une différence notable dans l'amplitude de la réponse
inflamnlatoire du tissu endobronchique (MORISSETTE et al 1995). En effet, les souris
BALB/c ont montré un recrutement des cellules inflammatoires, Ph4Ns et macrophages, plus
rapide que chez les souris DBAJ2. La réponse inflammatoire précoce était caractérisée par
un recrutement des PMNs survenant au cours des 24 premières heures de l'infection. Cette
réponse était suivie par un influx des macrophages inflammatoires dès le troisième jour
d'infection.
En utilisant le même modèle murin d'infection endobronchique, GOSSELIN et
collaborateurs (GOSSELIN et al 1995) ont analysé la production de plusieurs cytokines
•
inflammatoires, notamment l'interleukine 1a (IL-l a), l'interleukine 1~ (IL-l P), le
macrophage injlammatory protein la (MlP-la) et le TNFa, lors de la phase précoce de
•
8
l'infection àP. aeruginosa. Ces cytokines ont pu être mesurées entre 3 et 6 heures suivant
l'infection des animaux. sensibles et résistants. Un point intéressant est que les taux de TNFa
mesurés dans les lavages broncho..a1véolaires (LBA) de même que ceux de l'expression du
gène mesurés dans les cellules du LBA, étaient significativement supérieurs chez les souris
résistantes BALB/c que chez les souris sensibles DBA/2. Toutefois, aucune différence n'a
été notée quant aux niveaux d'expression et de synthèse des autres cytokines étudiées. Ces
résultats semblent suggérer un rôle important du TNFa dans la réponse spécifique de l'hôte
lors d'une infection pulmonaire.
Plusieurs études ont mis en lumière l'importance du recrutement des phagocytes au
site de l'infection dans l'éradication de la bactérie Pseudomonas aeruginosa (AMURA et al
•
1994, BURETet al 1994, CROWELL et al 1992). Ces études ont montré qu'un plus grand
nombre de cellules inflammatoires et la présence de plus fortes concentrations de TNPa
observées au site d'infection chez les souris résistantes peuvent refléter un processus
inflanunatoire plus efficace menant à une meilleure bactéricidie et à la clairance de la bactérie.
Puisque la production de cytokines varie dans les heures suivant l'infection, nous pouvons
penser que le macrophage résidant puisse être impliqué dans le recrutement des PMNs au site
d'infection.
1.6 Hypothèses de travail
Donc, en considérant les résultats obtenus avec une souche mucoïde de Pseudomonas
aenlginoso, nous avons tenté, de manière générale, de déterminer les mécanismes
•
inflammatoires responsables de la clairance de la bactérie lors de la phase précoce de
•
9
l'infection.
Des expériences in vitro et in vivo, ont été menées en utilisant une souche
mutante thennosensible de Pseudomonas aeroginosa. Cette souche, ne pouvant pas croître
à des températures supérieures à 30 oC otITe l'avantage d'étudier la phagocytose et l'activité
bactéricide des phagocytes sans avoir à compenser pour la multiplication bactérienne. Des
souris résistantes et sensibles ont donc été infectées avec la souche de Pseudomonas
aeruginosa (tsmPA) par voies Ïntra-trachéales afin de déterminer la cinétique, l'amplitude et
la qualité de la réponse inflammatoire déterminant l'issue de Pinfection (résistance ou
sensiblité à Pseudomonas).
Dans un premier temps, des études in vitro ont été menées dans le but de déterminer
l'implication des macrophages pulmonaires résidants et inflammatoires dans la clairance de
•
la bactérie. Pour ce faire, des études de phagocytose et de bactéricidie ont été effectuées sur
des cultures en monocouche de macrophages alvéolaires ou interstitiels résidants ou
inflammatoires.
Dans un deuxième volet d'expériences, nous avons étudié la dynamique de
l'éradication de Pinfection in vivo chez les souris BALB/e résistantes et DBAl2 sensibles.
Ces études avaient pour objectif de détenniner quels types cellulaires sont impliqués dans la
défense de l'hôte contre Pseudomonas ainsi que la cinétique du recrutement des phagocytes
lors de la phase précoce d'une infection pulmonaire. Ces études avaient également pour
objectifd'étudier la réponse de l'hôte et sa capacité à induire un profil cytokinique particulier.
En effet, l'hypothèse soulevée est que si la mutation du CFTR n'est pas responsable
•
de la différence de la réponse immunitaire de l'hôte lors d'une infection à Pseudomonas, il est
possible que l'expression des gènes codant l'expression de médiateurs cytokiniques puisse
•
10
différer chez un individu sensible comparativement à un individu résistant. Considérant les
travaux de GOSSELIN et al mentionnant une expression de TNFa plus élevée chez les
animaux résistants que chez les animaux sensibles, nous avons donc concentré notre étude sur
la cascade impliquant le TNFa. fi semble évident que le TNFajoue un rôle important dans
la défense de l'hôte. Toutefois, cette cytokine pro..inflammatoire ne possède pas de pouvoir
chimiotactique direct sur les PMNs. Cependant, le TNF a induit la production de plusieurs
cytokines pro..inf1ammatoires pouvant être responsables du recrutement des phagocytes au
site de l'inflammation.
Afin d'étudier le profil cytokinique induit lors de l'infection, des souris résistantes et
sensibles ont été infectées avec une souche thermosensible de Pseudomonas aeruginosa. Les
•
cytokines pro-inflanunatoires (TI.. 1~, TNFex) ont été mesurées par enzyme-/inked-
immunosorhent-assay (ELISA) dans le tissu pulmonaire. Le monocyte..chemotactic..protein.. l
(MCP.. l) a été étudié comme agent potentiellement chimiotaetique pour les macrophages
inflammatoires. Un regard a été porté sur le macrophage inflammatory protein-2 (1\.1IP-2)
comme agent chimiotaetique pour les neutrophiles. En effet, si l'interleukine-8 est la
principale chimiokine chez l'humain, celle..ci est inexsistante chez la souris. Or le MIP-2
serait l'équivalent murin de l'interleukine-8 et agirait de manière à induire l'influx des PMNs
au site de l'infection. Ainsi, nous étabHssons la cascade suivante:
IL-lp .... TNFa ... MIP..2 -+ recrutement des neutrophiles au site de l'infection
... MCP..1-+ recrutement des macrophages inflammatoires
•
•
Il
Afin de vérifier si seul le recrutement des neutrophiles est détenninant dans l'issue de
l'infection et si le rétablissement du niveau de TNFa est suffisant pour restaurer le phénotype
de résistance à
l'infectio~
des animaux sensibles ont été traités au TNFa au moment de
l'infection.
Une deuxième hypothèse a été soulevée à l'effet que la sensibilité à l'infection puisse
être associée non seulement à un délai dans le recrutement des phagocytes mais également à
une inhabilité à activer les neutrophiles. Afin de vérifier l'activation neutrophilique le
monoxyde d'azote, l'interleukine-6 et legranulocyte-macrophages-c%ny stimu/atingfactor
(GM-CSF) ont été mesurés dans le tissu pulmonaire de souris résistantes et sensibles en cours
d'infection à Pseudomonas aeruginosa.
•
Par ailleurs, nous avons voulu détenniner si la faible production de TNFa observée
chez les souris de la lignée sensible DBAJ2 est associée à une répression due à une surproduction de cytokines anti-inflammatoires. Nous avons donc vérifié l'hypothèse d'une
répresssion par la mesure de l'interleukine-4 et de l'interleuk.ine-l 0 dans le tissu pulmonaire
des souris DBAl2 infectées. Les résultats ont été comparés avec ceux observés dans le tissu
pulmonaire des souris résistantes BALBle infectées.
•
•
12
II MATÉRIEL ET lvfÉIHODES
2.1 Animaux
Des souris mâles de souches BALBlc et DBA/2 prOVena!lt des laboratoires Taconic
(Germantown, NY) ont été gardées dans un environnement stérile jusqu'au moment de
l'infection avec Pseudomonas aeruginosa.
Les souris avaient accès à de la moulée sèche
(Purina) préalablement autoclavée et à de l'eau stérile. Les animaux infectés étaient gardés
dans une pièce d'un niveau de confinement P3. Les infections avaient lieu alors que les souris
étaient âgées de 10 à 16 semaines.
•
2.2 Bactérie
Une souche mutante thermosensible de Pseudomonas aeruginosa, gracieusement
fournie par Dr Anne Morris-Hooke (Miami University, Oxford, Ohio) (MORRIS-HOOIŒ,
1987), est bactériostatique à des températures supérieures à 36°C. Une suspension
bactérienne en phase logarithmique de multiplication est obtenue à partir d'une colonie
ensemencée en bouillon de culture "Trypticase Soy Broth" (TSB) (Beckton Dickinson,
Cockeysville, h4D) à 30°C sous agitation constante (agitateur-incubateur: Lab-ligne, modèle
3528, numéro de série 9469, MeIrose Park, Ill). Pour la conservation à long terme, la
suspension bactérienne en phase log a été aliquotée dans un mélange TSB/gIycérol 20% puis
•
congelée à - SO°C. Pour chacune des expériences subséquentes, un aliquot de 1 ml de la
suspension mère a été ensemencée dans 8 ml de TSB puis diluée en série 1:4. La suspension
•
13
baetérielUle a par la suite été ajustée par néphélémétrie (néphélémètre: Bausch & Lomb Inc.
Modèle 33.50.02, numéro de série 0315723, Richmond, Ontario, Canada) à une densité de
108 CFU/ml avant une dernière dilution seNant à établir la dose d'infection (À = 600 nm, voir
courbe de néphélémétrie, figure 1).
2.3 Purification des macrophages interstitiels résidants et inflammatoires
Les macrophages interstitiels inflammatoires ont été obtenus 5 jours suivant
l'instillation intra-trachéale de 50 J.ll de billes d'agar contenant une souche de Pseudomonas
aeruginosa 508 tuée à la chaleur. Les billes ont été faites en ajoutant de l'agar liquide et une
suspension de Pseudomonas dans de l'huile minérale sous agitation tel que décrit par
•
MORISSETTE et al 1995. Ces billes ont été utilisées dans une dilution 112 dans du PBS
stérile. Les souris ont été sacrifiées par inhalation de CO2 • Pour chaque souris, la cavité
thoracique a été ouverte et la veine cave a été sectionnée. Les poumons ont alors été perfusés
avec un volume total de PBS-EDTA de 10 ml à travers le plexus orbital ou le coeur. Les
poumons ont été excisés suite au lavage bronchoalvéolaire dont la technique est décrite plus
bas, et sectionnés en explants de 1 à deux millimètres. Pour chaque expérience, les explants
pulmonaires obtenus de deux souris ont été taillés dans un milieu D-MEM (Gibco) contenant
5% SVP, 2 mg/ml de collagénase (Sigma, St-Louis, Mo), 50 flglml de DNAse 1(Boehringer
Mannheim, Laval, Québec, Canada), 1 à 2 U d'élastase (Boehringer Mannheim), et 25 mM
de tampon HEPES (acide N-2-hydroxyéthylpiperazine-N'-2-éthanesulfonique) (ICN
•
•
14
0,70
~
.'
0,60
,-..
§
0
0
\0
"-"
Q)
0,50
0,40
::s
0"
..c
Q..
0
....,
0,30
"(1)
en
l::
•
Q)
0
0 ,20
0,10
0,00
-+-----r--,-~~~
_
___,___r__r~...,...,....______r__.__,._.,.~_r_'I
109
106
CFUtsmPA
•
Figure 1. Courbe néphélémétrique du tsmPA dans un bouillon TSB. La densité
optique de la suspension bactérienne a été mesurée à différents intervalles pendant la
multiplication bactérienne (À = 600 nm). La courbe néphélémétrique a été détenninée en
comparant la densité optique au nombre de colonies bactériennes obtenues après
ensemmencement sur TSA
•
15
Biochemicals Ine, Aurora Ohio). La suspension tissulaire a été agitée doucement pendant 90
minutes à 37°C. Les amas tissulaires ont été désagrégés en les faisant circuler à quelques
reprises dans une pipette sérologique de la ml ouis successivement à travers des aiguilles de
20,21 et 22 G. La suspension cellulaire a alors été récoltée et centrifugée à 900 rpm pendant
10 minutes (centrifugeuse: Beckman CPR centrifuge, modèle 349702, no série 8k034, Paolo
Alto, CA). Les érythrocytes ont été lysés par l'addition de 10 ml de tampon de lyse
hypotonique (solution stérile de BSA 0.01%). Les cellules ont ensuite été lavées dans 30 ml
de D-MEM/gent8nÙcinel5% SVF et centrifugées à nouveau (900 rpm, la minutes). Après
avoir été resuspendus dans le milieu de culture, les macrophages ont été purifiés par
centrifugation (25 min., 2500 rpm) sur gradient de densité autofonné (Lympholyte-M:
•
Cedarlane Laboratories Limited, Homby, Ontario, Canada).
Les cellules situées à
l'interphase ont été récoltées et lavées 2 fois dans D-MEM/gentamicinel5% SVF et
resuspendues dans D-~l()01O SVF. Une nouvelle étape de purification des macrophages
a été effectuée en laissant adhérer les cellules sur une surface plastique (microplaques de 48
puits) pendant 2 heures à 37°C dans un atmosphère humide contenant 5% CO2 sous agitation
constante. Les cellules ont été simplement lavées et les macrophages adhérents ont été
incubés de 12 à 16 heures dans le D-MEM/IO% SVF avant l'essai de bactéricidie. Cette
méthode permet d'obtenir une pureté de > 99% de macrophages.
2.4 Isolation des macrophages péritonéaux
•
Les macrophages péritonéaux résidants ont été obtenus en perfusant la cavité intrapéritonéale avec 10 ml de RPMIlgentamicine (50 flglml)110% SVP. La suspension cellulaire
•
16
a été centrifugée (900 rpm, 10 nùD.) et resuspendue dans RPMI/IO% SVF. Les macrophages
ont été isolés par adhérence sur plastique (microplaques de 48 puits) suivie d'une incubation
de 90 minutes à 37°C/5%C02 • Les macrophages inflammatoires ont été récoltés 5 jours
après une injection intra-péritonéale de 1 ml de protéose-peptone 10%.
2.5 Essai de bactéricidie in vitro
La méthode de baetériciclie a été adaptée d'une procédure publiée précédemment
(GERVAIS et al 1986). Les macrophages ont été distribués dans des plaques de culture de
48 puits (Fisher Scientific, Pittsburg, Pa) à raison de 5 X lOS cellules/puits. Les cellules
adhérentes ont été infectées avec 2.5 X 10 6 bactéries tsmPA. Ces nombres ont été calculés
•
de manière à obtenir un ratio bactérie:cellule optimal de 5: 1. Suite à l'exposition des cellules
à tsmPA, les plaques ont été incubées 30 minutes à 37°C/5%C02 afin de permettre la
phagocytose. Des puits contenant soit des cellules seules, soit des bactéries seules
constituaient les témoins. La période de phagocytose a été terminée en retirant les bactéries
extra-cellulaires par 2 lavages consécutifs avec du RPMI maintenu à 37°C. L'activité
bactéricide a été déterminée en incubant des cellules pour une période de 90 minutes suivant
le retrait des bactéries extra-cellulaires. La phagocytose et l'activité bactéricide ont été
déterminées en lysant les cellules soit immédiatement après la période d'exposition de 30
minutes (phagocytose) soit 90 minutes après le retrait des bactéries (activité bactéricide). La
lyse a été obtenue par ajout de 500 Ill/puits d'une solution stéril~ de BSA 0,01 % (M/V) dans
•
l'eau distillée. Des dilutions sériées 1110 des lysats cellulaires ont été étalées sur "Trypticase
Soy Agar" (TSA) afin de permettre la numération bactérienne intracellulaire. L'activité
•
17
bactéricide est exprimée par la différence entre le nombre de bactéries intracellulaires restantes
après la période d'incubation de 90 minutes et le nombre de bactéries phagocytées pendant
les 30 premières nùflutes. L'activité bactéricide est exprimée en pourcentage.
2.6 Élimination systémique de P. aeruginosa
L'élimination systémique de la souche thermosensible de P.
aeruginosa a été
détennmée à la fois chez la souris sensible (DBAl2) et la souris résistante (BALB/c) à
l'infection. Une suspension de lOs cru/ml dans 0,2 Rd de PBS stérile a été injectée par voie
intra-veineuse dans la veine latérale de la queue en utilisant des seringues intradermiques
munies d'aiguilles 21G. Les souris ont été sacrifiées à 30 minutes et 4 heures suivant
•
l'administration de la dose bactérienne.
Les animaux étaient d'abord anesthésiés par
inhalation d'halothane en doses subléthales puis tués par dislocation cervicale. Le foie et la
rate ont été prélevés dans respectivement 8 ml et 9 ml de PBS stérile. Les organes étaient
conservés sur glace pendant toute la durée de la procédure. Les tissus ont été homogénéisés
à vitesse moyenne pendant 30 secondes (homogénéiseur: modèle PT 10/35, Brinkmann
Instrument, Mississauga, Ontario, Canada). La population bactérienne contenue dans les
tissus a donc été déterminée en étalant des dilutions 10g10 des homogénats sur TSA.
2.7 Instillation intra-trachéale de Pseudomonas aeruginosa
Les souris BALB/c et DBAl2 ont été anesthésiées par une injection intra-musculaire
•
d'un mélange 1: 1 fraîchement préparé de xylazine 2 mg/ml (Rompun, Bayvet Divisio~
Chemogro Limited Etobicoke, Ontario, Canada) et de kétamine hydrochlorure 15 mg/ml
•
18
(Rogarsetic, Rogar/STB Inc, London, Ontario, Canada). L'anesthésique était administré à
raison de 0,24 à 0,3 ml (xylazine OA8 mg/20 g souris; kétamine 3.6 mg/20 g souris) à l'aide
d'une seringue à insuline jetable. Les souris ont alors été rasées avec une lame de bistouri
neuve, selon les recommandations du "Canadian Animal Care Committee" et la zone
chirurgicale a été nettoyée par friction à l'éthanol 70%. La trachée a été exposée directement
par une incision cervicale médiane. L'animal a été intubé par voie oro-trachéale en utilisant
un cathéter intraveineux (22G) (Criticon, Tampa, Fla) relié à une seringue de 250 Jll
(Hamilton Co, Reno, Nev). Un volume de 50 J.11 de suspension bactérienne a été injecté dans
les voies aériennes, suivi immédiatement d'une ventilation d'un volume de 50 Jil. Après
l'inoculation, le muscle a d'abord été suturé avec un noeud simple et l'incision a été refermée
•
avec une suture double effectuée avec du fil monofilament de nylon [CE4] Dermalon 5.0;
Davis & Geck, Cyanamid Canada Inc, Montréal, Québec, Canada. (MORISSETTE et al,
1995) La zone chirurgicale a ensuite été fiietionnée avec une solution de proviodine (Rougier,
Chambly, Québec, Canada) afin d'éviter le développement d'une infection post-chirurgicale.
Les animaux ont été enveloppés dans une gaze stérile de manière à éviter l'hypothermie
causée par une réaction aux agents anesthésiants.
2.8 Détermination de la population bactérienne dans les poumons
Les poumons ont été excisés après 30 minutes, 2 h, 4 h , 6 h, 8 h, 18 h et 24 h suivant
l'infection intra..trachéale et placés immédiatement dans 9 mI de PBS stérile froid. Les
•
poumons ont été homogénéisés et des dilutions 10g10 ont été étalées sur TSA tel que décrit
plus haut pour le foie et la rate.
•
19
2.9 Lavage broncho-alvéolaire et numération ceUulaire
Les souris ont été anesthésiées par inhalation d'halothane et sacrifiées par dislocation
cervicale. Les souris ont alors été dénudées et la cavité thoracique a été ouverte. La trachée
a été ligaturée et canulée avec un cathéter intraveineu.'C de 22G connecté à deux seringues de
la ml via une valve à trois branches (Namic, Giens Falls, NY). Les poumons ont été lavés
avec un volume total de 5 ml de PBSIEDTA 0,05% par aliquots de 1 ml. Les fluides de
lavages broncho-alvéolaires (FLBA) ont été centrifugés à 900 rpm pendant 10 minutes
(centrifugeuse Beckman) et les cellules ont été resuspendues dans du PBS stérile, exempt
d'endotoxine. Le nombre total de cellules a été déterminé par numération nucléaire à ['aide
•
de la solution de Turk. Les comptes différentiels ont été déterminés en faisant adhérer sur
lame de verre 100 III de suspension cellulaire à l'aide d'une centrifugeuse Cytospin (Shanden
Southem Products Limited, Cheshire, United Kingdom). Les types cellulaires ont été
recensés par examen microscopique (microscope optique: Nikon Canada me., Mississauga,
Ontario, Canada) à la suite d'une coloration différentielle (Diff-Quick, American Scientific
Produets, McGraw Park, Dl).
2.10 Purification des surnageants d'homogénats
Les cytokines ont été mesurées dans la phase soluble des homogénats de poumons.
Les phases soluble des homogénats ont donc été purifiés par centrifugations et filtrations
séquentielles de manière à éliminer les débris cellulaires. Dans un premier temps, les
•
homogénats ont été centrifugés à 2 000 rpm à 4°C pendant 30 minutes. Les sumageants ont
•
20
été transférés dans de nouveaux tubes et centrifugés à 2 500 rpm à 4 °C pendant 30 minutes.
Les sumageants ont alors été filtrés successivement sur des ultra-filtres d'acétate de cellulose
Acrodisc (Gelman Science, Ann Arbor, MI) de S 1lIn, 0,45 Jlm et 0,22 Ilm. Les sumageants
ont été aliquotés et congelés à - 70 °C jusqu'à la mesure des cytokines. Au moment de la
quantification, des aliquots ont rapidement été dégelés dans un bain à 37°C puis centrifugés
à vitesse maximale pendant 5 minutes à 4 0 C dans une microcentrifugeuse (Fisher Scientific,
modèle 23 SC, Pittsburg, Pa).
2.11 Quantification de l'IFNy par ELISA
La concentration d'IFNy présente dans le tissu pulmonaire après infection
•
endobronchique au tsmP A a été mesurée dans la phase soluble des homogénats de poumons
par une méthode ELISA Des plaques ELISA de 96 puits (Immulon II, Fisher Scîentific,
Pittsburg, Pa) à fond en U ont été recouvertes d'un anticorps monoclonal, anti-IFNyDBlmAb de hamster (BioSource International, Camarillo, CA) à une concentration de 2 Jlglml
PBS, 50 Ill/puits. Les plaques ont été incubées à 4°C pendant 12 à 16 heures avant d'être
rincées 3 fois avec un tampon de lavage composé de PBS additionné de 0,1% Tween 20
(pBSrr20). Les sites non adsorbés ont été bloqués avec une solution de blocage: PBSff20
+ 1% BSA Environ 250 JlI de cette solution ont été ajoutés à chaque puits et les plaques ont
été incubées à la température de la pièce pendant 1 heure avant d'être lavées 3 fois avec
PBSrr20. Les standards ont été dilués dans la solution de blocage (pBSrr20/BSA). Pour
•
les standards, un IFNy recombinant (Genzyme, Cambridge, MA) a été dilué de 64 U/ml à
0,25 U/ml en dilution doublante. Les sumageants des homogénats ont été utilisés tels quels,
•
21
sans dilution. Cinquante I.d de chaque standard et de chaque échantillon ont été disposés dans
0
les puits en duplicata. Les plaques ont été incubées de 12 à 16 heures à 4 C. Après un
lavage répété 3 fois avec PBSff20, 50 JlI d'une dilution 1/1800 dans PBSrr20 d'une solution
d'anticorps polyclonaux de lapin anti-IFNy de souris (gracieusement fournie par Dr M.M.
Stevenson, MGH Research Institute, Montréal, Québec, Canada). Les plaques ont été
incubées 1 heure à la température de la pièce. Trois lavages avec PBSrr20 ont à nouveau
précédé l'addition de 50 IlVpuits d'anti-IgG de lapin provenant de la chèvre et conjugué à la
peroxydase ''Horseradish'' (Biorad, Mississauga, Ontario, Canada). L'anticorps conjugué a
été utilisé dans une dilution 113000 dans le PBS!f20. Les plaques ont à nouveau été incubées
à la température de la pièce pendant une heure puis lavées 3 fois avec PBSrr20, 100 JlVpuits
•
d'ABTS (Boehringer Mannheim, Laval, Québec, Canada) fraîchement préparé à 1 mg/ml dans
le tampon recommandé par le fabriquant (Boehringer Mannheim) ont été disposés dans les
puits et les plaques ont été incubées à la température de la pièce à l'abri de la lumière,
jusqu'au développement de la coloration verte. La densité optique a été lue à Â = 405 nm
avec référence à À = 492 om.
2.12 Quantification du TNFa par ELISA
Le TNF" contenu dans la phase soluble des homogénats de poumons a été quantifié,
d'abord par une méthode ELISA développée dans le laboratoire puis à l'aide d'une trousse
commerciale (BioSource International, Camarillo, CA). Les puits des plaques ELISA ont été
•
recouvertes d'un anti-TNFa de hamster monoclonal (Genzyme, Cambridge,
~fA)
à une
concentration de 2 Ilglml de PHS, 50 JlVpuits. Les plaques ont été incubées de 12 à 16 heures
•
22
à 4°C.
Entre chaque étape, les puits ont été lavés 3 fois avec une solution de PBS
additionnée de 0,05% Tween 20 (PBSrr20). Le standard de TNPa recombinant (Genzyme,
Cambridge, MA) a été dilué en dilution doublante de 64 li/ml à 0,5 U/ml dans PBSrr20. Les
échantillons ont été dilués 115 dans PBSrr20. Cinquante ,.11 de chaque échantillon et de
chaque standard ont été distribués en duplicata dans chaque puits et les plaques ont été
incubées à 4 oC pendant 12 à 16 heures. Les sites non spécifiques ont été bloqués en incubant
les plaques à la température de la pièce pendant 30 minutes avec une solution PBSff20 + 1%
lactalbumine, 250 J1l1puits. Une solution 1/1800 d'anticorps polyclonaux anti-TNFΠde lapin
(M.M. Stevenson, MGR Research Institute, Montréal, Québec, Canada) a été distribuée à
raison de 50 Ill/puits et les plaques ont été incubées à la température de la pièce pendant 2
•
heures. Le signal a été amplifié de la même manière que pour l 'IFNy. Les conditions du
développement de la coloration et la lecture de la densité optique sont les mêmes que
mentionnées ci-haut pour la quantification de l'IFNy.
2.13 Quantification de l'IL-IJl, IL-4, IL-6, IL-IO, Mcp... l et GM-CSF
Les cytokines pro-infIammatoires: n..-l~, IL-6 et MCP-l, de même que les cytokines
anti-inflammatoires: IL4 et IL... IO ont été mesurées à l'aide de trousses commerciales
(BioSource, Camarillo, CA). Le GM-CSF a été mesuré en utilisant une trousse de la
compagnie Endogen, (Woburn, MA). Toutes ces cytokines ont été mesurées dans la phase
soluble des homogénats de poumons après infection au tsmPA suivant la procédure suggérée
•
par le fabriquant. Chaque échantillon a été quantifié en duplicata.
•
23
2.. 14 Mesure du nitrite/nitrate
La production de monoxyde d'azote (NO) a été quantifiée en mesurant les
intermédiaires réactifs dérivés de l'oxydation du radical libre, soit les ions nitrite (NO;) et
nitrate (NO]-) par la méthode colorimétrique de Greiss. Cependant, puisque le réactif de
Greiss ne réagit pas avec le nitrate et qu'en présence d'oxygène, le nitrite dérivé de
l'oxydation du NO subit une seconde oxydation qui conduit à la fonnation de nitrate, il est
essentiel de réduire ce dernier selon un procédé enzymatique.
Dans un premier temps, 300 ,.Ll de chaque échantillon ont été traités avec 30 III de
nitrate réductase d'Aspergillus à une concentration de 0,01 U/ml (Sigma, St-Louis, Mo) et
•
30 fll de NADPH 100 flM (Sigma, St-Louis, Mo). Les tubes ont été incubés dans le noir à
la température de la pièce pendant 12 à 16 heures. Par la suite, 600 III du réactif de Greiss
(1% sulfanilamide dans l'acide acétique 30% et 0,1% de dihydrochlorure de N-(Inaphtyl)éthylènediamine (tous de Sigma) dans l'acide acétique 60% dans un ratio 1: 1) ont été
ajoutés. L'absorbance a été mesurée à À = 570 nm. La concentration de nitrite/nitrate a été
détenninée à ['aide d'une courbe standard de nitrate de sodium (Fisher Scientific, Pittsburg,
Pa) traitée à la nitrate réductase tel que mentionné ci-haut. La courbe standard s'est avérée
linéaire de 0,64 flM à 400 flM.
Puisque le nitrite/nitrate a été mesuré dans les sumageants
d'homogénats et que ceux-ci peuvent présenter une coloration de base variable d'un
échantillon à ('autre, il s'est avéré nécessaire de soustraire l'absorbance de chaque échantillon
•
•
24
en contact avec le réactif sans toutefois avoir préalablement été traité avec la nitrate
réductase, de la valeur de l'absorbance lue après la réaction de Greiss.
2.15 Statistiques
La portée de la différence entre les groupes de données a été analysée en utilisant le
test t de Student. Les calculs ont été effectués à partir du chiffrier électronique SigmaPlot 1.0
de Jandel Scientific pour Windows et QuattroPro 5.0 pour Windows.
•
•
•
25
m. RÉSULTATS
3.1 Implication des cellules mononucléaires
Afin de vérifier l'implication des cellules mononucléaires dans l'élimination de la
bactérie P. aeruginosa dans les voies respiratoires, nous avons exposé in vitro des
macrophages résidants et inflammatoires à une souche thermosensible de Pseudomonas
aeruginosa. L'expérience a été répétée pour les macrophages pulmonaires alvéolaires et
interstitiels. Les macrophages alvéolaires représentent la première ligne de défense contre
l'infection par un pathogène pulmonaire. Nous avons donc vérifié si l'activité bactéricide du
macrophage alvéolaire per se pouvait être responsable de la différence dans le contrôle de
•
l'invasion par Pseudomonas chez les souris résistantes et sensibles, aussi bien au niveau de
l'importance de la multiplication bactérierme que de la cinétique de prolifération bactérienne.
Les macrophages alvéolaires résidants et inflammatoires ont été obtenus de chacune des
lignées de souris résistantes et sensibles afin de détenniner, in vitro, leur fonction bactéricide
en présence de tsmPA. La fonction bactéricide des macrophages pulmonaires interstitiels a
également été vérifiée. Les activités bactéricides des macrophages pulmonaires ont été
comparées à celles des macrophages péritonéaux résidants et inflammatoires. La fonction
bactéricide d~jà bien connue de ces cellules pennet une référence fiable. L'utilisation d'une
souche bactérienne thermosensible (ne se multipliant pas à 37°C) nous pennet de d'évaluer
les premières étapes de phagocytose et de bactéricidie par les cellules phagocytaires, tels les
•
macrophages et les polymorphonucléaires, sans interférence avec la prolifération bactérienne
qui se produirait nonnalement avec une souche sauvage.
•
26
Tel que présenté à la figure 2A, les macrophages alvéolaires résidants et
inflammatoires obtenus des animaux résistants comme des animaux sensibles montrent une
phagocytose et une fonction bactéricide in vitro similaires. Le pouvoir bactéricide des
macrophages pulmonaires interstitiels, qu'ils soient résidants ou inflammatoires, est
comparable chez les souris résistantes et sensibles (Figure 2B). De plus, les macrophages
pulmonaires inflammatoires n'ont pas montré d'augmentation significative quant à leur
activité bactéricide comparativement à celle observée pour les macrophages pulmonaires
résidants. Toutefois lorsque l'on compare l'activité bactéricide des macrophages péritonéaux
inflammatoires et résidants, on voit une activité bactéricide accrue chez les macrophages
péritonéaux inflammatoires. De plus, les macrophages péritonéaux inflammatoires ont une
•
activité bactéricide significativement supérieure (P = 0,0001 à 0,015)
à celle des
macrophages pulmonaires inflammatoires lorsqu'ils sont exposés à tsmPA (Figure 2C). Ceci
suggère fortement que la capacité des macrophages à tuer Pseudomonas aeruginosa varie
selon leur site d'origine. Ceci a été démontré pour d'autres systèmes bactériens tels que
Listeria monocytogenes (GERVAIS et al, 1986). Cependant, aucune différence d'activité
bactéricide n'a été observée entre les animaux sensibles et résistants lorsque ['on comparait
un même type de macrophage.
3.2 Élimination de P. aeruginosa lors d'infections systémiques et pulmonaires
Les résultats obtenus lors de la série d'expériences in vitro suggèrent que l'activité
•
bactéricide des macrophages pulmonaires per se ne peut être responsable de la variation
phénotypique de la résistance ou la sensibilité à l'infection pulmonaire à Pseudomonas
A) MACROPHAGES ALVÉOLAIRES
•
Résidants
Inflammatoires
6
6
~ 5
·5
~ 4
.~
~
4
~
~
3
Ëi
2
~
~ 5
3
~ 2
U
co
~
U
~ 1
1
~
o --'---
o~-
BALBle DBA/2
BALB/e
DBAl2
B) MACROPHAGES INTERSTITIELS
Résidants
Inflammatoires
•
o~-
BALB/e DBA/2
BALB/e
DBAl2
C) MACROPHAGES INTRAPÉRITONÉAUX
Résidants
Inflammatoires
6
•
o --'---
o~-
BALB/e DBA/2
• • Phagocytose
BALB/e
1):\::'//)::1
bactérie intracellulaire
DBA/2
•
•
•
27
Figure 2 Étude in vitro de l'implication des macrophages dans la défense contre
Pseudomonas aeruginosa. Les activités phagocytiques et bactéricides des macrophages
alvéolaires (A) et interstitiels (B), résidants et inflammatoires, ont été déterminés in vitro à
l'aide du tsmPA Les activités bactéricides ont été comparées avec celles des macrophages
péritonéaux (C). Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes ± déviation standard (n =
3). Chaque n a été mesuré en triplicata. Les chifües apparaissant au-dessus des barres
représentent l'activité bactéricide exprimée selon la différence entre le nombre de bactéries
restant dans la cellule après 90 minutes et le nombre de bactéries phagocytées pendant les 30
premières minutes. Les barres noires illustrent la phagocytose alors que les barres grises
représentent le nombre de bactéries restantes (après 90 minutes).
•
28
aeruginosa. Cependant, ces études in vitro ne sont pas un corollaire exact de ce qui se
produit in vivo où nombre de cytokines et de chimiokines y sont impliquées. Ces dernières
modulent les fonctions phagocytiques et bactéricides des cellules inflammatoires. Nous avons
donc déterminé in vivo l'activité bactéricide des cellules alvéolaires en mesurant l'efficacité
des phagocytes à éradiquer une infection endobronchique à tsmP A. Les résultats ont été
comparés entre les animaux résistants et sensibles. Puis, nous avons comparé l'activité
bactéricide in vivo des phagocytes pulmonaires avec celle des macrophages du foie et de la
rate suivant une infection intra-veineuse avec tsmPA. Cette comparaison nous a permis de
déterminer si les mécanismes d'éradication de la bactérie diffèrent selon le type d'infection
induite, systénùque ou locale. Encore une fois, la souche mutante thermosensible de PA a été
•
choisie afin d'éviter la multiplication interne de la bactérie, pennettant ainsi une étude plus
claire de l'efficacité de la phagocytose et de l'élimination de la bactérie sans avoir à
compenser pour la multiplication normale de la bactérie.
Tel que le démontre la figure 3, l'invasion du foie et de la rate par la bactérie est
similaire chez les animaux résistants et sensibles 30 minutes suivant l'infection par injection
intra-veineuse de tsmP A Dans le tissu hépatique, les souris résistantes et les souris sensibles
ont montré une cinétique de clairance similaire. Par contre, dans le tissu splénique, une
différence significative dans la vitesse d'élimination de l'agent pathogène a été observée entre
les souris résistantes et sensibles. Les souris de la lignée BALB/c ont efficacement éliminé
la bactérie en 4 heures alors que les souris DBAl2 se sont montrées moins efficaces quant à
•
l'initiation de la bactéricidie (P = 0,037). Lorsque les souris ont été infectées par voie intratrachéale, les macrophages alvéolaires résidants des souris résistantes et sensibles n'ont pas
•
29
4
Rate
m
3
0
.S
~
\.;.
Q)
<u
ct: 2
:::>
LL
U
CD
0
-J
•
1
•
BALB/c
DBAJ2
0
0
50
100
ISO
200
250
300
250
300
Temps (minutes)
5
•
~
0
Foie
4
.~
~
~
3
::J
~
U
eo
0
~
••
2
BALB/c
DBA/2
1
0
50
100
150
200
Temps (minutes)
•
Figure 3. Clairance du tsmPA dans les tissus spléniques et hépatiques après une
infection systémique par voie intra-veineuse.
n = 3, les résultats sont exprimés en valeurs moyennes ± déviation standard.
•
30
5,5
~
5,4
~
C5
.~ 5,3
t:
~
~
~
U
00
5,2
5,1
••
0
~
5,0
BALB/e
DBAl2
4,9
•
0
50
100
150
200
250
300
Temps (minutes)
Figure 4. Étude in vivo de la réponse bactéricide des macrophages pulmonaires
résidents suite à une infection endobronchique à tsmPA.
n = 3, les résultats sont exprimés en valeurs moyennes ± déviation standard.
•
•
31
montré d'activité bactéricide in vivo puisqu'aucune diminution de la population bactérienne
n'a été observée dans les 4 premières heures de l'infection (Figure 4). En contre-partie, lors
de l'infection systémique précoce, les phagocytes du foie et de la rate sont en mesure de tuer
la bactérie facilement (Figure 3). Ces résultats supportent les données obtenues lors des
essais in vitro suggérant que
l'activité bactéricide des phagocytes varie selon le site
physiologique.
3.3 Étude du profil de la défense cellulaire lors d'une infection eodobronchique
Après l'infection des souris avec tsmPA par voie intra-trachéale, l'activité bactéricide
a été déterminée à différents intervalles de temps suivant l'instillation. Des intervalles
•
précoces (30 minutes, 2 et 4 heures) ont été choisis afin de déterminer l'habilité des
macrophages alvéolaires résidants à tuer Pseudomonas aenlgfnosa, alors que des temps un
peu plus tardifs (6, 8, 18 et 24 heures) ont été ciblés afin de déterminer si le recrutement de
cellules polymorphonucIéaires (PMN) était responsable de la clairance de l'infection. Les
résultats de la figure 5 montrent que l'élimination du tsmPA a été initiée seulement après le
recrutement des PMNs dans l'espace alvéolaire. La baetéricidie a été initiée entre 4 et 6
heures (Figure SA) suivant l'infection chez les souris BALBlc correspondant au moment du
recrutement des PMNs dans l'espace alvéolaire (Figure 5B). Toutefois, le recrutement de
PMNs dans l'espace alvéolaire a été retardé d'environ 2 heures chez les souris DBAl2
comparativement aux souris BALB/c. La population bactérienne contenue dans les voies
•
respiratoires des souris DBA/2 est donc demeurée inchangée durant les 6 premières heures
de l'infection. L'élimination de la bactérie a été initiée au moment de l'arrivée des PMNs, soit
•
7
32
A)
6
~
<::)
.~
t:
~
~
fi
5
4
~
....... ... -.
3
u
bQ
0
-
~
.....................................
.
2
~
•
1
0
10
0
20
30
40
50
100
B)
......
80
•
....... ...........•
<
CQ
~
60
fi)
~
fi)
;j
"0
40
fi)
~
Q.,.
---- BALBle
....•...
DBA/2
20
......•
'$..
0
o
10
20
30
40
50
Temps (heures)
•
Figure 5. Étude du profd de la défense cellulaire lors d'une infection endobronchique
à tsmPA. Le panneau A représente la population bactérienne quantifiée dans des homogénats
de poumons (n = 10) de souris BALB/e et DBA/2 infectées par voie intra-trachéale avec
tsmPA. Le panneau B représente le recrutement neutrophilique à 6, 8, 18 et 24 heures
suivant l'infection.
•
33
vers 6 heures suivant l'instillation. Les courbes de numération bactérienne (Figure SA)
montrent clairement que le profil de la défense anti-Pseudomonas diffère entre la lignée
résistante (BALB/c) et la lignée sensible (DBA/2). Donc, de manière générale, les résultats
montrent que le début de l'élilnination de la bactérie des voies respiratoires correspond à
l'influx neutrophilique dans l'espace alvéolaire.
3.4 Effet du TNFœ sur la réponse inflammatoire chez les souris sensibles infectées
Le TNFa favorise le recrutement et l'activation des phagocytes inflammatoires.
Gosselin et collaborateurs (GOSSELIN et al 1995) ont montré que les souris résistantes
•
(BALB/c) produisaient de plus fortes concentrations de TNFa dans les fluides des LBA que
celles retrouvées chez les souris sensibles DBA/2. Notre observation selon laquelle les souris
DBA/2 montraient un délais de recrutement de P1vINs nous a amenés à vérifier si le TNFa
joue un rôle dans l'amplitude de la réponse inflammatoire dans le poumon.
Du TNFœ
recombinant (500 U par souris, Genzyme, Cambridge, Ma) a été instillé par voie intratrachéale conjointement avec le tsmPA chez la souris sensible DBA/2 afin de déterminer si la présence de TNFcx au site d'infection, et à une concentration similaire à ce qui est observé
chez les souris résistantes, peut affecter le recrutement précoce des PMNs dans les voies
respiratoires. Les souris DBA/2 ayant reçu le TNFœ avec le tsmPA ont montré une
infiltration de PMNs au site inflanunatoire plus élevée que les souris infectées sans traitement
concomitant au TNFa. À 8 heures suivant l'infection nous avons obtenu Il,3 X lOS et 3,9 X
•
lOS cellules, chez les souris traitées avec le TNFa et les souris témoins, respectivement.
•
34
Tableau 2
Effet du traitement au TNFu sur l'infection endobroncb.ique à P. aeruginosa chez
les souris sensibles DBA/2·
Lignée murine
et traitement
30 min
6h
8b
18 h
24 h
A) Suppression de la bactérie (diminution en loglo de la population bactérienne)
DBA/2 + tsmPA
nab O.4±O.2 -O.5±O.4 -2.3±O.9 -3.0±O.3
DBA/2 + tsmPA + TNFa na O.3±O.1 -O.2±O.S -2.8±O.4 -3.9±O.3
BALB/c + tsmPA
na -O.5±O.1 -1.6±O.2 -4.0±O.4 éliminée
B) Proille de la réponse inflammatoire (%Pl\fNs)
•
•
DBA/2 + tsmPA
0
DBA/2 + tsmPA + TNFa 0
BALB/c +tsmPA
0
o
58±19
93±1
18±13
38±3
SO±17
85±16
83±3
91±1
89±5
89±5
87±2
a) Les souris ont été infectées par voie intra-trachéale avec 105 bactéries/souris (tsmPA) et
ont été traitées ou non avec 500 U de TNFa. Les souris (n = 3 par groupe) ont été sacrifiées
à différents intervalles. La cinétique de l'éradication du tsmPA a été détenninée dans des
homogénats de poumons et sont exprimés en variations 10g10 de CFU par rapport au compte
obtenu à 30 min. La réponse inflammatoire a été détenninée parallèlement sur une série de
souris différentes (n = 3 par groupe) Les fluides de LBA ont été récoltés et le pourcentage
de PMNs dans les FLBA a été déterminé tel que décrit dans la section Matériel et méthodes.
Les valeurs sont exprimées en moyennes ± déviation standard.
b) na = non applicable
•
35
Dix-huit à 24 heures suivant l'infection, nous avons obtenus 29,4 X lOs et 14,9 X lOs cellules,
respectivement (Tableau 2). L'amplitude de la réponse inflammatoire obtenue chez les souris
DBAl2 traitées au TNFa était similaire à ceDe obtenue chez les souris BALBlc non traitées.
Tel que présenté au Tableau 2, les souris DBAl2 inoculées avec tsmPA et le TNFa; ont
montré un influx neutrophilique dans l'espace broncho-alvéolaire plus précoce.
Fait
surprenant, malgré que le traitement au TNPa favorise le recrutement, la bactéricidie n'en est
pas davantage initiée. Elle demeure inchangée si on compare avec les souris DBAl2
normales. En effet, les souris infectées au tsmPA avec traitement au TNFŒ n'ont montré
qu'une légère augmentation de la clairance de la bactérie comparativement aux souris
infectées sans traitement. Par ailleurs, les souris BALB/c ont initiée l'élimination bactérienne
•
dès 6 heures suivant l'infection.
3.5 Production du TNFa dans les tissus pulmonaires.
En nous appuyant sur les résultats obtenus lors du traitement des souris DBAl2 avec
le TNFa ainsi que des travaux de GOSSELIN et al (1995), nous avons voulu vérifier la
cinétique de même que l'amplitude de la production de TNFa dans le tissu pulmonaire lors
d'une inf~1ion à Pseudomonas aeroginosa chez les souris sensibles et les souris résistantes.
Des souris BALB/e (résistantes) et DBA/2 (sensibles) ont été infectées par voie intratrachéale avec 105 CFU/souris de tsmPA selon la procédure décrite dans la section Matériel
et méthodes. À différents intervalles dans la phase précoce de l'infection, les souris ont été
•
sacrifiées et les poumons ont été excisés puis homogénéisés. Le TNFa; a été quantifié dans
la phase soluble des homogénats à l'aide d'une méthode ELISA. Les résultats montrent une
p = 0,086
A)
en
~ 3,0
S
•
~
p == 0,027
36
2,5
p = 0,118
"'0
_______1 BALB/c
~c: 2,0
~ DBA/2
1h
o
]
1,5
p = 0,016
en
~
5
1,0
"'0
~ 0,5
0,0
0,5
2
4
8
6
18
24
Temps après l'infection au tsmPA (heures)
3,5
•
c=J
B)
2,5
BALB/c
~ DBA/2
2,0
1,5
~ 1,0
"'0
~ 0,5
0,0
ncnves 0,5 2
4
6
8
18 24
Temps après ['instillation de PBS (heures)
•
Figure 6. Production du TNFu dans les tissus pulmonaires des souris résistantes et
sensibles infectées par le tsmPA. Les souris (0 = 4 à n = 14) ont été infectées par voie intratrachéale avec le tsmPA Les poumons ont été prélevés et homogénéisés et le TNF produit
a été mesuré dans la phase soluble des homogénats. Les résultats sont comparés à ceux
obtenus dans les tissus pulmonaires de souris instillés avec du PBS stérile (n = 2 à n = 4). Les
naïves (n = 4) n'ont été soumises à aucune procédure chirurgicale.
•
37
augmentation significative de la production de TNP dans le poumon chez la souris BALB/c
(Figure 6). Cette production augmente graduellement pour atteindre un maximum après
envirion 8 heures d'infection. Le taux de TNFa retourne à la normale vers 18 heures suivant
l'inoculation du tsmPA Lorsque l'on compare ces résultats avec les souris témoins qui n'ont
reçu que 50 ~I de PBS stérile, il apparaît clairement que cette augmentation est associée à la
présence de la bactérie dans les voies respiratoires puisque la procédure chirurgicale per se
n'induit pas la production de TNF chez la BALB/c. Par contre, les animaux sensibles
(DBA/2) n'ont montré aucune production significative de TNFa en présence de tsmPA.
Lorsque l'on compare les souris de la lignée BALB/c et DBA/2, la différence quant à
1) amplitude de la réponse au tsmPA est statistiquement significative aussi tôt que 2 heures
•
suivant l'infection (p = 0,016) et demeure ainsi, jusqu'à 8 heures (p = 0,086).
3.6 Étude de la production des médiateurs impliqués dans la cascade du TNF
3.6.1 Production de monoxyde d'azote dans les tissus pulmonaires
Il est connu que le TNP peut agir sur le recrutement et l'activation des cellules immunitaires de manière indirecte par la stimulation de la production de chimiokines et de
radicaux libres tels que le monoxyde d'azote (NO) (MONCADA et al 1991). Le NO est un
radical libre reconnu pour avoir des effets bactéricides.
n s'agit d'une défense cellulaire de
première ligne, donc non spécifique, contre un envarusseur bactérien ou parasite.
•
14
•
12
~
r==J
BALB/c
~ DBAl2
38
10
8
6
4
2
0,5
2
4
6
8
18
24
Temps suivant l'infection à tsmPA (heures)
•
14
c=J
12
~ DBA/2
BALB/c
~ 10
-~
8
6
4
2
ND ND . . . . . . ._ _
. . . . . .~. . . . . . . ~--.L-"'"""-------_
0,5 2
4
6
18
24
O-""--..L.....I..Q~
Temps suivant l'instillation avec PBS (heures)
•
Figure 7. Production de nitrite/nitrate dans le tissu pulmonaire suite à une infection
endobronchique à tsmPA. Les souris résistantes et sensibles (n=3) ont été infectées par
voie intra-trachéale avec 105 tsmPA/souris. Le nitrite/nitrate a été mesuré par la réaction de
Greiss dans la phase soluble des homogénats de poumons. Les résultats ont été comparés à
ceux obtenus dans les tissus pulmonaires de souris instillées avec du PBS stérile (un seul
échantillon par intervalle était disponible). ND, signifie que les valeurs contrôles pour les
DBAJ2 à 6 et 8 heures n'ont pu être déterminées.
•
39
Puisque les souris résistantes ont montré une production accrue de TNFa en cours
d'infection et que cette augmentation coïncide avec l'initiation de l'élimination de la bactérie
des voies respiratoires, nous avons voulu vérifier si l'activité bactéricide observée chez ces
animaux étaient associée à l'activation des neutrophiles recrutées dans l'espace bronchoalvéolaires par une production accrue de NO induite par le TNPa.
Le NO a donc été mesuré dans la phase soluble des homogénats de poumons de souris
infectées avec le tsmP A ou seulement instillées avec du PBS stérile. En utilisant la méthode
calorimétrique de Greiss, le NO a pu être mesuré par le biais de ses dérivés d'oxydation. Les
résultats de la figure 7 montrent que la production de monoxyde d'azote, tant chez la BALB/c
que chez la DBAl2 est faible (environ 6 J1M chez BALBlc et 9 J1M chez DBAl2). Bien que
•
la production de monoxyde d'azote soit légèrement plus élevée chez les souris de la lignée
DBAl2 que chez les souris de la lignée BALB/c, cette production demeure invariable au cours
de la période d'infection à Pseudomonas. De plus, lorsque l'on compare les résultats avec
ceux obtenus par une instillation de PBS stérile, on constate que le produit final mesuré reflète
l'activité basale de la nitric oride synthase, et ne peut donc pas être associée à une induction
par le TNFa.
3.6.1 Praduction d' IFNY dans les tissus pulmonaires
À l'examen microscopique, lors de la numération cellulaire différentielle, il ne nous
est pas
•
possible de distinguer les neutrophiles des cenules NK (natura/ kil/er) puisqu'ils sont
morphologiquement semblables. En effet, le NK mesure environ 12-15
~m
de diamètre, il
possède, comme le neutrophile, des granules cytoplasmiques et un noyau en "fer-à-cheval".
•
40
Toutefois, sachant que les cellules
NI(
ont un pouvoir défensif contre certains agents
infectieux par la production d'interféron-gamma (IFNy), nous avons déterminé l'implication
des NI( dans l'éradication de l'infection à Pseudomonas en mesurant la production d'IFNy
dans l'espace bronchoalvéolaire. Cette cytokine est également reconnue pour être produite
par les cellules T. Toutefois, puisque l'étude est menée en phase précoce, les cellules T ne
sont pas encore recrutées au site de l'infection, faisant des cellules NK la seule source
d'interféron possible.
Afin de quantifier la production d'IFNy consécutive à une infection endobronchique
au tsmP A, nous avons eu recours à une méthode ELISA mise au point dans le laboratoire.
Cependant, aucune production d'IFN n'a pu être détectée au cours des 24 premières heures
•
d'infection, ni chez les animaux sensibles, ni même chez les animaux résistants (0 = 4). Les
souris naïves et témoins (n = 2) n'ont démontré aucune sécrétion basale d'IFNy dans l'espace
alvéolaire (résultats non montrés).
3.6.3 Production d'IL-IP dans les tissus pulmonaires
Le TNFa est un excellent inducteur de la production d'interleukine-I-bêta (IL-IP)
chez le macrophage, le fibroblaste et la cellule épithéliale (DINARELLO 1984). Or, l'IL-I P
est
une cytokine pro-inflammatoire pouvant jouer un rôle important dans la défense de l'hôte.
n est
également capable d'agir en synergie avec le l'NFex pour lutter contre un agent
pathogène. Ceci justifiait alors l'étude de la cinétique de la production d'll..-IP dans les tissus
•
pulmonaires des souris BALBic et DBAl2 au cours de l'infection précoce avec le tsmPA
.-. 3,5
A)
~
c=J
.5 3,0
•
BALB/e
~ DBAl2
41
(1)
~ 0,5
1
d 0,0
0,5
2
4
6
8
18 24
Temps après l'infection au tsmPA (heures)
B)
3,0
~---,I BALB/e
2,5
•
~ DBAl2
2,0
1,5
1,0
U)
c
~
-
0,5
1
dO,0 ~-=~...L..JIo"L......J.-"-:L.....J.-.u....l--~--'--"~...ao...&.....-.a.1l~
nmves 0,5 2 4 6 8 18 24
Temps après l'instillation de PBS (heures)
•
Figure 8. Production d'IL-IP dans les tissus pulmonaires de souris résistantes et
sensibles infectées par le tsmPA par voie intra-trachéale. L'IL-l Pa été mesurée par
ELISA dans la phase soluble d'homogénats de poumons. Les résultats sont exprimés en
moyennes ± déviation standard. Pour les souris infectées au tsmPA (lOs CFU/souris), n = 6
à 12 (panneau A), alors que pour les témoins, n = 2 à 4 (panneau B).
•
42
L'IL-I f3 a été quantifié par ELISA dans la phase soluble des homogénats de poumons
de souris BALB/c et DBA/2 infectées avec le tsrnPA ou instillées avec du PBS stérile. Les
résultats de la figure 8 montrent que la bactérie induit très tôt la production d' IL-I ~ chez les
souris résistantes BALB/c.
Cependant la cinétique diffère de celle du TNFa.
Une
augmentation significative de l'IL-IP apparaît dès 30 minutes d'infection et le taux d'IL-l~
demeure relativement élevé et constant pendant les 24 heures suivant l'infection. Toutefois,
chez les souris sensibles DBAI2, bien que le taux d'IL-I f3 basal soit légèrement plus élevé que
chez la souris BALB/c, la présence de la bactérie tsmPA n'induit pas d'augmentation
significative de la production d'IL-Ip au cours des 24 premières heures d'infection. De plus,
lorsque l'on compare les valeurs
•
d'~-If}
obtenues pour les souris naïves (BALB/c et
DBA/2) avec celles des souris contrôles, on note que la procédure chirurgicale en eUe-même
n)induit pas une production d'IL-If}.
3.6.4 Production d'IL-6 dans les tissus pulmonaires
Lorsque les souris DBA/2 ont été traitées avec le TNFct, les résultats ont montré un
recrutement neutrophilique plus précoce que chez les souris DBAl2 infectées sans traitement
au TNF a. Bien que le nombre de neutrophiles recrutés au site de l'infection ait été augmenté
par le traitement au TNFa, la clairance de la bactérie ne s'en est pas trouvée améliorée
(Tableau 2). Nous avons mesurés la production d'll..-6 dans le tissu pulmonaire afin de
déterminer dans quelle mesure cette cytokine pouvait être impliquée dans l'activation des
neutrophiles en présence de Pseudomonas aeruginosa.
•
c=J
•
A)
BALB/e
~ DBAJ2
0,5
2
43
4
Temps après l'infection au tsmPA (heures)
B)
c=J
•
BALB/e
~ DBAl2
*
nmves 0,5 2
4
6
8 18 24
Temps après l'instillation de PBS (heures)
•
Figure 9. Production d'IL-6 dans le tissu pulmonaire de souris résistantes et sensibles
suite à une infection endobronchique avec le tsmPA. L'IL-6 a été mesurée par une
méthode ELISA dans la phase soluble des homogénats de poumons. Les résultats sont
exprimés en moyennes ± déviation standard. Pour les souris infectées avec le tsmPA (lOS
CFU/souris, panneau A), fi = 6, pour les souris instillées au PBS (panneau B), fi = 2 à 4. *:
significativement différent du point 0,5 h selon le test t de Student, p < 0,05.
•
44
Comme pour les autres cytokines, l'IL-6 a été mesurée dans les homogénats de
poumons par ELISA. Pour les souris BALB/c, une légère augmentation mais significative
d'IL-6 a été notée à 8 heures suivant l'infection avec le tsmPA (Figure 9). Toutefois, cette
augmentation ne semble pas être associée à l'interaction bactérielhôte puisque les souris
naïves et les souris témoins ayant été instillées avec du PBS stérile ont montré une production
d'IL-6 similaire. Les résultats obtenus pour les souris sensibles DBAl2 montrent que l'IL-6
n'est pas produit au cours de l'infection avec le tsmP A De plus, le taux de production basale
d'IL-6 ne varie pas entre les lignées résistante BALB/c et sensible DBA/2.
3.6.5 Production d'IL-4 dans les tissus pulmonaires
•
Par la mesure de l'IL-4 dans les tissus pulmonaires de souris infectées par le tsmPA,
nous avons tenté de déternùner si l'absence de production de TNFa chez les souris sensibles
DBAl2 a pu résulter d'une surproduction de cette cytokine anti-inflammatoire.
Les résultats de la figure 10 ne montrent aucune production significative d'IL-4 ni
chez la souris sensible, ni même chez la souris résistante lorsque l'on compare avec le taux de base mesuré chez les souris naïves BALB/c et DBA/2.. De plus le taux d'll..-4 basal est
similaire lorsque l'on compare les lignées sensible et résistante au tsmP A
•
,-. 3,5
!S
•
c=J
3,0
~ DBA/2
~
=
o
e
6
BALB/e
45
2,5
Q.,
~
2,0
CI)
~
c
~ 1,5
eo
-; 1,0
~
~
~ 0,5
~
~ 0,0
0,5
2
4
8
6
18
24
Temps après l'infection au tsmPA (heures)
.-. 3,5
1
S 3,0
c=J
en
•
c
o
~
o
2,5
~ DBA/2
Co
4)
"'0
en
m
'~
BALB/e
2,0
e
1,5
]
1,0
o
fi)
~ 0,5
~
0,0
naIves 0,5 2
4
6
8
18
24
Temps après l'instillation de PBS (heures)
•
Figure 10. Production d'~4 dans les tissus pulmonaires des souris résistantes et
sensibles infectées par voie intra-trachéale avec le tsmPA. L'IL-4 a été mesurée par
ELISA dans la phase soluble des homogénats de poumons des souris BALB/e et DBA/2
infectées avec le tsmP A (panneau A) ou instillées avee du PBS stérile (panneau B). Les
résultats représentent les moyennes ± déviation standard de n = 4 à n = 10 pour les souris
infectées et n = 2 à fi = 4 pour les souris témoins.
•
46
3.6.6 Production d'IL-IO dans les tissus pulmonaires
Dans le tissu pulmonaire, l'interleukine-l 0 ~-l 0) est produit par les mastocytes.
(MARIE et al 1997). Cette cytokine fréquement produite conjointement avec l'IL-4 est
reconnue comme ayant des effets anti-inflammatoires (NIIRO et al 1995, KUGA et al 1996).
TI a été démontré que les monocytes humains stimulés par le LPS produisent d'importantes
quantités d'IL-IO capable d'inluber le TNFa et l'IL-IP (te VELDE et al, 1990). Nous avons
donc voulu vérifier si l'IL-I0 produite pas les monocytes résidants et les mastocytes
pulmonaires pouvait agir à titre de régulateur d'inflammation chez la souris et si une
surexpression d'IL-ID pouvait être responsable de la déficience de la production de TNFa
chez DBA/2. L'IL-l0 a été mesurée dans les homogénats de poumons de souris sensibles
•
et résistantes infectées avec le tsmPA avec des trousses ELISA commerciales selon les
recommandations du fabriquant (BioSource International). Contrairement à ce que nous
attendions, les souris sensibles n'ont montré aucune production significative d'IL-ID (Figure
Il) alors que les souris résistantes ont montré une légère augmentation de l'a-IO vers 6 et
8 heures suivant l'infection avec le tsmPA. Cette augmentation est concomitante avec celle _
du TNFex (Figure 6). Toutefois, la valeur statistique n'a pu être établie en raison du peu de
données disponibles; n = 2 pour les souris infectées.
3.6.7 Production de MCP-l dans les tissus pulmonaires
Le monocyte chemotattractant protein-l (MCP-I) est produit par une variété de
•
cellules incluant les leucocytes mononucléaires et les fibroblastes en réponse au TNF
~
•
A)
~
-5
~
3,5
c:==J
3,0
BALB/e
~ DBA/2
c
0
e::J 2,5
0
47
0..
Q)
~
2,0
~
il
-5bO
0
E
1,5
0
..c:
~
~
1,0
'ï
T
~
â 0,5
0
,
d 0,0
~
-
0,5
2
4
6
18
8
24
Temps après l'infection au tsmPA (heures)
~
3,5
"'-
3,0
~c:
B)
~
c=J
c:
0
•
E 2,5
::s
0
c..
BALBlc
~ DBA/2
Q)
-=
"'0
~
2,0
c:
~
0
e0
..c:
~
~
1,5
1,0
~
;
~
-
0
0,5
,
d 0,0
ND ND
ND
naïves 0,5 2
4
6
NO
8 18 24
Temps après l'instillation de PBS (heures)
Figure Il. Production d'IL-IO dans les tissus pulmonaires des souris résistantes et
sensibles infectées par voie iotra-trachéale avec le tsmPA. L'a-ID a été mesurée par
•
ELISA dans la phase soluble des homogénats de poumons des souris BALB/c et DBA/2
infectées avec le tsmPA (panneau A) ou instillées avec du PBS stérile (panneau B). Les
valeurs sont exprimées en moyennes ± déviation standard de n = 2 pour les souris infectées
avec tsmPA. Une seule souris par point a pu être utilisée pour les témoins. ND = non
déterminé.
•
48
(YOSHIMURA et al 1989). Son action principale est de stimuler le recrutement des
macrophages au site inflammatoire (YOSHIMURA et al 1989, ROBINSON et al 1989).
Nous avons voulu vérifier dans queUe mesure le MCP-I pouvait être induit par le
TNF (X et ainsi médier le recrutement des phagocytes inflammatoires, notamment des
macrophages inflammatoires. Quant au recrutement des neutrophiles, notre attention a été
portée sur le macrophage inflammatory protein-2 (MIP-2) en tentant de mesurer les taux de
ARNm par une technique de RT-PCR semi-quantitative. Cependant, les essais ont dû être
abandonnés pour des raisons techniques et logistiques.
Les résultats de la figure 12 montrent la production moyenne de MCP-l après une
•
infection de 24 heures au tsmP A. La chimiokine a été mesurée dans les homogénats de
poumons à l'aide d'une trousse ELISA commerciale, selon les recommandations du
fabriquant (BioSource International). Les résultats obtenus ne montrent aucune production
significative de MCP-l chez la souris sensible DBAl2 alors qu'une augmentation significative
(p < 0,05) a été notée à 6 et 8 heures suivant l'infection des souris résistantes BALB/c lorsque
l'on compare ces données avec celles obtenues à 30 minutes suivant ('infection. Cependant,
lorsque l'on compare ces résultats avec ceux obtenus après une instillation au PBS stérile, il
semble que cette augmentation, bien que significativement supérieure au taux basal mesuré
chez les naïves, ne soit pas associée à la présence de la bactérie dans les voies respiratoires
mais dépendrait davantage de [a procédure chirurgicale.
•
A)
~
3,5
.s-
3,0
~
CI1
~ BALB/e
t::
•
~ DBAl2
o
e
49
2,5
5
c..
Q)
- 2,0
"0
CI1
œ
t::
'QJ
co
o
e
o
1,5
..c:
CI1
~
1,0
*
CI1
~
~,
*
0,5
~
u
~
0,0
0,5
2
8
6
4
18
24
Temps après l'infection au tsmPA (heures)
B)
î
l
'-'
CI1
t::
o
E
•
:::s
o
c..
3,5
3,0
~ BALB/e
2,5
~ DBAJ2
Q)
-
"0
CI1
as
2,0
c
-QJ
00
o
eo
1,5
* *
* *
..c:
CI1
~
1,0
CI1
â
~ 0,5
cL
u
~
0,0
nalves 0,5 2
4
6
8 18 24
Temps après l'instillation de PBS (heures)
•
Figure 12. Production de MCP-l dans les tissus pulmonaires de souris résistantes et
sensibles infectées avec le tsmPA. Le Mcp... l a été mesuré par ELISA dans la phase soluble
des homogénats de poumons. Les résultats représentent les moyennes ± déviation standard.
Et n = 6 pour les souris infectées alors que n = 2 à 4 pour les souris témoins. *;
significativement différent du point 30 min. selon le test t de Student, p < 0,05.
•
50
3.6.8 Production de GM-CSF dans les tissus pulmonaires
Afin d'étudier les facteurs pouvant diminuer la capacité bactéricide des neutrophiles
lors d'une infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa chez la souris sensible DBA/2,
nous avons vérifié l'implication du grunylocyte-macrophage-c%ny stimulatingfactor (GMCSF) dans les homogénats de poumons après avoir infecté les souris BALB/c et DBA/2 avec
le tsmPA par voie intra-trachéale.
Les résultats préliminaires (Figure 13) suggèrent une importante production de GMCSF à 2 heures suivant l'infection des souris BALB/c puis diminue de moitié dès 4 heures
post-instillation. Toutefois, chez la souris sensible DBAl2, aucune production importante de
•
•
GM-CSF n'a pu être mesurée au Cours des 24 premières heures d'infection. Chez les
quelques souris naïves qui ont pu être étudiées, le taux de GM-CSF demeure très bas tant
chez les animaux sensibles que les animaux résistants.
A)
î
3~5
'-'
3,0
bb
c::
~
•
1
~ DBAl2
0
e
::s
0
0-
BALBle
51
2,5
Q.)
"0
en
1;S
c::
~
2~0
0
1,5
e
0
n
..c:
~
~
en
1,0
â
"0
f.l.c
C'I)
0,5
U,
~ 0,0
0,5
2
4
8
6
18
24
Temps après l'infection au tsmP A (heures)
]' 3,5
B)
Ob
c::
'-'
~
3,0
c=J
0
•
e
::s
0
0-
2,5
~ DBAl2
Q.)
"0
en
~
c::
'cu
co
BALB/e
2,0
0
1,5
e
0
..c:
~
~
~
1,0
~
"0
~
C'I)
0,5
U1
~
0,0
ND
ND
naIves 0,5 2
4
6
ND
8 18 24
Temps après l'instillation de PBS (heures)
•
Figure 13. Production de GM-CSF dans les tissus pulmonaires de souris résistantes et
sensibles suite à une infection iotra-trachéale avec le tsmPA. Dans cette étude
préliminaire, le GM-eSF a été mesuré dans la phase soluble des homogénats de poumons de
BALB/e et DBAl2 infectées avec le tsmPA ou instillées avec du PBS stérile.
•
52
Tableau 3
Comparaison du profil inflammatoire des souris résistantes et sensibles
,
• f~tlon
j.
en reponse
ft.. une ln
en d () b ront h-lque au ts mPA.
.
•
Événement
BALBc (résistantes)
DBA12 (sensible)
Début de la clairance
bactérienne
6 h après infection
8 h après infection
Clairance bactérienne après
24 h d'infection
complète
incomplète (102-1oJ CFU)
Recrutement des
neutrophiles
6 h après infection
8 h après infection
TNFa
++++ (max 6-8 h)
+
NO
+
+
IL-l~
++ (30 min.-2 h)
+
IL-6
+
+
IL-4
+
+
IL-ID
++ (max 6..8 h)
-
MCP-I
++ (induit par la chirurgie)
+
GM-CSF
+++ (2 h)
+
INFy
ND
ND: non détectable
+ : taux de production basale
++ à ++t+ : induction significative, légère à très forte.
- : production basale très faible ou négligeable.
•
ND
53
•
IV DISCUSSION
La variation phénotypique de la réponse de l'hôte à l'infection pulmonaire à
Pseudomonas aeruginosa semble être liée à l'habilité de l'hôte d'induire une réponse
inflammatoire rapidement.
Il a effectivement été démontré que les souris résistantes
réagissaient à une infection à· souche mucoïde de Pseudomonas aeruginosa par un
recrutement précoce des cellules inflammatoires dans l'espace alvéolaire. Ce recrutement est
par ailleurs suivi d'une diminution draconnienne du nombre de bactéries entre les jours 2 et
3 de l'infection pulmonaire (MORISSETTE et al 1995). Or, ce recrutement de phagocytes
au site inflammatoire se produit plus tardivement ou avec moins forte intensité chez les
animaux sensibles.
•
Au cours de l'étude, nous avons tenté de détenniner si la clairance rapide de la
bactérie observée chez la lignée de souris résistantes BALB/c était due à une meilleure activité
bactéricide des macrophages pulmonairesper se et/ou résultait d'un recrutement plus efficace
des phagocytes inflammatoires. Ces deux processus étant impliqués directement dans la
défense de l'hôte contre l'invasion de microorganismes. Les macrophages pulmonaires appartiennent à deux populations: alvéolaires (se retrouvant dans l'espace alvéolaire) et
interstitiels (dans les interstices des cellules épithéliales fonnant les alvéoles). CROWELL et
collaborateurs (1992) ont montré que 37% des macrophages pulmonaires murins sont des
macrophages interstitiels. La majorité des macrophages sont donc alvéolaires. Ces deux
types de macrophages pulmonaires sont capables de phagocytose médiée par le récepteur
•
Fey.
•
54
Nous avons donc évalué la capacité des macrophages pulmonaires résidants et
inflammatoires à tuer Pseudomonas aeruginosa in vitro. Les résultats montrent que les
macrophages des animaux résistants et sensibles possèdent des fonctions phagocytiques et
bactéricides similaires. Ceci suggère que la variation phénotypique de la réponse de l'hôte
à Pseudomonas aeruginosa n'est pas le résultat d'une différence du pouvoir bactéricide des
macrophages alvéolaires ou interstitiels chez les deux lignées de souris. L'étude supporte
également l'existence d'une hétérogénéité quant à l'activation des macrophages selon son site
d'origine. En effet, les macrophages alvéolaires et interstitiels ont montré une plus faible
aetÎvité bactéricide que les macrophages péritonéaux soumis aux mêmes conditions
d'infection. Les macrophages alvéolaires sont morphologiquement et fonctionnellement
•
différents des macrophages péritonéaux.
Les capacités de migration, de phagocytose, de
même que la production d'arginase des macrophages alvéolaires étaient effectivement
inférieures à ce qui a été observé chez les macrophages péritonéaux (ZLOTNIK et 0/1982).
Les macrophages alvéolaires produisent également plus de TNF a que les macrophages
spléniques et les cellules de Kupffer lorsqu'elles sont stimulées in vitro avec du
lipopolysaccharide (LPS). Vraisemblablement, ces différences résulteraient des conditions
organiques spécifiques (OGIE et a11994). Cependant, nous ne pouvons pas exclure la
possibilité que l'activité bactéricide des macrophages alvéolaires et interstistiels contre
Pseudomonas aeruginosa puisse s'avérer moins efficace dans des conditions in vitro moins
favorables. En effet, le poumon est un milieu privilégié par la presssion partielle d'oxygène
•
et par le synergisme des cytokines et chirniokines présentes dans l'environnement nonnal mais
beaucoup moins dans les conditions de culture et de stimulation in vitro. Les macrophages
•
55
ont toutefois été incubés toute une nuit dans leur milieu de culture afin de favoriser
l'adaptation avant de procéder aux essais de phagocytose et de bactéricidie.
Lors d'une infection à Listeria monocytogenes, il a été démontré que les macrophages
péritonéaux inflammatoires montrent une capacité bactéricide supérieure à celle des
macrophages péritonéaux résidants (GER VAIS et aL 1986). Nous avons donc étudié les
fonctions bactéricides des macrophages pulmonaires résidants et inflammatoires afin de
déterminer si les macrophages inflammatoires nouvellement différenciés qui atteignaient
l'espace alvéolaire pouvaient montrer un plus fort pouvoir bactéricide que (es macrophages
alvéolaires résidants. Dans ce système d'infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa,
l'activité des macrophages alvéolaires inflammatoires ne différaient pas de celles des
•
macrophages alvéolaires résidants. Des résultats sinùlaires ont été obtenus lors de l'étude des
capacités bactéricides des macrophages interstitiels.
Comme il a été mentionné plus haut, il
est
possible que des interactions avec les
cytokines et chimiokines du milieu, des interactions entre les différents types cellulaires
composant le tissu pulmonaire puissent jouer un rôle important dans la réponse phagocytique
et bactéricide et donc, induire des différences significatives entre la réponse observée in vitro
et celle se produisant in vivo lors de l'infection. Nous avons donc conçu une expérience
d'infection pulmonaire pennettant d'étudier in vivo le rôle du macrophage alvéolaire résidant
et des P:MN's dans la réponse inflammatoire et l'éradication de Pseudomonas aeroginosa. Les
résultats obtenus démontrent que les macrophages alvéolaires résidants ne sont pas impliqués
•
dans la bactéricidie de Pseudomonas mais pourraient jouer un rôle crucial dans la production
et la sécrétion de cytokines et de messagers impliqués dans le recrutement des PMNs dans
•
56
l'espace alvéolaire colonisé par le tsmPA Nous avons effectivement trouvé que moins de 3%
des macrophages alvéolaires résidants avaient phagocyté le tsmP A au cours des 4 premières
heures de l'infection intra-trachéale (données non montrées). Ceci corrobore les résultats
obtenus par d'autres études au cours desquelles on a retrouvé un faible pourcentage de
macrophages alvéolaires de rat ayant phagocyté la bactérie à la suite d'une infection intratrachéale par Pseudomonas aeruginosa (BURET et al 1994). Ceci supporte également le
modèle proposé par DUNKLEY et collaborateurs (1995) suggérant que le macrophage
alvéolaire résidant jouerait un rôle comme producteur de cytokine plutôt que d'être un
effecteur direct de la baetéricidie.
L'importance des facteurs liés à un environnement organique (pression partielle
•
d'oxygène, synergisme cytokinique, fonctions organiques, etc) sur l'activité des phagocytes
et leur capacité d'éliminer un microorganisme pathogène a été déterminée en comparant le
processus de défense s'établissant dans le poumon avec ceux prenant place dans le foie et la
rate suivant une inoculation systémique. Puisqu'il s'agissait d'étudier les fonctions du
macrophage résidant dans la défense contre Pseudomonas, seules les 4 premières heures
d'infection ont été ciblées.
Deux phénomènes majeurs ont été observés. D'abord, les
phagocytes du foie et de la rate ont montré une activité bactéricide rapide et efficace alors que
les macrophages alvéolaires n'ont pas été en mesure d'initier la clairance proprement dite de
Pseudomonas du tissu pulmonaire. Ainsi donc, il semble qu'une infection systémique à
Pseudomonas conduit à une défense de l'hôte différente et plus efficace que lors d'une
•
infection localisée dans les voies respiratoires inférieures. Dans un deuxième temps, lors
d'une infection systémique, nous avons noté une capacité d'éradication de l'infection plus
•
•
57
efficace dans le tissu hépatique des animaux résistants comparativement à ce qui a pu être
observé dans le foie des animaux sensibles. Cette différence entre les lignées génétiquement
sensibles ou résistantes pourraient s'expliquer par des différences notables non seulement dans
la capacité bactéricide mais également dans la production de messagers pouvant induire
l'activation et le recrutement des macrophages et des PMNs.
L'implication in vivo des phagocytes inflammatoires pulmonaires dans l'éradication
du tsmP A a été déterminée entre 6 h et 24 h suivant une instillation intra-trachéale de la
bactérie. Les r~wtats démontrent que les PMNs sont les cellules responsables de la clairance
de Pseudomonas aeruginosa des voies respiratoires. Ceci concorde avec plusieurs rapports
démontrant le rôle crucial des PlviNs dans la clairance des infections. En effet, des souris qui
avaient été rendues granulocytopéniques par un traitement au cyclophosphamide n'ont pu
survivre à une infection à Pseudomonas aeroginosa à cause d'un recrutement de PMNs
inadéquat (AMURA et al 1994). Dans le même ordre d'idées, un modèle de réponse de
l' hôte face à une infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa a été suggéré. TI se
produirait d'abord une activation des macrophages alvéolaires. Cette activation conduirait
au recrutement des PMNs qui seraient à leur tour activés pour finalement tuer Pseudomonas
aeroginosa (CRIPPS et al 1995, DUNKLEY et al 1995). Le rôle du P~ proposé dans la
défense de l'hôte est appuyé plus fortement encore par le fait qu'un retard dans le recrutement
des PMNs chez les souris DBA12 corresponde à une diminution de l'efficacité de l'éradication
de l'infection. Notre modèle suggère que la résistance génétique de BALB/c à Pseudomonas
aenlginosa dépende à la fois du recrutement d'un nombre important de PM:N"s au site
d'infection et de l'activation des processus inflammatoires des phagocytes.
·'
58
L)observation parallèle de la clairance de la bactérie et le recrutement des PMNs
suggère fortement que ce type cellulaire joue une rôle majeur dans l'éradication de l'infection
pulmonaire. Le retard observé chez les souris DBA12 lors du recrutement des PMNs pourrait
résulter d'une cinétique de production des cytokines et des ctùmiokines moins hâtive que chez
les souris résistantes BALB/c. Ainsi donc, une plus faible production ou une production plus
tardive aurait une incidence sur l'expression et la production des molécules cl' adhésion.
Toutefois, le fait que les souris DBAl2 soient CS- ne pourrait probablement pas expliquer ce
délai dans le recrutement des PM::Ns.
nya effectivement plusieurs expériences démontrant
que les bactéries gram négatives telles que Pseudomonas aeruginosa induisent le recrutement
des Pr.dNs dans les poumons via un mécanisme d'activation dépendant des molécules
d'adhésion COI 8/CO11 plutôt que par l'activation du CS (DOERSCHUK et al 1991,
SCHMAL et al 1996, TANG et al 1995). Nous pouvons alors poser l'hypothèse que chez
les souris DBA/2, les macrophages alvéolaires ne peuvent produire les cytokines requises à
un niveau suffisant pour induire une augmentation de l'expression des molécules d'adhésion
responsables de l'extravasation des PMNs dans l'espace alvéolaire. Aussi, une série de
cytokines pro-inflammatoires a été étudiée et les résultats seront discutés plus en détail
ultérieurement. Une des cytokines qui fut jugée d'intérêt dans cette hypothèse est le TNFa.
La production de cette cytokine avait été montrée comme étant déficiente chez les souris
sensibles OBAl2 soumises à une infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa
(GOSSELIN et al 1995).
•
•
59
n a également été démontré que le TNPu favorise le recrutement des PMNs et des
macrophages au site d'infection en stimulant l'expression des molécules d'adhésion à la
surface des cellules endothéliales et des cellules épithéliales de même qu'à la surface des
PMNs (KOLLS et al 1993, SCHMAL et a/1996, VAN FURTH et al 1994). De plus, le
TNFu jouerait un rôle dans l'activation des
P~iNs.
Plus précisément, le ThTFa induit
l'activité phagocytique des PrvlNs, augmente la production d'anions superoxyde et de
peroxyde d' hydrogène chez le PMN en plus de stimuler la dégranulation qui peut être
mesurée par le relargage de myeloperoxydase, de
~-glucoronidase
et de lysosyme
(KLEBANOFF etai 1986, PIERANGELI et a/1993). De plus, les travaux de LAICHALK
et al (1998) ont également démontrés que le traitement intra-trachéal de souris CBAlJ avec
du TNF 7 jours avant l'infection pulmonaire par Klehsie//a pneumoniae augmentait la survie
des souris après 3 jours d'infection et favorisait la clairance bactérienne en association avec
une augmentation de l'activité pulmonaire de myeloperoxidase.
Lorsque nous avons traité les souris DBA/2 avec une dose de TNFu similaire à la
concentration produite par les souris BALB/c infectée, nous avons observé une augmentation
de l'intensité de la réponse inflammatoire. Le traitement au TNFcx des souris sensibles élevait
donc la réponse à un niveau similaire à celui observé chez la souris BALB/c. Le maximum
de la réponse a été atteint entre 4 h et 8 h suivant l'infection. Toutefois, le traitement des
souris DBA/2 infectées n'a pas augmenté l'efficacité de la clairance de l'infection. Malgré
le fait que le recrutement de PMNs a été rétabli à un nombre normal, i.e. similaire au nombre
•
de P:MNs présents au site d'infection dans les souris BALB/c, les souris résistantes ont réduit
la population bactérienne plus efficacement que les souris DBAl2 traitées au TNFcx. C'est
60
donc dire qu'une simple dose de TNFa administrée au moment de l'infection est insuffisante
pour modifier complètement le phénotype de sensibilité chez les souris DBAl2. Le traitement
a donc augmenté la réponse inflammatoire sans pour autant induire une activité bactéricide
efficace. Cependant, la présence de TNF a dans les poumons peut induire une cascade
d'événements et initier la synthèse et'ou le relargage d'autres facteurs tels que les cytokines
pro-inflammatoires et les chimiokines jouant un rôle dans le recrutement des PMNs dans les
voies respiratoires.
BURET et collaborateurs (1994), ont démontré qu'une inoculation intra-trachéale de
TNFa recombinant au moment de l'infection de rats naïfs améliore la clairance bactérienne
en augmentant la phagocytose par les neutrophiles broncho-alvéolaires sans induire, toutefois,
de changement dans le profil d'infiItration des cellules inflammatoires dans les poumons au
cours des 3 premières heures de l'infection. Plusieurs points peuvent expliquer la différence
entre les travaux de BURET et collaborateurs et les résultats obtenus dans notre laboratoire.
D'abord, il est possible que les souris réagissent différemment que les rats au traitement au
TNFCt, de même que le profil inflammatoire du modèle murin peut être différent de celui du
modèle de rat De plus, il semble que les souris DBAl2 présentent une déficience quant à la
production de TNFa lors d'une infection intra-trachéale à Pseudomonas aeroginosa. Ce qui
n'était pas le cas dans l'étude de BURET, dans laquelle les rats avaient une production
normale de TNFcx en cours d'infection. Leur approche consistait à induire une augmentation
des niveaux de TNFa tels qu'observés suite à une infection à Pseudomonas aeruginosa chez
des rats immunisés. Le TNFcx nonnalement produit par les rats naïfs à la suite d'une infection
à Pseudomonas peut atteindre des niveaux suffisants pour induire une réponse inflammatoire
•
61
maximale. Toutefois, la présence d'une quantité excessive de TNFa ne pourrait pas
augmenter une réponse inflammatoire déjà maximale mais pourrait augmenter la phagocytose
et l'activité bactéricide. En effet, GOSSELIN et collaborateurs (1995) ont traité de manière
systémique des souris BALB/c résistantes avec un anti-TNFa et ont montré une diminution
de la capacité de ces souris à éradiquer une infection pulmonaire à Pseudomonas aeroginosa
après 3 jours. Cette diminution n'était cependant pas associée à une diminution de l'intensité
de la réponse inflammatoire. Toutefois, dans une telle étude, on pourrait penser que la
détermination de l'amplitude de la réponse inflammatoire au jour 3 de l'infection puisse avoir
été un peu trop tardive pour qu'une différence soit observée.
n n'est donc pas exclu qu'un
anti..TNFa administré au début de l'infection puisse influencer l'intensité de la réponse au
•
cours de la phase précoce de l'infection.
Ce modèle murin de résistance et sensibilité à une infection endobronchique à
Pseudomonas aeruginosa nous a donc permis de déterminer certains événements importants
de la phase précoce qui sont responsables de l'issue de l'infection. Il semble clair que le
recrutement hâtif des PMNs soit primordial dans une éradication efficace. Le recrutement
serait induit par la libération de cytokines et de chimiokines produits par les macrophages
alvéolaires résidants. De plus, puisque les souris sensibles traitées au TNFa n'ont pas
présenté une meilleure clairance de l'infection que les souris sensibles sans traitement, et ce,
malgré un recrutement plus précoce, il semble que les neutrophiles recrutés dans l'espace
alvéolaire des souris sensibles soient moins actifs que ceux montrés chez les souris résistantes.
•
Comme il a été mentionné, il est possible que l'expression des molécules d'adhésion
soit affectée chez les souris sensibles. Toutefois, une seconde hypothèse pourrait être
•
62
soulevée.
L'examen microscopique sommaire des cellules récoltées lors des lavages
broncho-alvéolaires a permis d'observer quelques PMNs apoptotiques. Ainsi, la faible
activité bactéricide des neutrophiles des souris sensibles pourrait être due à un recrutement
de PMNs déjà sénescents et donc à une apoptose précoce. CePendant, une étude approfondie
de l'apoptose neulrophilique dans ce modèle serait nécessaire.
Donc, puisque le TNFœ joue un rôle primordial dans la défense de l'hôte contre
Pseudomonas aeruginosa en stimulant la production de cytokines pro-inflammatoires et de
chimiokines, en stimulant l'expression des molécules d'adhésion et en jouant un rôle de
médiateur dans l'apoptose, nous avons étudié la cascade des médiateurs de l'inflammation
impliquant le TNFœ. En accord avec les travaux de GOSSELIN et al (1995) nos résultats
•
montrent une production de TNFœ significative et rapide chez les souris résistantes. Aucune
production significative n'a pu être induite chez les souris sensibles. Or, cette cytokine est
reconnue comme un important médiateur endogénique de l'inflammation et des défense de
l'hôte contre les irûections (MANOGUE et a11992). Produit par les lymphocytes activés, les
cellules épithéliales et les fibroblastes, il peut agir indépendemment ou en conjonction avec
toute une variété de cytokines dépendant de la nature de l'infection et de l'organe touché
(TRACEY et al 1989, SHERRY et al 1988, MANOGUE et al 1988).
Généralement, le
TNFa n'est pas produit de manière constitutive. Lors d'une ÎIÛection bactérienne locale ou
systémique, le macrophage serait la principale source de TNF œ. Dans plusieurs maladies
infectieuses, le TNF a est connu pour être produit et libéré rapidement en grande quantité.
•
Sa capacité à modifier l'endothélium vasculaire et les leucocytes circulants de même que son
potentiel à induire d'autres médiateurs pro-inflammatoires et d'interagir avec eux font du
•
63
TNFa un agent bénéfique lors d'une infection locale (MANOGUE et al 1992, PHENG et al
1995). Toutefois, un relargage systémique du TNFa peut s'avérer dévastateur voire même
léthal pour l' hôte en raison de sévères lésions organiques, de nécroses hémorragiques et de
choc cardiovascuIaires (pHENG et al 1995).
Comme il a été précédemment mentionné, le TNFŒ est connu pour stimuler
l'e.xpression de la molécule d'adhésion ELAM-1 sur les cellules endothéliales et ainsi médier
l'adhésion et le recrutement des neutrophiles (BEVll.,ACQUA et al 1987, 1989). Or, le
TNFΠpeut agir en synergie avec l'IL-l pour induire l'expression de ELAM-1 et CDIl/CD18
et aussi favoriser le recrutement des neutrophiles. L'implication de l'IL-I a donc été étudiée
afin de déterminer le mode d'action du TNF a.
•
Chez les souris résistantes, l'IL.. 1P est mesurée en quantité élevée dès 30 minutes
d'infection. Alors que chez les souris sensibles, les quantités d'IL-l p mesurées demeurent
près du niveau de base. La cinétique observée chez les souris BALB/e nous permet de croire
que la cascade inflammatoire induite par la bactérie Pseudomonas aeruginosa est initiée par
la production et le relargage de l'IL-lp. En effet, la transcription de l'ARNm de l'IL-Ip est
rapide. Certains travaux ont démontré que chez le macrophage, la présence d'endotoxine
peut induire la transcription de l'ARNm de l'IL-lP en moins de 15 minutes (FENTON et al
1987, 1988, LffiBY et al 1986, SCHINDLER et al 1990a). SCHINDLER et collaborateurs
(1990b) ont montré que l'IL-1P agit comme stimulus sur l'expression de son propre gène
entraînant une accumulation constante et soutenue de l'ARNm pendant plus de 30 heures.
•
Mais la transcription et la traduction de l'IL-} peuvent être des processus distincts et
dissociés. Chez les macrophages activés avec de l'ARNm d'IL-l, de petites quantités d'un
•
64
second stimulus (endotoxine ou IL-I) induit rapidement la traduction et résulte en une
synthèse d'IL-l supérieure à ce qui est observé chez les cellules non activées. Le groupe de
SCmNDLER (199Oa) montre que certains stimuli tels que le Staphyloccocus epidermis tué
à la chaleur livrent un signal de traduction.
La stimulation autocrine de l'IL-l peut-être contrôlée par l'IFNy. Cette cytokine peut
également agir en synergie avec le TNFex (LAPIERRE et al 1988) dans la présentation de
l'antigène et l'activation des cellules NK en régulant les protéines de la famille des NF1d3
induites par le TNFa et pouvant lier l'élément enhancer du promoteur H-2Kb (gène de classe
1chez la souris) (ISRAEL et al 1989). L'IFNy est le principal médiateur de l'expression des
antigènes de classe II (GIACOMINI et al 1988). ln vitro, le traitement des cellules
•
présentatrices d'antigènes par le TNFa induisait une légère augmentation du complexe majeur
d'histocompatibilité (CMH) de classe II (LAPIERRE et al 1988, STEMlvIE et al 1990,
KINGSTON et al 1989). Mais le traitement avec le TNFa et l'IFNy augmentait l'expression
du C1vfH de classe II de manière synergique. Ainsi donc, afin de vérifier l'implication des
cellules NI< dans la présentation de l'antigène et la synergie possible avec l'importante
production de TNFœ observée chez les souris BALB/c résistantes, nous avons mesuré la
production d'IFNy dans le tissu pulmonaire des souris infectées. Or, l'IFNy est demeuré
indétaetable pendant les 24 heures d'infection. Ceci suggère que les cellules NI< ne sont pas
impliquées dans le processus d'éradication de Pseudomonas aeruginosa au cours de la phase
précoce de l'inflammation. Ce qui appuie davantage l'importance du recrutement et de
•
l'activation des neutrophiles dans le phénotype de résistance ou de sensibilité à l'infection.
•
65
Un autre élément important de la défense antibactérienne est le monoxyde d'azote
(NO). Lors d'une infection, ce radical libre est produit par la nitric oride synthase de forme
inductible (iNOS).
Cette enzyme calcium-indépendante (par opposition à la forme
constitutive qui est régulée par la présence de calcium) est présente dans plusieurs types
cellulaires, surtout chez le macrophage de rongeur. La iNOS pennet la synthèse de NO en
quantité importante et ce, sur de longues périodes en réponse aux stimuli cytokiniques
(TNF a, IL.. 1Pet IFNy) et bactériens.
Le rôle que joue le NO dans la défense immunitaire est essentiellement cytotoxique.
La principale caractéristique de ce radical est de pouvoir se lier au fer et expulser celui-ci de
la cellule cible. Cette propriété empêche donc la respiration mitochondriale de la cellule cible
•
en interférant avec les complexes 1 et II de la chaîne de transport des électrons. En retirant
le fer, le NO prive plusieurs enzymes vitales de leur cofacteur. C'est le cas de l'aconitase qui
est une enzyme clé du cycle de Krebs, de même que pour la ribonucléoside transférase qui
joue un rôle crucial dans la réplication de l'ADN (MONCADA et al 1991).
Chez les patients atteints de mucoviscidose, le NO a été démontré comme étant un
important médiateur de l'inflammation (FRANCOEUR et a/1995). Toutefois, les travaux
in vitro sur des lignées transformées de cellules épithéliales de patients atteints de
mucoviscidose (PK) ou de sujets nonnaux ont démontré que la production de NO n'était pas
liée à la mutation du CFTR. Toutefois, un relargage spontané de NO par les neutrophiles
pulmonaires de sujets FI< a été observé alors qu'aucun relargage spontané n'a été observé
•
chez les neutrohiles du sang périphérique de ces mêmes patients. Ceci suggérait donc que le
relargage de NO provenait de l'activation des neutrophiles localisés dans les poumons FK.
•
66
Au cours de cette même étude, il a été démontré qu'une souche clinique de la bactérie
Pseudomonas aeruginosa induit des quantités importantes de NO par les neutrophiles
périphériques exposés à la bactérie. Pseudomonas aeruginosa s'est par ailleurs montré un
meilleur inducteur de NO que la bactérie Escherichia coli chez les cellules épithéliales et les
neutrophiles (FRANCOEUR et al 1995). De plus, MALAVISTA et al (1992) ont rapporté
que la production de NO par le neutrophile humain avait un important pouvoir bactéricide sur
la bactérie Staphyloccocus aureus colonisant fréquemment les voies respiratoires des patients
FK. Ceci suggère que le NO pourrait constituer un mécanisme de défense de l'hôte contre
les infections pulmonaires dans les cas de mucoviscidose.
Dans notre modèle m~ nous avons donc vérifié si le NO pouvait être induit par la
•
présence dePseudomonas et si la production d'un tel radical libre constituait un mécanisme
important dans l'établissement d'un phénotype de résistance à l'infection. Par la méthode
calorimétrique de la réaction de Greiss, les dérivés oxydatifs du NO ont été mesurés dans les
homogénats de poumons complets après infection.
Étonnemment, les résultats montrent clairement que la présence de la bactérie tsmPA
n'induit pas de production substantielle de NO. La production constante et faible (moins de
la ~ observée semble donc dérivée de l'activité de la forme constitutive de NOS. En effet,
cette enzyme présente dans l'endothélium vasculaire permet un relargage régulier de petites
quantités de NO. Son effet physiologique pennet une relaxation vasculaire et diminue
l'aggrégation plaquettaire évitant ainsi la nécrose tissulaire et protégeant le tissu contre l'effet
•
dévastateur du TNFa (MONCADAet ai 1991). Cette hypothèse aurait pu être confinnée
par la mesure de l'expression des fonnes inductible et constitutive de la NOS par Western
•
67
Blot. Toutefois, ces travaux n'ont pas été jugés nécessaires pour la détermination du profil
inflammatoire responsable du phénotype de résistance puisqu'aucune variation significative
du métabolite actifn'a été détecté.
Le TNF et est un important inducteur de chimiokines telles que le monocyte
chemoattractantprotein -1 (MCP-1) (GORDON etaJ 1992, HANAZAWA et al 1993,1994,
SA1RIANO et a/1993, PINO et al 1997). Le MCP-l est une chimiokine de type C-C qui
agit notamment sur les monocytes mais pas sur les neutrophiles (YOSHIMURA et al 1989,
MATSUSffiMA et al 1989, VALENTE et a/198S). Le MCP-l est aussi connu pour avoir
un effet chimiotaetique sur les cellules NI< (ALLAVENA et al 1994, TAUB et al 1995) et
possiblement sur les cellules dendritiques (XU et al 1992).
•
Chez l'humain, le MCP-I est co-induit avec l'interieukine-8 (IL-8) qui sont les
principaux agents chimiotaetiques pour le macrophage. Chez la souris, bien que le récepteur
d'IL-S ait été trouvé, on n'a pas démontré la présence d'IL-8 murin.
n a été proposé que le
gène humain MCP-1 serait l'homologue du gène JE chez la souris (ROLLINS et al 1988) et
ne serait chimiotaetique que pour le macrophage.
Plusieurs travaux ont déjà rapporté de fortes quantités de MCP-l produit au site
d'inflammation associées à un important recrutement de monocytes lors de maladies autoimmunes (YLA-HERITUALA et a/1991, KOCH et a/1992). De récents travaux ont
également démontré que le MCP-I peut être efficacement induit par un stimulus bactérien
(PATERSON et a/1992, JIANG et a/1996) dans des cellules non-immunes telles que les
•
kératinocytes, les fibroblastes et les cellules endothéliales (ORAVES et al 1995). De plus, OU
et collaborateurs (1997) suggéraient que ('activation du récepteur de MCP-l était nécessaire
•
68
pour une bactéricidie ou un recrutement des leucocytes efficace au site de l'infection. Ceci
nous a donc amenés à vérifier si une déficience de MCP-l, possiblement induit par le TNPa,
pouvait être un des responsables du phénotype de sensibilité des souris DBA/2.
Toutefois, dans le modèle que nous avons utilisé, la bactérie gram négative
Pseudomonas aeruginosa n'induit pas le relargage de MCP-l ni chez la souris résistante, ni
chez la souris sensible.. De tels résultats pourraient s'expliquer par le fait que le MCP-l est
plus couramment associé à la réponse immunitaire contre une infection chronique mais peu
impliqué lors d'une réponse inflammatoire aiguë (JIANG et al 1996). En effet, comme il a
été mentionné précédemment, le MCP-I est un agent chimiotactique efficace pour le
macrophage.
•
Or, dans notre modèle d'infection pulmonaire murin le macrophage
inflammatoire n'est recruté que vers le jour 3 de l'infection (MORRISSETTE et a/1995).
n est donc probable que le MCP-l puisse être produit et reIargué au site de l'inflammation
qu'après les 24 premières heures de l'infection.
Cependant, si le recrutement des
macrophages est associé à une production de MCP-l, le recrutement des neutrophiles est
assuré, chez l'humain, par l'IL-S (GU et al 1997) . Or, chez la souris, bien que le récepteur
de l' IL..8 soit exprimé, le ligand n'a pas pu être détecté. Toutefois, le macrophage
inflammatory protein-2 (MIP-2) est reconnu pour être le pendant murio de l'll.,-S et donc
d'exercer une activité chimiotaetique sur le neutrophile (GREENBERGER et a/ 1996,
SCHALL et al 1994, SCHMAL et al 1996). Le MIP-2 peut lier un homologue du récepteur
murin d,IL-8 de type B avec une haute affinité (RANES et a/199S). La présence de fortes
•
concentrations de TNFex et d'll..-S dans les LBA et les expectorations de patients
FI(
(BONFIELD et al 1995, FRANCOEUR et al 1995, KHAN et al 1995, BEDARD et al
•
69
1993), a pennis de suspecter la production de MIP-2 chez la souris lors d'une infection
pulmonaire àPseudomonasaeruginosa. C'est d'ailleurs ce qu'ont pu démontrer HANES et
collaborateurs (1998) après avoir exposé des souris C57BU6 à des aérosols répétés de
Pseudomonas aeruginosa. L'expression compartimentalisée de MIP-2 a ainsi pennis un
important influx neutrophilique dans les poumons. De plus, le TNP (X induit une augmentation
de MIP-2 chez les souris CBA/J infectées par voie ïntra-trachéale par Klebsiella pneumoniae
(LAICHALK et al 1998).
TI est donc fort probable que le recrutement neutrophilique observé dans notre modèle
d'inflammation aiguë puisse être contrôlé par l'expression de MIP-2. De plus, nous pouvons
poser l'hypothèse que le phénotype de sensibilité à l'infection ne soit pas lié à une déficience
•
majeure de la production de MlP-2 puisque l'on pouvait améliorer l'influx des PMNs dans
les poumons par un traitement au TNFa au moment de l'infection. Ainsi, le TNFa peut
contrôler le recrutement des PMNs soit en augmentant l'expression des molécules d'adhésion,
soit en induisant la production de la chimiokine MIP-2. Récemment, une nouvelle chimiokine
a été clonée chez la souris; la lipopolysaccharide-induced CXC chemokine (LIX). Cette
chimiokine de la fanùlle des CXC agirait sur les neutrophiles et son action serait légèrement
plus tardive que celle de rvfIP-2 (SMITH et al 1995, ROYAI et al 1998). LIX et MIP-2
seraient tous deux exprimés dans les macrophages bien que les macrophages alvéolaires
n'expriment :MIP-2 que faiblement en présence de LPS. Ainsi, l'action de LIX et NIP-2 ne
seraient pas redondantes dans le sens où LPS activerait préférentiellement LIX alors qu'un
•
stimulus cytokinique activerait davantage la production de MIP-2 (ROYAI et al 1998).
•
70
Les résultats du tableau 2 montrent que malgré une amélioration du recrutement des
PMNs dans les poumons, l'activité bactéricide des leucocytes n'est pas augmentée par le
traitement au TNFŒ. Ceci suggère donc une déficience de l'activation des neutrophiles. Dans
un premier temps, l'IL.. 6 a été étudiée puisque cette cytokine est connue pour jouer un rôle
important dans l'activation du neutrophile (BIFL et al 1996). Or, il ne semble pas que l'IL...6
puisse expliquer la sensibilité des souris OBA/2 à Pseudomonas aeruginosa puisque la
présence de la bactérie ne réussit pas à induire efficacement la production de cette cytokine
en moins de 24 heures. Toutefois, il pourrait être intéressant d'étudier l'expression de l'IL-6
après 24 heures d'infection puisque 1'IL-6 peut réguler l'expression de MIP-I ct jouant un rôle
dans le recrutement des macrophages inflammatoires (SMITH et al 1998). Ainsi donc, si
•
1'IL-6 ne joue pas un rôle direct dans l'apparition du phénotype de sensibilité ou de résistance
en phase précoce, il n'est pas exclu qu'il le soit plus tardivement.
Par aillleurs, on peut également suspecter que les neutrophiles recrutés au site de
l'inflammation chez les souris sensibles soient déjà sénescents, ou qu'ils entrent rapidement
en apoptose. On sait que le granulocyte-macrophages-colony stimulatingfactor (GM-CSF)
induit le recrutement des phagocytes au site de l'infection en augmentant l'expression des
molécules d'adhésion COll/COlS (DALE et al 1998). Mais ce qui est particulièrement
intéressant en regard des résultats préliminaires obtenus au cours de notre étude est que le
GM-eSF assure une protection contre l'apoptose chez le neutrophile. En effet, des travaux
récents ont montré que le GM...CSF inhibait l'apoptose induite par la voie de Fas. Le
•
neutrophile continue ainsi à subir la stimulation par les cytokineâ pro-inflammatoires ainsi que
par le LPS et à produire des superoxides et des protéases pennettant la défense de l'hôte
•
71
contre l'invasion de microorganismes (HU et al 1997, GASMI et a/1996). Dans une autre
étude, le GM-CSF a montré un potentiel activateur pour l'expression de la caspase-l, aussi
appelée l'IL-Ipconverting enzyme (ICE) chez le neutrophile humain. Le clivage du pro-ILl ppar la caspase retarde ainsi la mort cellulaire programmée. L'inhibition de l'IL-l P prévient
le délai de l'apoptose (WllLIAMS et 0/1998). Selon les résultats préliminaires obtenus on
peut poser l'hypothèse que l'expression précoce de GM-CSF a8Ïrait donc sur la synthèse de
l'IL-l de manière à protéger le neutrophile de l'apoptose, conférant ainsi un caractère
résistant chez la souris BALB/c. Une activation prolongée des neutrophiles permettrait ainsi
une éradication plus efficace de l'infection.
De plus, des souris congéniques ont été caractérisées selon leur résistance ou leur
•
seOSlbilité à une infection endobronchique à Pseudomonas aeruginosa. Ces souris de nature
résistantes ont reçu un segment de gène des souris sensibles DBA/2, permettant ainsi de
déterminer quelle région génomique contient les gènes responsables de ce phénotype de
sensibilité. Une seule série de congéniques, CD.2, ont montré un caractère de sensibilité
(données non montrées) à Pseudomonas aeruginosa. Or, lorsque l'on examine la carte
génétique de la CD.2, on note que le gène Fas/ provenant de la lignée DBA/2 est présent dans
la région lq23-q25.1. Ce qui semble appuyer l'hypothèse d'une apoptose qui ne pourrait pas
être régulée négativement en absence de GM..CSF.
Une autre hypothèse pouvant expliquer la sensibilité des souris DBAl2 aurait été une
surexpression des cytokines anti-inflammatoires. En effet, le gène IL-JO de la souris DBA/2
•
ayant été transféré à la souris congénique CO.2, il était donc possible que l'IL-I0 ait été
surexprimé, inhibant ainsi le TNFa, l'IL-lp et le GM-CSF et diminuant donc le recrutement
•
72
des neutrophiles en inhibant l'expression des molécules d'adhésion (MULLIGAN et al 1993a,
1993b, 1997) et en empêchant le retard de la mort cellulaire programmée. Selon les travaux
de MULLIGAN et collaborateurs, l'n..-l0 protégerait les poumons contre les dommages
tissulaires associés à une forte inflammation et au dépôt de complexes immuns.
Contrairement à ce que nous attendions, la bactérie Pseudomonas aeruginosa n'a pas
induit de relargage d'IL-IO dans le tissu pulmonaire des souris sensibles DBAl2 mais semble
avoir induit l'expression d'IL-lOchez la souris résistante BALB/2.
n est donc possible que
l'IL-IO ait été produit chez la souris BALB/e en réponse au TNFa de manière à protéger le
tissu pulmonaire d'une réaction inflammatoire excessive. (VALLEY et 0/1996). Certaines
études ont montré que l'IL-IO pouvait s'avérer un excellent traitement contre le choc septique
•
causé par une baetérémie post-chirurgica1e (VAN DER POLL et al 1995, KATO et al 1995)
ou pour augmenter la survie des animaux à qui on avait administré une souche de
Streptoccocus du groupe B (CUSUMANO et al 1996). Toutefois, l'IL-l 0 ne s'est pas avéré
efficace contre les infection à Klebsie/Ja ou Streptoccocus pneumoniae (GREENBERGER
etai 1995, VANDERPOLL etai 1996). Fait intéressant, le groupe de SAWA (1997, 1998)
a trouvé que seules les souches de Pseudomonas aeroginosa produisant des exotoxines ayant
un pouvoir cytotoxique pouvaient induire la production d'IL-IO dans le poumon de souris
BALB/c. De plus, l'administration d'IL-IO exogène augmentait la survie des souris infectées
avec des doses léthales de Pseudomonas de souches cytotoxiques. De plus, il a été démontré
que les cellules épithéliales bronchiques et alvéolaires des patients atteints de mucoviscidose
•
présentent une déficience dans la production d'IL-IO (BONFIELD et al 1995a, 1995b). il
est donc probable que le gène codant pour l'IL-ID de la souris DBA/2 soit déficient et
•
73
diminue ainsi la protection du tissu pulmonaire contre les aggressions de la bactérie
Pseudomonas aeruginosa.
Quant à l'IL-4, produite par les mastocytes lors d'une infection bactérienne (MARIE
et al 1997), son effet anti-inflammatoire a été démontré chez la souris lors d'une péritonite
aiguë (SAWYER, et al 1996) et chez le rat lors d'une induction d'une arthrite expérimentale
par un streptocoque (ALLEN et al 1993). L'll..-4 peut également inhiber l'expression des
molécules d'adhésion ICAM-l et ELAM-l induite par l'IL-l et le TNP (THORNHILL et al
1990).
Nous avons donc vérifié l'implication probable de l'IL-4 dans le délai de recrutement
des neutrophiles au site inflammatoire et l'absence de TNFa chez les souris sensibles DBA/2.
Or, les résultats ne montrent aucune production significative d'IL-4 en phase précoce de
•
l'inflammation. TI est probable que l'absence de cellules T à ce stade de l'infection et qui sont
généralement la principale source d'IL-4 puisse expliquer ce résultat.
En effet, il est possible que la production d'll-4 par les mastocytes ne puisse pas être induite
directement pas un stimulus bactérien.
Il faut cependant soulever le fait que si la résistance peut être expliquée par une
meilleure induction du TNFa, de l'IL-lp, du GM..CSF et de l'IL-ID chez la souris, ces
résultats ne pourraient être extrapolés chez l'humain.
En effet, des protéines anti..
microbiennes, les ~-défensines, ont été récemment isolées dans plusieurs tissus humains
(BENSCH et al 1995, GOLDMAN et al 1997, MCCRAY et al 1997, ZHAN et al 1996).
il a été suggéré qu'une déficience des protéines anti-microbiennes sensibles aux fortes
•
concentrations de sel ait pu être impliquée dans l'établissement d'infections pulmonaires des
patients FK (GOLDMAN et al 1997, SMITH et al 1996). Toutefois, le modèle murin ne
•
74
pennet pas d'étudier l'implication des défensines dans l'issue de l'infection à Pseudomonas
aeruginosa. Bien que les défensines aient pu être isolées dans certains tissus comme les
cellules épithéliales de l'intestin (EISENBAUER et al 1992a, HUITNER et al 1994,
OUELLETfE et al 1994, 1992, TARVER et al 1998) et du tractus urogénital (BALS et al
1998), les neutrophiles murins, quant à eux, n'en expriment pas (EISENBAUER et al 1992b).
Toutefois, même si l'implication des défensines dans la défense de l'hôte dans les cas de
mucoviscidose est de plus en plus évidente (BALS et aI1998), il n'en demeure pas moins que
le profil inflammatoire peut jouer un rôle dans l'intensité et la cinétique de la réponse à
l'infection. De plus, dans les cas de pneumonies nosocomiales dans lesquelles aucune
déficience du transport ionique ne peut expliquer une altération des défensines, l'implication
•
•
des cytokines pro-inflammatoires, des chimiokines et de l'IL·IO dans l'éradication de
l'infection demeure un filon d'étude intéressant.
•
75
CONCLUSION
Au terme de cette étude, nous avons pu mettre en lumière au moins deux événements
angulaires dans la réponse inflammatoire aiguë à l'infection endobronchique à Pseudomonas
aeruginosa, chez la souris. Dans un premier temps, au niveau de la réponse cellulaire, le
neutrophile est le principal phagocyte responsable de la première défense contre la bactérie.
Ensuite, le recrutement dans l'espace alvéolaire et la capacité du neutrophile à tuer
Pseudomonas efficacement dépendent d'une série d'événements découlant de l'expression
du TNF Πdans le tissu pulmonaire.
•
Bien que tous les événements envisagés n'aient pu être démontrés clairement, nous
pouvons toutefois suggérer la séquence suivante. Selon les résultats obtenus lors des études
des facteurs cytokiniques, il semble que, chez la souris résistante, la bactérie induise
rapidement le GM-CSF et l'IL-lp. Ces deux cytokines agiraient en synergie pour favoriser
un retard de l'apoptose par la voie de Fas. L'IL-IP et le TNFa induisent ensuite un
recrutement des neutrophiles vraisemblablement par l'augmentation de l'expression des
molécules d'adhésion et de MIP-2. Plus tard, l'augmentation de l'expression de MCP-I par
le TNFa pennettra le recrutement des macrophages inflammatoires. En réponse à une forte
production de TNFa, l'expression de l'IL-LÜ est augmentée et assure une meilleure intégrité
du tissu pulmonaire et des phagocytes en les protégeant contre les exotoxines de
•
Pseudomonas (Figure 14 illustre la cascade hypothétique des événements menant à la
résistance de l'hôte).
•
76
La sensibilité génétique des souris DBA/2 pourrait être liée à un déficience dans la
production de TNFŒ mais puisque le traitement des souris sensibles avec une source exogène
de TNFa; ne rétablit pas le phénotype de résistance, on peut penser que d'autres déficiences
génétiques auraient un effet additif. Les résultats du présent travail laissent penser à une
déficience de l'expression du GM-CSF conduisant ainsi à une apoptose prématurée des
neutrophiles. Les résultats laissent également croire à une production déficiente d'IL-IO chez
les animaux sensibles. Les neutrophiles n'étant pas protégés contre les effets cytotoxiques
de Pseudomonas seraient donc plus rapidement sénescents.
Une étude plus approfondie de ces trois dernières cytokines pourrait permettre de
•
lever le voile sur des mécanismes importants dans la résistance et la sensiblité aux infections
pulmonaires à Pseudomonas. Ces facteurs pourraient ainsi devenir des cibles thérapeutiques
intéressantes non seulement pour les patients FI< mais également pour le traitement de
pneumonies nosocomiales à Pseudomonas dont les patients répondent mal aux traitements
antibiotiques.
•
•
77
--
\
MCP-l
recrutement
NEUfROPHIT,ES
recrutement
MACROPHAGES
GM-CSF
•
proted:lon
inhibition de
l'apoptœe
NEumOPH l',ES
Figure 14. Représentation schematique du mécanisme de défense pulmonaire contre
Pseudonwnas aeruginosa. La bactérie Pseudomonas aeruginosa cPA) induit la production
d'ILr1 qui synergise avec le l'NF pour provoquer le recrutement des neutrophiles via l'action
du MIP-2 et, plus tardivement, des macrophages via la sécrétion de MCP... l. Les phagocytes
sont protégés des effets cytotoxiques des exotoxines par la production d'IL...IO induites par
le TNF. Le GM-CSF pennet le délai de l'activation des gènes apoptotiques (voie de Fas) et
assure ainsi une activation soutenue des neutrophiles.
•
•
78
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier ma directrice de thèse, Ore Francine Gervais de m'avoir accueillie
dans son laboratoire et de m'avoir permis d'acquérir des connaissances relatives à
l'expérimentation sur un modèle munn.
Je remercie également Mlle Vasiliki Caouras, Mme Corinne Darmond-Zwaig et M.
Hugues Lacoste pour leur soutien technique de même que Ore Céline Morrissette pour ses
judicieux conseils.
Merci aux Ores Jacqueline Lagacé qui a gratieusement fournie la souche de
Pseudomonas aeruginosa 508, Anne Morris-Hooke pour la souche thermosensible de
Pseudomonas aeroginosa et Mary M. Stevenson pour les anticorps ayant servis à la mesure
du TNF et de l'IFN.
La recherche a été subventionnée en partie par la Fondation Canadienne de la Fibrose
Kystique, notamment par l'attribution d'une bourse d'étude.
•
•
79
•
BmLIOGRAPHIE
- Allavena P, Bianchi G, Zhou D el ai (1994), Induction ofnatural killer cell migration by
monocyte chemotactic protein-l, -2 and -3., Eur. J. Immunol. 24:3233-6
- Allen lB, Wang HL, Costa CL et al (1993), Suppression of monocyte function and
differential regulation of IL-l and IL-l ra by IL-4 contribute to resolution of experirnental
arthritis., 1. Immunol. 151 :4344-51
- Amura C, Fontana PA, Sanjuan N et Sordelli DO, (1994), The effect oftratment with
interleukin-l and tumor necrosis factor on Pseudomonas aeroginosa lung infection in a
granulocytopenic mouse model., Clin. Immunol. Irnmunopathol. 73 :261-6
•
- Bals
~
Goldman Ml et Wilson lM, (1998), Mouse p-defensin 1 is a salt-sensitive
antimicrobial peptide present in epithelia of the lung and urogenital tract., Infect. Immun.
66:1225-32
- Bedard M, McClure CD, Shciller NL et al (1993), Release ofinterleukin-8, interleukin-6
and colony-stimulating factors by upper airway epitheliaI ceIls: implications for cystic fibrosis.,
Am. J. Respir. CeU Mol. Biol. 9:455-62
- Bensch KW, Raida M, Magert HI et al (1995), hBD-l: a novel p-defensin trom human
plasma., FEBS Lett. 368:331-5
- Berger ~ (1991), Inflammation in the lung in cystic fibrosis., Clin. Res. Allergy 9: 119-42
- Berk RS et Hazlett LD, (1983), Further studies on the genetic control ofmurine corneal
reponse to Pseudomonas aeroginosa., Rev. Infect. Dis. 5:S936-40
•
•
80
- Berk ES, Leon MA et Halett LO, (1979), Genetic control of the murine comeal response
to Pseudomonas aeruginosa., Infect. Immun. 26:1221-3
- Bevilacqua MF, Pober JS, Mendrick DL, et al (1987), Identification of an inducible
endothelial-Ieukocyte adhesion molecule., Proc. Nat! Acad. Sei. USA 84:9238-42
- Bevilacqua MP, Stengelin S, Gimbrone MA Ir et Seed B, (1989), Endothetialleukocyte
adhesion molecule 1: an inducible receptor for neutrophils related to complement regulatory
proteins and lectins., Science 243: 1160-5
- Biftl WL, Moore EE, Moore FA et al (1996), Interleukin-6 induces delays neutrophil
apoptosis via a mechanism involving platelet activating factor., 1. Trauma. 40:575-9
.. Bonfield TL, Konstan MW, Burfeind P et al (1995b), Normal branchial epithelial cells
•
constitutively produce the anti..inf1ammatory cytokine interleukin-I 0 which is downregulated
in cystic fibroses., Am. 1. Respir. Cell Mol. Biol. 13:257-61
- Bonfield TL, Panuska JR, Konstan MW et al (1995a), Inflamrnatory cytokines in cystic
fibrosis Iungs., Am. 1. Respir. Crit. Care Med. 152:2111-8
- Bryan CS et Reynolds KL, (1984), Baeteremic nosocomial pneumonia: analysis of 172
single episodes fram one metropolitan area., Am. Rev. Respir. Dis. 129:668-71
- Buret
~
Dunkley ML, Pang G et al (1994), Pulmonary immunity ta Pseudomonas
aeruginosain intestinally immunized rats: raies of alveolar macrophages, tumor necrosis
factor alpha, and interleukin-la., Infect. Immun. 62:5335-43
- Cerquetti, MC, Sordelli DO, Ortegon RA, et al (1986), Lung defenses against Pseudomonas
•
aeruginosa in C5-deficient mice with different genetic backgrounds., Infect. Immun. 52:853..7
•
81
- Cripps MW, Dunkley ML, Clancy RL et Kyd J, (1995), Pulmonary immunity to
Pseudomoas aeruginosa., ImmunoL Cell Biol. 73:418-24
- Crowell RE, Heapty E, Valder C et al (1992), Alveolar and interstitial macrophage
population in the murine lung., Exp. Lung Res. 18:435-46
- Cusumano V, Genovese F, Mancuso G et al (1996), Interleukin-l0 protects neonatal mice
from lethal group B Stroptococcal infection., Infect. Immun. 64:2850-2
- Dale OC, Liles WC, Llewellyn C et Priee TH, (1998), Effects of granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor (GM-CSF) on neutrophil kinetics and function in normal human
volunteers., Am. 1. Hematol. 57:7... 15
.. Dinarello CA, (1984), Interleukin-l., Res. Infect. Dis. 6:51-95
•
- Doerschuk CM, Winn RI<, Cuxsoin HO et Harlan lM, (1990), CDl8-dependent and independent mechanisms of neutropyil emigration in the pulmonary and systemic
microcirculation ofrabbits., J. Immunol. 144:2327..33
- Dunkley ML, Pabst, Ret Cripps AW, (1995), an important role for intestinally dirived T
cells in respiratory defence., Immunol. Today 16:231-6
.. Eisenhauer PB, Harwig SSL et RI Lehrer, (1992a), Cryptdins: antimicrobial defensis of the
murine small intestine., Infect. Immun.60:3556..65
- Eisenhauer PB et RI Lehrer, (1992b), Mouse neutrophils lack defensis., Infect. Immun.
60:3446-7
- Fabregas N, Torres A, EI-Ebiary M et al (1996), Histopathologic and microbiologie aspects
•
ofventilator-associated pneumonia., Anesthesiology 84:160-71
•
82
- Fenton Ml, Clark BD, Collins KL, et al (1987), Transcriptional regulation of the human
prointerleukin-l beta gene., 1. Immunol. 138:3972-9
- Fenton Ml, Vermeulen MW, Clark BD, et al (1988), Human pro-IL-! Pgene expression in
monocytic cells is regulated by two distinct pathways., 1. Irnmunol. 140:2267-73
- Francoeur C et Denis M, (1995), Nitric oxide and interleukin·8 as inflammatory components
of cystic fibrosis., Inflamm. 19:587-98
- Gasmi L, McLennan AG et Edwards SW, (1998), The diadenosine polyphosphates Ap3A
and Ap4A and adenosine triphosphate interaet with granulocyte..macrohage colonystimulating factor to delay neutrophil apoptosis: implications for neutrophil: platelet
interaction during inflanunation., Blood 87:3442..9
•
- Gervais F, Morris-Hooke A, Tran TA, Skamene E, (1986), Analysis of macrophages
bactericidal function in genetically resistant and susceptible mice by using the teperaturesensitive mutant of Listeria monocytogenes. Infect. Immun. 54:315-21
- Gervais F, Stevenson M et Skamene E, (1984), Genetic control of resistance to Listeria
monocytogenes: regulation ofleukocyte inflarnmatory responses by the Hclocus., J. Immunol.
132:2078-83
- Giacomini P, Fisher PB, Duigou GJ, et al (1988), Regulation of class II lvfHC gene
expression by interferons: insights into the mechanism of action of interferon (review).
Anticancer Res. 8: 1153-61
- Goldman MI, Anderson GM, Stolzenberg ED et al (1997), Ruman
•
~~efensin-l
sensitive antibiotic in lung that is inaetivated in cystic fibrosis., CeU 88:553-60
is a salt-
•
83
- Gordon HM, Kucera G, Salvo R et Boss lM, (1992), Tumor necrosis factor induces genes
involved in inflammation, cellular and tissue repair and metabolism in munne fibroblast., 1.
Immnunol. 148:4021-7
- Gosselin D, DeSanetis J, Boulé, M et al (1995), Role of tumor necorsis factor alpha in
innate resistance to mouse pulmonary infection with Pseudomoas aeruginosa., Infect. Immun.
63:3272-8
- Graves DT et Jiang Y, (1995), Chemokines, a family of chemotaetic cytokines., Crit. Rev.
Oral Biol. Med. 6: 109-118
- Greenberger Ml, Strieter RM, Kunkel SL et al (1995), Neutralization ofIL-IO increases
survival in a murine model of Klebsiella pneumonia., J. Immunol. 155:722-9
•
- Greenberger MJ, Strïeter RM, Kunkel SL et al (1996), Neutralization of macrophage
infIammatory protein-2 attenuates neutrophil recruitment and bacterial clearance in murine
Klebsiella pneumonia., 1. Infect. Dis. 173: 159-65
- Gu L, Rutledge B, FiarilIo J et al (1997), ln vivoproperties of monocyte chemoatraetant
protein-l.,1. Leukoc. Biol. 62:577-80
- Hanazawa S, Takeshita A Amano S, et al (1993), Tumor necrosis faetor-Πinduces
expression of monocyte chemoattraetant JE via jos and jun genes in clonai osteoblasteic
MC3T3-El cells., 1. Biol. Chem. 268:9526-32
- Hanazawa S, Takeshita A et Kitano S, (1994), Retinoic acid suppression of c-fos gene
inhibits expression of tumor necrosis factor-alpha-induced monocyte chemoattraetant
•
JE/MCP-l in clonai osteoblastic MC3T3-El., 1. Biol. Chem. 269-21379-84
•
84
- Hanes HY, Chrîsp CE, Boucher Je et Deretic V, (1998), Microbial pathogenesis in cystic
fibrosis: pulmonary clearance of mucoid Pseudomonas aeruginosa and inflammation in a
mouse model ofrepeated respiratory challenge., Infect. Immun. 66:280-8
- Horan TC, White WJ, Jarvis WR et al (1986), Nosocomial infection surveillance 1984.,
CDC Surveillance Summary 32: 188-2988
- Hu B et Yasui K, (1997), Effects of colony-stimulating factors (CSfs) on neutrophil
apoptosis: possible roles at inflammation site., Int.I. Hematol. 66: 179-88
- Huttner KM, Selsted ME et Ouellette Al, (1994), Structure and diversity of the murine
cryptdin gene family., Genooùcs 19:448-53
- Israel A, Le Bail 0, Hatat D, et al (1989), TNF stimulates expression of mouse MHC class
•
1 genes by inducing an NfkB-like enhancer binding activity which displaces constitutive
factors., EMBO 1. 8:3793-800
- Jiang Y, Russell TR, Graves DT et al (1996), Monocyte chemoattractant Protein 1 and
interleukin-8 production in mononuclear ceUs stimulated by oral microorganisms., Infect.
Immun. 64:4450-5
- Johnston RB Jr, (1993), The complement system in host defense and inflammation: the
cutting edges ofa double edged sword., Pediatr. Infect. Dis. 1. 12:933-41
- Kato T, Murata A, Ishida H et al (1995), Interleukin-l0 reduces mortality trom severe
peritonitis in mice., Antimicrob. Agents Chemother. 39: 1336-40
- Khan TZ, Wagener J8, Bost T et al (1995), Early pulmonary inflammation in infants with
•
cystic fibrosis. Am. J. Respir. Crit. Care Mel. 151: 1075-82
•
85
- Kingston AE, Bergsteinsdottir K, Jessen KR et al (1989), Schwann ceUs co-cultured with
stimulated T ceUs and antigen express major histocompatibility complex (MHC) class fi
determinants without interferon-gamma and tumor necrosis factor on MHC class II
induction., Eur. J. Immunol. 19: 177-83
- Klehanoff SI, Vadas MA, Harlan JM et al (1986), Stimulation of neutrophils by tumor
necrosis factor., J. Immunol. 136:4220-5
- Koch AE, Kunkel SL, Harlow JA et al (1992), Enhanced production of monocyte
chemoattraetant protein-l in rheumatoid arthritis., J. Clin. Invest. 90:772-9
- Koch C et Hoiby N, (1993), Pathogenesis of cystic tibrosis., Lancet 341: 1065-9
- Kolls JI(, Nelson S et Summer WR, (1993), Recombinant cytokines and pulmonary host
•
defense., Am. J. Med. Sei. 306:330-5
- KonstanMW et BergerM, (1993), Infection and inflammation ofthe lung in cystic tibrosis.,
in Cystic Fibrosis, PB Davis, éditeur, Marcel Dekker, Inc NY, pp 219-276
- Kuga S, Ostuka T, Niiro H et al (1996), Suppression ofsuperoxide anion production by
interleukin-l0 is accompanied by a downregulation of the genes for submit proteins of
NADPH oxidase., Exp. Hematol. 24: 151-7
- Laichalk LL, Bucknell KA, Hutlhagie GB et al (1998), Intrapulmonary delivery oftumor
necrosis factor agonist peptide augments host defense in murine gram-negative bacterial
pneumonia., Infect. Immun. 66:2822-2826
•
•
86
- Lapierre LA, Fiers W et Pober JS, (1988), Three distinct classes of regulatory cytokines
control endothelial œil MHC antigen expression. Interaction with immune gamma interferon
differentiate the effects of tumor necrosis factor and lymphotoxin from those of leukocyte
alpha and fibroblast beta interferons., 1. Exp. Med. 167:794-804
- Larsen GL, Mitchell Be, Harper TB et al (1982), The pulmonary response ofC5-sufficient
and deficient mice to Pseudomonas aeruginosa., Am. Rev. Respir. Dis. 126:306..11
- Libby P, Ordovas JM, Auger KR et al (1986), Endotoxin and tumor necrosis factor induce
interleukin-l gene expression in adult human vascular endothelial cells., Am. 1. Pathol.
124:179-85
- Malavista SE, Montgomery RR et Van Blaricom G, (1992), Evidence for reactive nitrogen
•
intermediates in killing of staphylococci by human neutrophil cytoplasts., J. Clin. Invest.
90:631-6
- Manogue KR, van Deventer SIR et Cerami, A, (1992), Tumor necrosis factor alpha or
cachectin., in The cytokine Handbook, Angus Thomson, éditeur, Academie Press, USA pp
241-56.
- Marie C et Cavaillon lM, (1997), Le rétrocontrôle négatif de l'inflammation: rôle des
cytokines atünflammatoires., Bull. Inst. Pasteur 95 :41-54
- Martin DW, Shurr MI, Mudd MIl, et al (1993), Mechanism ofconversion to mucoidy in
Pseudomonas aeruginosa infeeting cystic fibrosis patients., Proc. Nad Acad. Sei. USA
90:8377-81
•
•
87
- Matsushina K, Larsen CG, DuBois Ge et Oppenheim JJ (1989), Purification and
characterization ofa novel monocyte chemotactic and activating factor produced by a human
myelomonocytic cellligne., J. Exp. Merl. 169: 1485-90
- McCray PB et Bently L, (1997), Ruman airway epithelia express a p-defensin., Am. 1.
Respir. Cell Mol. Biol. 16:343-9
- Moncada S, Palmer RMJ et Higgs E~ (1991), Nitric oxide: physiology, pathophysiology
and phannacology., Pharmacol. Rev. 43: 109-42
- Morris-Hooke,
~
Sordelli D0, Cerquetti MC et Bellanti JA, (1987), Differentiai growth
caracteristics and immunogenicity of tight and coasting temperature-sensitive mutants of
Pseudomonas aeroginosa., Infect. Immun. 55 :99-1 03
•
- Morissette C, Francoeur C, Darmond-Zwaig C et Gervais F, (1996), Lung phagocyte
baetericidal function in strains ofmice resistant and susceptible to Pseudomonas aeruginosa.,
Infect. Immun. 64:4984.92
- Morissette C, Skamene E et Gervais F, (1995), Endobronchial inflammation following
Pseudomonas aeroginosa infection in resistant and susceptible strians of mice., Infect.
Immun. 63: 1718-24
- Mulligan MS, Jones ML, Vaporciyan AAet al (1993), Protective effects ofIL-4 and IL-I0
against immune complex-induced lung injury., 1. Immunol. 151 :5666-74
- Mulligan MS, Vaporciyan ~ Miyasaka M et al (1993), Turnor necrosis factor et regulates
in vivo intrapulmonary expression ofICAM..1., Am. J. Pathol. 142:1739-49
•
- Mulligan MS, Warner RL, Foreback JL et al (1997), Protective effets ofIL-4, IL-! 0, IL-12
and IL-13 in IgG immune complex-induced lung injury., 1. Immunol 159:3483-9
•
88
- Niiro H, Otsuka T, Tanabe T et al (1995}, Inhibition by interleukin-l0 of inducible
cyclooxygenase expression in Iipopolysaccharide...stimulated monocytes: its underlying
mechanism in comparison with interleukin-4. Blood 85:3736-3745
- OgIe CI<, Wu Jz, Mao X et al (1994), Heterogeneity ofKupffer cells and splenic aIveolar,
and peritoneal macrophages for the production ofTNF, IL-l and fi..-6. Inflammation
13:511...23
- Ohno A., Myazaki S, Tateda K, et al (1992), The study ofpathogenic mechanism of chronie
Pseudomonas aeroginosa lung infections by mucoid strains., J. Jpn. Assoc. Infect. Dis.
66:407-15
- Ouellette Al, Hsieh MM, Nosek MT et al (1994), Mouse Paneth cell defensins: prirnary
•
structures and antibacterial activities of numerous cryptdin isoform., Infect. Immun.
62:5040-7
- Ouellette Al, Miller SI, Henschen AH et Selsted ME, (1992), Purification and prirnary
structure ofmurine cryptdin-l, a Paneth cell defensin., FEBS Lett. 304: 146-8
- Paterson
Re et Watts ~ (1992), Pulp responses to two strains ofbaeteria isolated from
human carious dentine (L. Plantarum) (NCTC 1406) and S. mlltans (NCTC 10919)., Int.
Endod. J. 25:134-41
... Pedersen SS (1992), Lung infection with aIginate-producing, mucoid Pseudomonas
aeruginosa in cystic fibrosis., Acta Pathol. Microbiol. Immunol. Scand. Suppl. 28:1-79
- Pennington JE et Williams RM, (1979), Influence of genetic factors on natural resistance
•
of mice to Pseudomonas aenlginosa., J. Infect. Dis., 139:396-400
•
89
- Pheng LH, Francoeur C et Denis M, (1995), The involvement of nitric oxide in a muse
model ofadult resprratory distress syndrome., Inflamm. 19:599-610
- Pier GB, Saunders lM, Ames P et al (1987) Opsonomphagocytic killing antibody to
Pseudomonas aeruginosa mucoid exolplysaccharide in older non-colonized patients with
cystic fibrosis., N. Engl. 1. Med. 31 :793-8
- Pier GB, Small GJ et Warren RB, (1990), Protection against mucoid Pseudomonas
aeroginosa in rodent models of endobronchial infections., Science 249:537-40
- Pierangeli SS et Sommenfeld G, (1993), Treatment ofmurine macrophages withe murine
interferon-gamma and tumor necrosis factor-alpha enhances uptake and intracelluJar killing
of Pseudomonas aenlginosa., Clin. Exp. Immunol. 93:165-71
•
- Ping D, Jones PL et Boss JM, (1996), TNF regulates the in vivo occupancy ofboth distal
and proximal regulatory regions ofthe MCP-l/JE gene., Irnrnunity 4:455-69
- Preston MJ, Kernacki
~
Berk JM et al (1992), Kinetics of serum, tear, and comeal
antibody responses in resistant dans susceptible mice intracomeally infected with
Pseudomonas aeruginosa., Infect. Immun. 60:885-91
- Remick DG, Nguyen DT, Eskandari MI<, et al (1989), Cyclosporine A inhibits TNF
production without decrasing TNFa rnRNA levels., Biochem. Biophys. Res. Comm.,
161:551-555
- Robinson E~ Yoshiura T, Leonard EJ, et al (1989), Complete amino acid sequence ofa
human monocyte chemoattraetant, a putative mediator of cellular immune reaetions., Proc.
•
Nad Acad. Sci. USA, 86: 1850-4
•
90
- Rollins BI, (1991), JFlMCP-l: an early-response gene encodes a monocyte-specifie
cytokine., Cancer Cell 3:517-24
- Rouby IJ (1996), Nosocomial infection in the critically iD. The lung as a target organ.,
Anesthsiology 84:757-9
.. Rovai LE, Herschman HR et Smith lB, (1998), The murine neutrophil..chemoattractant
chemokine LIX, KC, and MIP-2 have distinct induction kinetics, tissue distributions, and
tissue-specifie sensitivities to glucocorticoid regulation in endotoxemia., J. Leukoc. Biol.
64:494-502
.. Samano JA, Hora K, Shan Z et al (1993), Regulation ofmonocyte chemoattractant protein1and macrophage colony-stimulating factor-1 by IFN-gamma, tumor necrosis factor-alpha,
•
IgG aggragates, and cAMP in mouse mesangial celIs., 1. Immuno!. 150:1971 ..8
- Sawa T, Corry DB, Gropper MA et al (1997), ll..-10 improves lung injury and survival in
Pseudomonas aeruginosa pneumonia., 1. Immuno!. 159:2858-66
- Sawa T, Ohaca M, Kurahashi K et al (1998), In vitro cellular toxicity predicts Pseudomonas
aeruginosa virulence in lung infections., Infect. Immun. 66:3242-3249
- Sawyer RG, RosenlofLK et Pruett 1L, (1986), Interleukin-4 prevents mortality from acute
but not chronie mUTine peritonitis and induces an accelerated TNF resopnse., Eur. Surg. Res.
28:119-23.
- Schall TJ (1994), The chemokines., in The cytokine Handbook 2nd ed., Thomas AW,
éditeur, Academie Press, San Diego CA, pp 419-460
•
•
91
- Schindler R, Clark BD et Dinarello C~ (1990a), Dissociation between interleukin-l beta
mRNA and protein synthesis in human peripheral blood mononuclear ceUs., J. Biol. Chem.
265: 10232-7
- Schindler R, Ghezzi Pet Dinarello CA, (1990b), IL-l induces IL-l. IV. IFNy suppresses
IL-l but not lipopolysaccharide-induced transcription of IL-l., J. Immunol. 144:2216-22
- Schmal IL Shanley TP, Jones ML et al (1996), Role for macrophage inflammatory protein-2
in lipopolysaccharide-induced lung injury in rats., 1. Immunol. 156: 1963-72
.. Smith JB et Hersclunan HR (1995), Glucocorticoid-attenuated response genes encode
intercellular mediators, including a new C-X-C chemokine. J. Biol. Chem. 270: 16756-65
- Smith D, Travis SM, Greenberger EP et Welsh Ml, (1996), Cystic flbrosis airway epithelia
•
fail to kill bacteria because of abnonnaI airway surface fluid., Cell 85:229-36
- Smith RE, Strieter RM, Phan SR, et al (1998), TNF and IL-6 mediate MIP-l ex expression
in bleomycin-induced lung injury., 1. Leukoc. Biol. 64: 528-36
- Sordelli DO, Cerquetti MC, Bellanti JA et al (1987), Specifie pulmonary defense against
Pseudomonas aeroginosa after local immunization with temperature-sensitive mutants., J.
Gen. Microbiol. 133: 2835-41
- Sordelli DO, Cerquetti MC, EI-Tawil G et al (1985), Ibuprofen modifies the inflammatory
response of the murine lung ta Pseudomonas aeroginosa., Eur. J. Respir. Dis. 67: 118-27
- Starke JR, Edwards MS, Langston C et Baker C, (1987), A mouse model of chronic
pulmonary infection with Pseudomonas aenlginosa and Pseudomonas cepacia, Pediatr. Res.
•
22:698-702
•
92
- Stemme S, Fager G et Hansson GK, (1990), MHC class II antigen expression in human
vascular smooth muscle cells is induced by interferon-gamma and modulated by tumor
necrosis factor and lymphotoxin., Immunology 69: 243-9
- Tang WW, Yi ES, Remick DG et al (1995), Intratracheal injection of endotoxin and
cytokines. IX. Contribution ofCD11aJICAM-1 to neutrophil emigration., Lung Cell. Mol.
Physiol. 13 :L653-9
- Tarver AP, Clark DP, Diamond G et al (1998), Enteric p-defensin: molecular cloning and
characterization of a gene with inducible intestinal epithelial cell expression associated with
Cryptosporidium parvum infection., Infect. Immun. 66: 1045-56
- Taub DO, SayerTJ, Carter CR et Ortaldo JR, (1995),
•
(X
and
Pchemokines induce NI< cell
migration and enhance NK-mediated cytolysis., 1. Immunol. 155:3877-88
- te Velde AA, Huijbens RJF, Heije K, et al (1990), Interleukin-4 (IL-4 inhibits secretion of
IL-lp, tumor necrosis factor-a and IL-6 by human monocytes. Blood 76:1392-1397
- Thornhill, ~ et Haskard DO, (1990), rr.,-4 regulates endothelial cell activation by IL-l,
tumor necrosis facto, or IFN-gamma., J. Immunol. 145:865-72
- Torres A, Azmar R, Gatell JM et al (1990), Incidence, risk and prognosis factos of
nosocomial pneumonai in mechanically ventilated patiens., Am. Rev. Repir. Dis. 142:523-8
- Valente JA, Graves DT, Vialle-Valentin CE et al (1988), Purification of a monocyte
chemotactic factor secreted by nonhuman primate vascular cells in culture., Biochem.
27:4162-4168
•
- Van der Poli T, Marchant A. Buurman WA et al (1995), Exogenous IL-ID protects mice
from death during septic peritonitis., J. Immunol. 155:5397-401
•
93
- Van der Poli T, Marchant A, Keogh CV et al (1996), Interleukin-l0 impairs hostdefense in
murine Pneumococcal pneumonia., J. Infect. Dis. 174:994-1000
- Van Furth R, Van Zwet TL, Buisman A' et Van Oissel IT, (1994), Anti-tumor necrosis
factor antibodies inhibit the influx of granulocytes and monocytes into an infalmmatory
exudate and enhance the growth of Listeria monocytogenes in various organs., 1. Infect. Dis.
170:234-7
- Walley KR, Lukacs NW, Stnadiford Tl et al (1996), Balance ofinflarnmatory cytokines
related to severity and mortality ofmurine sepsis., Infect. Immun. 64:4733-8
- William ~ Watson G, Rotstein on et al (1998), The IL...1p-converting enzyme (caspase-l)
inhibits apoptosis of inflammatory neutrophils through activation of IL-l p., 1. Immunol.
•
161:957-62
... Woods, DE, Sakol PA, Bryan LE et al (1991), ln vivo regulation of virulence in
Pseudomonas aeruginosa axxociated with genetic rearrangement., J. Infect. Dis. 163: 143...9
- Xu P, Reddigari SR, Rucinski D et al (1992), Monocyte chemotactic and activating factor
is a patent histamine-releasing gactor for human basophils. 1. Exp. Merl. 175:489-93
- Yla-Hertuala S, Lipton BA, Rosenfeld lv1E, et al (1991), Expression of monocyte
ehemoattractant protein-l in maerophage..rich areas of human and rabbit atherosclerosis
lesions., Proe. Nad Acad. Sei. USA 88:5252..6
- Yoshimura T, Robinson EA, Tanaka S et al (1989), Purification an amino aeid analysis of
two human glioma-derived monocyte ehemoattraetants., 1. Exp. Merl. 169: 1449-59
•
94
- Yoshimura T, Yuhki N, Moore SK, et al, (1989), Human monocyte cemoattractant protein1 (MCP-I). Full-Iength cDNA cloning, expression in mitogen-stimulated blood mononuclear
leukocytes, and sequence similarity to mouse competence gene JE., FEBS Letters
244: 487-93
- Zhao C, \Vang 1 et Lehrer RI, (1996), Widespread expression ofbeta-defensin hBD-l in
human secretory glands and epithelial ceUs., FEBS Lett. 396:319-22
- Zlotnik A, Vatter A, Hayes RL et al (1982), Mouse pleural macropyages characterization
and comparison with mouse aJveolar and peritoneal macrophages., RES J. Reticuloendothel.
Soc. 31:207..20