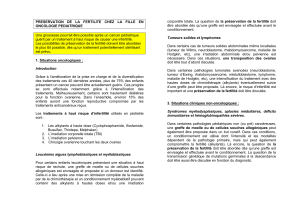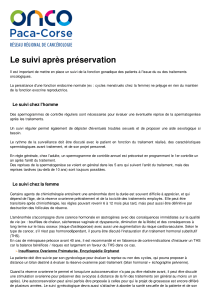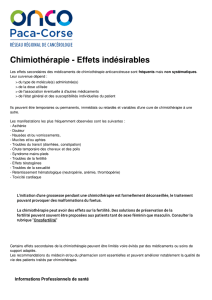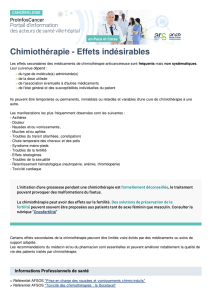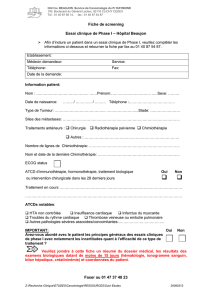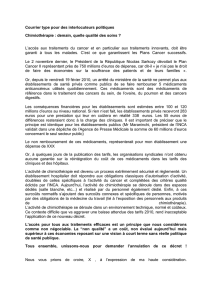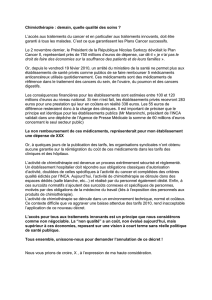Effets à long terme sur la fonction gonadique des chimiothérapies

Mini-revue
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2012 ; 14 (2) : 69-76
Effets à long terme sur la fonction
gonadique des chimiothérapies
administrées chez l’enfant
Long-term effects of chemotherapy on gonadic function in children
Frédérique Duquesne1
Jean-Hugues Dalle2
1Hôpital Robert-Debré,
service d’hémato-immunologie,
48, boulevard Serrurier,
75019 Paris,
France
2Hôpital Robert-Debré,
université Paris VII - Denis-Diderot,
service d’hémato-immunologie,
48, boulevard Serrurier,
75019 Paris,
France
Résumé. L’amélioration de la survie des enfants atteints de cancer doit faire prendre en compte
les effets à long terme des thérapeutiques anticancéreuses, notamment sur la fonction gona-
dique. Le risque d’atteinte gonadique après traitement chimiothérapique pour cancer chez
l’enfant est variable suivant le patient (sexe, âge), le type de chimiothérapie et la patholo-
gie sous-jacente. Le risque est maximal en cas d’utilisation d’alkylants, en particulier à forte
dose. Ce risque augmente avec l’âge chez la fille. Les auto- ou allogreffes de cellules souches
hématopoïétiques et la maladie de Hodgkin sont extrêmement pourvoyeurs de stérilité ou
d’hypofertilité. Lorsque la perte de la fonction gonadique est inévitable, les possibilités de
préservation de la fertilité existent à tous les âges, même si certaines techniques sont encore
expérimentales.
Mots clés : fertilité, chimiothérapie, enfant, cancer, cryoconservation
Abstract. The long-term quality of life and follow-up amelioration of patients treated for mali-
gnant disease during childhood must include long-term adverse effects of treatment, especially
on the gonadic function. The effect on ovary and testis after treatment of malignant disease
during childhood depends upon type of chemotherapy, dosage, patient age and pathology.
The risk is maximal with alkylating agents especially in high dose. This risk increases with age
in girls. The bone marrow transplantation and the Hodgkin’s lymphoma induce significant risk
of infertility. When infertility occurs, many techniques of preservation are available, even if
some of them are still to be regarded as experimental methods.
Key words: fertility, chemotherapy, child, cancer, cryopreservation
Les récents progrès des traitements
anticancéreux ont permis une
amélioration notable de la survie des
enfants et des adolescents suivis pour
cancer. Sur ces 30 dernières années,
la survie sans récidive (EFS) des moins
de 15 ans, tout cancer confondu,
est ainsi passée de 67 % dans les
années 1980 à plus de 83 % de nos
jours [1].
L’amélioration de la survie des
enfants atteints de cancer doit faire
prendre en compte les effets secon-
daires à long terme des thérapeutiques
anticancéreuses, notamment sur la
fonction gonadique. En effet, parmi
ces survivants de cancer, le pourcen-
tage d’infertilité serait de un cas sur
trois contre 5 % dans la population
générale [1, 2].
Se préoccuper de la fertilité des
patients traités pour cancer est donc
devenu une démarche incontour-
nable dans leur prise en charge.
Rappel sur la fonction
gonadique normale
Chez la femme : l’ovogenèse
Même si de récents travaux
tendent à bousculer les connaissan-
ces acquises depuis les années 1950,
il est communément admis que le
stock ovocytaire de la femme est déjà
constitué avant sa naissance [3]. Les
ovaires contiennent un maximum
de follicules primordiaux au sep-
tième mois de la vie intra-utérine puis
ce nombre de follicules diminue de
fac¸on exponentielle pendant la vie.
Une femme possède ainsi un à deux
millions de follicules à la naissance,
doi:10.1684/mte.2012.0394
médecine thérapeutique
Médecine
de la Reproduction
Gynécologie
Endocrinologie
Tirés à part : F. Duquesne
69
Pour citer cet article : Duquesne F, Dalle JH. Effets à long terme sur la fonction gonadique des chimiothérapies administrées chez l’enfant. mt Médecine de la
Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2012 ; 14 (2) : 69-76 doi:10.1684/mte.2012.0394
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Mini-revue
400 000 au début de la puberté et moins de 1 000 à la
ménopause [3, 4].
Le nombre de follicules primordiaux, c’est-à-dire la
réserve ovarienne, correspond directement à la capacité
de grossesse d’une femme et donc à la fertilité. Ainsi, la
destruction prématurée du stock de follicules est à l’origine
d’une insuffisance ovarienne exocrine précoce. Faddy
et al., en 1992, ont ainsi montré qu’une perte de 90 %
de la réserve ovarienne avant l’âge de 14 ans provoquait
une insuffisance ovarienne dès l’âge de 27 ans [4, 5].
De plus, ce dysfonctionnement ovarien a pour consé-
quence directe l’infertilité mais aussi les symptômes de
privation en œstrogènes.
La cause la plus fréquente chez la femme de méno-
pause précoce est l’exposition de l’ovaire à une substance
toxique et en particulier à des agents cytotoxiques tels que
les chimiothérapies [4].
Chez l’homme : la spermatogenèse
La spermatogenèse débute à la puberté. Les sperma-
tozoïdes sont produits à partir de cellules germinales ou
spermatogonies avec un cycle de 74 jours de la sperma-
togonie au spermatozoïde [5-7].
La restauration éventuelle de la spermatogenèse après
traitement chimiothérapique dépend donc de l’intégrité de
la spermatogonie et de sa capacité ultérieure à se différen-
cier.
Les dommages cellulaires induits par les cytotoxiques
peuvent également toucher les tubes séminifères qui
deviennent dysfonctionnels ou les cellules somatiques
(cellules de Sertoli et cellules de Leydig) qui sont cepen-
dant plus résistantes. La spermatogenèse peut donc être
également supprimée par l’impossibilité pour les cellules
de Sertoli à créer un environnement favorable aux sper-
matozoïdes, ou encore par manque de testostérone [7].
Évaluation de la fertilité
Chez la fille
L’évaluation de la réserve folliculaire est utilisée pour
estimer le risque d’infertilité chez les patients traités pour
cancer [5].
L’évaluation clinique simple à la puberté consiste en
l’existence ou non d’une aménorrhée. Si, après chimio-
thérapie, avoir des cycles menstruels normaux ne garantit
pas une fertilité normale, l’aménorrhée est elle un facteur
prédictif péjoratif pour la fertilité.
Les dosages hormonaux sont également utiles.
La mesure du taux plasmatique d’hormone follicu-
lostimulante (FSH) est la technique la plus simple et la
moins coûteuse permettant d’explorer l’âge ovarien et
donc utilisée en routine. La FSH est une gonadotrophine
sécrétée par l’hypophyse antérieure, modulée par la gona-
dolibérine ou Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH),
décapeptide hypothalamique. Plusieurs études ont montré
qu’un taux élevé de FSH (>10 UI/mL) est corrélé à une
insuffisance de sécrétion d’œstrogènes et donc à un
facteur de risque d’infertilité, même si un taux normal
n’exclut pas un dysfonctionnement ovarien [2, 5, 8].
L’inhibine B, hormone sécrétée par le follicule durant
le cycle ovarien, est une hormone impliquée dans la régu-
lation négative de la FSH et son dosage permet d’estimer
la capacité sécrétoire de la réserve ovarienne.
L’hormone antimullérienne (AMH) est sécrétée par les
follicules ovariens. Sa sécrétion augmente progressive-
ment à partir de la puberté puis diminue avec l’âge et
devient indétectable à la ménopause. Son taux est donc
directement corrélé avec la réserve folliculaire et repré-
sente le meilleur marqueur de suivi chez la femme : les
taux plasmatiques d’AMH diminuent bien avant que la
FSH n’augmente [1, 9].
L’échographie pelvienne est également utilisée. La
taille des ovaires est mesurée, ainsi que le nombre de
follicules actifs chez la fille pubère.
Chez le garc¸on
Chez le garc¸on pubère comme chez l’adulte, le sper-
mogramme est le meilleur examen : évaluation du nombre
de spermatozoïdes, de leur forme, viabilité et mobilité
[5, 10].
Il est le reflet de la fonction exocrine testiculaire et
donc de la fertilité. Cependant, un cycle de spermatoge-
nèse étant de trois mois environ, il faudra veiller à ne pas
le réaliser trop tôt après la fin du traitement.
Le volume testiculaire doit être également apprécié.
Les dosages hormonaux sont également utilisés :
mesure des taux d’hormone lutéinisante (LH), FSH, tes-
tostérone et inhibine B.
La FSH est sécrétée par la glande pituitaire et son
dosage est augmenté si le tissu testiculaire est lésé à cause
de la perte du feed-back négatif.
L’inhibine B, sécrétée par les cellules de Sertoli, dimi-
nue en cas de dysfonctionnement testiculaire et représente
le meilleur marqueur hormonal de suivi chez l’homme.
Cependant, l’inhibine B est un marqueur très sensible.
Un taux bas d’inhibine B est le reflet d’un taux bas de sper-
matozoïdes, cependant, parfois suffisant pour permettre
une reproduction assistée, voire même une conception
naturelle. Il est donc conseillé de toujours réaliser un sper-
mogramme lorsqu’un souhait de conception est exprimé,
quel que soit le dosage d’inhibine B [5, 10].
Risque d’infertilité après
chimiothérapie rec¸ue pendant l’enfance
Les agents antimitotiques comme les chimiothérapies
et la radiothérapie peuvent être à l’origine d’une toxicité
gonadique importante [5, 11].
70 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Le risque d’atteinte de la fonction gonadique après
traitement chimiothérapique pour cancer chez l’enfant
est variable suivant le patient (sexe, âge), le type de chi-
miothérapie rec¸ue, la dose, les modalités d’administration
utilisées et la pathologie pour laquelle l’enfant est traité.
Action de la chimiothérapie anticancéreuse
sur la fonction gonadique
Les principaux médicaments utilisés en chimiothé-
rapie anticancéreuse sont divisés en différentes classes
thérapeutiques selon leur mode d’action. Dans les pro-
tocoles thérapeutiques, ces agents sont le plus souvent
associés afin d’obtenir un effet synergique, au prix d’une
augmentation des effets secondaires.
Les principales classes de chimiothérapie sont [5] :
–les alkylants : ils forment des ponts covalents
entre les brins d’ADN rendant impossible la répa-
ration de l’ADN pendant la réplication. Ce sont le
cyclophosphamide, la procarbazine, l’ifosfamide, les
nitroso-urées, le chlorambucil, le melphalan, le busulfan,
la carboplatine... ;
–les antimétabolites : ils bloquent ou détournent une
voie de synthèse de l’ADN. Ce sont le méthotrexate, la
mercaptopurine, la fludarabine, l’aracytine... ;
–les agents intercalants : ils induisent des cou-
pures d’ADN. Ce sont les anthracyclines : daunorubicine,
adriamycine... ;
–les agents scindants : ils provoquent des fragmenta-
tions de l’ADN. La bléomycine fait partie de cette classe ;
–les poisons du fuseau : ils bloquent les cellules en
métaphase. Ce sont la vinblastine, la vincristine... ;
–les épipodophyllotoxines : ils inhibent la topo-
isomérase II, impliquée dans la torsion/détorsion de
l’ADN. Ce sont le VP16, le VM26...
Toutes les chimiothérapies provoquent une affection
de la fonction gonadique, mais la toxicité est variable selon
le type de molécule utilisée (tableau 1) [12, 13].
Les chimiothérapies les plus toxiques sont ainsi les
agents alkylants. Tous les alkylants n’ont pas la même toxi-
cité : le risque est encore plus important avec le busulfan
qu’avec le melphalan ou le cyclophosphamide [14, 15].
Meirow a ainsi comparé l’action stérilisante des agents
alkylants à celle des autres antimitotiques et a retrouvé
une insuffisance ovarienne de 42,4 % en cas d’utilisation
d’agents alkylants contre 14 % lorsque ces agents ne sont
pas utilisés [16]. Cela pourrait s’expliquer par le fait que
les agents alkylants exercent leurs effets cytotoxiques en
l’absence de prolifération cellulaire, à la différence des
autres agents antimétabolites. Chez la fille, ils détruisent
ainsi les follicules en croissance mais aussi les follicules
primordiaux du stock de réserve pouvant être ainsi respon-
sable d’une stérilité définitive.
À l’opposé, le risque est très modéré avec des
substances comme la vincristine, le méthotrexate, la bléo-
mycine, le fluoro-uracile [14, 15].
La dose cumulée a un impact avec un risque
d’insuffisance gonadique d’autant plus important que la
dose administrée est importante. Cela a pu être vérifié in
vitro. Ainsi, Meirow et al. ont comptabilisé le nombre de
follicules primordiaux résiduels chez des rongeurs après
administration de doses cumulées de cyclophosphamide
et ont montré que ce nombre diminuait d’autant plus que
la dose était importante [17].
La difficulté est que la plupart des patients sont traités
avec de multiples agents et que la contribution relative de
chaque substance est donc difficile à déterminer. Il paraît
donc plus licite d’évaluer le risque d’infertilité en fonc-
tion de la pathologie du patient. C’est en effet le type de
maladie qui va déterminer le protocole thérapeutique et
donc la dose, la durée, le mode d’administration et les
associations des différentes substances [14, 18].
Risque d’atteinte de la fonction gonadique
selon la pathologie
La maladie de Hodgkin (MdH)
La maladie de Hodgkin (MdH) est une pathologie
extrêmement pourvoyeuse de stérilité.
Avant même tout traitement anticancéreux, du fait
de la maladie elle-même, il peut exister, chez l’homme,
un dysfonctionnement gonadique. Le mécanisme exact
est inconnu mais toute pathologie, cancéreuse ou non,
associant une augmentation du catabolisme et une aug-
mentation des hormones de stress, s’accompagne d’une
diminution du taux de gonadotrophines témoin d’un dys-
fonctionnement gonadique. Le processus inflammatoire
lié à la maladie, avec un relargage de cytokines souvent
important, a un impact négatif sur la spermatogenèse. Ce
peut également être une explication [5, 6, 19-21].
Tableau 1. Toxicité des chimiothérapies sur la fonction gonadique.
Haut risque Risque intermédiaire Risque faible (ou absent) Risque inconnu
Cyclophosphamide
Chlorambucil
Melphalan
Busulfan
Moutarde azotée
Procarbazine
Cisplatine
Adriamycine
Méthotrexate
5-fluoro-uracile
Vincristine
Bléomycine
Actinomycine D
Taxanes
Oxaliplatine
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012 71
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Mini-revue
Dans la MdH en particulier ce dysfonctionnement
gonadique préthérapeutique est retrouvé. Ainsi, on note
11 % d’azoospermie avant tout traitement et 69 %
d’anomalies spermatiques [5, 19-21]. Les patients porteurs
de MdH présentent fréquemment des signes systémiques
au diagnostic avec fièvre et sueurs nocturnes et un
syndrome inflammatoire biologique important pouvant
expliquer ce taux important d’altération des paramètres
spermatiques [19].
Par ailleurs, les protocoles thérapeutiques utilisés dans
la MdH contiennent des alkylants à dose importante, à
l’origine de la dysfonction gonadique.
Comme dit précédemment, plus la dose d’alkylants
utilisée est importante, plus le risque d’infertilité est
majeur [1, 22]. Ainsi, les enfants et les adolescents trai-
tés avec une chimiothérapie type MOPP/COPP (moutarde
azotée/cyclophosphamide, oncovin, procarbazine, pred-
nisone) ont un risque majoré d’infertilité par rapport à ceux
recevant une cure de type ABVD (adriamycine, bléomy-
cine, vinblastine, dacarbazine) [11, 14, 19].
Chez le garc¸on, après MOPP, plus de 90 %
d’azoospermie sont retrouvés [19]. La fille est un peu
moins sujette au risque d’infertilité pour le même trai-
tement rec¸u. Une ménopause précoce (plus ou moins
précoce suivant la dose d’alkylants rec¸ue, l’âge au moment
du diagnostic et la susceptibilité individuelle) est en
revanche retrouvée dans la quasi-totalité des cas [22].
Le risque d’atteinte de la fertilité est encore majoré en
cas d’irradiation pelvienne.
Les leucémies aiguës
Après un traitement standard de la leucémie aiguë (LA),
il existe peu de risque d’atteinte gonadique. Les proto-
coles actuels n’incluent en effet pas d’agent alkylant (et en
particulier de cyclophosphamide) à forte dose.
Différentes études relatent 10 % de filles développant
des anomalies ovariennes et en particulier une ménopause
précoce après un traitement standard de leucémie aiguë
lymphoblastique (LAL) [1, 11].
Chez le garc¸on également, la fertilité est préservée,
même si près d’un patient sur deux ayant rec¸u une chi-
miothérapie pendant l’enfance (même à dose modérée)
présentera des altérations des paramètres spermatiques à
l’âge adulte [19].
Le risque de stérilité ne concerne réellement que les
enfants présentant une rechute «on therapy »pour les-
quels une intensification thérapeutique avec allogreffe
de cellules souches hématopoïétiques (CSH) va s’avérer
nécessaire.
Les tumeurs solides (sarcome d’Ewing, ostéosarcome,
neuroblastome, néphroblastome, tumeur cérébrale,
hépatoblastome) et les lymphomes non hodgkiniens
De même que pour les LA standards, il existe un risque
théorique faible de développer une infertilité après une
chimiothérapie de première ligne. Ce risque paraît tout
de même un peu plus important dans les tumeurs solides,
notamment car les enfants atteints sont souvent plus âgés
et que le traitement peut inclure une irradiation locali-
sée, parfois pelvienne selon le site primitif de la maladie
[1, 14].
Ainsi, les protocoles thérapeutiques des sarcomes
d’Ewing ou des rhabdomyosarcomes comportent dans les
formes graves une irradiation abdominale ou pelvienne à
la dose de 20 à 30 Gy. Or, cette dose est connue pour être
à l’origine d’une insuffisance ovarienne dans plus de 97 %
des cas (voir infra) [14, 23].
Dans les tumeurs cérébrales également, le risque de
dysfonction ovarienne est majoré. Cela est essentiellement
lié à l’irradiation spinale et à l’utilisation de nitroso-urées
qui font partie de la famille des alkylants [1, 11, 23].
Il est important de noter qu’une reprise des menstrua-
tions après traitement gonadotoxique n’est pas synonyme
de respect de l’intégrité de la réserve ovarienne. On peut
ainsi constater l’installation secondaire de troubles du
cycle souvent témoins d’un risque d’insuffisance ova-
rienne prématurée. Ainsi, Larsen et al. notaient parmi
100 femmes survivantes de cancer pendant l’enfance
(tout cancer confondu), 70 patientes présentant des cycles
menstruels réguliers ou un taux de FSH non augmenté
mais ayant pourtant un volume ovarien plus petit, un
nombre de follicules par ovaire moindre et donc un risque
majoré de ménopause précoce [24].
Les greffes de cellules souches
hématopoïétiques
Quelle que soit la pathologie sous-jacente pour
laquelle la greffe de cellules souches hématopoïétiques
(CSH) est réalisée, l’intensité de traitement est telle – à
l’exception des greffes dites à conditionnement réduit
(moins de 20 % des cas en pédiatrie) – que le risque
d’infertilité est quasi constant et toujours à prendre en
considération et à discuter avec le patient et sa famille.
Le conditionnement myéloablatif qui prépare à la
greffe de CSH comprend de la chimiothérapie haute dose
associée on non à de la radiothérapie. Ce conditionne-
ment est particulièrement gonadotoxique et induit dans la
grande majorité des cas une infertilité à l’âge adulte.
Il est difficile de définir si ce dysfonctionnement gona-
dique est lié à l’irradiation corporelle totale (ICT), à la
chimiothérapie haute dose, à la chimiothérapie conven-
tionnelle rec¸ue avant le traitement myéloablatif ou à
l’association des trois [11, 25].
L’ICT, particulièrement utilisée dans le conditionne-
ment des LAL de l’enfant, délivre habituellement une dose
de 12 Gy fractionnée en six doses.
Même si le fractionnement des doses est «protecteur »,
comparativement à la même dose délivrée en une seule
fraction, on estime chez la fille que la moitié de la popula-
tion folliculaire serait détruite pour une dose d’irradiation
72 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

inférieure à 2 Gy et qu’une dose de 15 Gy rec¸ue pendant
l’enfance induit 100 % d’insuffisance ovarienne prématu-
rée [23].
Chez le garc¸on, 0,1 à 1 Gy suffisent à perturber la sper-
matogenèse et des doses supérieures à 4 Gy causent des
dégâts permanents [11].
L’ICT est donc particulièrement délétère sur la fonction
gonadique.
La chimiothérapie haute dose lorsqu’elle utilise plu-
sieurs alkylants tels que le busulfan, le cyclophosphamide
et/ou le melphalan est également très gonadotoxique avec
presque 100 % d’infertilité observée.
Même lorsqu’elles sont utilisées seules, ces chimiothé-
rapies utilisées à haute dose sont extrêmement toxiques sur
la fonction gonadique.
Ainsi, le busulfan en monothérapie (circonstance
exceptionnelle chez l’homme) est pourvoyeur d’infertilité
chez presque tous les patients [11, 14].
Le melphalan, utilisé seul, le serait un peu moins avec
des cas de fonction ovarienne normale [11, 19].
Le rôle du cyclophosphamide utilisé seul à doses myé-
loablatives (120 à 200 mg/kg) n’est pas aussi net puisqu’il
est décrit des patientes traitées dans l’enfance et ayant une
puberté et un taux de gonadotrophines normaux alors que
d’autres développent des anomalies du développement
pubertaire [10, 25, 26]. Des cas de grossesse chez les par-
tenaires de garc¸ons ayant rec¸u du cyclophosphamide sans
irradiation ont également été décrits [26].
Une étude réalisée chez 34 filles greffées pour des
pathologies variées retrouve 20 % de femmes présentant
une fonction ovarienne normale et des règles régulières,
15 % avec des règles régulières mais un taux de FSH
élevé et 65 % avec un complet dysfonctionnement ovarien
[25]. Une autre étude réalisée chez 82 enfants prépubères
confirme ce taux de 20 % de fonction ovarienne nor-
male avec même neuf grossesses observées. Cependant,
ces neuf grossesses sont grevées de cinq fausses couches
spontanées toutes chez cinq patientes ayant rec¸u un condi-
tionnement incluant une ICT [26].
Chez le garc¸on, le conditionnement myéloablatif est
également extrêmement toxique avec plus de 85 %
d’azoospermie retrouvée après greffe de CSH [2, 25].
Risque d’atteinte gonadique en fonction
du patient
Chez la fille
Chez la fille, l’âge au début du traitement est un facteur
péjoratif majeur [4].
En effet, l’âge est corrélé à la réserve folliculaire : les
ovaires des plus jeunes filles contiennent un plus grand
nombre d’ovocytes que ceux des femmes plus âgées et
pour le même traitement le risque de ménopause pré-
coce augmente donc avec l’âge de la patiente puisque au
moment du traitement la réserve folliculaire est moindre
[25].
Il est également classique de penser que l’ovaire infan-
tile, qui ne contient que des follicules quiescents, est
moins sensible à l’effet délétère de la radiochimiothéra-
pie. L’apparition du cancer après la puberté est donc un
facteur de risque d’infertilité supplémentaire.
Cela explique l’intérêt possible d’un traitement par
agoniste de la GnRH, qui remet les ovaires à l’état quies-
cent, chez les jeunes filles et les jeunes femmes pubères
au moment de la chimiothérapie afin de préserver leur
fonction ovarienne [1].
Chez le garc¸on
Chez le garc¸on, c’est différent. Le stock de spermato-
gonies est identique à tout moment de la vie et l’âge n’est
donc pas un facteur prédictif d’infertilité [25].
Autres complications
en dehors de l’infertilité
Chez la fille
Outre la stérilité observée à l’âge adulte,
l’administration d’un conditionnement myéloablatif
avant greffe de CSH chez la fillette nubile induit une
insuffisance ovarienne endocrine à l’origine d’un retard
de croissance et d’un retard de développement des
caractères sexuels secondaires à la puberté.
Les effets indésirables sur la fonction endocrine et la
croissance sont a priori moindres en cas de chimiothéra-
pie haute dose seule sans association à la radiothérapie
[2, 11, 25].
Ces effets secondaires sur la fonction endocrine ne sont
par ailleurs pas décrits après traitement standard de LA ou
de tumeurs solides de l’enfant.
Un suivi endocrinien et gynécologique est donc néces-
saire en post-greffe afin de mettre en route dès que
nécessaire un traitement substitutif adéquat en vue de
l’obtention d’une taille (sub)normale à l’âge adulte et le
développement de cycles menstruels réguliers. Ce traite-
ment substitutif sera arrêté à intervalles réguliers pendant
deux mois afin de dépister un éventuel recouvrement de
la fonction gonadique [2, 25].
Chez l’homme
Chez l’homme, les cellules de Sertoli et les cellules
de Leydig sont beaucoup plus résistantes aux dommages
cellulaires induits par les cytostatiques que l’épithélium
germinal et l’hypogonadisme endocrine est donc rarement
noté. Ainsi, après traitement cytostatique, le taux de FSH
est souvent anormalement élevé alors que le taux de LH et
de testostérone sont normaux chez la majorité des patients
[6, 24].
Une atteinte de la fonction endocrine a été décrite en
cas d’irradiation du système nerveux central de plus de
40 Gy [6].
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012 73
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%