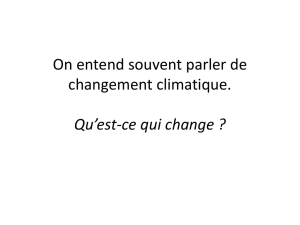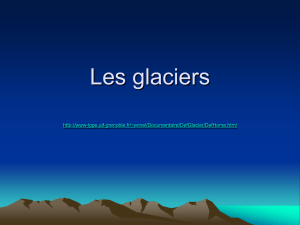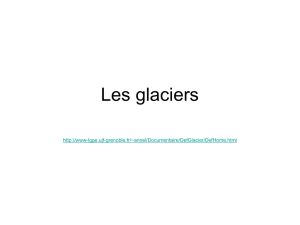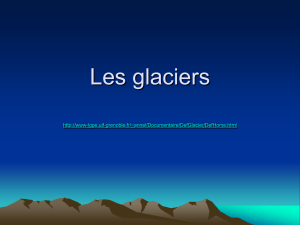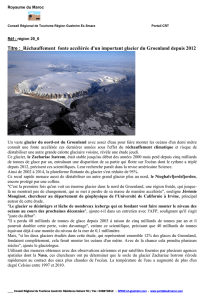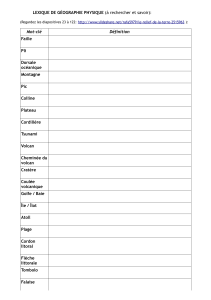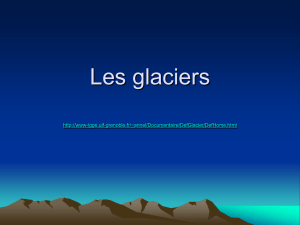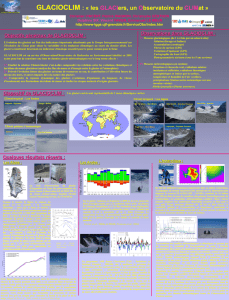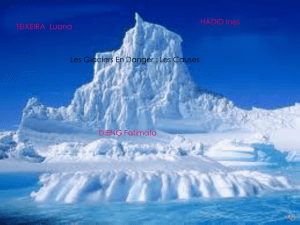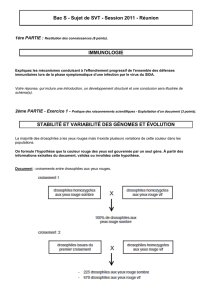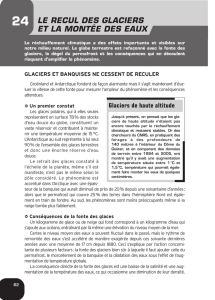Dossier CLIMAT : L`impact du réchauffement climatique sur les

de glace flottantes sont plus vulné-
rables à la fonte que les glaciers
continentaux car les rivages de
l’Antarctique sont plus chauds que
le cœur du continent. Ces franges
glaciaires agissent comme des
freins à l’avancée vers la mer des
glaciers continentaux.
On oublie souvent que l’Antarctique
est un continent; son climat n’évolue
donc pas de manière uniforme sous
l’effet du réchauffement planétaire.
Certaines régions du Pôle Sud se
refroidissent, d’autres se réchauffent.
Dans l’étroite Péninsule antarctique
qui pointe vers l’Amérique du Sud,
la température s’est élevée de 0,5°C
par décennie depuis les années
1940. Depuis 1974, la superficie des
sept plates-formes glaciaires
entourant cette péninsule a diminué
d’environ 13.500km2.
Entre la fin du mois de janvier et le
début du mois de mars 2002, un
événement inquiétant est venu
confirmer ce réchauffement local :
la plate-forme Larsen-B , située à
l’est de la Péninsule, s’est désintégrée
en 35 jours alors qu’elle existait
depuis 12.000 ans. Un iceberg de la
taille du Luxembourg ainsi qu’une
myriade de morceaux de glace
(d’une superficie totale de 3250
km2) sont alors partis à la dérive. Il
s’agit du détachement de glace le
plus important en 30 ans dans cette
région.
du point de départ du phénomène,
précipite d’importantes quantités
d’eau douce dans l’Atlantique Nord,
diminuant significativement la sali-
nité et donc la densité des eaux,
ralentissant les courants marins.
Une réaction en chaîne inquiétante
s’amorce alors : plus le réchauffe-
ment de la planète s’accentue, plus
les glaciers fondent, plus l’eau de
mer s’adoucit, plus sa densité
décroît, plus les courants océa-
niques risquent de s’arrêter.
Un fort ralentissement aurait des
conséquences désastreuses sur la
ressource halieutique et sur le cli-
mat de la planète. Les courants
marins contribuent à la biodiversité
marine en alimentant certaines
régions en plancton (par exemple
sur les Grands Bancs de Terre Neuve
ou les côtes du Pérou). Par ailleurs,
les océans sont un élément clé de la
complexe machinerie climatique
(l’effet El Niño en est l’exemple) ; si
la circulation océanique est perturbée,
de nombreuses régions verront leur
climat radicalement modifié. Par
exemple, si le Gulf Stream s’arrête,
le Nord de la France pourrait
connaître des hivers comparables
aux rudes hivers canadiens.
> La montée des eaux :
Le niveau des mers s’est déjà élevé
de 12cm depuis 1880. Deux fac-
teurs concourent à cette élévation :
la dilatation thermique des eaux et
la fonte des glaces.
Le réchauffement des eaux de sur-
face de 0,5°C constaté depuis 1880
est ainsi responsable d’une élévation
(par dilatation) du niveau des mers
de 5cm. Les autres 7cm sont impu-
tables à la fonte des glaciers polaires
et de montagnes.
> La fonte des glaciers de monta-
gne : Menace sur la ressource en
eau, les écosystèmes et la biodiversité
L’eau de fonte des glaciers alimente
largement les réserves d’eau douce,
à la fois en surface et sous terre.
Dans certaines régions tempérées
et tropicales, elle est un élément
central de la vie des écosystèmes,
de la production d’énergie hydro-
électrique, de l’activité industrielle,
des systèmes d’irrigation et des
réserves d’eau potable. Parce que la
glace des glaciers fond lentement à
la saison chaude, elle offre des
réserves d’eau approvisionnant
régulièrement les systèmes de drai-
nage en aval.
Dans certaines régions, le réchauf-
fement climatique entraîne un
déclin des précipitations. De moindres
chutes de neige et une fonte plus
précoce augmentent les risques
d’inondations en début d’année et
réduit l’écoulement de l’eau dès la
fin du printemps et durant l’été.
Une moindre humidité à la fin du
printemps et durant l’été engendre
des risques accrus de déclenchement
de feux de forêts, de broussailles et
de prairies. Cela signifie également
une ressource en baisse pour l’agri-
culture, la production hydroélectrique
et industrielle et pour la consomma-
tion domestique. Les écosystèmes
soumis au stress de la sécheresse
vont s’appauvrir et attirer les inva-
sions d’insectes et de parasites.
4. Plate-formes glaciaires en
Antarctique:
90% de la glace de notre planète se
trouve en Antarctique : soit sur le
continent antarctique lui-même
(sous forme de calotte d’une épais-
seur moyenne de 2km) soit sous
forme de plates-formes glaciaires
(d’une épaisseur de quelques mètres
à plusieurs dizaines de mètres) qui
prolongent les glaciers continentaux
et flottent sur la mer, formant une
frange le long des côtes. La plus
imposante d’entre elles est la
plate-forme de Ross qui couvre
500.000km2, une superficie
équivalente à la France. Ces plaques
1. Qu’est ce qu’un glacier ?
Un glacier est une vaste étendue de
glace permanente à l’échelle
humaine qui progresse dans le sens
de la pente sur laquelle elle repose.
Les glaciers se forment par accumu-
lation d’épaisses couches de neige
que la pression de leur propre poids
transforme en glace. L’appellation
«glacier» était habituellement réser-
vée à une surface glacée égale ou
supérieure à 1 km2, mais depuis
quelques décennies, nombreux sont
les glaciers à être passés sous ce
seuil, suite à une fonte accélérée.
Les processus qui retirent de la
masse au glacier, ou ablation, sont :
la fonte, le détachement (vêlage)
d’icebergs, l’évaporation et l’érosion
par le vent. C’est un phénomène
naturel qui revient dans la vie d’un
glacier avec le cycle des saisons.
Tant que les chutes de neige équili-
brent ce qui est perdu par ablation,
la masse du glacier reste à peu près
constante. Lorsque l’ablation l’em-
porte sur l’accumulation, le glacier
perd en surface et en volume : on
dit alors qu’il recule.
Les glaciers apparaissent dans un
contexte géographique et climatique
particulier : la plupart d’entre eux
se concentrent dans des régions qui
connaissent des chutes de neige
importantes en hiver et des tempé-
ratures estivales fraîches. Ces
conditions sont réunies dans les
régions polaires et montagneuses
car ces milieux sont en mesure de
préserver, pendant l’été, la neige
tombée pendant l’hiver.
2. Le réchauffement
climatique
• les causes du réchauffement :
L’évolution du climat mondial est
directement liée à notre consom-
mation d’énergie. Le réchauffement
actuel de la planète résulte de
l’augmentation des émissions de
gaz à effet de serre, dont le princi-
pal est le dioxyde de carbone (CO2),
produit de l’utilisation des
combustibles fossiles (charbon,
pétrole, gaz). Depuis la révolution
industrielle, les pays du Nord ont
généré des gaz à effet de serre en
quantités telles que notre planète
ne parvient plus à les absorber. Ils
s’accumulent dans l’atmosphère et
renforcent le phénomène naturel de
l’effet de serre. Sous l’action de
l’Homme, le climat mondial est en
train de se dérégler.
Le Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) des
Nations-unies, composé de plus de
2.000 éminents scientifiques du
monde entier, a publié son dernier
rapport en 2001, apportant des
preuves nouvelles et déterminantes
sur l’existence d’un réchauffement
planétaire et sur la responsabilité
humaine dans ce phénomène.
Selon les différents scénarios
d’émissions élaborés par le GIEC, la
température moyenne globale
pourrait augmenter de 1,4 à 5,8°C
d’ici à la fin du siècle.
Militantes de Greenpeace récoltant de l’eau de fonte de glacier
Glacier proche du sommet du Kilimanjaro
Au cours du XXème siècle, la tem-
pérature moyenne globale s’est déjà
élevée de 0,6°C.
• les conséquences du réchauffe-
ment :
Les changements climatiques cons-
tituent la menace écologique
majeure de ce siècle.
Ils auront des répercussions multiples
sur les écosystèmes et les commu-
nautés humaines. Les chercheurs du
GIEC estiment que le niveau des
mers pourrait s’élever de 14 à 80
cm d’ici 2100. Les îles de basse alti-
tude comme les Maldives pourraient
être englouties et les régions de
delta pourraient perdre de
nombreuses terres cultivables et
habitables (Bangladesh, Egypte,
Pays-Bas, Camargue). Globalement,
118 millions de personnes pourraient
être ainsi poussées à l’exode.
Il faut également redouter la multi-
plication d’évènements météorolo-
giques extrêmes (inondations
dévastatrices, tempêtes ou cyclones
violents, vagues de chaleur, épisodes
de sécheresse) qui mettront à mal
les infrastructures, les économies et
les systèmes agricoles, notamment
des pays en développement.
Le climat devenant plus propice au
développement des populations
d’insectes, les maladies à vecteurs
(malaria, dengue) trouveront de
nouveaux terrains d’expansion.
L’évolution est un processus lent;
les écosystèmes ne pourront pas
s’adapter à une montée aussi rapide
des températures : de nombreuses
espèces animales et végétales ris-
quent de s’éteindre. Les récifs
coralliens sont massivement
menacés par le blanchiment dû à
l’augmentation de la température
des océans. Les glaciers subiront
un recul accéléré et beaucoup
pourraient disparaître dans les
prochaines décennies.
3. Les effets du réchauffement
climatique sur les glaciers
Depuis 60 à 100 ans, la tendance
générale est au retrait des glaciers
partout dans le monde. Les glaciers
de montagne, souvent initialement
moins stables et plus petits que les
glaciers polaires, sont particulière-
ment touchés.
• La fonte des glaciers polaires :
Perturbation des courants marins
et montée des eaux
> La circulation thermohaline
menacée :
La circulation thermohaline globale
est un phénomène grâce auquel
l’eau dans les océans est toujours
en mouvement. Une grande partie
de la chaleur solaire reçue par la
Terre est emmagasinée dans les
océans qui constituent ainsi un
immense réservoir de chaleur. La
circulation thermohaline est déter-
minante dans le transport et la
distribution de cette chaleur à
l’échelle globale. Les courants
chauds de surface vont réchauffer le
climat de certaines régions et les
courants froids profonds modèrent
les températures des régions équa-
toriales. Paris et Québec sont
situées aux mêmes latitudes, pourtant
le climat y est tout à fait différent :
Québec et la côte est du Canada
sont refroidis par le courant du
Labrador alors que Paris, comme
tout l’est de l’Europe sont réchauf-
fés par le Gulf Stream.
En profondeur, les masses d'eau se
déplacent sous l'effet de variations
de densité, dues aux modifications
de la température et de la salinité
en surface. La circulation thermo-
haline forme une grande boucle
impulsée à l’est du Gröenland où la
densité des eaux est très forte
(température froide et forte salini-
té), leur permettant de descendre
vers les profondeurs. C’est cette
plongée qui est le moteur de la
grande boucle globale des courants
marins qui constitue un cycle de
1000 ans environ.
Or la fonte accélérée de nombreux
glaciers nordiques et surtout de la
calotte glaciaire, situés à proximité
Circulation thermohaline atlantique
C
o
u
r
a
n
t
c
h
a
u
d
d
e
s
u
r
f
a
c
e
C
o
u
r
a
n
t
f
r
o
i
d
,
p
r
o
f
o
n
d
e
t
s
a
l
é
Transfert de chaleur
vers l’atmosphère
Bilan de glace cumulé à l’échelle globale
(Glacier Mass Balance Bulletin 6)
22 rue des Rasselins - 75020 Paris
Tél.: 01 44 64 02 02 - www.greenpeace.fr
L’Arctique Sunrise naviguant autour de l’île de James Ross
Dossier CLIMAT :
L’impact du réchauffement climatique sur les glaciers
Péninsule
antarctique PÔLE SUD
Larsen
Plate-Forme
de Ross
Fracture dans la plate-forme Larsen
Lac asséché. Amazonie, Brésil
© Greenpeace/Morgan
© Greenpeace/Hungria
© Greenpeace/Morgan
©Greenpeace/van Olden
© Greenpeace/Morgan
Antarctique
Plate-Formes glaciaires
41
23
Greenpeace avait organisé en 1997
une expédition sur la Péninsule
antarctique afin d’alerter la commu-
nauté internationale sur les ruptures
de glace répétitives depuis les
années 60 et l’apparition de fissures
et de crevasses sur le glacier Larsen.

L’impact du réchauffement climatique sur les glaciers
ARCTIQUE, PÔLE NORD
Le réchauffement de la planète est entre 2 et 4 fois plus important
dans les régions arctiques. La glace autour du Pôle du nord s'est
rétrécie de 7,4 % ces 25 dernières années, avec un record de fonte à
l'été 2002.
GLACIER BLOOMSTRANDBREEN,
ARCHIPEL DES SVALBARD, NORVÈGE
Le réchauffement de la planète est entre 2 et 4 fois plus important
dans les régions arctiques.
Il a reculé de 2 km depuis 1928. Le rythme s’accélère depuis 1960
avec un recul de 35 m par an en moyenne. Les glaciers de Svalbard
ont perdu 512 km2 soit 16% de la fonte des glaces de l’Hémisphère
Nord entre 1961 et 1993.
LE GLACIER DU KILIMANJARO, TANZANIE
Le Mont Kilimanjaro est l’un des rares endroits au monde où l’on
trouve de la glace et de la neige sur l’équateur. Cependant ce site
exceptionnel est menacé : ses glaces pourraient avoir complète-
ment fondu d’ici à 2015.
Depuis la première cartographie du glacier en 1912 , 80% de sa
surface a disparu (un tiers au cours des 15 dernières années).
LE GLACIER ORUBARE
OUGANDA/RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le glacier Orubare est situé sur le
Mont Rwenzori, qui culmine à
5109 m, troisième point le plus
élevé d’Afrique. En 1906, on y
trouvait un vaste glacier. En
1994, ce glacier s’était scindé en
4 glaciers beaucoup plus petits.
L’HIMALAYA, ASIE
Au Népal, depuis 1975, la température moyenne a augmen-
té de 1,5°C. Si la cadence actuelle se maintient, il est très
probable que tous les glaciers himalayens auront disparu d’ici
à 2035. Plus de 2 milliards de personnes dépendent des sept
fleuves directement alimentés par les glaciers himalayens et
risquent à terme de manquer d’eau potable
LE GLACIER IMJA, NÉPAL
Devant la langue du glacier Imja, juste au sud-est de
l’Everest, un lac (Imja Tsho) est apparu en 1960 et conti-
nue à se remplir; il prend la place laissée par le recul du
glacier, qui se fait à raison de 10 m par an.
A l’instar de l’Imja Tsho, une cinquantaine de lacs de
l'Himalaya risquent de déborder d'ici cinq à dix ans et
d'inonder les vallées en aval, menaçant la vie de dizaines
de milliers de personnes.
GLACIER GRINNELL, ETATS-UNIS
En 1850, Grinnell couvrait 2,33 km2; sa superfi-
cie est tombée à 1,33 km2en 1993. Entre 1850 et
1920, Grinnell a reculé en moyenne de 6 m
chaque année. Entre 1920 et 1946, le retrait était
de 15 m par an. Entre 1946 et 1979, le retrait
redescendit à 4 m par an, mais le glacier perdit
de nouveau 46% de sa superficie par rapport à
1946.
LE GLACIER QORI KALIS, PÉROU
Son retrait annuel a été de 155 m
entre 1998 et 2001; soit un retrait
3 fois plus rapide qu’entre 1995 et
1998 et 32 fois plus rapide qu’entre
1963 et 1978.
LE KA ROIMATO (glacier Franz Josef),
NOUVELLE ZÉLANDE
Il a reculé de plus de 1 500 m depuis les premières
mesures en 1860, bien qu’il ait connu quatre ou cinq
avancées pendant cette période. L’avancée la plus
récente, une poussée très forte entre 1983 et 1999,
s’est maintenant inversée et le glacier est entré dans
une phase de retrait.
PLATE-FORME GLACIAIRE LARSEN, ANTARCTIQUE
La plate-forme glaciaire située a l'est de la Peninsule Antarctique a
perdu une grande partie de sa surface entre janvier et mars 2002. La
plate-forme Larsen-B, vieille de 12.000 ans, s'est effondrée, liberant un
iceberg de la taille du Luxembourg. Depuis 1974, la surface des sept
plate-formes glaciaires qui entourent la péninsule ont perdu
13.500km2, confirmant le réchauffement local des températures.
LES ALPES, EUROPE
Les glaciers alpins ont perdu un tiers de leur surface en 150 ans. 95% des glaciers
alpins pourraient fondre au cours des 100 prochaines années et de nombreux petits
glaciers pourraient disparaître complètement dans les décennies à venir.
LA MER DE GLACE, MASSIF DU MONT BLANC, FRANCE
La mer de Glace s’étend sur 4 km. Mais depuis le milieu du XIXe s., son front est
remonté de 1 100 m à 1 600 m d’altitude (environ une perte de 1,5 km de longueur),
d'abord lentement puis rapidement entre 1930 et 1970. Elle a aussi perdu plus de
80 m en épaisseur au niveau de la station du Montenvers.
LES PYRÉNÉES, FRANCE/ESPAGNE
Les glaciers pyrénéens de petite taille sont des indicateurs environnemen-
taux particulièrement sensibles aux variations climatiques. Depuis 150 ans
ils ont fortement régressé puisque la perte de superficie est de 80 à 90%.
En 1870, la surface englacée pyrénéenne représentait 40 à 45 km2, elle est
tombée à 5 km2en 2000 (source P. René )
LE GLACIER D’OSSOUE
(MASSIF DU VIGNEMALE)FRANCE
• 1850, le Glacier d’Ossoue couvre environ 110 ha. 1950, sa surface est de
73 ha et en 2002 de 58 ha. Entre 1850 et 2002, le front du glacier a recu-
lé d'environ 800 m; avec une accélération entre 1960 à 2002, période
durant laquelle il a reculé d'environ 300 m.
Imprimé sur papier recyclé blanchi sans chlore.
© Greenpeace/Morgan
© Norwegian polar institute/Greenpeace
© Greenpeace/Aslund
©Gesellschaft f. oekologische Forschung/Greenpeace
©L.Gaurier
©P.René
©Marble, Glacier National Park archives
©Fagre, Glacier National Park archives
©L.Thompson/Byrd Polar resarch center
©P.Glogg
©V.Sella
©E.Scneider
©A.Byers
©J.Wattie
©J.Wattie
1
/
2
100%