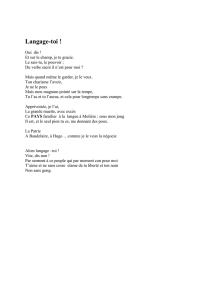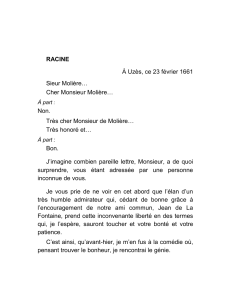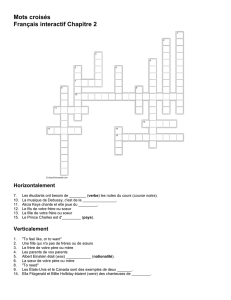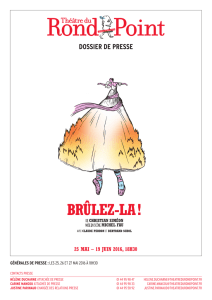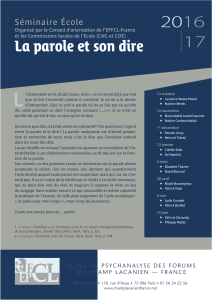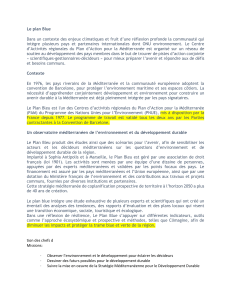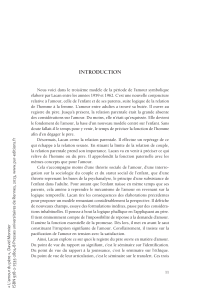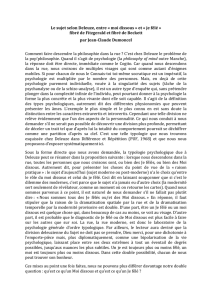LA MISE EN SCÈNE DES FEMMES DANS LA PUBLICITÉ

Simone Davis
Centre Draper, New York University
LA MISE EN SCÈNE DES FEMMES
DANS LA PUBLICITÉ
Traduit de l'anglais par Maggy Chambón
« Sur le plateau de cocktail des monceaux de choses représen-
taient autre chose
:
des canapés en forme de poissons rouges, du
caviar en boulettes, du beurre sculpté de visages et des petits
verres givrés qui transpiraient du poids de refléter tellement de
choses
destinées à vous mettre en appétit. »
Zelda Fitzgerald, Save Me the Waltz
Dans les images publicitaires, on voit souvent une belle femme poser à côté du produit. Son
travail consiste à le représenter et en fait, à le rendre plus
attractif.
Elle symbolise également
l'effort que pourrait faire le consommateur pour pallier ses propres insuffisances
à
travers l'achat
de ce produit. Ce personnage à la Carole Merrill s'allongeant sur un célèbre capot de voiture
dans une publicité, je l'appelle le « véhicule », en référence au linguiste I. A. Richards lorsqu'il
désigne, en 1936, les parties d'une métaphore1 (Richards, 1936). Il introduit le terme de
« véhicule » pour décrire le « ténor », c'est-à-dire la chose que l'on cherche à dépeindre. Le
ténor est « l'idée fondamentale ou le sujet principal que le véhicule ou le personnage signifie ».
Tout en étant, officiellement, le sujet principal, le ténor semble avoir besoin d'être étoffé et rendu
plus
attractif.
C'est czplus que le véhicule peut apporter. Le mannequin de la publicité joue ainsi
le rôle de véhicule pour un ténor qui est le produit. Son travail consiste à donner du sens, par sa
présence, à l'attrait du produit.
Lorsque le mannequin effectue un travail métaphorique dans la publicité, il nous propose
une métaphore que l'on peut utiliser pour illustrer le rôle symbolique et de représentation des
femmes dans la société de consommation. La réponse des femmes face au poids de la réflexion
HERMÈS
22,
1998 163

Simone Davis
(pour utiliser la phrase de Zelda Fitzgerald) est une médiation énergique car nous ne véhiculons
évidemment jamais uniquement les projections des autres (Fitzgerald, 1991, p. 7-196). Nous
pouvons nous engager dans des mimesis, et essayer d'approcher de plus près le travail de
représentation que nous sentons être le nôtre, même inconsciemment, mais nous le faisons en
apportant des complications et des particularités sociales, nos tics personnels, nos ambivalences
et nos désirs. Dans cet article, je me propose d'utiliser cette figure de la femme « véhicule », pour
analyser l'héroïne d'une nouvelle de F Scott et Zelda Fitzgerald. Our Own Movie Queen, sorte
de collaboration entre les époux Fitzgerald, utilise un humour grossier pour mettre une certaine
distance entre l'héroïne et le lecteur, mais ce type de burlesque est aussi limité car il décrit ce qui
peut se passer quand un « véhicule » véritablement insoumis refuse de freiner l'exubérance de
son travail de représentation.
Dans la publicité, le renforcement de l'attrait est réciproque : le produit et le mannequin
s'attirent mutuellement. Il en résulte un monde d'objets érotisés et de femmes « produits ». Pour
parler de ces processus, attachons-nous d'abord à étudier ce passage tiré de Zelda Fitzgerald
dans lequel le personnage de Gay est, tout comme ses vêtements et ses bijoux, « de première
qualité ». « La première chose qui faisait que tu remarquais Gay était cette manière qu'elle avait,
comme si elle se déguisait en elle-même. Tous ses vêtements et ses bijoux étaient tellement beaux
qu'elle les portait "à la surface". Elle pouvait le faire parce qu'elle aussi était d'une qualité
exceptionnelle. Elle avait sans aucun doute la meilleure silhouette de tout New York, sans
laquelle elle n'aurait pu gagner tout cet argent tout simplement en posant sur scène pour donner
de l'importance à deux longueurs de tulle vert. Et ses cheveux avait cette couleur blonde qui
n'est plus une couleur du tout mais une substance faite pour
refléter
la lumière. » (The Original
Follies Girl, p. 293). Elle n'est pourtant pas tout à fait synonyme de ces objets décoratifs. Il faut
se rappeler que « les deux mètres de tulle vert ont besoin du corps de Gay pour leur donner de
l'importance » (Fitzgerald,
1991,
p.
293-297).
Je vais détailler
les
effets de cette réciprocité, mais
attardons-nous pour l'instant sur la fonction vitale exercée par le «véhicule» et voyons
comment sa présence anime les produits qui l'entourent.
La plupart des consommatrices savent qu'une certaine partie de ce pouvoir « véhiculaire »
leur appartient. Elles croient à leur propre insuffisance, une insuffisance (supposée) qui les
pousse à consommer, mais elles savent qu'elles n'ont pas besoin d'être mannequins pour que leur
travail en tant que femmes dans notre culture de consommation ne soit en partie véhiculaire.
Rachel Bowlby a décrit l'expérience d'une femme qui fait du lèche-vitrines et ressent cette
insuffisance quand elle se projette et se voit enrichie par le produit qui se trouve de l'autre côté
de la
vitrine.
La réinterprétation du stade du miroir lacanien dans cette culture de consommation
serait, selon ce modèle, le stade du lèche-vitrines. Cette analogie, parallèle dans un sens à
l'approche de Laura Mulvey qui associe le miroir lacanien et l'écran de cinéma, aurait cependant
besoin d'être approfondie (Bowlby, 1985 ; Mulvey, 1992 ; Culver, 1988). «Je ne suis pas
convaincue, en effet, que seule une sensation de manque remplisse l'espace entre, d'une part,
l'identification qui est projetée sur l'objet et, d'autre part, l'image du corps de la femme qui fait
164

La mise en scène des femmes dans
la
publicité
du lèche-vitrines » (Schneider, 1995). La consommatrice de Bowlby, qui contemple longuement
le mannequin bien habillé à travers la vitrine, verra peut-être également son propre reflet
superposé à l'image du mannequin. Comme elle est femme, et donc objet de désir, elle ne se voit
pas simplement mise en valeur par le produit mais ayant, en quelque sorte, un plus grâce à
lui.
Il
y a là une contradiction qu'il faut laisser de côté pour l'instant
:
la croyance de la consommatrice
en sa propre insuffisance et sa propre plénitude coexistent. En tant que femme elle a « ce qu'il
faut », pourtant ce n'est jamais assez2.
Lorsque I. A. Richards a associé pour la première fois le terme de « véhicule » à son
partenaire le « ténor », dans sa discussion de 1936 sur les métaphores, il a défini ce dernier
comme fondamental. Il est à l'origine du sens : « idée fondamentale ou thème principal que le
véhicule ou la figure implique ». En utilisant ici un vocabulaire embelli à l'extrême et particu-
lièrement
suggestif,
Richards
s'est
cependant empressé de signaler à la fois la liquidité de cette
hiérarchie métaphorique et la vitalité du véhicule dans l'utilisation concrète : « le véhicule n'est
pas normalement le simple embellissement d'un ténor qui, autrement, ne changerait pas... Au
contraire, le véhicule et le ténor coopèrent pour produire du sens avec des pouvoirs plus variés
qu'ils ne possèdent l'un ou l'autre seul... Dans un cas extrême, le véhicule peut presque devenir
une décoration ou une coloration du ténor, de l'autre, mais dans d'autres cas le ténor peut
presque devenir une excuse pour l'introduction du véhicule et n'est plus ainsi le sujet principal »
(Richards, 1936, p. 100-101).
Richards célèbre la richesse de signification qui semble naître du processus même de
l'accouplement métaphorique. Sa description de ce va-et-vient, de ces échanges de sens, comme
une « coopération » rehaussant les deux termes, est pourtant mise à l'épreuve par sa représen-
tation d'un sujet principal dont la prééminence est menacée par la proximité d'un « véhicule »
trop vivace3.
En théorie, du moins, le véhicule est embauché pour représenter l'attirance de quelque
chose d'autre. Dans une publicité, ce quelque chose d'autre est le produit à côté duquel il se
trouve, comme dans le grand prix du jeu télévisé « la Roue de la Fortune » où l'on voit Carole
Merrill montrer l'objet avec beaucoup de charme. Comme le véhicule textuel de Richards,
Carole Merrill accomplit un travail de représentation qui est toutefois surdéterminé. Elle est, en
partie, une métaphore. Le prix est aussi beau qu'elle et c'est sa présence qui le prouve. (Une
preuve aussi peu concluante que peut l'être une métaphore textuelle). Ah, c'est elle qui vient
avec le prix ! C'est-à-dire qu'elle sera son corollaire — un prix, elle-même. Elle personnifie un
vous potentiel, le possesseur extatique du prix4.
Pour les femmes en général, ce quelque chose d'autre qu'elles se trouvent en train de
représenter, peut se déplacer et se reproduire. Dans les années vingt, c'était le devoir véhiculaire
de la femme au foyer américaine des classes moyennes de « soutenir » son homme sur le marché
du travail. Elle représentait et augmentait l'attrait de son mari simplement en restant près de lui.
À travers son image personnelle et le micro-environnement domestique, soigneusement cons-
truits et consommés, la femme était censée faire de la publicité pour
les
atouts de son mari en tant
165

Simone Davis
qu'acteur sur le marché du travail et, d'une manière encore plus diffuse, pour la viabilité de ce
marché en général (Veblen, 1934).
Les femmes devaient faire un effort de présentation, se rendre décoratives, et les véhicules
de la publicité pouvaient les aider dans ce domaine. Frank Presbrey explique avec gratitude,
dans The History and Development of Advertising (1929), que « Plus d'un mari doit avoir une
impression agréable de sa femme au petit déjeuner grâce au pouvoir de suggestion de la belle
femme qui verse le café dans la publicité » (Presbrey, 1929).
La « nouvelle femme » de cette période, du moins telle qu'elle était perçue et proposée par
les médias, faisait un travail similaire pour la modernité elle-même, ou du moins, pour le type de
modernité le plus approprié au développement de la société de la consommation. Son style chic
et décontracté pouvait représenter et mettre en valeur
les
attributs de l'ère moderne5. Le fait que
les femmes puissent avoir des comportements marginaux ou tabous ne serait que la preuve de
leur joie de
vivre.
Il faut rappeler à cet égard les « vêtements gratte-ciel » présentés en 1928
:
des
robes longues, étroites, coupées selon le modèle du pont de Brooklyn, du Paramount Building
ou de la tour du
Ritz,
entre autres. Ces vêtements donnaient aux femmes la mission « d'exprimer
l'Amérique du vingtième siècle telle qu'elle devait l'être »6. En utilisant les lignes verticales de sa
propre silhouette, celle qui portait la « robe gratte-ciel » pouvait faire de la publicité pour
l'environnement de plus en plus vertical des villes. Après tout, comme nous le rappelle une
publicité de la crème démaquillante Ponds, « être attirante et garder le charme de la jeunesse
aussi longtemps que possible » est
«
le premier devoir de la femme envers la société dans laquelle
elle évolue »7. Une autre fonction de la femme en tant que véhicule consiste à améliorer l'image
de la caste sociale à laquelle elle appartient, du professionnel qui la photographie, du directeur
ou du propriétaire de la marque qu'elle propose au public. Susan Porter Benson cite un article
à l'usage des vendeuses stagiaires : « Chaque commerçant devrait se rappeler que ses employés
sont ses représentants personnels et que le public ne le connaîtra et ne le jugera qu'à partir de ses
contacts avec ses vendeurs »8.
Que signifierait un véhicule de représentation qui vendrait ses propres attraits, comme si
ceux-ci pouvaient être si facilement canalisés ? La présence du véhicule est-elle déstabilisante
simplement à cause de sa fluidité même ? Un discours prononcé en 1928 par Edward Steichen,
célèbre photographe de mode, d'art et de publicité lors d'une réunion de cadres de l'agence J.
Walter Thompson le suggère. Steichen commence son discours, par ailleurs lucide, par une
longue liste incohérente des problèmes qu'il rencontre avec les mannequins
:
« Les mannequins.
Le problème le plus insurmontable, qui nous est extérieur, est certainement la question des
mannequins. Je ne pense pas qu'il y ait à
Vogue
un seul département qui occupe davantage M.
Condé Nast que cette question des mannequins. Rien de particulier. Il travaille sur ce problème
depuis des années et ne l'a toujours pas
résolu.
Je ne pense pas que l'on puisse le résoudre. Nous
avons tout essayé. Tout ce qu'on peut faire c'est tenter de nous en accommoder le mieux
possible » (phrase prononcée à la réunion des représentants J. Walter Thompson, le 31 janvier
1928).
166

La mise en scène des femmes dans
la
publicité
Il me semble que Steichen est rendu incompréhensible par la disparité qui existe entre le
vrai mannequin, incorrigiblement humain, extra-métaphorique, et ce que l'on voudrait qu'il
soit, à savoir, un véhicule de représentation, lisse et imperméable. J'espère que la discussion qui
va suivre éclaircira précisément cette disparité, ce problème insoluble que Steichen a trouvé si
indéfinissable, et établira des liens entre la problématique de l'image des femmes et de leur
labeur et des différences entre les classes sociales. Les représentations culturelles que nous allons
examiner révèlent à la fois les ambivalences de la métaphore pour ce système social et la charge
reposant sur
la
femme elle-même en tant que véhicule, lorsqu'elle négocie sa place sur l'axe entre
simple ornement et sujet principal.
La position du véhicule
a
beaucoup en commun avec Γ objet petit
a
de Lacan. Celui-ci décrit
les tâches assignées au petit a mais focalise clairement son commentaire d'avantage sur le prix
que devra payer le sujet mâle que sur la femme qui habite le site de a. Sans le petit
a,
il manque
quelque chose9. Bien que je ne veuille pas laisser de côté les spécificités historiques, j'utilise cet
objet petit
a
de manière aussi fantasmatique, je le crains, ou du moins, aussi métaphorique que
Lacan lorsqu'il donnait une image de la femme telle qu'il voulait qu'elle soit, ou qu'elle paraisse,
dans les publicités10. Comment éviter de reprendre cette représentation des femmes comme les
images fugaces d'une imagination limitée ? En m'efforçant de regarder le travail effectué11. Le
titre de cette intervention, tiré de Save Me the Waltz de Zelda Fitzgerald, est « le poids de la
réflexion », car je prends comme sujet le travail du véhicule (et principalement la peine qu'il se
donne mais aussi les bénéfices qu'il en retire).
J'estime que jouer le rôle de petit a est un travail difficile. On doit agir sous la menace
perpétuelle de la déchéance. « Aucune femme ne se trouve aussi haut placée qu'elle puisse se
permettre de négliger sa beauté », disait la reine Marie de Roumanie lorsqu'elle mettait en garde
ses lectrices dans le plus populaire de tous les témoignages de la haute société utilisé par le savon
Ponds in 192512. C'est une tâche difficile que d'être l'objet qui provoque les sujets, un travail
ardu, bien qu'enivrant, de faire semblant d'être Dieu. Les effets spécifiques et l'existence de ce
travail aident à constituer l'identité des protagonistes féminins de Zelda Fitzgerald, qui servent
d'intermédiaire dans sa relation avec son mari Scott, et celle de Gracie Axelrod, le personnage
principal de Our
Favorite
Movie Queen (Fitzgerald, 1991, p. 273-292).
L'œuvre des époux Fitzgerald nous offre un terrain particulièrement fertile pour compren-
dre le problème du travail de représentation des femmes dans les années vingt, en partie
simplement parce qu'ils ont participé avec tellement d'énergie et de succès à la culture populaire
de cette époque en tant qu'écrivains et célébrités. Ce travail offre toutefois un intérêt particulier
qui est dû au rôle excessivement véhiculaire que jouait Zelda en tant que femme. Elle était la
muse de Scott et, pour le public, elle représentait la femme moderne idéale. Plus que le
porte-parole de son époque, elle était sa personnification, sa concrétisation.
Que dire de la femme qui ne peut pas, ou qui ne veut pas être réduite à n'être rien d'autre
qu'un endroit de rêve et qui apporte excès et bouleversement à son interprétation de l'objet petit
a ? Gracie Axelrod, l'héroïne de Our Favorite Movie Queen, une nouvelle écrite en 1923, est
167
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%