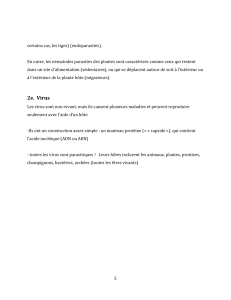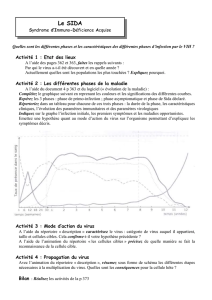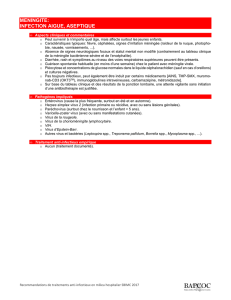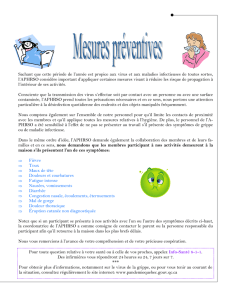Virus et insectes : relations multiples et variées

éditorial
Virus et insectes : relations multiples et variées
F. Rodhain
Professeur honoraire
à l’Institut Pasteur, Paris Les virus existent depuis longtemps ; depuis toujours serait-on tenté de
dire. Ils sont aussi anciens que les premières formes de vie apparues sur
terre, aussi vieux que l’ADN disent certains. Les « espèces » virales sont
nombreuses, même si nous ne pouvons pas aujourd’hui en connaître le nombre
réel. Les insectes, eux aussi, sont très anciens : ils existent depuis au moins
400 millions d’années (Dévonien), les premières formes ailées (donc déjà
évoluées) datent de 290 millions d’années (Carbonifère). Les insectes sont très
nombreux : ils représentent aujourd’hui plus de 80 % des formes animales
vivantes connues. Mais surtout le nombre des individus est énorme ; certains
estiment qu’il y aurait au moins 10
18
individus d’insectes sur terre, soit 2 mil-
liards pour 1 homme ! Dès lors, comment imaginer que les virus et les insectes ne
se soient pas rencontrés de multiples fois et qu’ils n’aient pas noué des relations
plus ou moins durables ?
Les différents systèmes virus-insectes
Les premières relations entre les virus et les arthropodes ne datent donc pas
d’hier, et les transmissions de virus par insectes pourraient remonter à quelque
200 millions d’années [1]. Quoi qu’il en soit, on observe aujourd’hui que les
systèmes virus-insectes ont pris des aspects extrêmement variés :
– il peut parfois s’agir de virus simplement hébergés et donc conservés et
transportés, par des insectes ;
– le virus peut parfois entraîner des troubles chez son insecte-hôte et afficher
ainsi une « entomopathogénicité » (par ex. : les agents des polyédroses ou de
granuloses d’insectes) ;
– à la frontière de la pathogénicité, on peut parfois observer, chez l’insecte-hôte,
une modification physiologique à la suite de l’infection (par ex. : le cas du virus
Matsu ou des Rhabdovirus comme sigma et bien d’autres, qui confèrent une
sensibilité inhabituelle au CO
2
, ou celui des virus responsables d’un dérègle-
ment du sex-ratio de la descendance, etc.) ;
– il existe, par ailleurs, des virus d’invertébrés, en particulier d’insectes, qui sont
transmis par d’autres insectes. C’est le cas des associations particulièrement
complexes impliquant d’une part des hyménoptères ichneumonides ou bra-
conides endoparasitoïdes et des Polydnavirus (Ichnovirus, Bracovirus)oudes
Ascovirus, et des insectes-hôtes, le plus souvent des chenilles de lépidoptères,
d’autre part [2]. Ces virus, hébergés, génération après génération par les guêpes
et injectés par elles, avec leurs œufs, dans les insectes-hôtes, interagissent avec la
régulation endocrinienne des mues et inhibent le système immunitaire, permet-
tant ainsi le développement des larves d’hyménoptères dans le corps des che-
nilles qui ne se défendent plus. Ces virus constituent ainsi des vecteurs de
transfert d’informations génétiques destinées à rendre l’hôte tolérant vis-à-vis du
parasite [3, 4] ;
– des virus de végétaux sont souvent transmis par des vecteurs [5]. Les végétaux
étant des organismes immobiles, beaucoup de leurs virus sont disséminés par des
insectes, notamment des homoptères (pucerons, cochenilles, cicadelles, etc.),
mais aussi des coléoptères, des lépidoptères, etc. ;
doi: 10.1684/vir.2007.0083
Virologie 2007, 11 : 91-5
Virologie, Vol. 11, n° 2, mars-avril 2007
91
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

– et, bien sûr, un grand nombre de virus de vertébrés sont
également transmis par des insectes vecteurs. Les premiers
« arbovirus » remonteraient à quelque 150 millions
d’années. On dit qu’aujourd’hui, plus de 70 % des virus de
plantes et quelque 40 % des virus de mammifères ont des
arthropodes comme vecteurs [6].
Il faut bien percevoir ce que ces classifications ont
d’artificiel ; nous observons de nombreux intermédiaires
entre ces catégories. Ainsi :
– des effets pathogènes sont parfois entraînés par des arbo-
virus, même chez leurs vecteurs habituels ; certains arbovi-
rus (comme les Bunyavirus du groupe California) peuvent
induire une sensibilité au CO
2
chez les moustiques ;
– des arbovirus, dont le mode de transmission habituel est
vectoriel, peuvent, dans certaines circonstances, être trans-
mis par d’autres voies. Pour certains arbovirus, comme le
virus de la stomatite vésiculaire des ruminants, on discute
encore du mode le plus efficace de transmission : par vect-
eur hématophage ou par des sauterelles ingérées par inad-
vertance ?
– certains virus, comme les Phlebovirus des phlébotomes,
se maintiennent dans les populations d’insectes par trans-
mission verticale et ne passent qu’occasionnellement sur
vertébrés : ils se situent à la frontière des arbovirus ;
– et se pose également la question de la transmission méca-
nique de virus, par exemple lors de repas interrompus. Ici,
le virus ne subit aucune réplication chez l’insecte qui n’est,
en fait, qu’un transporteur. Peut-être est-ce le cas pour le
virus de la leucose bovine chez les tabanides, ou encore
celui de l’anémie infectieuse des équidés (Retroviridae,
Lentivirus) avec les stomoxes ou les tabanides. Mais il
existe aussi des virus de plantes disséminés par des pollini-
sateurs et, inversement, des virus de pollinisateurs passent
d’un insecte à l’autre grâce aux fleurs visitées qui agissent
en tant qu’agent contaminant passif. Et cela dure depuis
quelque 160 millions d’années !
– et que dire des virus infectant des protozoaires qui, eux-
mêmes, se développent à l’intérieur d’insectes (par ex. :
virus de leishmanies) ou des virus trouvés dans des rickett-
siales (RLO : rickettsia-like organisms) présentes dans les
cellules épithéliales du tube digestif des glossines ?
En outre, non seulement des familles, bien que monophylé-
tiques, peuvent comprendre des arbovirus et des « non-
arbovirus » (par ex. : Flaviviridae), mais certaines, comme
les Rhabdoviridae, comprennent à la fois des virus
d’insectes (sigma), des virus de vertébrés (virus de pois-
sons, virus rabique... certains, comme le VSV, étant trans-
mis par insectes) et même des virus de plantes, également
transmis par insectes [7].
Manifestement arbitraires, les frontières établies par les
chercheurs sont floues et évolutives. Nous pouvons ob-
server toutes les situations intermédiaires entre les dif-
férentes catégories et, d’ailleurs, par le jeu de l’évolution,
certains virus sont passés de l’une à l’autre.
Quoi qu’il en soit, les relations virus-insectes constituent,
on le voit, un énorme champ de recherche. Sur un plan très
pratique, les insectes sont devenus des animaux de labora-
toire. On sait que les arbovirologistes utilisent depuis
longtemps des insectes, ou encore des cultures de cellules
d’insectes, pour isoler des virus à des fins diagnostiques ou
de recherche. Par ailleurs, on cherche bien entendu à utiliser
les virus entomopathogènes comme agents de lutte bio-
logique contre les insectes « nuisibles » (ravageurs de cul-
tures ou de forêts, tordeuses, phylloxera ou vecteurs de
maladies). Chacun connaît bien, également, l’intérêt que
présentent, pour les biologistes, certains virus d’insectes,
comme les Baculovirus, en matière de transgenèse. Sur un
plan plus fondamental enfin, n’oublions pas que la
tolérance conférée par des virus aux chenilles qui se lais-
sent progressivement dévorer par des insectes parasitoïdes
est un phénomène sur lequel se sont penchés de célèbres
entomologistes comme Réaumur ou Dufour, notamment
dans le cadre du grand débat sur la génération spontanée et
la transmutation des espèces [8].
Quelques aspects du fonctionnement
des systèmes arbovirus-insectes
Obligé de se répliquer dans une cellule vivante, un virus est
un parasite. Cela signifie qu’il doit vivre et se maintenir
dans un milieu physiquement discontinu, vivant, c’est-à-
dire mortel, qui se défend en développant contre lui des
réactions de défense et qui est lui-même soumis à de fortes
contraintes de la part de l’environnement.
Cela dit, pour les arbovirus, l’intervention d’un insecte
vecteur apparaît très intéressante. L’adoption de ce mode
original de transmission leur permet de résoudre plusieurs
des difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement pour as-
surer leur survie : la recherche d’un hôte vertébré et la
pénétration dans cet hôte, la manière de quitter cet hôte ; le
vecteur permet aussi d’éviter une perte de virus par disper-
sion dans le milieu extérieur. Il permet enfin la dissémina-
tion facile du virus à partir d’un hôte virémique qui n’a
guère de contacts avec ses congénères parce que rapide-
ment immobilisé par la maladie virale aiguë. Grâce à ses
préférences trophiques qui ne sont pas toujours très strictes,
le vecteur offre de multiples occasions de franchir les
barrières d’espèce. De plus, il conserve longtemps le virus
dans son organisme ; il peut même parfois le transmettre à
sa descendance et jouer ainsi un rôle de réservoir naturel.
Enfin, on estime que c’est surtout à son niveau qu’ont lieu
les phénomènes de recombinaison et de réassortiment qui
déterminent l’évolution des virus.
En revanche, le virus doit être capable de survivre, de se
répliquer, d’exprimer l’information génétique, alternative-
éditorial
Virologie, Vol. 11, n° 2, mars-avril 2007
92
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

ment dans deux systèmes biologiques radicalement dif-
férents à tous égards. Il ne s’agit plus ici de franchir, de
temps à autre, une barrière d’espèce mais d’établir, au-
dessus d’un énorme fossé phylogénétique, un pont perma-
nent et fonctionnant alternativement dans un sens et dans
l’autre.
L’écologie d’un arbovirus comporte donc deux niveaux ; le
premier est son environnement immédiat : la cellule de
l’hôte (une cellule nerveuse ou une cellule de l’épithélium
intestinal d’un moustique par exemple) ; le second est
l’environnement de son insecte-hôte et de son vertébré-
hôte ; c’est à ce titre que l’on peut parler d’un virus « tropi-
cal », « de forêt », etc.
Nous connaissons aujourd’hui plus de 650 arbovirus. Ce
nombre témoigne de leur succès évolutif. On en trouve dans
diverses familles de virus : Togaviridae, Flaviviridae,
Rhabdoviridae, Reoviridae, Bunyaviridae, etc. Parmi eux,
plus d’une centaine sont connus pour être pathogènes pour
l’espèce humaine et beaucoup d’autres le sont pour des
animaux domestiques.
Ces virus constituent, avec leurs hôtes vertébrés et leurs
arthropodes vecteurs, des systèmes dont le fonctionnement
se révèle extrêmement complexe.
Une condition sine qua non, ou presque, pour qu’un virus
puisse être transmis par un vecteur hématophage est de
provoquer une phase de virémie chez le vertébré. Pour être
efficace, cette virémie doit répondre à deux critères : elle
doit être suffisamment élevée et suffisamment prolongée.
Son titre déterminera les arthropodes qui pourront
s’infecter (en fonction de la réceptivité de ces arthropodes
vis-à-vis du virus en question) ; sa durée déterminera le
nombre d’arthropodes réceptifs qui s’infecteront sur le
vertébré infectant (c’est-à-dire le pouvoir amplificateur du
vertébré pour le virus en question).
Par la suite, chez l’insecte vecteur, les virions ingérés avec
le sang pénètrent dans les cellules de l’épithélium de la
partie postérieure du mésentéron, s’y répliquent, avant de
déverser dans les espaces intercellulaires entre la couche
épithéliale et la membrane basale ; ils infectent alors
d’autres organes et s’y répliquent à nouveau. Une troisième
phase de réplication, très intense, survient enfin dans les
glandes salivaires (lobes latéraux surtout) et le virus est
stocké dans les canaux salivaires, prêt pour être injecté lors
du repas suivant. L’arthropode est alors dit « infectant ».
Mais la notion la plus importante est ici celle d’incubation
extrinsèque : la bonne réalisation de tous ces phénomènes
demande du temps ; après s’être gorgé sur un vertébré
virémique, notre arthropode ne sera infectant (c’est-à-dire
que sa salive contiendra des virions) que 10 à 12 jours plus
tard, cette durée étant variable suivant le virus,
l’arthropode, les conditions d’environnement (en particu-
lier la température). Pour les épidémiologistes, cela signifie
que, pour avoir une bonne capacité vectorielle, l’insecte en
question doit survivre suffisamment longtemps. Générale-
ment, le début d’une épidémie a lieu au moment du pic des
populations de vecteurs, alors que son acmé coïncide avec
une population vectorielle en déclin mais composée
d’individus âgés.
Par ailleurs, dans certains systèmes, il peut exister une
transmission verticale du virus, d’une génération à la sui-
vante. Si la fréquence de ce phénomène est suffisante, le
vecteur est alors aussi un réservoir de virus dont il peut
assurer la maintenance sur place pendant des périodes
défavorables à la transmission au vertébré, surtout s’il a des
œufs durables. Il faut alors, en outre, qu’existe une trans-
mission trans-stadiale. Enfin, il faut reconnaître que nous
ne savons rien sur la transmission sexuelle des virus (trans-
mission du mâle à la femelle lors de l’accouplement) dans
la nature, un phénomène parfois observé au laboratoire.
Quoi qu’il en soit, ces phases successives de développe-
ment viral dans l’organisme de l’arthropode sont suscep-
tibles de constituer autant de barrières potentielles qui,
lorsque l’une d’elles au moins est efficace, peuvent rendre
le système non fonctionnel. Par exemple, si une barrière
salivaire s’avère efficace, l’insecte infecté ne devient pas
infectant ; il n’est pas vecteur. L’arthropode est alors dit
« incompétent ».
Il faut d’emblée retenir que, pour un virus donné, cette
compétence vectorielle varie au sein d’une même espèce
d’arthropode, selon les populations. Il ne s’agit pas d’une
règle de « tout ou rien », de sorte que, pour un virus donné,
différents vecteurs interviendront, avec des compétences
vectorielles différentes : il y a des degrés dans la com-
pétence. Il s’agit, en fait, d’une modulation de l’infection
virale chez l’insecte, aboutissant à l’installation d’un cer-
tain état d’équilibre. Si la compétence est trop forte, il y a
risque d’emballement du système qui serait alors trop effi-
cace ; si elle est trop faible, on aboutit à l’arrêt de la
transmission.
C’est sur le terrain que l’on peut apprécier la seconde
dimension de l’écologie des virus. Là, c’est la biologie de
l’insecte vecteur qui va s’avérer déterminante pour com-
prendre les modalités de circulation du virus en question. Il
faut connaître, entre autres, les préférences écologiques du
vecteur, la dynamique de sa population, sa longévité, ses
préférences trophiques, etc. L’ensemble de ces paramètres
qui, généralement, varient avec la saison, va déterminer la
capacité vectorielle de l’arthropode, qui est la résultante de
la compétence et de l’action que tous les facteurs de
l’environnement exercent sur elle.
On conçoit bien que le rôle de l’insecte ne se limite pas à la
simple transmission du virus. L’insecte sélectionne un ou
plusieurs génotypes au sein de la population virale qu’il a
absorbée, il assure aussi son amplification, son passage
d’une espèce-hôte à une autre, sa maintenance dans le
foyer, sa persistance durant l’hiver ou la saison sèche, et
éditorial
Virologie, Vol. 11, n° 2, mars-avril 2007
93
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

même, en cas de co-infection, il permet les réassortiments
ou les recombinaisons avec un autre virus, et donc
l’évolution de la lignée. Le passage sur un vecteur inhabi-
tuel peut être, pour le virus, l’occasion d’ouvrir un nouveau
cycle lui permettant d’émerger chez d’autres hôtes, dans un
autre écosystème.
Les systèmes arbovirus-insectes
non fonctionnels
On connaît des ordres entiers d’insectes auxquels aucun
virus ne paraît associé. Pourquoi certains ordres, comme les
lépidoptères ou les hyménoptères, ou encore les diptères
sont-ils porteurs de nombreux virus, alors que des groupes
entiers paraissent indemnes de virus ? Peut-être seraient-ils
seulement moins étudiés ? De nombreuses interrogations
demeurent ainsi sans réponse.
Il existe aujourd’hui quelque 15 000 espèces d’insectes
hématophages, mais nous connaissons beaucoup
d’hématophages qui ne transmettent rien.
Pourquoi les glossines, les poux, les punaises, etc. ne sont-
ils vecteurs d’aucun virus ? Pourquoi les virus des fièvres à
phlébotomes qui circulent chez les rongeurs du bassin
méditerranéen n’ont-ils pas pu s’associer à leurs puces ?
Parmi les moustiques eux-mêmes, pourquoi existe-t-il si
peu de virus à Anopheles alors qu’il y en a tant chez les
Culex et les Aedes ?
Évolution des systèmes
arbovirus-vecteurs
Il est très difficile de reconstituer l’histoire des relations
virus-insectes ; pour ce faire, on pourrait imaginer de
s’adresser aux meilleurs fossiles d’insectes que nous ayons,
ceux qui sont emprisonnés dans l’ambre. Mais, nous
n’avons malheureusement pas de virus fossiles.
Un point certainement essentiel pour l’évolution des virus
réside dans les taux très élevés de substitutions nucléo-
tidiques observés chez les virus à ARN (de l’ordre de 10
-2
à
10
-4
par site et par an). Ce n’est certainement pas une
coïncidence si la quasi-totalité des virus de végétaux et
d’animaux transmis par insectes sont des virus à ARN,
avec, pour certains, un génome segmenté.
L’arthropode apparaît comme un site privilégié pour
l’évolution des arbovirus car l’infection est persistante chez
eux (elle y dure plus longtemps que chez le vertébré),
surtout s’il existe une transmission verticale, et elle permet,
grâce aux co-infections, des changements génomiques :
recombinaisons homologues (entre deux variants d’un
même virus) ou hétérologues (entre deux virus de même
famille) et réassortiments. Les exemples sont nombreux.
Ainsi, on pense aujourd’hui que les Bunyavirus du groupe
California se sont diversifiés en même temps que les Aedes
qui leur servent de vecteurs, ce qui est en accord avec la
spécificité observée au niveau de ces systèmes virus-
vecteurs.
Pour les Alphavirus du complexe VEE, en revanche, dont
les vecteurs sont des Culex du sous-genre Melanoconion,
l’hypothèse la plus plausible paraît être une diversification
résultant du passage sur un autre vecteur (switching),
comme dans le cas du virus Everglades [9]. Un autre
exemple nous est fourni par l’émergence du virus O’Nyong
Nyong qui n’est vraisemblablement pas autre chose qu’un
virus Chikungunya passé d’Aedes sur Anopheles,cequi
s’est traduit par la survenue d’une très importante épidémie
en Afrique orientale en 1959 (plusieurs millions de cas).
Si les circonstances font qu’un virus vient à passer par un
vecteur qui n’est pas son vecteur habituel, il va avoir
l’occasion d’infecter des hôtes vertébrés également inhabi-
tuels (cela dépend des préférences trophiques de
l’arthropode), ce qui pourra entraîner l’établissement de
nouveaux cycles. Les bio-invasions par des vecteurs, de
plus en plus fréquentes, sont évidemment très favorables à
de tels changements.
Grâce aux co-infections chez l’insecte vecteur, l’apparition
de nouveaux virus à génome non segmenté peut résulter de
recombinaisons. L’exemple classique d’un tel mécanisme
concerne le genre monophylétique des Alphavirus : il s’agit
de l’apparition sur le continent américain, ilyaunpeuplus
de 1 000 ans, du virus de l’encéphalite équine de l’ouest
(WEE) par recombinaison entre celui de l’encéphalite
équine de l’est (EEE) et le virus Sindbis (SIN) ou un virus
proche de SIN [10]. Cette recombinaison hétérologue a
certes pu se produire chez un hôte vertébré mais sa surve-
nue chez un vecteur co-infecté est plus probable en raison
de la longue persistance de l’infection virale chez l’insecte.
Avec des virus à génome segmenté, une telle circonstance
peut permettre des réassortiments. Au laboratoire, on sait
réaliser cela depuis longtemps. En théorie, cette éventualité
ne devrait pas être rare ; toutefois, dans la nature, un tel
phénomène est freiné par l’existence de phénomènes
d’interférence entre des virus proches, qui peuvent rendre
l’insecte réfractaire à une surinfection après un certain
délai.
Impact des changements
environnementaux
On conçoit facilement que les systèmes virus-insectes
soient sensibles aux changements environnementaux. Or,
l’environnement change au gré des saisons, de manière
cyclique. Mais, en outre, il se trouve aujourd’hui exposé à
deux autres types de modifications, irréversibles celles-là :
éditorial
Virologie, Vol. 11, n° 2, mars-avril 2007
94
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

les effets du changement climatique d’une part, ceux qui
résultent des activités humaines d’autre part. Les systèmes
virus-insectes en subiront de plein fouet les conséquences.
Notre accroissement démographique et l’évolution socio-
économique de nos sociétés sont à l’origine de bouleverse-
ments de plus en plus profonds des milieux naturels :
– disparition progressive des écosystèmes naturels ;
– construction de barrages, adoption de nouvelles tech-
niques d’élevage, mise en place de cultures irriguées ;
– urbanisation, généralement mal contrôlée ; une évolution
importante à cet égard est le développement de liens étroits
entre l’homme et certains vecteurs comme Aedes ægypti,ce
qui aboutit à l’émergence de cycles « domestiques », fonc-
tionnant en milieu urbain et auxquels la totalité des indivi-
dus se trouve alors exposée ;
– extraordinaire développement, en fréquence comme en
rapidité, des transports, reflet de la mondialisation, qui a
aboli les barrières écologiques qui, autrefois, nous pro-
tégeaient. Les virus, les insectes, peuvent ainsi tester de
nouveaux hôtes, de nouveaux environnements. Et certains
nouveaux arrivants s’associent, les uns avec un virus
existant sur place, les autres avec un insecte autochtone. La
plupart ne persistent pas, mais quelques-uns toutefois réus-
sissent à se maintenir (par ex. : le virus West Nile en
Amérique) ;
– changement climatique enfin, dont la réalité n’est plus
contestable, qui affectera le fonctionnement des systèmes
virus-insectes, avec des conséquences importantes en ter-
mes d’éco-épidémiologie, même si le nombre et la variété
des interactions mises en jeu rendent les prévisions bien
difficiles.
Conclusion
Généralement, lorsqu’il les a identifiés, l’homme ne voit
pas d’un bon œil ces associations virus-insectes. Il les
considère comme des « associations de malfaiteurs » et,
lorsque ces systèmes sont considérés comme nuisibles
économiquement ou dangereux pour la santé, il s’efforce de
les détruire, le plus souvent en s’attaquant à la composante
insecte. Pour ce faire, des outils assez grossiers ont tout
d’abord été mis au point (insecticides), mais on peut imag-
iner d’autres moyens d’action, par exemple en cherchant à
modifier génétiquement les insectes afin de les rendre non
permissifs aux virus ou encore incapables de les trans-
mettre. Pour différentes raisons, cela demeure difficilement
utilisable sur le terrain. Il faudra, en tout cas, si l’on décide
de recourir à de telles méthodes, procéder avec beaucoup de
prudence et de discernement. On peut aussi chercher à
utiliser un virus susceptible de constituer un agent de lutte
biologique contre un insecte considéré comme indésirable.
Cependant, que l’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, il
n’y a sans doute pas lieu de se faire du souci pour le futur
des virus d’insectes, dont le nombre doit être considérable :
il en existera tant qu’il y aura des insectes. Or, malgré tous
les efforts déployés par les hommes, nous ne sommes pas à
la veille de voir disparaître les insectes.
Références
1. Lovisolo O, Hull R, Rösler O. Coevolution of viruses with hosts and
vectors and possible paleontology. Adv Virus Res 2003 ; 62 : 325-79.
2. Volkoff AN. Les polydnavirus : vecteurs de transfert d’informations
génétiques entre un hyménoptère et un lépidoptère. Virologie 1999 ; 3 :
29-34.
3. Espagne E, Dupuy C, Huguet E, et al. Genome sequence of a Polyd-
navirus : insights into symbiotic virus evolution. Science 2004 ; 306 :
286-9.
4. Glatz RV, Asgari S, Schmidt O. Evolution of polydnaviruses as insect
immune suppressors. Trends Microbiol 2004 ; 12 : 545-54.
5. Hébrard E, Froissart R, Louis C, Blanc S. Les modes de transmission
des virus phytopathogènes par vecteurs. Virologie 1999;3:35-48.
6. Van den Heuvel JF, Hogenhout SA, van der Wilk F. Recognition and
receptor in virus transmisssion by arthropods. Trends Microbiol 1999;7:
71-6.
7. Hogenhout SA, Redinbaugh MG, Ammar ED. Plant and animal rhab-
dovirus host range : a bug’s view. Trends Microbiol 2003 ; 11 : 264-71.
8. Carton Y. Réaumur (1683-1757) : le véritable fondateur de
l’entomologie en France. Bull Soc Entomol Fr 2004 ; 109 : 445-53.
9. Weaver SC, Bellew LA, Rico-Hesse R. Phylogenetic analysis of Al-
phaviruses in the Venezuelan Equine Encephalitis complex and identifi-
cation of the source of epizootic viruses. Virology 1992 ; 191 : 282-90.
10. Hahn CS, Lustig S, Strauss EG, Strauss JH. Western equine encepha-
litis virus is a recombinant virus. Proc Natl Acad Sci USA 1988 ; 85 :
5997-6001.
éditorial
Virologie, Vol. 11, n° 2, mars-avril 2007
95
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
5
100%