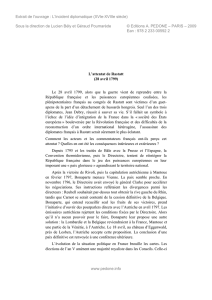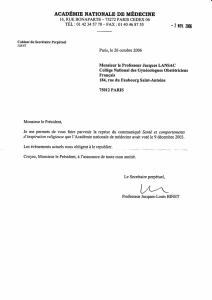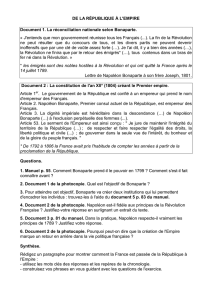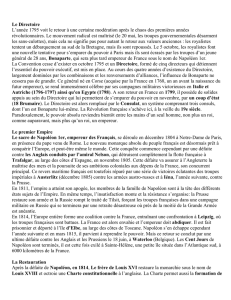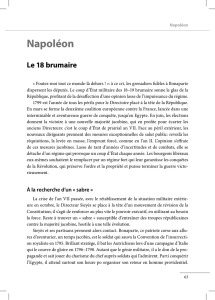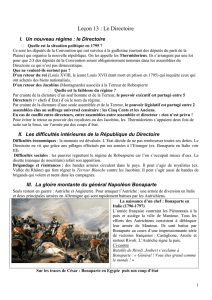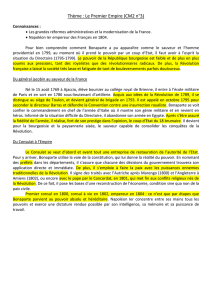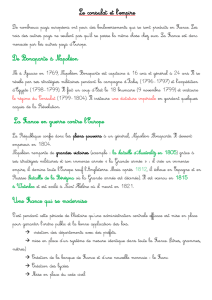LA REPUBLIQUE THERMIDORIENNE (1794-1799)

LA REPUBLIQUE THERMIDORIENNE (1794-1799)
A) La Convention
En 1794, pendant longtemps la convention avait instauré un gouvernement révolutionnaire basé sur « la terreur », il s’agissait
maintenant de l’assouplir. Le 9 thermidor a marqué un tournant dans l’histoire de la révolution, la mort de Robespierre a
entrainé la ruine de la politique démocratique et égalitaire. Ne voulant plus des constitutions de 1991 et 1993, on créa une
nouvelle commission qui était chargée de constituer une nouvelle constitution. Elle fut adoptée le 22 août 1795 (5 fructidor an
III). Elle marqua le début de la république thermidorienne qui s’acheva par un coup d’Etat, celui de Bonaparte au 18 brumaire
qui mettra fin à la révolution, en 1799.
I. Réaction thermidorienne
Les Thermidoriens, les vainqueurs de Robespierre au 9 thermidor étaient considérés comme des terroristes. Mais ils furent
contraint de mettre fin à la terreur et la Plaine domina la Convention. Les représentants de cette Plaine furent Sieyès,
Cambacérès … qui se joignirent à Tallien. Cette évolution, cet assouplissement de la Convention est connue sous le nom de
« réaction thermidorienne » qui se marqua dans 4 domaines : la réorganisation du gouvernement, l’attitude face aux Chouans,
la politique religieuse et la rédaction d’une nouvelle Convention. En quelques mois, le gouvernement perdit sa force et son
autorité. Beaucoup de prisonniers furent libérés. Tandis que certains étaient ou guillotinés ou emprisonnés, d’autres reprenaient
leur fonction au sein du gouvernement. Les pouvoirs du Comité du Salut Public furent diminués, ceux de la Commune
passèrent à des commissions nommées par la Convention. Les comités révolutionnaires furent épurés, le Tribunal
révolutionnaire fut réorganisé et la liberté de commerce rétablie.
Au Sud de la Loire, pendant que les Vendéens se révoltaient, les Chouans en Bretagne pillaient les caisses publiques et
pillaient les convois de vivres pour affamer les villes. Nulle part, la réaction contre le terrorisme ne se montre aussi nettement
que dans l’attitude de la Convention face à ces rebelles. La Convention avait d’abord employé des moyens impitoyables. Mais
sur les conseils de Carnot et Hoche, ils offrirent l’amnistie, l’exemption de service militaire, et le libre exercice de culte. Des
conventions furent signées sur ces sujets de février à mai 1795.
Puisque le catholicisme était alors toléré dans ces régions, on le toléra également dans le reste de la France. Malgré l’arrêt des
persécutions chrétiennes, la Convention resta hostile au catholicisme. Elle le montra d’ailleurs en sept. 1794 en annonçant que
l’Etat ne paierait plus « les frais et les salaires d’aucun culte ». Quelques mois plus tard, on annonçait la séparation de l’église et
de l’Etat (fév. 1795). Les prêtres, pour pouvoir exercer librement devaient « faire acte de soumission à la république ». Alors le
catholicisme renaissait enfin.
Maintenant que les victoires permettaient d’en finir avec le gouvernement révolutionnaire, les thermidoriens aurait dû mettre en
application la Convention de l’an I mais ils n’en voulaient pas. La Convention de l’an I était trop démocratique, non seulement
elle établissait le suffrage universel mais elle permettait au peuple de mettre son véto aux lois votées par les assemblées. Elle
contraignait l’Etat à un certain nombre de subventions envers l’éducation, les chômeurs et les infirmes. Si les lois n’étaient pas
appliquées par le gouvernement, le peuple avait le devoir de se soulever.
Opposés à ces idées, les Thermidoriens rédigèrent une nouvelle Constitution en 1795 qui rétablissait le suffrage censitaire à
deux degrés comme en 1791 tout en gardant la république. Les électeurs peu nombreux, étaient répartis en deux assemblées :
la Chambre des députés proposait les lois et le Sénat les adoptait ou les rejetait. Pour éviter toute dictature, celle-ci était
renouvelée au tiers chaque année. Le pouvoir exécutif quant à lui fut confié à cinq directeurs au lieu d’un seul magistrat et tous
les ans, un seul était remplacé par tirage au sort. Aucune de ces autorités n’avait de pouvoir sur les autres. Ce système était
certes ingénieux, mais montrait une faille, En cas de conflits entre les assemblées, la seule solution était un coup de force : le
coup d’Etat de Bonaparte au 18 Brumaire, qui mettra fin à la révolution.

Bien que victorieux à l’étranger, la situation des thermidoriens en France était catastrophique. Ils avaient supprimé la loi du
maximum de prix, des taxes, les réquisitions et émis une quantité énorme d’assignats. Ainsi la vie était devenue quasi
inabordable. Pendant qu’une petite partie s’enrichissait rapidement, tout le reste mourait de faim. Cette famine conduit à un
certain nombre d’émeutes, et le peuple demandait qu’on revienne à la Constitution de 1793. Ils envahissèrent la Convention
dont l’un de ses membres fut assassiné, quelques Montagnards essayèrent de saisir le pouvoir. Pour la première fois depuis
1789, les troupes durent mettre fin à l’insurrection. Les survivants des Comités de Sûreté générale et de Salut Public furent
accusés à l’exception de Carnot parce qu’il avait organisé la « victoire ». Les Montagnards furent exclus de l’Assemblée, la
Garde nationale ne fut composée que de bourgeois aisés. Les bâtiments des Jacobins furent détruits, le Tribunal
révolutionnaire supprimé et le mot « révolutionnaire » censuré.
La défaite des Jacobins favorisa les royalistes. Au lendemain du 9 thermidor, ils avaient reparus, sous prétexte d’assouplir la
terreur, ils attaquaient la république. A Paris, des jeunes de la bourgeoisie appelés Muscadins étaient recrutés par les
royalistes. Dans le Sud-est ils massacrèrent les Jacobins : à la
terreur rouge
succéda la
terreur blanche
. En même temps les
Chouans reprirent les armes en Bretagne, où un navire anglais débarquait des émigrés qui furent fusillés en juillet 1795 à
Quiberon.
Ces évènements ouvrirent les yeux des thermidoriens sur le péril de droite. Les prochaines élections amèneraient-elles une
majorité de royalistes ? Louis XVII, fils de Louis XVI étant mort, le comte de Provence prit le nom de Louis XVIII, émit des
représailles et parla du prochain rétablissement de l’Ancien Régime. Pour sauver la république et eux-mêmes, les thermidoriens
votèrent le décret des deux tiers, les deux tiers des futurs membres du Conseil devraient être élus parmi les conventionnels
sortants, donc tous républicains.
Furieux les royalistes et les modérés de Paris, se soulevèrent, ce fut l’insurrection du 13 Vendémiaire an IV (5 oct. 1795). Mais
le général Bonaparte, à qui Barras avait confié les troupes de Paris, les dispersa.
La Convention revint à une politique de défense républicaine : elle prit des mesures contre les prêtres réfractaires, les parents
des émigrés et les Vendémiairistes. Quelques semaines plus tard la Convention se sépara.
II. L’œuvre de la convention
Malgré tous les problèmes de la France, la Convention eut le temps de discuter de l’organisation de la France. Elle siégeait
sans arrêt et jusque tard dans la nuit, et certains membres, même les plus robustes s’y épuisaient. A l’exemple de la
Constituante et de la Législative, la Convention créa un certain nombre de Comités, chargés de discuter des sujets avant qu’ils
soient présentés aux séances de la Convention. Il y avait en dehors des Comités de Salut Public et de Sûreté générale, les
comités de Constitution, des Finances, de Législation, d’Instruction Publique.
Avant le 9 thermidor les décisions était d’inspiration démocratique et égalitaire, après, elle furent d’inspiration nettement
bourgeoise.
La tâche la plus lourde était celle du Comité des Finances dirigé jusqu’en 1795 par Cambon. Malgré les efforts, la situation
financière s’aggrava. Les sommes dépensées pour la guerre étaient énormes, les français ayant une certaine mauvaise volonté
à payer leur impôts contraignirent le Trésor à l’inflation. L’accroissement énorme des assignats devait entrainer leur
dépréciation. Le Comité tenta de la ralentir. Compte tenu de la concurrence entre la monnaie et le billet, le Comité décida que
l’assignat serait la seule monnaie légale et les particuliers durent donner tout leur or à l’Etat pour régler leurs achats à l’étranger.
Le meilleur moyen pour faire remonter les assignats jusqu’au trésor était de diminuer la quantité, pour cela ils les faisaient
remonter au trésor et les détruisaient. Il multiplia les emprunts volontaires ou forcés, parce que ceux-ci devaient être payés en
assignats.

Ces actions permirent en 1793, de stopper la chute des billets. Mais cela reprit en 1794, et fut brutale après le 9 thermidor,
parce que les thermidoriens émirent plus d’assignats que depuis 1790. Cette chute s’accompagna de la hausse du coût de la
vie et de l’instabilité des prix. Alors, les pauvres souffraient d’une réelle misère.
Si le Comité ne put retarder la chute de la monnaie, il prit une décision qui survécut ensuite : le Grand Livre de la Dette publique
(août 1793). On avait mis en commun les dettes de l’Ancien Régime et celles de la Révolution, cette manipulation faisait appel à
un seul intérêt, rallier à la république un certain nombre de rentiers royalistes. Une loi en 1795 décida de l’unité monétaire du
franc.
La Convention travailla le code unique pour toute la France, mais elle n’adopta aucun des projets remarquables que le député
Cambacérès lui présenta. Le code civil ne sera promulgué qu’en 1804 par Bonaparte. En revanche la Convention vota
l’application du système métrique à base décimale. La Convention enleva les registres de l’état civil aux prêtres et les confia
aux municipalités et inaugura la pratique du mariage civil et le mariage religieux devint facultatif. Elle autorisa le divorce, interdit
jusque là par l’église catholique. Elle diminua les droits du père de famille au profit de la femme et des enfants. En 1794, elle
proclama l’émancipation des esclaves aux colonies.
On ne changea rien aux classes sociales et aucune mesure ne fut votée en faveur des classes pauvres si ce n’est par
opportunisme. C’est pour détourner les paysans de s’allier pour une insurrection au lendemain du 2 juin, que les Montagnards
décrétèrent l’abolition totale et sans indemnités de tous les droits féodaux le 17 juillet 1793. Les titres féodaux devaient être
brûlés en présence du Conseil municipal et de tous les citoyens. Ainsi les paysans obtinrent gratuitement contrairement à
d’autres paysans d’Europe la propriété libre et absolue de leurs terres. Par contre la Convention ne prit aucune mesure
concernant les prolétariats des campagnes. Quant aux ouvriers, la Convention leur imposa un maximum de salaires, tandis
qu’elle ne faisait pas observer un maximum de denrées. Elle fit une promesse non tenue faute de fonds sur l’organisation d’une
Assistance publique et enseignement gratuit.
Les assemblées se passionnèrent pour le problème de l’enseignement. Talleyrand et Mirabeau, Concordet, Lakanal, et l’abbé
Grégoire demandaient la création de l’Instruction publique : ils voulaient que l’instruction fasse partie de l’Etat. La question était
d’autant plus pressante que la Révolution avait détruit les ordres religieux qui se chargeaient d’une partie de cet enseignement.
La veille de sa séparation, la Convention vota une loi pour l’instruction publique (oct. 1795), il y aura au moins une école
primaire par canton mais elle ne sera gratuite que pour les indigents. L’enseignement secondaire sera donné dans l’Ecole
Centrale du département. On enseigna plus de matières qu’auparavant, et on écarta l’enseignement religieux. La discipline était
très libérale et on traitait les élèves comme des grands garçons.
La Convention montra encore plus d’intérêt à l’enseignement supérieur. Elle créa et réorganisa la plupart des établissements
scientifiques et Grandes Ecoles d’aujourd’hui. Elle constitua dans chaque chef-lieu une bibliothèque et un dépôt d’archives, elle
ouvrit la collection de tableaux du roi réunie maintenant au Louvre. Enfin elle créa l’institution de France qui devaient être selon
Daunou « l’abrégé du monde savant ».
B) Le directoire (1795-1799)
I. La politique intérieure
A partir du 25 oct. 1795, le directoire composé de cinq membres dirigea la France. Les cinq directeurs étaient d’anciens
conventionnels, ce qui fait que le pouvoir appartenait toujours aux mêmes. Simplement, la République passait d’une phase

révolutionnaire à une phase « de l’égalité constitutionnelle ». Mais la Révolution n’était pas terminée car les directeurs
rencontraient toujours des obstacles d’ordre politique, militaire, financier et moral.
Al’intérieur, les Jacobins et les royalistes menaçaient le Directoire, dont la politique pour éviter le coup d’état était de tirer tantôt
à gauche tantôt à droite. A l’extérieur, la guerre se poursuivait à cause du problème de la reconnaissance de la frontière du
Rhin par l’Autriche et l’Angleterre. Pour gouverner et pour faire la guerre, il fallait de l’argent. Comme la monnaie était dévaluée,
l’Etat n’arrivait plus à rémunérer ses fonctionnaires et la pauvreté s’était installée. Au contraire, certaines personnes possédait
de grandes fortunes et vivaient dans le luxe. De là, la montée croissante des loisirs et plaisirs tels que les bals, les salles de
jeux, les restaurants …
D’ailleurs qu’ils fussent riches ou pauvres les français se désintéressaient des affaires publiques. La guerre et la Révolution les
avaient lassés. Ils étaient devenus indifférents à toutes les affaires politiques, ne les intéressait que leur vie quotidienne.
Les assignats avaient perdu de leur valeur donc une masse énorme de papier-monnaie devait être détruite. Pour les faire
revenir, le gouvernement décida de lancer un emprunt et ainsi de supprimer l’assignat.
Comme il restait beaucoup trop d’assignats, le gouvernement décida de les échanger contre les mandats territoriaux qui durent
être détruits au bout d’un an (fév. 1797). Les spéculateurs en profitèrent pour acheter les domaines de l’Etat à bas prix.
La crise financière persistant, le gouvernement dut céder aux exigences des financiers qui leur demandaient un paiement en
biens nationaux à bas prix. Parfois même ils demandaient l’abandon d’une partie de leur impôts, ils n’hésitaient même pas à
corrompre les fonctionnaires.
N’ayant pas la confiance du peuple, le gouvernement ne put lancer d’emprunt et ce fut la banqueroute partielle. Il créa alors
d’autres impôts, l’impôt sur les portes et fenêtres, et quelques impôts indirects. Le gouvernement se prépara même à faire
payer des contributions directes mais il échoua ; pour Bonaparte la voie était tracée.
Les Jacobins présentèrent le premier danger pour le Directoire. En 1796, alors que les ouvriers criaient famine, éclata la
conspiration des égaux. A leur tête, un dénommé Babeuf réclamait le retour de la Constitution de l’an I et l’établissement d’un
régime communiste. Les « babouvistes » conspirèrent donc pour renverser le Directoire. Les Jacobins s’unirent à ses
babouvistes communistes, mais un des leurs dénonça Babeuf à Carnot, qui le fit exécuter.
C’était la première fois qu’il y avait un complot communiste qui voulait mettre en place une dictature politique.
Les royalistes reprirent alors espoir. Cette menace avait modifié la position du gouvernement. Sous l’influence de Carnot, il
accepta le retour des émigrés et des réfractaires, les royalistes en profitèrent. Ils essayèrent de gagner l’opinion publique sans
coup de force afin de remporter les élections de 1797. Ils rétablirent légalement la monarchie. Ils remportèrent les élections
d’avril 1797 caché sous un parti : « le parti de l’ordre », pour le renouvellement du tiers des conseils.
Dans ces nouveaux conseils, la majorité de droite choisit comme nouveau Directeur un Directeur : Barthélémy.
Il s’en suivit un conflit entre la majorité du conseil et la majorité du Directoire. Il fallait le résoudre par la force, les trois Directeurs
menacés firent le coup d’Etat du 18 Fructidor an V (4sept. 1797).
Les généraux les plus illustres Hoche et Bonaparte acceptèrent de donner à Augereau le commandement de la division militaire
de Paris.
Augereau fit arrêter Barthélémy et Carnot s’enfuit. Réunie d’urgence, la minorité républicaine des Conseils annula entre autres
les élections dans 49 départements.
La République était sauvée, à l’aide d’un coup d’Etat militaire mais en violation de la légalité.

La répression du mouvement royaliste profita aux Jacobins, ils remportèrent les élections législatives de 1798. Le problème est
que les Directeurs ne voulaient pas plus d’une majorité Jacobine que d’une majorité royaliste. Par un coup d’Etat le 22 floréal
de l’an VI (4 mai 1798), ils annulèrent 98 élections. La constitution de l’an III n’était plus. Le gouvernement exerça une véritable
dictature pendant un an.
Cependant, rien n’avait empêché le réveil de l’activité économique : les cultures étaient bonnes, la production de charbon, etc.
L’industrie française devait être protégée contre la concurrence anglaise, d’où la politique commerciale du Directoire qui
préparait ainsi la voie à Napoléon et à sa politique du blocus continental.
Par ailleurs la guerre continuait, avec une armée désorganisée, avec peu d’effectifs. Les généraux étaient constamment en
conflit avec les commissaires que le Directoire avaient placés auprès d’eux, et certains tel Bonaparte était peu enclins à obéir
au gouvernement.
Au printemps 1799, les élections furent un échec pour le gouvernement face à deux adversaires : les révisionnistes favorables à
une révision de la Constitution et les Néo-jacobins républicains qui ne pardonnaient pas entre autre au Directoire d’avoir fait
contre eux le coup d’Etat de Floréal. Ces derniers décidèrent les Conseils à se débarrasser de trois Directeurs, c’était le coup
d’Etat du 30 Prairial (18 juin 1799). Un nouveau coup d’Etat allait régler définitivement le sort du Directoire, ce fut le coup d’Etat
du 19 Brumaire. Il était l’œuvre d’un jeune général victorieux en Italie et en Egypte, Napoléon Bonaparte.
II. Le coup d’Etat du 18 brumaire et la fin du directoire.
Bonaparte était un officier singulier, il espérait se tailler un rôle à la faveur de la Révolution car il était ambitieux et ardent
patriote. Il avait essayé de s’opposer aux adversaires de la Convention quand ils avaient décidé de livrer la Corse aux anglais.
Menacé de mort il s’était enfuit et seulement alors il s’était vraiment senti français. Montagnard, dès 1793 il devient général,
grade qu’il perdra par la suite pour avoir déserté en Vendée. Le 13 Vendémiaire (oct. 1795), il est choisi par Barras pour
triompher de l’insurrection royaliste. C’est cette journée qui décida en partie de sa fortune. Il obtient le commandement en chef
de l’armée d’Italie.
La campagne d’Italie révéla le génie militaire de Bonaparte. Bien que indociles et pillards, ses soldats accomplissaient des
prodiges. Mais les plans de campagne était l’œuvre personnelle de Bonaparte. Il n’était pas seulement un grand homme de
guerre, il avait travaillé plus pour lui que pour la France, il avait agi en maître. L’Orient le hantait, il rêvait d’y accomplir des
exploits prodigieux et d’y établir l’hégémonie française comme il l’avait fait dans la Méditerranée.
Après la campagne d’Italie, Bonaparte proposa au Directoire et lui fit accepter l’idée d’une expédition en Egypte. L’expédition
permettrait de dominer la Méditerranée, ouvrirait au commerce français la route de la Mer Rouge, constituerait une magnifique
colonie et fournirait une excellente base pour ruiner la domination et le commerce anglais dans l’Inde. Bonaparte était
enthousiasmé, il s’embarqua en mai 1798 avec 40 000 hommes. Il multiplia les victoires et réorganisa le pays.
La guerre avait recommencé par la faute du Directoire, à la suite de sa politique d’annexions qu’il avait pratiquée au cours de
l’année 1798. L’Europe était indignée, la Turquie, l’Autriche, le royaume de Naples et la Russie, s’allièrent à l’Angleterre pour
former la seconde coalition. Le Directoire l’emporta dès le début, malgré la supériorité des ennemis. Au mois d’oct. 1799,
Bonaparte arrive pour se mêler à la lutte des parties, s’élever au dessus d’eux et s’emparer du pouvoir.
 6
6
1
/
6
100%