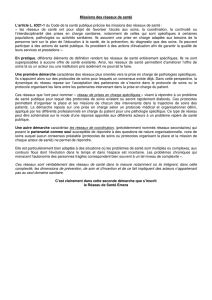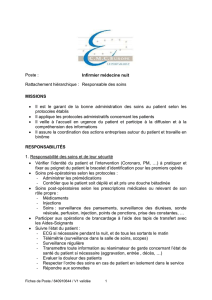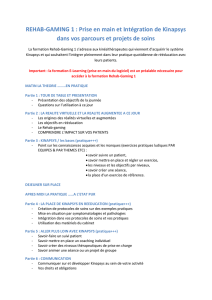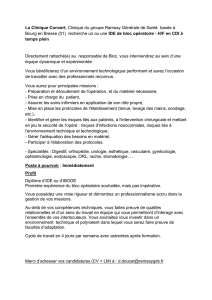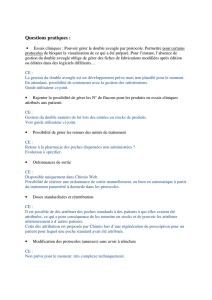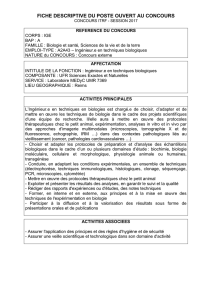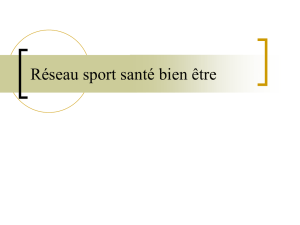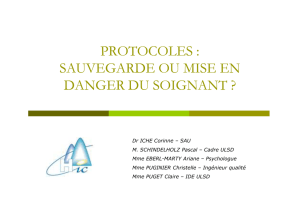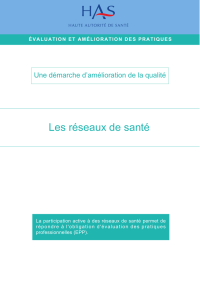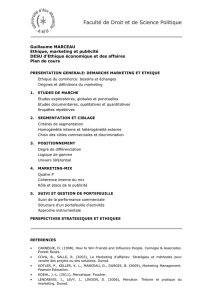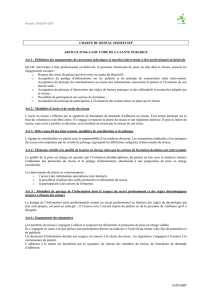Doit-on inclure les patients dans les protocoles

Doit-on inclure les patients
dans les protocoles ?
Tr
es souvent, lorsque nous
rencontrons une personne
malade et que nous nous posons
la question de l’orientation th
era-
peutique, l’interrogation qui nous
vient imm
ediatement en t^
ete est
« dans quel protocole vais-je pouvoir
l’inclure ? ». Cette id
ee premi
ere
que tout patient doit ^
etre rattach
e
a un protocole n’est pas neutre, elle
est le fruit d’un long conditionne-
ment. Nous sommes structur
es
et construits autour de l’opinion
que la recherche clinique, particu-
li
erement dans les centres hospita-
liers universitaires, fonde notre
pratique. En h
ematologie, le pour-
centage de patients inclus dans des
protocoles est de l’ordre de 17 %
[1] avec une fr
equence particuli
ere
dans certaines pathologies : 30 %
des malades pour les lymphomes,
my
elomes et LLC dans le cadre des
grands groupes coop
eratifs, et
jusqu’
a 70 % pour les leuc
emies
aigu€
es. Quels sont les m
ecanismes
qui nous poussent
a vouloir, en
premi
ere intention, proposer un pro-
tocole th
erapeutique et cette fac¸on
d’op
erer est-elle et doit-elle ^
etre
g
en
eralisable ? Pour souligner cette
intrication du soin et de la recherche,
Canguilhem affirmait : « soigner c’est
faire l’exp
erience, accepter de soi-
gner, c’est de plus en plus aujourd’hui,
accepter d’exp
erimenter sous une
responsabilit
e finale rigoureuse-
ment sanctionn
ee, les m
edecins
ont toujours exp
eriment
eence
sens qu’ils ont toujours attendu un
enseignement de leurs actions »
[2].
Difficulte´s pour le me´decin
Les protocoles th
erapeutiques consti-
tuent certainement un progr
es majeur
dans l’histoire
epist
emologique de la
m
edecine, mais la recherche clinique
rencontre un certain nombre de
limites pratiques et th
eoriques dont
il pourrait ^
etre utile d’^
etre conscient.
En premier lieu, il convient de se
poser la question de ce qui nous
motive
a inclure un patient dans un
protocole. Notre but est-il de faire
avancer la connaissance m
edicale ?
D’offrir
a notre patient le meilleur
traitement possible ? Voire potentiel-
lement l’acc
es
a une innovation ?
Mais d’autres arguments plus trou-
bles pourraient
egalement intervenir
de fac¸on plus ou moins consciente
dans notre r
eflexion, tels la recherche
de reconnaissance pour soi ou
l’institution, l’attrait des incitations
financi
eres [3] ou encore une certaine
d
eresponsabilisation, en tant que
prescripteur, li
ee au formalisme du
protocole. L’ensemble est pond
er
e
par la perception que nous avons de
l’importance de la recherche clinique
formelle et de son int
er^
et pour la
communaut
e scientifique. Cet
etat
de fait a pu ^
etre r
esum
e ainsi par le Pr
Zittoun : « On en vient
a constater
que l’int
er^
et que manifestent les
cliniciens envers leurs malades est
fonction de leur int
egration dans les
protocoles du service et les essais en
cours » [4].
En miroir, les obstacles
a l’inclusion
des patients dans les protocoles
ont
et
e largement
etudi
es, et les
r
eticences peuvent aussi bien se situer
H
ematologie
Tir
es
a part : S. Malak
Pour citer cet article : Malak S. Doit-on inclure les patients dans les protocoles ? H
ematologie
2014 ; 20 : 69-72. doi : 10.1684/hma.2013.0863
Publie´ dans He´matologie
vol. 16, n
o
2, mars-avril
2010
Sandra Malak
Membre de la Commission d’
ethique
de la Soci
et
e franc¸aise d’h
ematologie ;
Chef de clinique, Service d’h
ematologie
clinique, H^
opital Saint-Antoine, 184 rue
du faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris ;
et D
epartement de recherche en
ethique,
Universit
e Paris-Sud 11, 63 rue
Gabriel-P
eri, 94278 Le Kremlin-Bic^
etre
doi: 10.1684/hma.2013.0863
69
H
ematologie
vol. 20 n8suppl
ement 1, mars 2014
0 ans de la commission d’
ethique de la SFH1
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

du c^
ot
e du patient que du prescripteur. Les m
edecins vont
^
etre notamment sensibles
a la contrainte temporelle que
repr
esente le protocole th
erapeutique, qui empi
etera bien
souvent sur le temps d
evolu aux autres activit
es de soins,
et se fera donc potentiellement au d
etriment d’autres
personnes malades. En outre, il peut exister des difficult
es de
fonctionnement d’
equipe, mettant en cause la capacit
e
ag
erer la lourdeur logistique des protocoles : manque
d’habitude des
equipes, manque de personnel d
edi
e,
manque d’exp
erience dans la recherche. La question de
la responsabilit
e n’est pas neutre, dans un contexte de
judiciarisation des pratiques, la crainte de telle ou telle
consid
eration ou l’interpr
etation qu’on peut en faire, pourra
nous amener
a prendre la d
ecision que nous jugeons la plus
propre
a nous apporter la s
ecurit
em
edico-l
egale. La rigueur
et le formalisme du protocole pourraient donc apparaı
ˆtre
s
ecurisants, mais il faut bien avoir en t^
ete que ni le
consentement, ni la coll
egialit
e, ne peuvent en aucun cas
d
elester le m
edecin de sa responsabilit
e propre. A contrario,
certains m
edecins particuli
erement attach
es
a leur libert
ede
prescription pourraient vivre l’inclusion dans un protocole
comme une entrave, avec la perte du pouvoir de d
ecision, la
n
ecessit
ed’adh
erer
a des proc
edures rigides avec l’obliga-
tion de rendre des comptes
a des tiers. Par ailleurs, la place
essentielle de la recherche en g
en
eral, et en l’occurrence
clinique dans l’
evolution carri
erale hospitali
ere, est certai-
nement un facteur nous poussant
a inclure le plus grand
nombre de patients possible dans des protocoles. L’impres-
sion est grande que bien plus que notre capacit
e clinique
ou de p
edagogie, c’est la capacit
e que nous aurons
a mener,
ou tout du moins
a participer,
a des publications qui sera
le moteur de la carri
ere universitaire ou parfois m^
eme
hospitali
ere. Dans ce contexte, le choix d’inclure ou non un
patient sera souvent entach
e de mobiles propres.
Dans d’autres cas, nous pouvons nous trouver dans une
situation o
u il est difficile d’allier
a la fois le r^
ole de
th
erapeute et celui d’investigateur avec un possible conflit
entre ces deux aspects de la pratique m
edicale. Des
exemples illustrant ces situations sont la possibilit
e
d’inclusion dans un protocole dont la question pos
ee
nous semble d
esu
ete, l’inqui
etude que nous pouvons avoir
concernant la toxicit
e d’un traitement, la pr
ef
erence
personnelle pour l’un des traitements, la r
eticence
a
recruter des patients dans un essai comprenant un bras
sans traitement, la restriction de la capacit
e d’individualisa-
tion du soin, ou encore l’inflation d’examens sans b
en
efice
direct pour la personne malade.
Difficulte´s pour le malade
Le risque serait que la d
ecision th
erapeutique soit plus
orient
ee vers le b
en
efice de la recherche que celui de la
personne malade. Dans toute recherche il y a une certaine
instrumentalisation du sujet de recherche, qui risque d’^
etre
trait
e comme un simple objet, et non pas comme une
personne [5]. Une partie de la solution pourrait se trouver
dans la r
egle kantienne absolue, selon laquelle l’autre doit
^
etre toujours trait
e « comme une fin en soi, et jamais
comme un moyen ». La d
eclaration d’Helsinki qui
edicte les
principes
ethiques applicables aux recherches m
edicales
sur des sujets humains affirme : « Dans la recherche
m
edicale sur les sujets humains, les int
er^
ets de la science et
de la soci
et
e ne doivent jamais pr
evaloir sur le bien-^
etre du
sujet » [6]. De plus, l’inclusion dans un essai n
ecessite
de pouvoir donner un consentement libre, mais les fortes
implications de la relation th
erapeutique et le sentiment de
d
ependance ressenti par une personne malade vis-
a-vis de
son m
edecin, font qu’il est difficile d’exercer sa libert
ede
choix quand soins et recherches sont aussi
etroitement li
es.
Le consentement est un
el
ement fondateur de l’
ethique de
la recherche clinique. Celle-ci est apparue indispensable
dans les suites de la seconde guerre mondiale et s’est
construite en r
eaction aux atrocit
es commises lors
d’exp
erimentations humaines pass
ees. Elle s’est impos
ee
comme une mesure
ethique indispensable au respect de la
personne impliqu
ee dans une recherche biom
edicale, lui
rendant la parole, de fac¸on
a ce qu’elle puisse exercer son
autonomie. Tous les codes
ethiques et les recommanda-
tions l’
edictent comme principe essentiel
a toute d
emarche
exp
erimentale impliquant des ^
etres humains. Le premier
principe du Code de Nuremberg est r
edig
e dans les termes
suivants :« le consentement volontaire de l’^
etre humain
est absolument essentiel ». Il a m^
eme
et
e compl
et
e
en sp
ecifiant qu’« il faut que la volont
e soit pleine et
autonome, que la personne soit parfaitement consciente
des implications de sa participation
a la recherche. Le
consentement le plus authentique est donc celui qui est
donn
e en pleine connaissance des objectifs, des m
ethodes
et des effets possibles de la recherche » [7]. Mais bien
souvent, nous nous retrouvons face
a des personnes en
situation de grande fragilit
e, pour lesquelles « consentir
a
un acte th
erapeutique se fait dans l’
emotion, la souffrance,
le d
esarroi et l’urgence, sans v
eritable compr
ehension
de la port
ee de la d
ecision » [8]. Peut-on alors parler
de consentement ? Et quelles sont donc les raisons qui
poussent quelqu’un
a participer
a une recherche ? « Parce
qu’il a confiance en ce m
edecin ou en la m
edecine ? Par
d
esir de plaire au m
edecin ? Par d
esir de contribuer
a
l’avancement de la science ? Par go^
ut du risque ? » [9].En
outre, la recherche clinique constitue la voie privil
egi
ee
d’acc
es
a l’innovation. Pour une personne qui pr
esente une
pathologie pour laquelle il n’existe pas de traitement de
r
ef
erence et dont la seule possibilit
eth
erapeutique se
trouve dans l’acc
es
a un protocole, peut-on encore parler
de libert
e de participation, si on ne lui offre pas la possibilit
e
d’acc
es
a l’innovation en dehors de ce protocole ? [10].
Nous nous retrouvons donc certainement, malgr
e les
70 H
ematologie
vol. 20 n8suppl
ement 1, mars 2014
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

enonc
es d
eontologiques, dans une situation d’asym
etrie ;
et bien souvent on se rend compte que dans le cadre
de la relation th
erapeutique, le principal n’est pas le
consentement lui-m^
eme, l’accord ou le refus, mais la
parole rendue et
echang
ee. L’avantage pour la personne
malade pourra pourtant se retrouver dans la s
ecurit
e
m
ethodologique li
ee au protocole, s
ecurit
e d’une
etude
multicentrique sur les motivations des investigateurs, leur
consensus et les espoirs attendus, s
ecurit
evis-
a-vis de la
toxicit
e par les mesures de pharmacovigilance et la veille
sanitaire, validation des donn
ees, et au moindre doute,
obtention de r
esultats globaux imm
ediats. Anecdotique-
ment, il est souvent dit que les patients inclus dans les
protocoles, toute situation
egale par ailleurs, auraient
un meilleur pronostic, mais
a ce jour cette assertion n’a
pas pu ^
etre v
erifi
ee [11].
Le dialogue sur la participation ou non
a une recherche ne
peut se faire sans une information adapt
ee. Et celle-ci dans
le cadre de la recherche clinique n’est pas sans poser
probl
eme. Malgr
e les explications et les
echanges, quand
nous devons donner la feuille d’information contenant
tous les effets secondaires possibles des traitements de
r
ef
erence et des traitements exp
erimentaux, combien de
fois observons-nous un mouvement de recul de la part des
patients, li
e
a l’incompr
ehension de ces informations qui
malgr
e tout le soin qu’on peut y apporter restent d’une
grande brutalit
e pour la personne qui se voit d
ej
a en subir
les effets. Cette fac¸on de faire est souvent en conflit avec
les pr
ecautions d’annonce que les bonnes pratiques
nous dictent et la possibilit
eder
ealiser une annonce
en plusieurs
etapes. Faut-il « toujours dire toute la v
erit
e
a
tous les malades » [9]. La tentation que peut avoir le
m
edecin de « tout dire » pourrait se confondre avec le
d
esir de se d
echarger d’un lourd fardeau, voire de se
d
efausser de toute responsabilit
e sur l’avenir de ce
malade. Le m
edecin, en informant, doit prendre garde
a ne pas entacher cette information de ses propres mobiles
psychologiques, sociaux ou culturels qui pourraient
parasiter le message, mais il est certain que plus le projet
propos
e nous semblera adapt
e, plus nous y adh
erons,
plus le raisonnement ayant amen
e
acetted
ecision nous
semble coh
erent et fruit d’une d
elib
eration sereine, plus le
partage de l’information sera ais
e et plus grande sera
l’adh
esion du patient.
Limites des protocoles
Ces diff
erentes questions ne peuvent se poser que pour les
patients potentiellement incluables dans les protocoles,
mais il n’est pas toujours possible de trouver un essai
a
proposer
a notre patient, soit parce que la pathologie dont
il souffre est peu courante, soit parce qu’il n’y a pas de
centre investigateur
a proximit
e du centre de traitement,
soit encore, parce qu’il n’y a pas d’essai ouvert
ace
moment donn
e pour cette pathologie. Mais, m^
eme quand
un essai clinique est a priori accessible, l’inclusion d’un
patient n’est pas toujours possible, il sera souvent exclu, du
fait de comorbidit
es, de l’
etat d’avancement de la maladie,
d’un ^
age inad
equat, ou d’un
etat g
en
eral trop pr
ecaire
[12]. En effet, seule une minorit
e de personnes –les
patients les plus en forme et souvent ayant une maladie
a un stade initial de prise en charge –est
eligible pour
la recherche clinique. Ce sont ceux pour lesquels un
maximum de b
en
efice est attendu, et qui ne risquent donc
pas de compromettre le r
esultat de l’
etude par une
evolutivit
e trop grande de la maladie ou des effets
secondaires trop importants.
En l’absence d’essai ouvert, constatant ce manque, les
m
edecins pourraient initier un nouvel essai avec un objectif
ad
equat
a proposer
a notre patient mais, les d
elais des
diff
erentes d
emarches, notamment aupr
es des instances
de r
egulation et des comit
es d’
ethique, sont incompatibles
avec une
evolution de la maladie
al’
echelon individuel.
Devant une pathologie tumorale
evolutive, il est inconce-
vable d’entreprendre la cr
eation d’un essai clinique qui
pourrait b
en
eficier
a notre patient, la r
eponse ne sera que
diff
er
ee et collective. Le concept de protocole n’est
d’ailleurs pas univoque. La situation est
eminemment
diff
erente en fonction des objectifs poursuivis et de ses
concepteurs. S’il s’agit d’un protocole de recherche
acad
emique multicentrique conc¸u par les repr
esentants
de la majorit
e des investigateurs d’une discipline sur tout le
territoire national, les enjeux apparaissent plus clairement
pour les malades qui y participent et pour les investigateurs.
Le plus souvent, ils repr
esenteront le r
ef
erentiel th
erapeu-
tique du meilleur traitement. S’il s’agit d’un protocole
« Essais pr
ecoces », il s’adresse
a des malades en fin de
ressources th
erapeutiques, c’est une chance qu’on peut
leur donner avec une nouvelle mol
ecule, mais c’est aussi
des effets secondaires majeurs et une qualit
e de vie alt
er
ee,
la limite avec la phase terminale
etant
etroite. Quant aux
protocoles
a vis
ee biologique, ils n’interviennent, le plus
fr
equemment, que par les contraintes qu’ils entraı
ˆnent
pour les malades sans que ceux-ci n’en tirent directement
b
en
efice.
A l’oppos
e de ces essais coop
eratifs, se situent les
protocoles g
er
es par l’industrie pharmaceutique dont
l’int
er^
et est souvent scientifique mais dont la finalit
e est
aussi commerciale pour le d
eveloppement d’un nouveau
m
edicament ou l’obtention d’AMM. L’int
er^
et pour l’inves-
tigateur pourra ^
etre financier, en plus d’^
etre m
edical, et son
champ d’intervention est quasiment nul. C’est dans le
cadre de ces protocoles qu’il est le plus difficile de
d
eterminer les enjeux, tant parfois le v
eritable moteur de la
recherche semble nous
echapper. Par ailleurs, la question
m^
eme de la m
ethodologie et de la statistique pourrait ^
etre
interrog
ee. La recherche clinique en g
en
eral et th
erapeu-
tique telle que nous la pratiquons aujourd’hui est
71
H
ematologie
vol. 20 n8suppl
ement 1, mars 2014
Doit-on inclure les patients dans les protocoles ?
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

certainement une avanc
ee majeure. L’evidence based-
medicine permet de peser scientifiquement nos d
ecisions,
en s’affranchissant d’un empirisme p
etri de croyances. Elle
apporte une plus grande objectivit
e dans les pratiques [13].
Il s’agit-l
a d’une avanc
ee majeure et elle devrait nous faire
passer « de la m
edecine exp
erimentale
alam
edecine
scientifique » [14]. Nous incluons dans des protocoles
parce que nous avons l’esp
erance et la croyance que de ce
type d’
etude pourra d
ecouler la meilleure prise en charge
possible. Il n’est pas rare de voir des
echanges au cours des
r
eunions de concertation pluridisciplinaire se r
esumer
a des
confrontations d’articles o
u les pourcentages sont avanc
es
telles des v
erit
es d
efinitives devant emporter la d
ecision et
dicter le destin du patient. L’
etude randomis
ee devient ainsi
d
etentrice de la preuve absolue. Elle accepte la dimension
de l’incertitude statistique, mais r
efute dans son essence
m^
eme la pr
esomption improuvable, alors qu’un certain
nombre de champs sont aujourd’hui encore tr
es difficile-
ment
etudi
es par des essais randomis
es parmi lesquels : les
traitements consid
er
es efficaces par sagesse convention-
nelle, par exemple la chirurgie du cancer, les maladies de
trop faible pr
evalence comme les maladies orphelines, des
traitements dont l’impact est perc¸u comme trop faible ou
trop important [15]... Il est essentiel de se rappeler qu’il
s’agit avant tout d’une m
ethode d’aide
alad
ecision
th
erapeutique, et en tant que telle, elle connaı
ˆt bien
evidemment de nombreuses limites, intrins
eques et
d’applicabilit
e. En conclusion, il est certain que la recherche
clinique formelle est source d’enseignements rigoureux, et
permet une
evaluation fiable. Mais le formalisme ne semble
pas adapt
e
a toutes les situations et la recherche ne peut
^
etre une fin en soi. Elle devra r
epondre
a la double exigence
du soin et de la recherche, notre but de th
erapeute
etant la
meilleure prise en charge possible de notre malade qui doit
rester la finalit
e premi
ere et ne peut se faire sans un
examen de nos motivations.
Conflit d’int
er^
ets : aucun.
Re´fe´rences
1. Inca. Plan d’action 2010 : Recherche. 04/02/2010.
2. Canguilhem G. Le Normal et le pathologique. Paris : PUF, 1966
3. Hirsh J, Guyatt G. Clinical experts or methodologists to write clinicalgui-
delines? Lancet 2009 ; 374 : 273-5.
4. Zittoun R. Donner leur juste place a la clinique et aux soins en h
ematologie.
Paris : Commission d’
ethique de la SFH, 2009.
5. Rodriguez-Arias D. Recherche biom
edicale et populations vulnerables. Paris :
L’Harmattan, 2006
6. Article 5. Principes
ethiques applicables a la recherche medicale impliquant
des etres humains. Declaration d’Helsinki. Association Mondiale Medicale ; juin
1964, amendeea Seoul2008 (disponible sur : http://www.wma.net/fr/30publi-
cations/10policies /b3/index.html).
7. Jonas H. Le principe responsabilit
e, une
ethique pour la civilisation
technologique. Paris : Flammarion, 2001
8. Hirsch E, Pytkwicz P. Le consentement.
Ethique et soins hospitaliers Espace
ethique - Travaux 1997-1999. Paris : AP-HP/Doin, 2001
9. Jouet JP. L’illusion du choix. Les relations asym
etriques. Paris : Commission
d’
ethique de la SFH, 2005
10. Ameisen J, Hirsch E. Le traitement compassionnel. Medecine/Sciences
2005 ; 21 : 102-5.
11. Peppercorn JM, Weeks JC, Cook EF, Joffe S. Comparison of outcomes in
cancer patients treated within and outside clinical trials: conceptualframework
and structured review. Lancet 2004 ; 363 : 263-70.
12. Townsley CA, Selby R, Siu LL. Systematic Review of Barriers to the
Recruitment of Older Patients With Cancer Onto? Clinica Trials. J Clin Oncol
2005 ; 23 : 3112-24.
13. Fourrier L. Evidence based Medicine. In : Dictionnaire de la penseemedicale.
Paris : PUF, 2005.
14. Bernard C. Introduction
al’
etude de la m
edecine exp
erimentale. Paris :
Flammarion, 1997
15. Cook D. Evidence-based Critical Care Medicine. A potential tool for change.
New Horiz 1998 ; 6 : 20-5.
72 H
ematologie
vol. 20 n8suppl
ement 1, mars 2014
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
4
100%