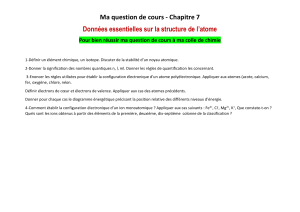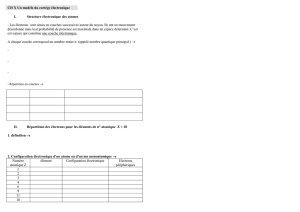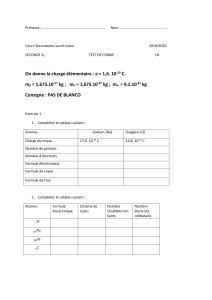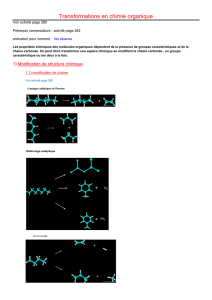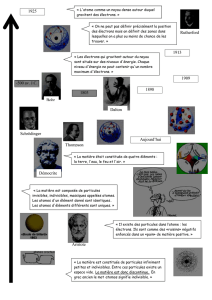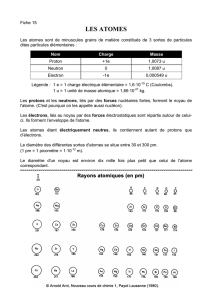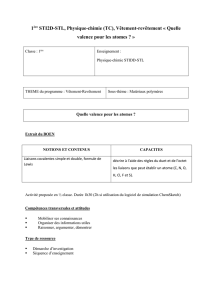La liaison chimique

La liaison chimique
Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 1
I] Introduction
Les atomes peuvent interagir de plusieurs façons pour former des agrégats. Grâce à des
exemples spécifiques, nous illustrerons les différents types de liaisons chimiques.
I-/ Liaison chimique (seulement évoquée)
Lorsque le chlorure de sodium NaCl est dissous dans l’eau, il conduit l’électricité, ce qui
montre qu’il est constitué d’ions Na+ et Cl-.
Quand le sodium et le chlore réagissent, pour former NaCl, il y a transfert d’électrons entre
les atomes de sodium et de chlore, ce qui entraîne la formation d’ions Na+ et Cl-, qui s’agrègent pour
former NaCl solide.
Le système a atteint le plus bas niveau énergétique possible.
Le caractère très électronégatif de l’atome de chlore, le caractère très électropositif de
l’atome de sodium et la très grande force d’attraction entre des ions très rapprochés et de charges
opposées constituent la force agissante de ce processus.
On a là un exemple de liaison ionique.
Quand la différence d’électronégativité est au moins supérieure à 2, les deux électrons sont
entièrement accaparés par l’atome le plus électronégatif : on forme alors une liaison ionique.
Il y a transfert d’électrons d’un atome vers un autre atome et on a alors formation d’ions
parfaitement individualisés. La liaison ne s’effectue plus par mise en commun de deux électrons,
mais est due à une attraction électrostatique entre charges de signes opposés.
Les liaisons ioniques sont moins solides que les liaisons covalentes.
Il y a formation d’un composé ionique quand un atome très électronégatif réagit avec un
atome très électropositif. En d’autres termes, un composé ionique est le résultat de la réaction d’un
métal avec un non-métal.
Dans la liaison ionique, il y a transfert complet du
doublet de liaison vers l’atome le plus électronégatif.
Ce type de liaison ne fait pas l’objet de ce cours.
Mais comment une force de liaison peut elle exister entre deux atomes atomiques ?
I-/ Liaison covalente
Prenons l’exemple de la molécule de dihydrogène 2.
Entre deux atomes H, il peut à priori se manifester 2 types d’interactions :
Des forces de répulsion électron-électron et noyau-noyau (proton-proton), facteur
défavorable à la formation de liaison.
Des forces d’attraction entre l’électron de l’un et le noyau de l’autre, facteur
favorable à la formation de liaison.

La liaison chimique
Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 2
Il y aura formation de liaison entre les deux atomes d’hydrogène si l’énergie totale du
système 2 diminue par rapport à celle des atomes H isolés.
Si deux atomes d’hydrogène se rapprochent, ils vont d’abord s’attirer, puis se repousser.
C’est ce que l’on voit lorsque l’on représente la variation de l’énergie potentielle de deux
atomes d’hydrogène en fonction de la distance qui les sépare ;
Au fur et à
mesure que les deux
atomes se rapprochent
l’un de l’autre,
l’énergie diminue,
jusqu’à ce que la
distance soit de
0,74.
Ensuite, elle
augmente en raison de
la répulsion que les
deux noyaux exercent
l’un sur l’autre.
On voit que, pour une distance déterminée égale à 0,74, l’énergie potentielle est
minimale, ce qui correspond à un état stable selon le principe de la thermodynamique.
l’état le plus stable, pour deux atomes d’hydrogène, correspond à la formation d’une
molécule , avec une distance interatomique – ou internucléaire – d = ,.
Cette distance est la longueur de la liaison chimique H-H, résultant d’une interpénétration
des orbitales atomiques des deux atomes d’hydrogène, qui avaient initialement, à l’état d’atomes
isolés, un rayon atomique 0= 0,53.
Ce type de liaison, où la distribution électronique le long de la liaison est parfaitement
symétrique, est appelé liaison covalente.
La liaison covalente parfaite est établie par mise en commun de deux électrons, chacun
appartenant à un atome. Les 2 atomes se partagent les électrons de façon égale. Ils sont identiques
ou de même électronégativité.
La moitié de la distance interatomique correspond au rayon covalent de l’atome
d’hydrogène, c'est-à-dire au rayon de l’atome d’hydrogène lorsqu’il est engagé dans une liaison
covalente.
L’énergie correspondante mise en jeu 458 .1 est l’énergie libérée quand la
molécule se forme. On parle de EP, énergie de liaison +458 .1 : c’est l’énergie qu’il faut
fournir pour casser la liaison dans la molécule gazeuse 2 et obtenir deux électrons H isolés gazeux.
I-/ Liaison covalente polaire

La liaison chimique
Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 3
Entre ces deux types de liaisons, qui sont des cas extrêmes, on trouve des cas
intermédiaires : les atomes n’y sont pas différents au point qu’il y ait transfert complet d’électrons
d’un atome vers l’autre, mais suffisamment différents pour qu’il y ait partage inégal d’électrons.
On a alors une liaison covalente polaire, aussi appelée liaison covalente partielle ou liaison
ionique partielle.
La liaison covalente polarisée présente une dissymétrie de distribution électronique le long
de la liaison : le nuage électronique est déporté vers l’atome le plus électronégatif.
La dissymétrie est d’autant plus grande que la différence d’électronégativité est plus élevée.
La polarisation de la liaison entraîne l’écriture de charges partielles + ou , à l’origine d’un
moment électrique – dit « dipolaire » - permanent.
Exemples : HF, H2O
On ne forme ce type de liaison que si la différence d’électronégativité entre les deux atomes
est faible (<2).
I-/ Liaison covalente dative ou de coordination ou donneur-accepteur
Il existe en fait deux possibilités pour mettre en commun deux électrons :
Soit chaque atome possède 1 électron célibataire (cas de la liaison covalente
polarisée ou non).
Soit un des deux atomes dispose d’une case vide et l’autre d’une case avec une
paire électronique : on a alors une liaison covalente dative ou de coordination ou donneur-
accepteur.
+
Quand on veut préciser la provenance du doublet électronique, on représente la liaison
dative par une flèche dont la pointe est tournée vers l’accepteur. Le plus souvent on ne l’indique pas,
car une fois établie, la liaison dative ne se différencie pas d’une liaison de covalence polarisée. On
pourra également la représenter par ou + .
I-/ Résumé
En résumé, il existe deux types principaux de liaisons : les liaisons atomiques par mise en
commun d’électrons (liaisons de covalence polarisées ou non, liaisons datives) et les liaisons ioniques
par transfert d’électrons.
La liaison covalente et la liaison ionique représentent les deux cas limites de liaisons ; la
plupart des liaisons sont plus ou moins polarisées et peuvent donc être considérées comme des
liaisons intermédiaires entre ces deux types de liaisons extrêmes.
La polarité de la liaison jouant un grand rôle en chimie, il est important de quantifier
l’attraction d’un atome envers les électrons.

La liaison chimique
Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 4
II] Caractère ionique partiel (CIP) d’une liaison polarisée
Dans une molécule de type AB où les atomes A et B ont des électronégativités différentes, la
liaison est une liaison covalente polarisée.
L’attraction électrostatique expérimentale entre les atomes A et B partiellement chargés est
supérieure à celle prévue théoriquement.
Plus la différence d’électronégativité est grande entre A et B, plus le caractère ionique de la
liaison est important. Plus elle est faible, plus le caractère covalent de la liaison est important.
Une molécule AB qui présente un foyer de charge positive et un foyer de charge négative est
dite dipolaire et a un moment dipolaire - moment électrique entre deux pôles -. Placées dans un
champ électrique, ces molécules adoptent une position particulière.
Ce caractère dipolaire est représenté par une flèche dirigée vers le foyer négatif. (en
physique, convention inverse).
Exemple : HCl
On comprend donc que toute liaison de covalence polarisée possèdera un certain caractère
ionique partiel (CIP) suivant la valeur de comprise entre 0 100%× ou 0 100%×.
Le caractère partiel ionique est donné par la relation :
=
= ()
()=
Où est le moment dipolaire théorique que présenterait la liaison si elle était à
100% ionique.
est le moment dipolaire expérimental et est égal à ×
d est la longueur de la liaison
est la charge partielle de chaque atome
e est la charge élémentaire
est exprimé en C.m (Coulomb par mètre) dans la système SI ou D (Debye).
1D = 1029
3 .= 3,34.1030.
Les molécules polyatomiques peuvent également présenter un moment dipolaire.
L’eau, H2O, l’ammoniac NH3, soumises à un champ électrique, se comportent comme si elles
avaient un foyer de charge positive et un de charge négative.

La liaison chimique
Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 5
Certaines molécules ont des liaisons polaires sans présenter toutefois de moment dipolaire.
Ceci se produit quand les polarités des liaisons individuelles sont placées de façon à s’annuler.
Placées dans un champ électrique, ces molécules n’adoptent aucune position particulière.
Exemples : SO3 et CH4
Les électronégativités de S / O / C / H sont respectivement 2,5 / 3,5 / 2,5 et 2,1. Les liaisons
SO et CH sont donc polaires. Mais les moments dipolaires sont disposés de façon symétrique et de
même norme ; ils s’annulent.
III] Théorie des électrons localisés
Nous venons d’étudier les caractéristiques générales de la théorie de la liaison chimique,
appliquées à des liaisons individuelles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%