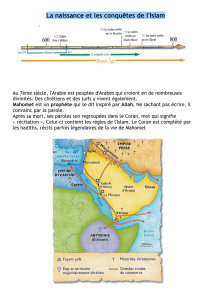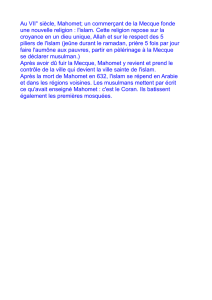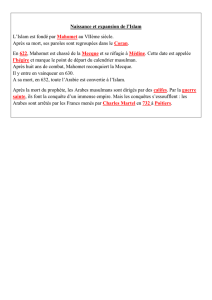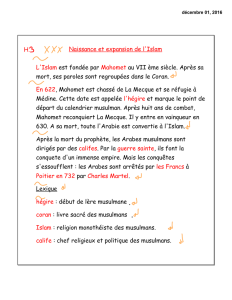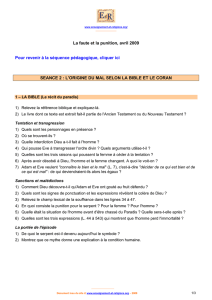Jésus et Mahomet, hommes d`influence - Fichier

| CULTURE & IDÉES | Samedi 5 décembre 2015
0123 | 3
Jésus et Mahomet, hommes d’influence
Jérôme Prieur et Gérard Mordillat. PROD.
propos recueillis par
cécile chambraud
et jérôme gautheret
Coauteurs de trois séries docu-
mentaires consacrées à
l’émergence du christia-
nisme (Corpus Christi, L’Ori-
gine du christianisme, L’Apo-
calypse), Gérard Mordillat et
Jérôme Prieur ont cette fois interrogé le
Coran pour comprendre sur quel « hu-
mus » religieux et théologique il était né.
Leur série, intitulée « Jésus et l’Islam », sera
diffusée sur Arte les 8, 9 et 10 décembre.
Pourquoi, après le « Nouveau Testa-
ment », vous être tournés vers le Coran ?
Gérard Mordillat Nous sommes partis
de l’histoire des judéo-chrétiens, ces lais-
sés-pour-compte qui, chassés de partout,
se sont installés aux premières marches
de ce qui deviendra le berceau de l’islam.
Leur présence est attestée. C’est ainsi que
nous en sommes arrivés au Coran et à la
place tout à fait singulière qu’il fait à Jésus,
prophète et messie dans l’islam, qui se
trouve cité beaucoup plus souvent que
Mahomet lui-même dans le texte. Puis
nous nous sommes mis à travailler.
Comme toujours, nous avons défini un pe-
tit objet : deux versets de la sourate 4 qui
racontent la crucifixion de Jésus. En exa-
minant chaque mot, on a pu tirer tous les
fils qui arrivent jusqu’à l’islam.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
Jérôme Prieur Le Coran est un livre très
compliqué, un texte à la fois clair et obs-
cur. Il n’est pas narratif, pas continu. De-
puis le Moyen Age, les savants musulmans
se perdent en conjectures pour retrouver
l’ordre dans lequel le texte a été révélé, mis
par écrit. Aujourd’hui, personne n’est d’ac-
cord. Autre difficulté : on trouve bien des
inscriptions, des poésies antérieures au
Coran, mais elles ont été mises par écrit
après. Il y a de nombreux textes parallèles
permettant de situer le contexte du Nou-
veau Testament, mais on n’en trouve pas
l’équivalent dans le monde musulman.
En considérant le Coran comme un objet
historique et non simplement comme
la parole de Dieu, êtes-vous conscients
d’avoir abordé des problématiques
qui interfèrent avec l’actualité ?
G. M. On aborde un terrain sensible car,
dogmatiquement, le Coran étant la parole
de Dieu, il ne peut être ni traduit ni com-
menté. Il y a eu cette chose affreuse, la fer-
meture de la pensée critique islamique à
notre XIe siècle, qui à mon avis pèse
aujourd’hui de façon directe ou indirecte
sur la conscience de bien des musulmans.
Mais on s’est rendu compte, avec les cher-
cheurs rencontrés, qu’il y a tout de même
un essor de la recherche.
A-t-il été compliqué de convaincre
les chercheurs de s’exprimer ?
G. M. Non. Nous avons procédé comme
d’habitude. Nous commençons par un im-
portant travail de lecture des textes des
chercheurs. Puis nous leur proposons des
hypothèses sur lesquelles nous leur de-
mandons de réfléchir..
J. P. Notre approche est résolument non
confessionnelle. C’est valable aussi bien
pour le Coran que pour le Nouveau Testa-
ment. Elle n’est pas polémique non plus.
Notre projet est d’envisager le Coran
comme un livre que l’on peut lire en tant
qu’honnête homme.
G. M. A l’image, le sens de ce que disent
les chercheurs est donné autant par la pa-
role que par des signes : les silences, les re-
gards, les hésitations… Le cinéma est un
outil critique exceptionnel : on peut voir
dans l’attitude de quelqu’un quelque
chose qui va au-delà de ce qu’il dit. L’exer-
cice était particulièrement sensible pour
les chercheurs de culture musulmane :
beaucoup sont conscients qu’il est extrê-
mement important, scientifiquement et
politiquement, de remettre de l’intelli-
gence historico-critique dans le question-
nement sur ces textes.
Les chercheurs vous ont-ils parlé de cette
tension entre le savant et le croyant ?
J. P. Oui. Au cours du tournage, un mo-
ment m’a particulièrement marqué. C’est
quand l’un des chercheurs, Suleiman
Mourad, interrogé sur l’auteur du Coran,
commence par répondre : « En tant que
croyant… », puis il ajoute : « En tant que
chercheur, je me dois d’aller plus loin… »
Comment décririez-vous le panorama
de la recherche sur le Coran ?
G. M. Actuellement, il y a deux grands
courants. L’un, qui veut rester dans la pers-
pective de l’analyse des textes par la tradi-
tion musulmane (les hadiths et la sîra,
deux ensembles constitués environ deux
siècles après la mort du prophète), est sur-
tout fort en Allemagne. Pour nombre de
chercheurs, la tradition religieuse devient
une boussole dont il est à peu près impos-
sible de se détacher. Dans l’autre courant,
plutôt représenté aux Etats-Unis et en
France, les chercheurs mènent un travail
historico-critique plus pointu. Ils considè-
rent notamment que l’influence juive, ju-
déo-chrétienne et chrétienne sur l’émer-
gence de Mahomet et les premières consti-
tutions du Coran n’est pas périphérique,
mais au contraire centrale.
Cette ligne de fracture traverse-t-elle le
monde musulman ou y a-t-il une lecture
plus occidentale en face d’une lecture
plus spécifiquement musulmane ?
J. P. Il y a un écart considérable entre le
texte du Coran et ce que dit la tradition.
Dans la lecture par la tradition, dominante
au sein du monde musulman, Mahomet
se serait détaché d’un humus païen, poly-
théiste. A l’inverse, d’autres chercheurs
tendent à montrer que l’apparition de Ma-
homet s’est faite dans un environnement
beaucoup plus compliqué. Ce ne sont pas
des spéculations ; les références affleurent
dans le texte. Ça renverse les perspectives,
et c’est en cela que Jésus n’est pas un per-
sonnage périphérique ou anecdotique,
mais le révélateur d’une tension interne.
Dans votre série, la figure de Mahomet
apparaît en partie comme une
construction politique, ce qui risque
de prêter à controverse…
G. M. Il y a le même écart entre le Maho-
met de l’histoire et celui de la foi qu’entre
le Jésus de l’histoire et celui de la foi. J’aime
beaucoup la formule d’Henri Barbusse qui
disait : « Quand Jésus vivait, il n’y avait pas
de Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ est ap-
paru, il y a longtemps que Jésus était
mort. » On pourrait dire la même chose :
du temps où Mahomet vivait, il n’y avait
pas le Mahomet quasiment déifié de la tra-
dition croyante, et au moment où cette fi-
gure hors du commun a été montrée
comme unique, il y a longtemps que le
vrai Mahomet était mort.
Le Mahomet historique, je pense, est
inatteignable. A partir de la construction
du Dôme du Rocher (692), sur l’inscription
duquel son nom apparaît au côté de celui
de Jésus, on en a fait la figure magnifiée
d’un homme paré de toutes les qualités. Le
même travail a eu lieu avec Jésus, que l’on
a fini par enlever du judaïsme pour en
faire un chrétien. De quoi Mahomet a été
enlevé ? Je n’en sais rien. En tout cas, on en
a fait le musulman par excellence.
J. P. Ce que l’on peut déduire du Coran et
de la tradition musulmane, c’est tout de
même que Mahomet était un chef de
guerre, un chef de tribu, que c’était un exé-
gète, car il avait un grand savoir. Mais il y a
aussi, dans le Coran, un portrait en creux :
Mahomet y est accusé d’être un poète, un
fou qui se dit inspiré de Dieu… Ce qui est
intéressant, tous les épigraphistes et les
numismates nous le disent, c’est que Ma-
homet disparaît complètement pendant
près de soixante-dix ans après sa mort. Il
réapparaît sur une monnaie soixante-six
ans ou soixante-sept ans après, puis sur le
Dôme du Rocher.
Au moment où l’expansion de l’islam
est déjà largement amorcée…
J. P. Cette disparition et cette réappari-
tion montrent qu’à un moment donné le
calife Abd Al-Malik a besoin d’une figure
intermédiaire pour constituer l’islam
comme religion et comme religion d’un
empire naissant. Il faut un intermédiaire
entre Allah et les fidèles, que Jésus aurait
pu être.
G. M. La tradition a historicisé, a in-
venté un personnage.
J. P. Et lui a donné un rôle politique, pas
seulement théologique et guerrier. Il y a
une incarnation dans l’islam qui passe
par Mahomet. C’est une religion qui ne
cesse de dire : « Nous en revenons à un
monothéisme pur, antérieur, que les juifs
ont corrompu, que les chrétiens ont tra-
vesti. » D’où le fait de se revendiquer
d’Abraham, qui permet de « détenir » le
premier des ancêtres, avant les juifs, qui
ont Moïse, et les chrétiens, qui ont Jésus.
Mais en même temps cela permet de
donner un corps à cette figure intermé-
diaire, un corps sans visage, que petit à
petit on ne va plus pouvoir représenter.
Un courant de l’islam prône
aujourd’hui un retour à l’islam des ori-
gines. Mais cette religion des commen-
cements ressemble-t-elle à celle qui est
aujourd’hui fantasmée par ce courant ?
G. M. Le fantasme des origines prôné par
les wahhabites saoudiens n’a rien à voir
avec ce que l’on peut savoir de ce qu’était
l’islam du temps de Mahomet.
J. P. Le Coran conserve les traces de diffé-
rentes virtualités théologiques qui ont
fracturé l’islam naissant. Pour expliquer
l’environnement dans lequel est né l’islam,
il y a la piste des judéo-chrétiens, mais il y a
aussi les querelles théologiques venues du
christianisme.
Quels sont les points communs entre
l’émergence du christianisme et celle
de l’islam ?
J. P. Je dirais le phénomène hérétique. Il
y a une doctrine très simple, le mono-
théisme. Mais on sent qu’elle favorise des
conceptions théologiques très différen-
tes. C’est sa richesse, et aussi sa force
d’implosion.
G. M. Au départ, Jésus et Mahomet sont
inspirés par l’imminence de la fin des
temps. Dieu doit intervenir dans l’his-
toire, tout balayer et établir une sorte de
théocratie universelle. Dans le cas de Jé-
sus, cette attente vient sans doute du fait
qu’Israël est occupé par l’armée ro-
maine, ce qui est perçu comme étant le
signe d’un péché d’Israël vis-à-vis de son
Dieu. Dans le cas de Mahomet, le Coran
permet de penser qu’au départ sa posi-
tion personnelle était difficile à l’inté-
rieur de son clan, voire de sa tribu, puis-
qu’il en sera banni. Son appel à une autre
divinité que celle de la tribu lui permet
de s’imposer.
J. P. Et il y a la dimension politique, sans
laquelle une église ou une religion n’exis-
terait pas. S’il n’y avait pas eu la constitu-
tion d’un empire qui utilisait le Coran
comme un fédérateur, de même que si le
christianisme avait été instrumentalisé
par l’Empire romain, ces religions seraient
des souvenirs aujourd’hui. p
¶
à vo i r
« jé sus
et l’i slam »
de Gérard Mordillat
et Jérôme Prieur.
Série documentaire
en sept épisodes
de 52 minutes.
Sur Arte le mardi
8 décembre à 20 h 55,
le mercredi
9 décembre à 22 h 25
et le jeudi
10 décembre à 22 h 25.
Après leur vaste série
documentaire sur
le christianisme,
les réalisateurs
Jérôme Prieur et
Gérard Mordillat se
penchent sur la place
non négligeable
de Jésus dans le Coran
1
/
1
100%