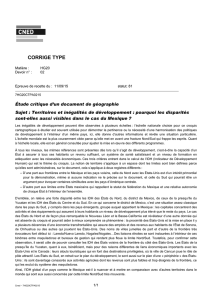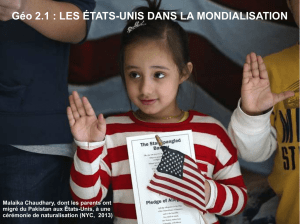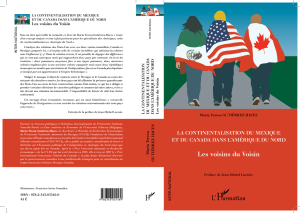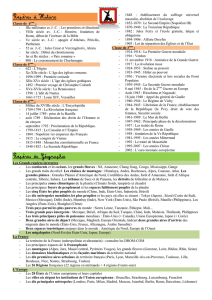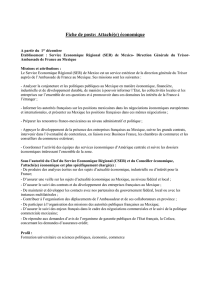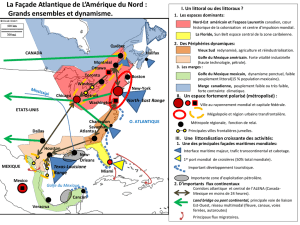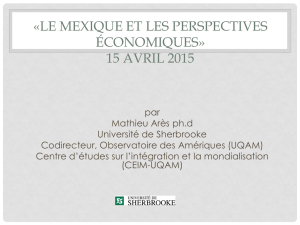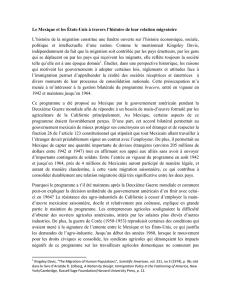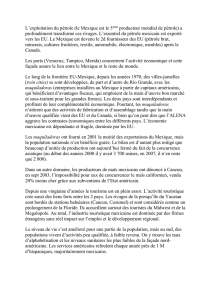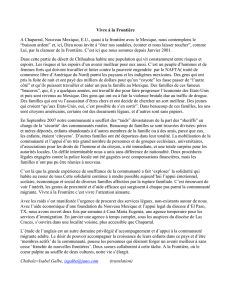Le Canada, les États-Unis, le Mexique et la

Cahiers de recherche sociologique
Document généré le 23 mai 2017 18:46
Cahiers de recherche sociologique
Le Canada, les États-Unis, le Mexique et la
continentalisation de l’économie nord-américaine
Dorval Brunelle et Christian Deblock
L’économie mondiale en mutation Volume 6, numéro
1, Printemps 1988
2 1
9 2 Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Athéna éditions
ISSN 0831-1048 (imprimé)
1923-5771 (numérique)
2 1
9 2 Découvrir la revue
Citer cet article
Dorval Brunelle et Christian Deblock "Le Canada, les États-Unis,
le Mexique et la continentalisation de l’économie nord-
américaine." Cahiers de recherche sociologique 61 (1988): 63–78.
Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services
d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous
pouvez consulter en ligne. [https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-
dutilisation/]
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de
Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la
promotion et la valorisation de la recherche. www.erudit.org
Copyright © Cahiers de recherche sociologique, 1988

Cahiers de recherche sociologique, vol. 6, no 1, printemps 1988
Le Canada, les États-Unis, le
Mexique et la continentalisation
de réconomie nord-américaine
Dorval BRUNELLE et Christian DEBLOCK
La notion de continentalisation, telle qu'elle sera utilisée dans ces
pages,
vise à rendre compte et à cerner deux processus interreliés: le
premier, et le plus déterminant sans doute, renvoie à la reconfiguration
d'une
structure industrielle transnationale à l'intérieur de l'espace
continental, tandis que le second reflète la multiplication et
l'intensification des relations d'échange entre les pays impliqués.
Ainsi définie, l'expression n'est pas originale puisque les auteurs
ont depuis toujours souligné la complémentarité économique, politique
et sociale qui caractérise les rapports entre les États-Unis et le Canada.
Ce qui est relativement nouveau, par contre,
c'est
l'idée
d'adjoindre
désormais le Mexique aux deux autres pays et d'envisager maintenant le
phénomène de la consolidation d'un espace économique et social nord-
américain sous un jour différent, c'est-à-dire en ouvrant le cadre
théorique de façon à tenir compte de l'évolution des trois sociétés
impliquées.
Cet ajout pose un défi à l'analyse, puisqu'il ne
s'agit
pas seulement
d'intégrer à des démarches éprouvées le réseau des échanges que le
Mexique entretient avec les États-Unis et le Canada, il
s'agit
d'abord et
avant tout à cette occasion
de
prendre acte de la nature asymétrique de la
position occupée par le Mexique au sein de l'espace en question. Si le
Canada et les États-Unis comptent parmi les pays les plus développés,
par contre le Mexique appartient au Tiers-Monde: au surplus son
histoire, ses grandes idéologies et ses implications socio-politiques le
rapprochent davantage de l'Amérique latine que de l'Amérique anglo-
saxonne. Toute la question est alors de savoir s'il y a quelque
fondement à vouloir rassembler des cadres socio-économiques aussi
divers autour
d'une
unité qui n'aurait d'assise que géographique.

64 L'économie mondiale en mutation
Schématiquement, deux façons de procéder
s'offrent
à nous ici: on
peut soit chercher à repérer les causes de l'émergence
d'une
économie
politique du continentalisme au sein de l'espace en question, soit évaluer
que certaines transformations internes au Mexique et aux États-Unis
nous obligent désormais à devoir élargir l'acception du terme.
Selon la première démarche, on pourra relever, entre autres choses,
que l'évolution récente de l'économie mondiale a conduit à la formation
de grands blocs géo-économiques, au premier rang desquels figure le
Marché commun européen, que l'activité industrielle et commerciale
s'est
redéployée du côté de la bordure de l'Océan Pacifique et que, en
conséquence, les États-Unis, le Canada tout comme le Mexique seraient
désormais tous trois partie prenante face aux contraintes qui militent en
faveur
de
la formation d'un bloc économique nord-américain. A l'appui
de cette thèse, il faudrait relever l'importance prémonitoire que prend
l'engagement souscrit par le président Reagan lors de sa campagne
électorale de
l'été
1980, de vouloir mener concurremment des
négociations de libre-échange aussi bien avec
le
Canada au nord, qu'avec
le Mexique, au sud. Les deux séries de négociations ont ensuite été
mises en marche respectivement en mars 1985 avec le Canada et en
septembre de la même année avec le
Mexique.
Sur
ce
front, sa politique
aura été couronnée de succès puisque deux accords ont effectivement été
signés, le premier avec le Mexique le 7 novembre
19871,
l'autre avec le
Canada, le 2 janvier 1988, qui jettent tous deux les bases
d'une
entité
qui
s'impose
dorénavant comme un nouveau bloc économique aux yeux
des autres puissances, dont le Japon, en particulier2.
Pourtant, quel que soit le poids des contraintes internationales dans
l'éventuelle consolidation d'un bloc économique nord-américain, il ne
1 W. A. Orme, jr.,
"U.S.,
Mexico Sign Trade Pact Requiring Talks on
Conflict", The Washington Post, 1 novembre 1987, p. D 8. Même si
l'accord, aux dires du représentant au commerce, C. Yeutter, est plus
modeste que ceux que les États-Unis ont signés — ou s'apprêtent à le faire
— avec Israël et avec le Canada, il participe du même esprit et doit leur
être comparé.
Au surplus, l'accord avec le Mexique prévoit que les négociations entre
les deux partenaires sont ouvertes et qu'ils disposent de 90 jours pour
s'entendre autour de sept questions en litige, à savoir: les textiles,
l'agriculture,
l'acier,
les produits électroniques, l'investissement étranger,
la propriété intellectuelle et les industries des services.
2 "North-America vs. Japan?", International Herald Tribune, 12 janvier
1988,
p. 4.

La continentalisation 65
faudrait pas être conduit à minimiser le poids des contraintes infra-
continentales pour autant. Le continentalisme a été une des pièces
maîtresses dans la stratégie reaganienne de reconquête des marchés
d'exportation; durant le deuxième mandat surtout, les déclarations de
Reagan, de son secrétaire
d'État
adjoint aux Affaires interaméricaines,
Elliot Abrams, ou celles du représentant au commerce, Clayton K.
Yeutter, se sont faites de plus en plus précises et convaincantes sur la
question de l'accroissement
de
l'interdépendance entre les États-Unis, le
Mexique et
le
Canada3.
Pour les industriels américains, l'enjeu est de
taille:
non seulement
l'ouverture des frontières élargit le bassin des consommateurs éventuels
de l'ordre de quelque cent millions, mais surtout
elle
permet
de
réduire le
niveau actuel de sous-utilisation de la capacité productive
des
entreprises
domestiques. A terme, bien sûr, une telle voie de développement peut
s'avérer
sans issue si elle conduit à éviter d'aborder le problème posé par
le renouvellement d'un appareil productif
menacé
par l'obsolescence.
Alors,
dans la mesure où la question de savoir s'il faut ou non
recourir à l'adoption de politiques industrielles aux États-Unis polarise
les options et les esprits4, l'ouverture du marché continental
constituerait une réponse exemplaire puisqu'elle correspond d'abord et
avant tout aux canons du libéralisme le plus pur défendu par la Maison-
Blanche
d'une
part, qu'elle équivaut à contourner le problème de
l'adoption
d'une
politique industrielle ensuite en le soumettant
désormais aux exigences
de ce
marché continental de l'autre.
Au surplus, les deux autres partenaires, le Mexique et le Canada,
sont également sensibles à l'évolution des conjonctures internationale et
nationale, avec le résultat que, là aussi, l'option continentale gagne en
crédibilité ainsi que peuvent en témoigner les accords commerciaux
récents signés avec les États-Unis, en même temps que les forts
courants d'opinion favorables aux alternatives dites "néo-libérales" sur
lesquels ces réalignements stratégiques se sont appuyés5.
3 "Crece la interdependencia de Mexico, E.U. y Canada: Abrams",
Finanzas, Mexico, D.F., 5 juin 1987, à la une. Ou encore: "Mexican-
U.S.
Trade Talks", The New York Times, 28 octobre 1987, p. D.7.
4 J.-M. Saussois, "Les USA à la recherche
d'une
politique industrielle",
Revue française de gestion, no 46, juin-juillet-août 1984, pp. 61-69.
5 Pour le Canada, la pièce maîtresse de ce réalignement est le Rapport de
la Commission royale sur l'union économique et les perspectives de

66 L'économie mondiale en mutation
Ces quelques indications font rapidement le tour des facteurs qui
ont présidé à l'émergence
d'une
économie politique du continentalisme.
Mais il subsiste un autre réseau de causes liées plus spécifiquement à
des transformations intervenues de part et d'autre de la frontière
américano-mexicaine, en particulier.
Nous faisons référence ici à plusieurs phénomènes comme
l'émigration légale et illégale des Mexicains en territoire américain et
aux entreprises de sous-traitance — maquila — qui ont refaçonné
l'économie frontalière depuis quelques années. Or, dans la perspective
d'une
ouverture des trois sociétés impliquées, ces transformations
pourraient
s'avérer
lourdes de conséquence dans le processus de
redéploiement économique en cours en Amérique du
Nord.
Et même le
Canada pourrait
s'avérer
touché par cette restructuration depuis que
certains conseillers en investissements proposent désormais d'engager
des
capitaux canadiens
dans
l'exploitation
d'une
main-d'oeuvre mexicaine
à
bon
marché6.
Ces deux ordres de facteurs, les premiers relevant
d'une
économie
politique, les seconds de stratégies ponctuelles d'investissement, ne sont
évidemment pas étanches; ils se complètent et s'additionnent au
contraire et nous autorisent à avoir recours à une notion de
continentalisation qui devrait tenir compte de l'évolution parallèle des
phénomènes d'intégration économique à l'intérieur
d'une
Amérique du
Nord qui rassemble les États-Unis, le Mexique et le Canada.
En un sens, la continentalisation reflète l'ouverture progressive des
économies nationales depuis la Deuxième Guerre et participe de ce que
l'on a appelé parfois la tri-polarisation de l'économie capitaliste7. Dans
un autre sens cependant, ce déploiement à l'intérieur du continent nord-
américain revêt des caractéristiques spécifiques inscrites dans l'histoire
propre à chacun des trois pays impliqués, de même que dans les
développement du Canada, Ottawa, 1985. Au sujet de la situation
mexicaine, on pourra se référer à R. Villarreal, La Contrarrevolución
monetarista. Teoría, Política Económica e Ideología del Neoliberalismo,
Mexico, Ediciones Océano, S.A., 4e édition, 1984.
6 F. Blaser, "'Canadian Business Missing Out on Mexico", Financial
Post, 25 mai 1987, p. 8.
7 E. H. Preeg, Economie Blocs and U.S. Foreign Policy, Washington,
D.C., National Planning Association, 1974.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%