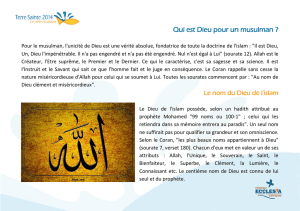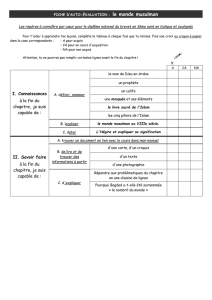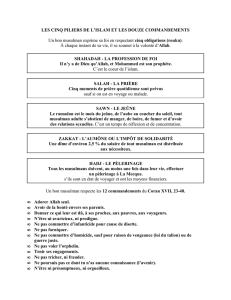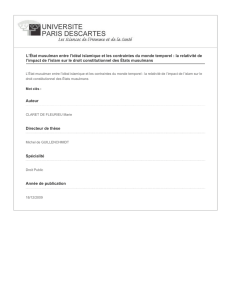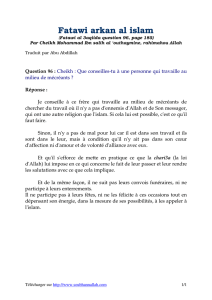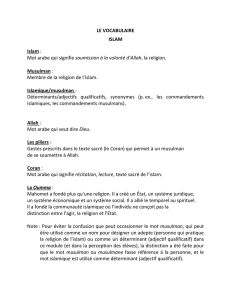Les élections politiques d`un point de vue islamique Chauki Lazhar

Les élections politiques d’un point de vue
islamique
Chauki Lazhar
Directeur Adjoint, CILE
La religion, pour les musulmans, représente le cadre éthique qui est supposé guider l’action
humaine vers l’objectif de sa création. L’universalité de ce cadre réside notamment dans la
généralité de la plupart des principes qui le constituent. Ainsi l’humain fut doté d’une raison
an d’être capable de porter la responsabilité (al-amānah) de conduire sa vie individuelle et
collective vers la plénitude à partir de ce cadre qui lui a été fourni. Sur le plan politique, très
tôt dans l’histoire musulmane, le pouvoir califal bien guidé (Khilāfah Rāchidah) fût remplacé
par un pouvoir dynastique autoritaire, ce qui empêcha les musulmans de produire une pensée
politique élaborée issue de leurs références.
Après des siècles de sclérose et l’émergence d’un nouvel ordre mondial, le dé est de taille et
requiert des musulmans une créativité sans précédent an de mettre en évidence le paradigme
politique islamique et de trouver les moyens et les solutions de sa concrétisation dans le monde
contemporain. Cependant, l’Islam ne fait pas de l’énorme patrimoine intellectuel humain, et
en l’occurrence celui sur le plan politique, tant qu’il ne va pas à l’encontre de ses principes et
tant qu’il est en accord avec ses objectifs. Par ailleurs, dans la quête de l’humain vers l’objectif
de sa création, le réalisme de l’Islam ne lui impose pas de dépasser les limites de ses capacités,
mais plutôt d’œuvrer à la réalisation de la justice selon la mesure du possible.
Cadre Méthodologique
L’objectif principal pour lequel l’Islam fut révélé, selon la tradition musulmane, est de permettre
à l’être humain d’accomplir le sens de son existence. Cette mission dans sa dimension collective
consiste à ce qu’il assume la responsabilité d’être un Kalif (vicaire); «Lorsque Ton Seigneur
cona aux Anges : «Je vais établir sur terre un vicaire.» (Le Coran, 2:30). En d’autre termes: Dieu
l’a éprouvé en lui délégant la gestion des relations humaines, sur le plan social et politique ainsi
que la gestion et le développement de la Terre et de ses ressources. La tâche de l’être humain
est donc d’œuvrer de manière à ce que cette gestion s’approche d’une exemplarité à même
de procurer bonheur et plénitude à l’humanité. Êmanant de la perfection Divine, la religion
représente, pour les musulmans, le manuel qui guidera cette gestion dans tous ses aspects,
comme le rappelle le verset suivant: «Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme
un exposé de toute chose, tel un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans» (Le
Coran, 16:89).
32-F

C’est ainsi que pour les musulmans la réussite de cette mission dépend en grande partie de la
délité au message de l’Islam. De ce fait, l’Islam est la référence majeure pour les musulmans
et le pouvoir législatif n’appartient à personne d’autre qu’à Allah, comme indiqué dans de
nombreux versets dans le Coran, comme par exemple : « Le jugement n’appartient qu’à Allah»
(Le Coran, 3:57) et: «C’est Allah qui juge et personne ne peut reconsidérer Son jugement, et Il
est prompt à régler les comptes » (Le Coran, 13:41).
Néanmoins, si la religion est «un exposé de toute chose» et que, par conséquent, l’autorité
législative n’appartient qu’à Dieu seul, le champ qui est réservé à la raison humaine reste très
grand, puisque l’humain ne fut doté d’une raison que pour porter la responsabilité de la gestion
de sa vie, comme on le lit dans le Coran: «Nous avions proposé la responsabilité aux cieux, à la
terre et aux montagnes. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l’homme s’en est
chargé ; car il est très injuste et très ignorant.» (Le Coran, 33:72).
Par ailleurs, même si la révélation est venue mettre en évidence toute chose, cela ne veut pas
dire que toute chose l’est de manière détaillée: ainsi la plupart des textes de l’Islam renferment
des principes généraux qui ne traitent pas des détails ou des modalités spéciques de leur
application. Les seules prescriptions détaillées sont celles qui ne peuvent subir l’inuence du
temps ou de l’espace et sont applicables dans tout contexte, comme les prescriptions concernant
le crédo (ʾaqīdah), les adorations cultuelles (ʾibādāt) et les questions familiales.
Cette caractéristique de l’Islam (la généralité des principes) garantit son adaptation et son
applicabilité à toute époque et en tout lieu. Si les modalités d’application de la plupart des
principes avaient été dénis de manière détaillée, l’Islam aurait perdu son caractère universel
et son application n’aurait plus été possible avec l’évolution des époques et des lieux. Les détails
et les modalités d’application de la plupart des prescriptions relèvent donc de l’idjtihād (travail
d’interprétation et d’application des textes), qui sera fait à la lumière des principes généraux
de l’Islam, en adéquation avec les circonstances et les spécicités concrètes du contexte. C’est
pour cette raison que le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit: «Allah vous a imposé des
obligations, ne les négligez pas, Il a mis des limites, ne les dépassez pas. Il a rendu certaines
choses illicites, ne violez pas ces interdits; Il s’est abstenu de se prononcer sur d’autres par
miséricorde pour vous et non par oubli, alors ne les recherchez pas.»1
L’interdiction de rechercher les choses sur lesquelles Dieu s’est abstenu de se prononcer est
limitée à l’époque de la Révélation, comme indiqué par Ibn Ḥajar (1448-1372 G) et d’autres
savants,2 car le questionnement des principes lors de l’époque de la Révélation risquait de
(1) Al-Daraquṭni Sunan (Beyrouth: Muʿassasat al-Risālah, 2004), hadith 4445; Al-Bayhaqī, Al-Sunan Al-Kubra (Bey-
routh: DKI, 2003), hadith 20217; et jugé bon (ḥasan) par Al-Albānī dans sa révision de Kitāb Al-Imān de Ibn Taymiyah
(Beyrouth: al-Maktab al-Islamī, 1993), 44.
(2) Voir: Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī (Beyrouth: Dār al Mrifah, 1959), 20/340.
33-F

détailler ces principes et de les dénaturer dans leur caractère général et universel, ce qui aurait
pu provoquer gêne et diculté pour les générations dont la situation contextuelle spécique
exige d’autres détails et d’autres modalités d’application.
La miséricorde évoquée dans le Hadith renvoie donc à la possibilité d’appliquer les principes de
l’Islam à toute époque sans devoir subir de gêne ou de diculté. C’est pour cela qu’Allah dit dans
le Coran: «O Les croyants! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient
divulguées, vous nuiraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran
est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est Pardonneur
et Indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions (pareilles) puis, devinrent de par
leurs faits mécréants.» (Le Coran, 102-3:101).
Ils devinrent mécréants de par leurs faits car les prescriptions avaient été spéciées à force
de vouloir les détailler lors de la Révélation, au point qu’ils n’arrivaient plus à les mettre en
application en toutes circonstances.
L’éminent Savant, théoricien des nalités de la Sharīʾah, Muḥammad Al-Ṭahir Ibn ʾAshūr (-1897
1973 G) dit la chose suivante: «Il est donc établi que la Sharīʾah islamique est applicable à toute
époque grâce au fait que ses prescriptions sont constituées de règles et de concepts généraux qui
renferment les sagesses et les intérêts dont peuvent être déduits toutes sortes de prescriptions
qui visent toutes les mêmes objectifs. C’est pour cette raison que les détails et les spécications
furent évités par les fondements de la Sharīʾah[…] Il y a toutefois des détails dans le Coran et la
Sunna[…] mais leur grande majorité est constituée de [prescriptions de] type général.»3
Ainsi pouvons-nous conclure qu’un des fondements du crédo musulman réside dans le fait
que le pouvoir législatif appartient à Allah, et que ce pouvoir législatif représente surtout un
cadre éthique universel de principes et de nalités à respecter dans la gestion des aaires
humaines au niveau social et politique. En d’autres termes, Allah a établi les nalités qui
doivent être poursuivies par l’être humain et a laissé l’élaboration de la plupart des moyens et
des modalités à la responsabilité de l’intelligence humaine, qui les dénira selon les spécicités
des circonstances.
On peut résumer le rapport entre la révélation et la raison dans la gestion politique et sociale
de la vie humaine dans les points suivants :
1. Le pouvoir législatif revient à la Révélation, qui ore un cadre éthique global et universel:
«Le jugement n’appartient qu’à Allah» (Le Coran, 6:57).
2. La raison a le devoir de comprendre et d’interpréter les Textes de la Révélation pour en
déduire les principes et les prescriptions; cette compréhension relève de l’autorité des savants
(3) Ṭahir Ibn ʾAshūr, Maqāṣid Al-Sharīʾa Al-Islāmiyya (Tunis: al-Sharikah al-Tūnisiyyah, 1988), 93-94.
34-F

(5) Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Badāiʾ al-Fawāid (Beyrouth: Dār al-Kitāb al-ʾArabī), 4/15.
(4) Voir: Abū Ishāq al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt (Le Caire: al-Maktabah al-Tawfīkiyah, 2003), 4/74-87.
(Uléma) spécialisés dans les Textes, maîtrisant les sciences des textes: «S’ils la rapportaient au
Messager et aux détenteurs d’autorité (les Savants), ceux d’entre eux qui cherchent sa déduction
l’auraient appris.» (Le Coran, 4:83).
3. La raison a le devoir de chercher les moyens d’application des principes déduits des textes
et de connaître le contexte dans lequel les principes doivent être appliqués, an de dénir
si l’application est possible et dénir la meilleure manière d’appliquer selon les exigences du
contexte. Les Savants dénissent ce processus par «Taḥqîq al-Manāṭ»4. Ce travail relève de
l’autorité des Savants spécialisés dans les Textes, mais aussi de celle des « gens d’expérience »
et des spécialistes des diérents contextes: politique, social, économique…
bn al-Qayyim (1350–1292 G) dit à ce sujet : «La diérence entre la preuve de la légitimité de la
prescription et la preuve de l’application de la prescription: la première dépend du législateur
(des textes sacrés) et la deuxième des sens (expérience) ou de l’information ou de l’addition.
La première catégorie dépend donc du Livre (Coran) et de la Tradition (prophétique) […] et la
deuxième […] des gens d’expérience.»5
Ceci met en évidence que l’autorité de proposer des moyens d’application des principes
universels de l’Islam et l’autorité exécutive et judicaire – car traitant de la réalité humaine
concrète – relève de la responsabilité de l’humain. Cela veut dire que le pouvoir exercé par
l’autorité politique, la sentence prononcée par le juge, la fatwa émise par le Savant… n’est pas la
parole de Dieu, n’est pas infaillible, mais reste un eort humain qui est susceptible d’être remis
en question. Il est donc clair qu’il n’y a pas lieu de parler de théocratie en Islam.
Ce préambule nous apporte une idée du cadre dans lequel s’inscrivent les élections en Islam,
sur le plan de leur validité et de leur modalité.
Ainsi peut-on comprendre la validité des élections en Islam du fait que celles-ci peuvent
représenter un moyen d’application de plusieurs principes de l’Islam, notamment le principe
de la concertation (shūra) qui est l’un des principes fondamentaux de la politique en Islam.
En eet, l’Islam n’est pas venu avec un modèle politique détaillé prêt à l’emploi quant à
l’établissement, l’exercice, le transfert du pouvoir et la nature des institutions d’un État ou le
rapport entre les diérents représentants de la société politique et civile, etc. Tout cela ne fut pas
détaillé par les Textes car cela dépend en grande partie du contexte et de la réalité de la société
et de ses spécicités. Cependant l’Islam est venu avec un nombre de principes visant à encadrer
et orienter l’aspect politique de la vie humaine comme la justice (al-ʾadl), la bienfaisance (al-
iḥsān), l’équité (al-qisṭ), la liberté, le dépôt de conance (al-amānah), l’inaliénabilité des biens
publics, la concertation (al-shūrā), etc.
35-F

Pour revenir à l’exemple de la shūrā, l’Islam impose la concertation et la consultation et va
même jusqu’à l’évoquer à côté de la prière et de l’aumône: « …qui répondent à l’appel de leur
Seigneur, accomplissent la prière, se consultent entre eux à propos de leurs aaires, dépensent
de ce qui Nous leur attribuons… » (Al-shūrā: 38). Dans un autre verset on peut lire: «Et consulte-
les à propos des aaires » (Āl-ʾImrān: 159).
Ces deux versets nous donnent un des principes universels qui doivt orienter l’aspect politique
de la vie humaine: la consultation dans sa dimension horizontale, entre les membres constituants
de la société, et dans sa dimension verticale, entre les gouvernants et les gouvernés. La mise
en pratique et les modalités de l’application de ce principe dans la désignation de l’autorité
politique par exemple, sera dénie par l’ijtihād en fonction des circonstances concrètes du
contexte.
Un exemple illustrant des applications distinctes de ce principe dans l’établissement du chef
de l’État est la désignation des quatre Califes: l’établissement de Omar (qu’Allah l’agrée), par
exemple, eu lieu, de manière indirecte, par le biais d’une concertation entre les représentants
du peuple, puis sa légitimité fut conrmée par le peuple par le moyen du serment d’allégeance
(bayʾa). Quant au Calife Othmane (qu’Allah l’agrée), on peut comparer sa désignation à un
«surage universel direct», du fait que les habitants de Médine furent consultés un par un,
comme cela est rapporté dans le récit connu sous le nom de «récit de la shūrā.»6
Par ailleurs, il apparaît dans notre préambule que la concertation ne concerne pas seulement
les Savants ou les spécialistes, mais aussi l’ensemble du peuple, selon la nature du cas. Ainsi,
s’il s’agit de comprendre ou d’interpréter un Texte sacré, la concertation sera réservée aux
Savants spécialisés dans les sciences des Textes. S’il s’agit de l’application d’un principe
ou d’une prescription qui concerne un champ d’action spécique (médecine, économie,
militaire…) la concertation engagera alors aussi des spécialistes du domaine en question. Et s’il
s’agit de questions qui touchent l’intérêt de l’ensemble de la communauté (comme le choix du
gouvernement) la concertation peut être générale.
On trouve des exemples de chacun de ces cas dans la biographie du Prophète (paix et bénédiction
sur lui) et de ses Califes Bien-Guidés. Pour ne donner que l’exemple du dernier cas : le Prophète
(paix et bénédiction sur lui) consulta l’ensemble des Compagnons avant l’expédition de Uhud
pour savoir s’ils favorisaient le fait de mener la bataille en se retranchant à Médine, ou plutôt en
allant à la rencontre de l’ennemi. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) et ses Compagnons
les plus proches étaient favorables à la première option, mais c’est l’option de l’oensive qui fut
(6) Ce récit est notamment rapporté par al-Bukhārī dans son Ṣaḥīḥ (Beyrouth: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001), 5/15, ha-
dith 3700, on peut lire dans al-Bukhārī que ʾAbd al-Raḥmān Ibn ʾAwf dit: «Par Allah je n’ai laissé aucun foyer des
Muhajirīn et des Ansārs sans leur avoir demandé leurs avis, est j’ai vu qu’ils penchaient vers ʾUthmān.»
36-F
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%