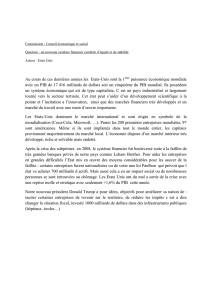Les effets de la conjoncture ne sont pas que transitoires

Thème du mois
4La Vieéconomique Revue de politique économique 3-2014
Les effets de la crise ont ététransitoires dans certains pays et durables dans d’autres. Ils ont surtout ététransitoires
Dans l’industrie automobile. En illustration: chaîne d’assemblageàDetroit. Photo: Keystone
La conjonctureest souvent définie comme
l’ensemble desévénements affectant l’actua-
lité économique, lorsqu’ils ontune influence
limitée et concentrée surlecourtterme.
Nombreux sont, en effet, ceux quipensent
qu’elleest associée àdes événements passa-
gers,provisoires, parfois cycliques. Cesphéno-
mènes seraient voués àsedissoudreprogres-
sivement dans les tendances plus profondes
et structurelles de nos économies. Cesder-
nières influenceraient alors le devenir à long
terme de nos sociétés.
Or,ilfautreconnaîtreque les concepts de
courtetdelongtermes ne sont pas clairement
définis dans la théorieéconomique. Souvent,
les économistes se sententtrès empruntés
lorsqu’onles interroge sur la définitiontem-
porelle(la durée) qu’ils associent àces no-
tions. En fait, même s’il est parfoisnécessaire
d’attendrequelques années afin de pouvoir
identifierdes évolutions lentes et structurelles
dans nos économies, et de les distinguerdes
phénomènes conjoncturels, il serait faux de
croire queles mutations structurelles ne sont
pas présentes en permanence. L’adaptation
descadresréglementaires, les changements de
comportement ou desprixrelatifs, la création
ou la disparitiond’entreprises, l’apparitionde
nouvelles technologies ou au contrairel’obso-
lescence confirmée de l’appareil productif
sont desprocessus continus1.
Mesurer la conjoncture
Bien quel’onpuisse mesurer la conjonc-
turedeplusieursmanières, les économistes et
le grand public se concentrentsouvent soit:
–sur les variations (annuelles ou trimes-
trielles) du produit intérieur brut (PIB)
en volume, corrigé de l’effet desprix, ou
de ses composantes;
–sur les résultats desenquêtes de conjonc-
ture(mensuelles ou trimestrielles);
–sur les indicateurs du marchédutravail.
Étantdonné quelePIB (ou ses compo-
santes) affiche une tendanceàlahausse, il est
nécessairedecalculerson taux de variation
pour comprendreson évolution. Lesrésul-
tats desenquêtes de conjonctureoscillent
normalement aux alentoursd’une moyenne
historique plus ou moins constante. On peut
Les effets de la conjoncturenesont pas quetransitoires
Quels effets la crise financière
et économique de 2008/2009
a-t-elle eu sur la conjoncture(ou
àcourtterme) et quels sont ceux
quidureront (à long terme)? Pour
répondreàcette question, il faut
d’aborddéfinir «conjoncture» et
«structure» et exposer les instru-
ments utilisés pour les mesurer.
La crise pourrait avoir eu des ef-
fets transitoires, durables mais
non permanents, enfin durables
et permanents. Actuellement, les
deux premiersconcerneraient da-
vantagelaSuisse et les États-
Unis, le dernier la zone euro. La
politique dispose d’outils pour
agir,outenter d’agir,àcourtou
long termesur l’économie. Toute-
fois, les interactions entreces
deux tempssont complexes.
Bruno Parnisari
Chef du secteur Conjon-
cture, Secrétariat d’État à
l’économie SECO, Berne
Frank Schmidbauer
Chef suppléant du secteur
Conjoncture, Secrétariat
d’État àl’économie SECO,
Berne

Thème du mois
5La Vieéconomique Revue de politique économique 3-2014
de la demandepeutimpliquerunécartnéga-
tifentre le PIB effectif (alors plus faible) et le
PIBpotentiel (plus élevé), comme cela aété
le cas entre2009 et 2013 dans la plupartdes
pays industrialisés. L’estimationdel’écartde
production intéresse notamment la politique
monétaire, car il annoncedepossibles ten-
sions inflationnistes lorsqu’il est positif et
déflationnistes dans le cas inverse. En ma-
tièredefinances publiques, la positionrela-
tive d’une économie par rapportàson PIB
potentielpermetdedistinguerles compo-
santes conjoncturelle et structurelle dans le
solde(déficit ou excédent) desadministra-
tionspubliques.
Crises financièreetéconomique
et potentiel de croissance
La Commissioneuropéenne et l’Organi-
sationdecoopérationetdedéveloppement
économiques (OCDE) calcule chaque année
le PIBpotentiel desÉtats européens, de
même quecelui desautresnations industria-
lisées. Nous nous intéresserons plus particu-
lièrementaux PIBeffectifetpotentiel des
États-Unis, de la zone euro et de la Suisse, sur
la période 1997–2015.
Les États-Unis
Le graphique 1 montre que(comme on
pouvait s’yattendre) la trajectoire du PIB
potentieldes États-Unis est plus stable que
celledeson PIBeffectifetdessine une ten-
dancedelongterme. On noteraque même si
la croissanceest redevenuepositivedepuis
2010,l’écartdeproductiondevrait rester né-
gatifjusqu’en 2015 au moins et s’accompa-
dès lors directement interpréter les résultats
dessondages effectués (soldedes réponses
obtenues lors d’enquêtes d’opinionsur un
domaine spécifique). Pour les indicateurs du
marchédutravail, différents typesdelecture
et d’analyses sont possibles (des taux de va-
riationaux quotes-parts en %, comme c’est
le cas pour le taux de chômage).
Calculerletaux de variation du PIB(ou de
celuidunombred’emplois surlemarchédu
travail) n’est pas la seule manièredemesurer
la conjoncture. Beaucoup d’analystes, et no-
tamment les économistes desbanques cen-
trales et desministères desFinances s’yes-
saient en calculant le PIB potentiel d’un pays.
En comparant ce dernieraveclePIB effectif,
on obtientalors l’écartdeproduction («output
gap»)
Le PIB potentiel d’une économie fait réfé-
renceàson potentield’offre(facteurs de pro-
ductionettechnologie). Surune durée de
plusieursannées, la croissancepotentielle
devrait résulter de la progressiondelapopu-
lationactiveetduprogrès technique. Sur
quelques trimestres, le PIBpotentiel peut
évoluer, en fonctionnotamment desvaria-
tionsdustock de capital. On peut ainsi le
considérer comme le PIB«théorique» qu’une
économie atteindrait si tous les facteurs de
production (capital et travail) étaient utilisés
dans desconditions normales. On entend
par ce dernierterme un niveau de croissance
soutenable et sans tensions inflationnistes.
L’écartdeproduction peut être positif: cela
arrive lorsquelePIB effectif dépasse le PIB
potentiel. Il s’agit d’un phénomène momen-
tané quis’accompagne souvent de tensions
inflationnistes. Àl’inverse, une forte baisse
PIB potentiel
En milliards d’USD
PIB effectif
15500
14500
13500
12500
11500
10500
9500
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Taux de variation du PIB potentiel Taux de variation du PIB effectif
Écart entrePIB potentiel et PIB effectif (en %duPIB potentiel)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
En %
Source: Commission européenne /LaVie économiqueRemarque: le PIB effectif et le PIB potentiel sont exprimés aux prix constants de 2005; l’écartde
production représenteladifférence entreles deux.
Graphique 1
États-Unis: PIB effectif et potentiel, taux de croissance et écartdeproduction
1Enpoussant le raisonnement àson extrême, on pourrait
direque le courtterme se termine aujourd’hui et le long
termecommence demain.

Thème du mois
6La Vieéconomique Revue de politique économique 3-2014
gner ainsi d’un chômage«conjoncturel»(lié à
la sous-utilisationdupotentiel de crois-
sance). Repriseéconomique et retouràune
bonne conjoncture ne doiventpas être confon-
dus. On remarquera, par ailleurs, quesila
crise financièreaeuunimpact surlePIB po-
tentieldes États-Unis (notamment en 2009 et
2010), ce dernieraretrouvéàpartirde2013–
2014 un rythme de croissancesimilaireàce-
luienregistré avant la crise.
La zone euro
La zone euro connaîtune situationdiffé-
rente, plus délicateetsans douteplusdifficile
àinterpréter (voir graphique 2). Nonseule-
ment le recul du PIByaété plus marqué
qu’aux États-Unis en 2009, mais l’impact des
crises financièreetéconomique surleniveau
et le taux de croissanceduPIB potentiel
semble plus important. On noteraque le po-
tentieldecroissancedelazoneeuroest passé
d’environ 2% avant la crise financièreà0,5%
après celle-ci, selonles calculs de la Commis-
sioneuropéenne.
La Suisse
L’évolutiondes PIBeffectifetpotentiel
helvétiques entre1997 et 2015 semble indi-
quer qu’aucun effetpermanent ne s’est ma-
nifesté jusqu’àprésent, selonles calculs de
l’OCDE (voir graphique 3). Si la crise finan-
cièreaeudes effets négatifssur le niveau ou
le taux de croissanceduPIB potentieldurant
cettepériode,d’autres facteurs semblent
avoir eu deseffetsinverses (desorte queles
taux de croissanceduPIB potentieletleni-
veau de celui-ci ne semblent pas avoir beau-
coup souffertdurant cettepériode). On peut
pensernotamment àlacroissancedémogra-
phique soutenuedurant cettemême période
et àson effetpositif surlacroissancepoten-
tielle.
La crise conjoncturelle ades implications
àcourt, moyenetlong termes
L’actualité desdernières années semble
avoir eu troistypes d’effetsdifférents sur
l’activité économique:
1. Deseffetstransitoires: une crise conjonctu-
rellegrave –dans ce cas, la crise financière
de 2009 –affecte les variations du PIBef-
fectif, mais ne pèserait qu’à courtterme
surcelui-ci. Le PIBeffectifreviendrait ra-
pidementsur sa trajectoire de croissance
et le PIBpotentiel ne serait pas affecté par
la crise (ou uniquement de manièretran-
sitoire). Le niveau du PIBpotentiel peut
effectivementbaissermomentanément,
mais aussi se redresserrapidementetdans
une égale mesure(ni le niveau, ni le taux
de croissanceduPIB potentielneseraient
réellementaffectés par la crise). Ce scéna-
riosemblecorrespondreaucas suisse, si
l’ons’enréfèreaux estimations de
l’OCDE du PIBpotentiel (avecles
nuances mentionnées antérieurement).
2. Deseffetsdurables, mais non permanents:
une crise conjoncturelle grave peut affec-
terlePIB effectif et le PIBpotentiel.Dans
ce cas, le niveau du PIBpotentiel s’en
trouve «durablement» affecté, mais sa
croissancerenoue assez rapidementavec
le rythme quiétait le sienavantlacrise.
Ce scénario semble s’observerenpartie
aux États-Unis.
3. Deseffetsdurables et permanents: une crise
conjoncturelle grave peut affecterl’éco-
nomie en profondeur,sinon seulement le
PIBpotentiel ne retrouve pas sa tendance
PIB potentiel
En milliards d’euros
PIB effectif
9300
8800
8300
7800
7300
6800
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Taux de variation du PIB potentiel Taux de variation du PIB effectif
Écart entrePIB potentiel et PIB effectif (en %duPIB potentiel)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
–5.0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
En %
Source: Commission européenne /LaVie économiqueRemarque: voir graphique 1.
Graphique 2
Zone euro: PIB effectif et potentiel, taux de croissance et écartdeproduction

Thème du mois
7La Vieéconomique Revue de politique économique 3-2014
mique doiventêtreconfondus. La théorie
économique et l’observationdes années
1960–2013 laissent peudedoute surles ou-
tils àmettreenœuvre lorsqu’il s’agit d’agir
rapidementoudemanièreconséquentesur
la conjonctureouplusindirectement sur
certains comportements et surles structures
de l’économie (les fameuses conditions-
cadres). La politique monétaire, de même
quelapolitique budgétairedans certains cas
offrentdes outils permettant d’influencer la
conjoncture.
Parcontre, la qualité de l’envi-
ronnement réglementaire, la politique
concernant le marchédel’emploi, les arran-
gements institutionnels liés aux assurances
sociales et les politiques d’immigration dans
les pays confrontés àunfortvieillissement
démographique continueront notamment à
jouerunrôle centralpour les perspectives de
croissanceàlongterme.
Lesdifférents liens entreconjonctureet
structuresontténus. La réduction desdés-
équilibresstructurelssefait toujoursdans un
contexte conjoncturel donné. Pensons no-
tamment àlaréduction desdéficits structu-
rels desadministrationspubliques dans la
zone euro en 2012 et 2013. Il s’agissait là
d’une exigence incontournable afin d’éviter
une nouvellecrise financière. Àl’opposé,
l’abus d’outils conjoncturelspeutdenou-
veau faireplonger deséconomies dans de
nouveaux déséquilibresstructurels. Nous
pouvonspenseraux risques liés au maintien
de politiques monétaires très expansion-
nistes dans plusieurspaysindustrialisés.
Courtetlongtermes sont bel et bien liés; la
réalité ne se laisse pas enfermerdans une vi-
sionbinairedutemps.
d’expansiond’avant la crise, mais qu’il
s’en éloigne avecletemps, en raisond’un
taux de croissancepotentiel réduit. La
zone euro pourrait en constituerune
bonne illustration,sil’onencroit les esti-
mations de la Commissioneuropéenne.
Unelittératurenourrieacherché àidenti-
fierl’origine de telles différences. Elle en re-
vientsouvent aux conséquences de la crise fi-
nancièreetéconomique surles déterminants
de la croissanceàlongterme: changementdu
taux de chômagestructurel et du taux de par-
ticipationsur le marchédutravail, effets
d’hystérèse surlemarchédutravail, détério-
ration du capital humain, baisse desinvestis-
sements en rechercheetdéveloppement,
changementducadre réglementaire, etc.
Dans le cas de la zone euro,ilfautégalement
retenir le mauvais état de santé du secteur
bancaire, quinejoue plus sonrôle de finan-
cement desinvestissements dans beaucoup
de pays,depuis plusieurs années.
L’estimationdes potentiels de croissance
débouche, toutefois, surdes résultats fragiles,
quidevront être révisés lorsqu’ondisposera
d’un recul plus important surles caractéris-
tiques de la reprise dans les différents pays.
L’analyseconjoncturelle gagneenacuité avec
le temps2.
Ne pas confondreles outils
de la politique économique
Lesdifficultés rencontrées lors de l’iden-
tification, la séparationdes phénomènes
conjoncturelsetstructurelsainsi quel’im-
possibilité de croire queces deux influences
soient indépendantes ne signifient pas pour
autant queles outils de la politique écono-
PIB potentiel
En millions de francs En %
PIB effectif
600000
575000
550000
525000
500000
475000
450000
425000
400000
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Taux de variation du PIB potentiel Taux de variation du PIB effectif
Écart entrePIB potentiel et PIB effectif (en %duPIB potentiel)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
–1.0
–2.0
–3.0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Source: OCDE /LaVie économiqueRemarque: voir graphique 1.
Graphique 3
Suisse: PIB effectif et potentiel, taux de croissance et écartdeproduction
2Qu’en est-il du diagnostic courant? Àl’époque des an-
ciens films photographiques, quiétaient développés en
chambrenoireavecunrévélateur et un fixateur
chimiques, l’imagen’apparaissait d’abord quesous
formedecontours. Puis, progressivement (en quelques
secondes), celle-ci se précisait pour laisser apparaître
l’ensemble du motif photographié. Le diagnostic
conjoncturel partage de fortes similitudes avec cetan-
cien procédé, sauf qu’il faut souvent attendrequelques
trimestres, voiredes années, pour quel’imageconjonc-
turelle se précise davantage.
1
/
4
100%