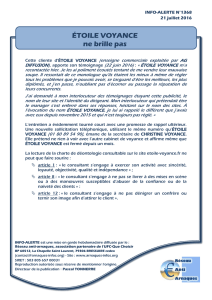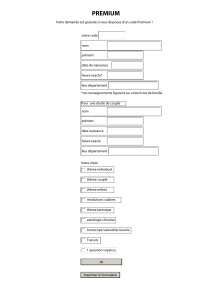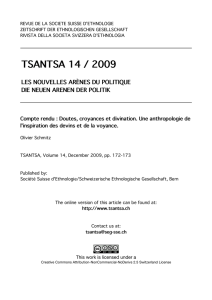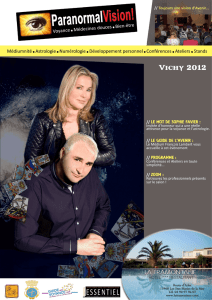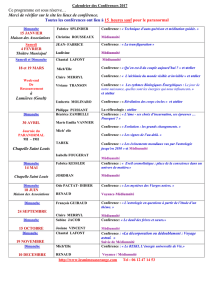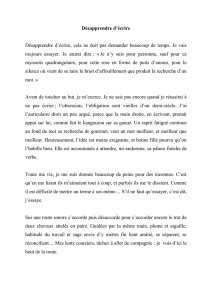Apprendre et désapprendre : Quand la médiumnité croise l

Anthropologie et Sociétés
Document généré le 23 mai 2017 18:19
Anthropologie et Sociétés
Apprendre et désapprendre : Quand la médiumnité
croise l’anthropologie
Deirdre Meintel
De l’observation participante à l’observation de la
participation Volume 35, numéro 3, 2011
2 1
9 2 Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Département d’anthropologie de l’Université Laval
ISSN 0702-8997 (imprimé)
1703-7921 (numérique)
2 1
9 2 Découvrir la revue
Citer cet article
Deirdre Meintel "Apprendre et désapprendre : Quand la
médiumnité croise l’anthropologie." Anthropologie et Sociétés
353 (2011): 89–106.
Résumé de l'article
Cette étude traite du processus d’apprentissage de la
médiumnité tel que vécu par l’auteure dans le cadre d’une
enquête menée auprès de spiritualistes à Montréal. D’une part
sont examinés les choix qu’implique une telle démarche sur les
plans méthodologique, éthique et personnel. D’autre part sont
discutés les apports de cette approche quant à la compréhension
des expériences spirituelles des participants de l’enquête.
Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services
d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous
pouvez consulter en ligne. [https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-
dutilisation/]
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de
Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la
promotion et la valorisation de la recherche. www.erudit.org
Tous droits réservés © Anthropologie et Sociétés,
Université Laval, 2011

Anthropologie et Sociétés, vol. 35, no 3, 2011 : 89-106
APPRENDRE ET DÉSAPPRENDRE
Quand la médiumnité croise l’anthropologie
Deirdre Meintel
Introduction1
Le sujet de cette étude a été suggéré par le livre Learning Religion
(Berliner et Sarro 2009) et en particulier par le chapitre de T.M. Luhrmann.
L’auteure adopte une approche « experience near » (Wikan 1991) pour décrire
l’apprentissage religieux de membres d’une congrégation évangélique dont
les enseignements mettent l’accent sur la prière et sur un dialogue soutenu
entre l’individu et Dieu. Ainsi, nous2 avons été amenée à regarder de plus près
l’expérience d’apprentissage de la médiumnité, telle que nous l’avons observée
et vécue dans une église spiritualiste.
Selon Aaron Turner, en règle générale, la pratique de la réflexivité par
laquelle l’ethnologue s’interroge sur son rôle de participant actif dans le processus
de construction des résultats du terrain a rarement donné lieu à la réinsertion de
l’anthropologue dans les représentations du terrain et dans la construction des
connaissances. En fait, cette réflexivité tend à se limiter à des réflexions ex post
facto où la distinction entre l’ethnologue et le terrain est maintenue et où sa
participation est laissée de côté (A. Turner 2000 : 51-52). Par ailleurs, soutient
l’auteur, les discussions de l’expérience « incarnée » (embodied) se limitent à
celle des autres, tenant ainsi l’anthropologue lui-même à distance. Bien des
anthropologues ont fait le récit de leurs expériences vécues sur le terrain, dont un
nombre disproportionné de femmes (B. Tedlock 1995). Plusieurs anthropologues
de la religion ont d’ailleurs fait état de leurs expériences d’initiation aux
traditions religieuses de peuples éloignés de leur propre société, comme par
exemple Halloy (2006), Stoller (1989, 2004) ou encore Desjarlais (1992).
Nos présentes réflexions s’inspirent surtout des travaux d’anthropologues
qui non seulement font preuve de réflexivité dans leur travail de terrain
– notamment par « l’observation de la participation » (B. Tedlock 1991) – mais
cherchent aussi à se servir de leur expérience pour mieux appréhender celles
1. Nous remercions Jean-Guy Goulet de nous avoir fourni plusieurs références utiles. Nous
remercions également le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour
le financement reçu pour cette recherche.
2. Le « je » est réservé aux descriptions d’expériences personnelles de l’auteure sur le terrain.
08_Meintel.indd 89 2011-12-06 13:43:19

90 DEIRDRE MEINTEL
des autres, sans toutefois confondre les deux3. Plus que de réaliser une étude
de notre expérience, notre objectif a été, à l’instar de cette dernière auteure, de
Jill Dubisch (2008), d’Edith Turner (Turner et al. ; Turner 1992, 1994, 1996)
et de Jean-Guy Goulet (1993, 1998), d’apprendre à travers celle-ci. Comme
ces auteurs, nous ne nous prononçons pas sur le statut ontologique de nos
expériences en milieu spiritualiste ni sur celles des participants à la recherche.
Cependant, une telle approche oblige l’ethnologue à « prendre au sérieux les
idées et croyances » (Ewing 1994 : 578) de ces derniers. Comme l’explique Jill
Dubisch à l’égard de la position adoptée par Edith Turner, il s’agit d’éviter de
« rationaliser ou d’expliquer ses propres expériences ou celles de ses informateurs
en dehors des cadres où elles ont été vécues ou en des termes différents de ceux
qui ont été utilisés pour les exprimer » (Dubisch 2008 : 334)4.
Malgré notre curiosité à ce sujet, la médiumnité au centre des pratiques
rituelles spiritualistes nous semblait inaccessible en tant qu’expérience personnelle.
Que la médiumnité puisse représenter un objet d’« apprentissage » allait être
une des premières découvertes faites sur ce terrain long et riche. Au fil des
pages qui suivent, après avoir décrit le processus d’apprentissage tel que nous
l’avons vécu, nous examinerons de plus près les choix qu’une telle démarche
représente sur les plans méthodologique et éthique. Sera ensuite traitée la
question des apports potentiels d’une telle approche pour des recherches de
terrains semblables au nôtre.
L’étrangeté chez soi
Nos réflexions font suite à un terrain mené dans une congrégation
spiritualiste de Montréal que nous connaissons depuis une dizaine d’années :
l’Église spirituelle de la guérison (ÉSG) qui compte approximativement 275
membres5. Après une longue expérience de recherche sur des thèmes liés à la
migration et à l’ethnicité aux îles du Cap-Vert et ailleurs, la recherche auprès
de spiritualistes comportait un élément initiatique, en ce sens qu’elle obligeait
une réflexivité particulière quant à nous-mêmes ou à nos croyances et quant à
l’attitude à adopter par rapport à celles des spiritualistes. En outre, les frontières
de la congrégation sont très floues : il n’y a pas de conversion, soit de changement
d’appartenance religieuse (Meintel 2007a). En effet, comme nous l’avons expliqué
ailleurs, nombreux sont les membres de cette congrégation qui fréquentent
parallèlement d’autres groupes, principalement des églises catholiques et des
3. Voir par exemple Barbara Tedlock (2005) ; Dennis Tedlock (1997) ; Jeanne Favret-Saada
(1977).
4. Notre traduction.
5. Nous avons modifié les noms et certains détails descriptifs afin de dissimuler l’identité de
l’Église spirituelle de la guérison ainsi que celle des individus mentionnés dans le texte.
08_Meintel.indd 90 2011-12-06 13:43:19

Apprendre et désapprendre 91
regroupements néochamaniques (2007 et 2011). C’est l’expérience religieuse des
participants qui est centrale dans leur lien à l’ÉSG et c’est une des raisons pour
lesquelles elle constitue l’objet principal de notre recherche.
Ce terrain représentait donc une occasion inouïe de nous rapprocher de
l’objet de recherche et de participer à l’expérience vécue par les autres acteurs,
dans la mesure de nos capacités personnelles. Initialement, nous ressentions une
certaine distance sociologique par rapport au milieu spiritualiste, due à notre
statut professionnel et à nos origines. En plus d’être largement issus de milieux
ouvriers, les spiritualistes de ce groupe sont très majoritairement nés au Québec
et de langue maternelle française, ce qui n’est pas notre cas. Ces différences sont
toutefois loin d’être absolues puisque le groupe compte quelques immigrants,
quelques anglophones et quelques individus assez scolarisés. L’élément
principal de l’étrangeté que nous ressentions concernait sans doute la présence
de la médiumnité dans un contexte religieux autrement familier : nous nous
trouvions face à des gens de notre ville, pleinement impliqués dans la vie
moderne, pour lesquels le contact direct avec les esprits et la guérison spirituelle
étaient normalisés.
Comme Dubisch l’a constaté dans ses recherches sur la guérison énergétique,
une recherche, bien que menée « chez soi », peut amener l’anthropologue vers
une nouvelle culture où, entre autres, les esprits sont « réels et actifs » (Dubisch
2008 : 331). Chez les spiritualistes, par ailleurs, les mots usuels anglais ou
français acquièrent de nouveaux sens ; lorsqu’un médium dit : « ils me disent... »,
les habitués savent qu’il s’agit d’esprits guides. Les couleurs vues par un médium
(physiquement, s’il voit l’aura des gens, sinon dans la pensée) ont un sens qui
varie selon les circonstances. Par exemple, le vert peut signifier autant la nature,
que la guérison ou l’amour, etc.
Une recherche « chez soi » où le chercheur s’ouvre à des expériences
comme celle de la médiumnité semble présenter des défis particuliers. Lorsque
les anthropologues font des apprentissages chamaniques dans des cultures
considérées comme exotiques, la distinction entre la « rationalité » (de chez
nous, de la science) et les « croyances » de l’autre demeure intacte. Cependant,
ce clivage n’existe pas toujours au niveau expérientiel chez les chercheurs
ayant connu d’autres mondes spirituels dans des contextes lointains. En effet,
certains continuent à entretenir un rapport avec ces mondes, et ce, même
de retour chez eux (voir aussi Goulet 1993 ; Stoller 2004). L’accusation
de « devenir natif » (going native), qui selon Ewing (1994) hante toujours
l’anthropologue interprétatif, porte une charge supplémentaire quand il s’agit
de modes de pensée, de croyances et de visions du monde de « l’autre proche »,
pour emprunter le terme de Marc Augé (1989). Dans ce cas, la crédibilité du
chercheur risque d’être fragilisée, une considération qui a amené la sociologue
Mary Jo Nietz (2002) à réaliser son enquête sur les Wiccans dans une localité
loin de son milieu universitaire.
08_Meintel.indd 91 2011-12-06 13:43:19

92 DEIRDRE MEINTEL
D’un côté, la proximité géographique risque de compromettre l’étanchéité
de la frontière entre le terrain et la vie quotidienne du chercheur (Hirvi sous
presse). De l’autre, cette proximité permet à la temporalité de la recherche d’être
plus « naturelle » que d’ordinaire en sciences sociales, du moins dans le cas d’un
petit terrain comme le nôtre. On peut par exemple laisser davantage évoluer les
rapports de terrain ainsi que la compréhension de la culture religieuse de l’Autre
avant de procéder à des entrevues formelles. Par contre, la durée de l’enquête
risque de modifier les rapports sur le terrain, les attentes des acteurs face au
chercheur ainsi que le positionnement du chercheur par rapport aux phénomènes
religieux à étude. Près de cinq ans se sont écoulés avant que nous ne puissions
jouer des rôles actifs (comme guérisseuse et médium-apprentie) lors des offices
religieux de l’ÉSG. La question ne se serait probablement pas posée dans le cadre
d’une recherche échelonnée sur un an ou deux seulement.
La médiumnité
La médiumnité est définie de façon variable selon les chercheurs pour
se référer soit à l’incorporation d’esprits et/ou à la canalisation d’informations
du monde « divin » vers le monde des vivants (Krippner 2008 : 2). Certains
la limitent à la transmission d’informations de personnes décédées, et parlent
plutôt de canalisation quand il s’agit d’informations provenant d’autres types
d’entités (par exemple : Emmons 2008). Dans l’ÉSG, la médiumnité concerne
toute perception venant de l’« au-delà », une expression qui désigne le monde
des esprits dans cette congrégation. Ces perceptions peuvent prendre la forme
de visions, de rêves, de voix ou de sons (clairaudience), d’odeurs, de goûts ou
d’autres sensations (chaleur, fraicheur, picotement, etc.) reçues par le médium.
Typiquement, ces perceptions sont interprétées par le6 médium. Parfois, ce dernier
n’arrive pas à interpréter ce qu’il a capté et le message consiste simplement en la
description de l’image ou de la vision. La canalisation (channelling) est pratiquée
par deux ministres-médiums à l’ÉSG ; il s’agit d’une transe profonde où des
esprits guides (qui ont vécu sur la terre) parlent à travers la personne du médium
qui, lui, n’est pas conscient de ce qu’il dit. Toute forme de médiumnité acceptée
dans l’ÉSG est encadrée spirituellement : les voyants sont formés par un (une)
ministre-médium et, lors de l’exercice, leurs activités sont précédées et suivies
par des prières.
Après avoir décrit le processus d’apprentissage de médiumnité tel
que nous l’avons vécu et observé, nous examinerons de plus près les choix
qu’implique notre démarche sur les plans méthodologique et éthique. Sera
ensuite traitée la question de ce qu’une telle approche peut apporter à des
terrains semblables au nôtre.
6. Nous employons le masculin pour fins de simplicité ; en fait, les médiums à l’ÉSG sont
souvent des femmes. Quatre des huit ministres sont des femmes.
08_Meintel.indd 92 2011-12-06 13:43:19
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%