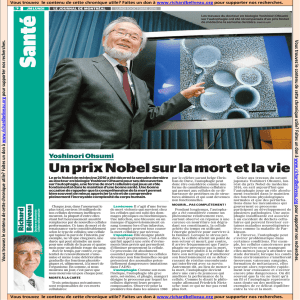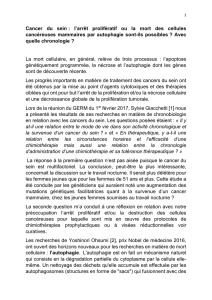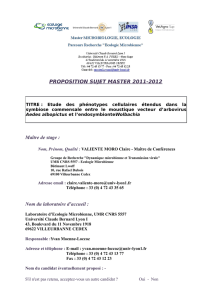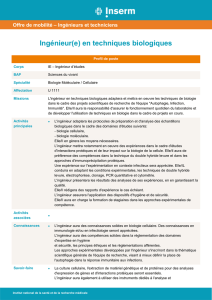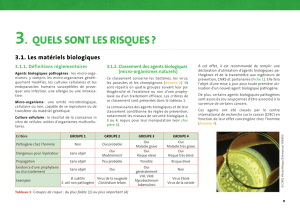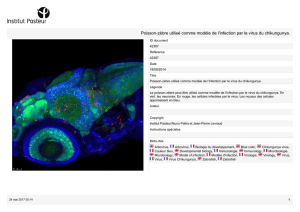L`autophagie et les infections virales

L’autophagie et les infections virales
Vincent Miazza
Laurent Roux
Département de microbiologie
et médecine moléculaire,
Faculté de médecine,
Université de Genève,
Genève, Suisse
Résumé. L’autophagie est une réponse cellulaire à divers stress auxquels une
cellule eucaryote peut être soumise. Elle permet de circonscrire un volume cyto-
plasmique par une vésicule à double membrane en vue de la dégradation de son
contenu. Ce contenu peut comprendre des pathogènes dont la cellule veut se
débarrasser. En cela l’autophagie participe au mécanisme de défense de la cel-
lule infectée. Dans le cas des virus, comme on pouvait s’y attendre, ce méca-
nisme tend à provoquer des réactions de détournement ou de neutralisation de
cette défense. Par ailleurs, certains virus ont évolué pour prendre appui sur
l’autophagie dans le but d’optimiser leur potentiel de multiplication. La descrip-
tion des relations complexes entre multiplication virale et autophagie n’en est
qu’à ses débuts. Cette revue tente ainsi de faire le point sur le sujet à un moment
où elle peut jouer le rôle de déclencheur de nouvelles pistes d’explorations.
Mots clés
:
autophagie, virus, relations hôte-pathogène
Abstract. Autophagy is a cellular response to various stresses under which a
eukaryotic cell can be put. It involves the engulfment of a cytosolic volume by
a double membrane vesicle in order to degrade its content. This content can
comprise pathogens that the cell wants to get rid of. In that, autophagy is part
of the defense mechanism of an infected cell. For viruses, as expected, this
defense mechanism leads to escape or neutralization reactions. Furthermore,
some viruses have evolved to hijack autophagy in order to optimize their mul-
tiplication potential. The description of the complex interactions between viral
multiplication and autophagy is only at its start. This review attempts to update
the field at a time when it can give rise to new exploration avenues.
Keywords
:
autophagy, virus, host-pathogen-interactions
1
Généralités
L’autophagie (ou autophagocytose) est une réponse cellu-
laire à divers stress auxquels une cellule eucaryote peut
être soumise. L’autophagie permet de circonscrire un
volume cytosolique dans une vésicule puis de dégrader
son contenu après fusion avec le lysosome. La vésicule
d’autophagie peut contenir des organelles, des protéines
à longue durée de vie ou des agents pathogènes. Il est
important de distinguer l’autophagie de la voie protéo-
lytique qui concerne les protéines à courte durée de vie
dégradées par le protéasome [1]. Notons que l’autophagie
est impliquée dans plusieurs maladies humaines (maladie
de Parkinson, maladie d’Alzheimer, maladie de Hungting-
ton, myopathie) [2].
On distingue généralement l’autophagie assistée
(chaperone-mediated autophagy), la microautophagie et
la macroautophagie [3] :
–l’autophagie assistée fait intervenir la protéine chape-
rone Hsc70 qui reconnaît un motif KFERK-like sur la
protéine cible. Le complexe protéine-Hsc70 se lie à
LAMP-2A, une protéine lysosomale transmembranaire
responsable du transfert de la protéine dans la lumière
du lysosome où elle est dégradée [4] ;
–la microautophagie voit la membrane lysosomale
s’invaginer et circonscrire des petits volumes de cyto-
plasme qui sont amenés dans la lumière du lysosome
où leur contenu est dégradé ;
–la macroautophagie (communément appelée autopha-
gie) est la voie principale de dégradation de constituants
cytoplasmiques. Elle se caractérise par la formation d’une
vésicule à double membrane (autophagosome) qui finit par
fusionner avec le lysosome. Suite à la dégradation par les
hydrolases lysosomales, le contenu peut être recyclé.
Dans cette revue, nous nous focaliserons uniquement sur
le processus de macroautophagie dans la cellule de mam-
Virologie 2009, 13 (1) : 37-51
doi: 10.1684/vir.2009.0227
revue
Virologie, Vol. 13, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2009 37
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

mifère, que nous appellerons plus simplement « autopha-
gie ». De plus, il est à noter que cette revue n’a pas la pré-
tention d’être exhaustive. Elle se concentre sur l’autopha-
gie en relation avec les infections virales.
Formation et régulation de l’autophagie
De nombreux gènes impliqués dans la formation et la régu-
lation de l’autophagie ont été décrits qui portent le nom de
gènes atg (autophagy-related genes). Ces gènes sont parti-
culièrement bien décrits chez la levure où on en dénombre
au moins une vingtaine [3].
Formation de l’autophagosome
La formation de l’autophagosome peut être subdivisée
grossièrement en étapes distinctes (figure 1b, c, d).
Dans la phase précoce d’induction (formation de la mem-
brane d’isolation, figure 1b) intervient le complexe pro-
téique Beclin1/hVps34. Beclin1 joue un rôle de plateforme
d’assemblage. Elle affiche un domaine de liaison à Bcl-2,
un domaine coil-coiled, un domaine d’évolution conservée
(ECV) et un signal d’exportation nucléaire. hVps34, est
une phosophatidylinositol 3-kinase de classe III [3]. En se
fondant sur des données chez la levure, on peut supposer
que ce complexe permet le recrutement des protéines Atg
ainsi que la production de phosphatidylinositol
3-phosphates [PtdIns(3)P] [6]. De nombreuses protéines
régulatrices interviennent dans ce complexe. Bcl-2, pro-
téine anti-apoptotique, lie directement Beclin1 via le
domaine éponyme (figure 1b) et a un effet inhibiteur sur
l’autophagie [7]. La seconde, UVRAG (pour UV irradia-
tion resistance–associated gene) a, contrairement à Bcl-2,
une fonction activatrice de l’autophagie [8]. UVRAG
régule également le complexe en se liant directement à
Beclin1 via le domaine coil-coiled (figure 1b), renforçant
de ce fait, l’association entre Beclin1 et hVps34 [5]. Il est
pourtant à noter que, très récemment, deux travaux remet-
tent en question le rôle de UVRAG dans le processus
d’autophagie au profit d’un rôle dans le trafic vésiculaire
[9, 10].
Plusieurs protéines Atg sont impliquées dans la suite des
événements. Ces protéines pourraient servir en partie au
recrutement des membranes ainsi qu’à leur incurvation
nécessaire à la formation des vésicules à double membrane
que sont les autophagosomes. Il est à noter que l’origine de
ces membranes est sujette à controverse. Elles pourraient
provenir du reticulum endoplasmique, du Golgi ou être
synthétisée de novo. La protéine LC3 (microtubule-
associated protein 1 light chain 3, Atg8 chez la levure)
revêt une importance particulière dans la formation de
l’autophagosome. Suite à l’induction de l’autophagie, le
précurseur LC3-I est clivé dans sa partie C-terminale par
des autophagines (Atg4 chez la levure). Ce clivage permet
la liaison covalente d’un phosphatidyl-éthanolamine favo-
risant l’attachement aux membranes de cette forme lipidée,
appelée LC3-II [3] (figure 1c). LC3 est par ailleurs la seule
protéine Atg encore associée à l’autophagosome mature.
Deux autres protéines, Atg5 et Atg12, jouent un rôle clé
dans la formation de l’autophagosome. Ces deux protéines,
liées l’une à l’autre de manière covalente, forment un com-
plexe qui s’associe également à la membrane d’isolation
[11] (figure 1c). Au contraire de LC3, les protéines Atg5
Abréviations
Virus
CV Coxsackie virus
EBV Virus d’Epstein-Barr
FMDV Virus de la fièvre aphteuse
HCMV Cytomégalovirus humain
HCV Virus de l’hépatite C
VIH-1 Virus de l’immunodéficience humaine 1
HBV Virus de l’hépatite B
HRV Human Rhinovirus
HSV-1 Herpes Simplex Virus 1
KSHV Kaposi’s Sarcoma-associated HerpesVirus
PV Polio virus
MHV Virus de l’hépatite murine
TMV Virus de la mosaïque du tabac
VSV Virus de la stomatite vésiculaire
γHV68 Murine γ-Herpes Virus-68
Protéines
Atg Autophagy-related genes
eIF2αeukaryotic Initiation Factor 2α
Hsc70 Heat shock cognate 70 protein
ICP34.5 Infected cell protein 34.5
LAMP Lysosome-associated membrane protein
LC3 Microtubule-associated protein 1 light chain 3
LMP1 Latent membrane protein 1
CMH-II Complexe majeur d’histocompatibilité de classe II
Mtor mammalian target of rapamycin
PKR Protein kinase R
pp1αprotein phosphatase 1α
RIG-I Retinoic acid inducible gene-I
SKD1 (Vps4A) Suppressor of K(+) transport growth defect1
TLR7 Toll like receptor 7
UVRAG UV irradiation resistance–associated gene
Vps Vacuolar protein sorting
Divers
3-MA 3-methyl adenine
CMA Chaperone-mediated autophagy
ESCRT Endosomal sorting complex required for transport
HR Réponse hypersensitive
MVB MultiVesicular Bodies
PCD Programmed cell death
PtIns3P Phosphatidylinositol 3-phosphates
revue
38 Virologie, Vol. 13, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2009
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

et Atg12 se détachent de l’autophagosome mature. Il est à
noter que des cellules privées de Atg5 (atg5-/-) ne sont pas
compétentes pour l’autophagie [6].
Une fois arrivé à maturation l’autophagosome fusionne
avec le lysosome. Cette fusion passe fréquemment, dans
les cellules de mammifères, par l’intermédiaire d’une
fusion avec un endosome avant d’aboutir finalement à un
autophagolysosome (figure 1d, e). Cette fusion implique
les protéines, SKD1 AAA ATPase (homologue de
Vps4B chez la levure, [12, 13] et Rab7 [14] (protéine
GTPase). Un arrêt de cette fusion par expression de domi-
nants négatifs de ces protéines provoque l’accumulation
d’autophagosomes.
Régulation de l’autophagie
Deux systèmes de régulation de l’autophagie sont décrits,
l’un (mTOR) pour inhiber sa formation et l’autre (eIF2α)
pour l’induire.
mTOR (mammalian target of rapamycin) est une sérine/
thréonine kinase jouant le rôle de senseur des conditions
environnementales. Lorsqu’elle est activée, par exemple
en conditions riches en nutriments, elle inhibe l’autophagie
(figure 1a, [15]). Bien que très peu d’études soient centrées
sur ce sujet dans les cellules de mammifères, on peut néan-
moins supposer que mTOR agisse directement sur les pro-
téines Atg. Chez la levure, TOR phosphoryle Atg13 et
empêche la formation du complexe Atg13/Atg1, essentiel
pour le recrutement des protéines Atg à la membrane d’iso-
lation. En conditions de privation de nutriments, provo-
quant l’inactivation de TOR, Atg1 et Atg13 seraient hypo-
phosphorylées, conditions qui favoriseraient l’autophagie
[16]. De la même manière, la rapamycine, une substance
inhibant TOR/mTOR, favoriserait l’état hypo-phosphorylé
des Atg13/Atg1, induisant l’autophagie [15, 17].
Chez la levure, il a été clairement démontré que la phos-
phorylation d’eIF2α(un facteur d’initiation de la traduc-
tion) effectuée par la kinase GCN2, est essentielle pour
l’activation de l’autophagie lors de la carence en nutri-
ments. Dans les cellules de mammifères, c’est PKR (éga-
lement une kinase impliquée dans la phosphorylation
d’eIF2α) qui est importante pour l’induction de l’auto-
phagie [18] (figure 1a). Il est important de remarquer que
Autophagie
membrane
d’isolation
autophagosome
fusion au
lysosome
autophagolysosome
Beclin1/hVPS34
ATG12/ATG5
Bcl-2
UVRAG
LC3-I
LC3-II
Autophagines
SKD1
Rab7
b
cd
e
mTOR
eIF2α−P
a
PKR
TLR7
CMH-II
Rapamycine
Figure 1. Événements moléculaires de l’autophagie chez les mammifères. Les protéines cellulaires impliquées dans les différentes éta-
pes de l’autophagie sont présentées. a) Deux voies régulatrices nous intéressent dans cette revue, mTOR (inhibitrice de l’autophagie) et
eIF2α(activatrice de l’autophagie). Il est à noter que la Rapamycine, en inhibant mTOR, induit l’autophagie.
b) Le complexe Beclin1/hVPS34 est crucial pour la formation de la membrane d’isolation. Ce complexe est régulé par les protéines cellu-
laires Bcl-2 et UVRAG.
c) LC3-I est clivée par les autophagines, ce qui permet d’ajouter un phosphatidyl-éthanolamine pour donner la forme lipidée, appelée
LC3-II. LC3-II et le complexe Atg12/Atg5 sont impliqués dans les événements qui permettent l’élongation et la maturation de l’autophago-
some.
d) Les protéines SKD1 et Rab7 sont impliquées dans la fusion de l’autophagosome au lysosome.
e) La fusion au lysosome permet la dégradation de son contenu ainsi que l’activation de TLR7 ou la présentation de peptides par MHCII.
En vert, les partenaires activateurs et en rouge les partenaires inhibiteurs de l’autophagie.
revue
Virologie, Vol. 13, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2009 39
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

PKR joue un rôle majeur dans l’immunité innée ; elle est
activée suite à l’infection virale. Ainsi, dans ces cellules, la
phosphorylation d’eIF2αentraine une stimulation de
l’autophagie aussi bien après carence de nutriments
qu’après stimulation de PKR par une infection virale.
Ces deux systèmes viennent en fait compléter la régulation
par le complexe Beclin/hVps34. Leur action est vraisem-
blablement liée, mais on ne connait pas du tout à ce point le
mécanisme par lequel eIF2αstimule l’autophagie.
Autophagie et réponses de défense
contre l’infection
La réponse innée
Lors d’infections virales, l’autophagie est clairement liée à
l’immunité innée, non seulement via la protéine PKR (cf. ci-
dessus), mais également par l’intermédiaire de plusieurs
autres protéines. C’est le cas de TLR7 (Toll Like Receptor
7), un récepteur transmembranaire présent dans les endo-
somes. Les TLR, de manière générale, reconnaissent les aci-
des nucléiques des virus qui ont été endocytosés [19]. Dans
des cellules dendritiques plasmacytoïdes, la voie de l’inter-
féron est activée via TLR7 lors d’une infection par VSV
(vesicular stomatitis virus) et l’activation de TLR7 est
dépendante de l’autophagie. En effet, la production
d’interféron-αn’est pas induite dans des cellules atg5
-/-
[20].
Une deuxième étude met en relation l’autophagie avec une
autre protéine impliquée dans l’immunité innée, RIG-I.
RIG-I est une hélicase cytoplasmique qui détecte des
ARN viraux possédant une extrémité 5’-triphosphate, ou
des ARN double brin [21]. L’activation de l’immunité
innée via RIG-I, après infection de cellules MEFs (murine
embryonic fibroblasts) par VSV, est dépendante du com-
plexe Atg5-Atg12 [22]. Cette fois, pourtant, la production
d’interféron augmente en réponse à l’infection par VSV
dans des cellules MEF atg5
-/-
. De façon intéressante, l’effet
semble contraire lorsque l’infection se passe dans des cel-
lules dendritiques ou dans des fibroblastes. Toutefois, dans
les deux cas la production d’interféron semble être liée à
l’autophagie.
Le but ultime de la cellule infectée étant de se débarrasser
de « l’intrus », on peut également citer le processus dit de
« xénophagie » comme faisant partie de l’immunité innée.
En effet, la xénophagie est le processus qui permet la dégra-
dation du pathogène par la voie lysosomale (figure 1e).
La réponse de l’immunité adaptative
Il semble de plus en plus évident que l’autophagie joue un
rôle dans la présentation de peptides par le complexe
majeur d’histocompatibilité de classe II (CMH II) [23].
Il existe notamment une publication démontrant l’impor-
tance de la macroautophagie dans la présentation d’une
protéine virale, EBNA-1 (virus d’Epstein-Barr), par le
complexe CMH II [24].
La mort cellulaire
Bien que l’autophagie permette la survie des cellules dans
le cas de la carence en nutriments (cf. ci-dessus), elle peut
également induire la mort cellulaire. Ce type de mort cel-
lulaire s’appelle PCD de type II (type II programmed cell
death) [25, 26] au contraire de l’apoptose qui est une PCD
de type I. L’importance de l’apoptose dans la défense
contre les infections virales a déjà largement été étudiée
[27]. Comme nous le verrons plus tard, la PCD de type II
est également impliquée dans les infections virales, condi-
tions où elle peut être connectée à l’apoptose.
Les virus et l’autophagie
Au vu de la nature, des fonctions et des implications de
l’autophagie, on comprend que les virus aient développé,
au cours de l’évolution, des stratégies de « maîtrise » du
processus. Certains virus bloquent l’autophagie, d’autres
la détournent à leur profit, comme pour d’autres machine-
ries cellulaires [corps multi-vésiculaires (MVB), cytosque-
lette, apoptose, machinerie de traduction…]. Les virus ne
sont, d’ailleurs, pas les seuls pathogènes à devoir composer
avec l’autophagie. Plusieurs bactéries [28, 29] et parasites
[30, 31] ont également été décrits en étroite liaison avec ce
processus cellulaire.
La suite de cette revue va voir des virus de différents types
présentés dans leur implication avec l’autophagie : des
virus à ADN, à ARN, et des rétrovirus.
Les virus à ADN
Les Herpesviridae
Les virus de la famille des Herpesviridae ont des génomes
composés d’ADN double brin de grande taille. Ces géno-
mes peuvent coder pour plus d’une centaine de protéines,
dont près de la moitié ne sont pas essentielles pour le cycle
de multiplication : elles sont dévolues à la relation avec la
cellule hôte ou plus largement avec les réactions de l’hôte
infecté.
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
HSV-1 possède une protéine neurovirulente, ICP34.5
(infected cell protein 34.5), qui joue un rôle fondamental
dans l’autophagie dans la mesure où elle permet au virus de
la contourner de deux manières différentes.
La première consiste à contrecarrer l’effet activateur de
PKR sur l’autophagie [18] (figure 2). ICP34.5 recrute une
protéine phosphatase 1α(pp1α) qui dé-phosphoryle
eIF2α−P, empêchant ainsi l’induction de l’autophagie tout
revue
40 Virologie, Vol. 13, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2009
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

en restaurant la traduction cellulaire [32]. L’antagonisme
d’ICP34.5 sur PKR est déterminant pour éviter la dégrada-
tion du virus, une démonstration faite en utilisant des cellu-
les PKR-/- et une souche virale déficiente pour le gène
ICP34.5 [33]. Cette conclusion doit être tempérée par le
fait que l’élimination de l’autophagie dans des cellules pri-
maires Atg5-/- n’affecte pas significativement la multiplica-
tion de HSV-1 [34]. Les auteurs en concluent que si ICP34.5
est bien impliquée dans la régulation de l’autophagie, c’est
la prévention par cette protéine de l’arrêt de la traduction
plutôt que son contrôle sur l’autophagie qui représente l’élé-
ment déterminant l’efficacité de multiplication de HSV-1
dans des cultures de cellules primaires.
La seconde manière de contourner l’autophagie est liée à la
protéine Beclin1, avec laquelle ICP34.5 peut également
interagir (figure 2). Reste pourtant à préciser à ce jour le
mécanisme par lequel ICP34.5 inhibe la fonction de
Beclin1 [35].
Cytomégalovirus humain (HCMV)
HCMV inhibe la formation d’autophagosomes dans des
fibroblastes primaires humains (MRC5) [36]. Le virus a
un effet sur la redistribution de la protéine de fusion GFP-
LC3. Lors d’induction d’autophagie GFP-LC3 présente
une distribution ponctiforme, alors qu’en conditions d’inhi-
bition cette distribution est diffuse dans le cytoplasme.
C’est cette distribution diffuse qui est observée dans les
cellules infectées par HCMV. Il semblerait que le niveau de
LC3-II augmente après infection, mais que cette augmen-
tation ne soit pas suivie de formation d’autophagosome
(distribution ponctiforme). Ainsi, l’inhibition par HCMV
de l’autophagie arriverait après la lipidation de LC3-I.
De plus, HCMV active la voie mTOR, ce qui pourrait par-
ticiper à l’inhibition de l’autophagie (figure 3). Cela a pour
résultat de rendre les cellules infectées résistantes à la rapa-
mycine.
Par ailleurs, deux protéines virales pTRS1 et pIRS1 peuvent
bloquer la phosphorylation de eIF2α[37, 38]. La conséquence
en est bien sûr la levée de l’arrêtdesynthèsedeprotéines,
mais également la réduction possible d’un effet inducteur de
l’autophagie par eIF2α-P.
Quant au bénéfice que HCMV tire de l’inhibition de l’auto-
phagie, on peut imaginer, comme pour HSV-1, qu’il se
situe au niveau du contrôle de la dégradation des particules
virales, mais un tel gain n’a pas été démontré.
KSHV et γHV68
Le virus du sarcome de Kaposi (Kaposi’s sarcoma-
associated herpesvirus, KSHV) et le virus murin γ-
herpes-68 (γHV-68) codent pour une protéine homologue
de Bcl-2 (viral Bcl-2, vBcl-2). Comme la protéine Bcl-2
cellulaire, ces protéines virales interagissent directement
avec Beclin1 et sont en mesure d’inhiber l’autophagie
grâce à cette interaction (figure 4) [7, 39]. Le rôle de cette
inhibition pour l’infection virale reste toutefois à détermi-
ner. vBcl-2 semble être importante pour l’établissement de
l’infection chronique. Il serait dès lors aussi important de
neutraliser l’autophagie que d’empêcher l’apoptose, un
rôle attribué également à vBcl-2.
Le virus d’Epstein-Barr (EBV)
EBVexprime une protéine oncogène LMP1, nécessaire à la
prolifération des lymphocytes B infectés. LMP1 induit
l’autophagie de manière dose-dépendante. À faible niveau
de LMP1 les cellules affichent un grand nombre d’autopha-
gosomes, elles se trouvent dans un état d’autophagie pré-
coce. À haut niveau LMP1, en revanche il y a accumulation
d’autolysosomes [40]. La quantité de LC3-II varie égale-
ment selon la quantité de LMP1, le rapport LC3-II/LC3-I
augmentant dans les cellules où LMP1 est le plus fortement
HSV-1
Beclin1
Autophagie
eIF2α-P
Dégradation virale
pp1α
vICP34.5
eIF2α
Figure 2. HSV-1 et l’autophagie. Les protéines en vert sont celles
impliquées dans la voie de l’autophagie. Les protéines en noir pro-
duites (v = virales), activées ou recrutées dans le cadre de l’infec-
tion interviennent pour moduler l’étendue de l’autophagie. pp1α:
phosphatase cellulaire recrutée par la protéine virale ICP34.5. En
jaune, effet biologique sur le cours de l’infection virale : ici, l’auto-
phagie est inhibée, ce qui équivaut à une diminution de la dégrada-
tion des composants viraux. La flèche verte en trait tillé indique une
diminution du pouvoir inducteur de eIF2α-P, du fait de sa déphos-
phorylation induite indirectement par la protéine virale. Voir égale-
ment le texte pour plus de détails.
revue
Virologie, Vol. 13, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2009 41
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%