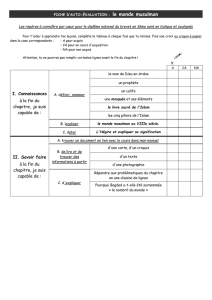l`islam dans l`axe du mal

REGARDS
SUR
L'ISLAM.
I
L'ISLAM
DANS
L'AXE
DU MAL
RAPHAËL
LIOGIER
L
l
islam
est
aujourd'hui
mis en
accusation devant
le
tribunal
«
impartial
» de l'«
opinion publique mondiale
». Le
réquisitoire
est
simple
:
l'être musulman
est
incompatible avec celui
de
la
démocratie.
-Comme
si la
démocratie était autre chose qu'un
compromis historique, quelque
chose
de
plus mystérieux
et de
plus
intemporel qu'une vulgaire
situation
socio-historique détermi-
née, comme s'il s'agissait moins
stricto
sensu d'un système poli-
tique avec
des
caractéristiques institutionnelles
propres
qu'une
essence
ou
même
une âme
dont
les
démocraties concrètes c'est-à-
dire
les
États
«
industriels avancés
» se
font
les
porteurs
prophé-
tiques.
La
démocratie serait
dès
lors
un
ensemble
de «
valeurs uni-
verselles
»
constitutives d'une
«
bonne
humanité
» ou
même d'une
humanité
droite,
une
orthohumanité.
Le
monde raisonnable
de la
modernité s'assimilerait
à une
orthohumanité, digne
et
universelle,
comme
il y a une
orthodoxie digne
et
éternelle dans chaque reli-
gion.
De
même qu'au sein d'une tradition religieuse l'orthodoxie

REGARDS
SUR
L'ISLAM,
I
L'isiam
dans
ï'axe
du
mal
renvoie négativement
à
l'hétérodoxie
- ou à
l'hérésie dans l'image-
rie
chrétienne
- au
sein
de la
modernité mondialisée
l'ortbohuma-
nité
renvoie négativement
à une
humanité hérétique,
hétérodoxe,
dont l'islam
-
avec
en son
cœur l'islamisme
:
projet satanique
de
transformation
de la
société humaniste
en
société
islamique
- est
la
figure
la
plus aboutie. Cette vision,
au
sens mystique
du
terme,
place l'islam
sur un axe du mal
situé au-delà
des
lignes
de
démar-
cation
de la
démocratie.
Modernité
de
l'islam
Ce
visage monstrueux
nous
ferait
presque
oublier
que ce
même
islam
est le
produit direct
de
notre histoire monothéiste.
Ce
culte
est
aussi
une
culture
qui a
participé
à
construire
nos
identités
d'Occidentaux
- que nos
proches
ou
lointain ancêtres soient
juifs,
chrétiens catholiques, orthodoxes, musulmans
ou
autres
- à
partir
d'un même berceau méditerranéen.
Le
patrimoine
qui se
synthé-
tise dans
ce que
l'on appelle fièrement
la
démocratie
est le
fruit
laborieux
d'une
évolution dialectique, c'est-à-dire d'un
processus
historique
à
base
de
contradictions intellectuelles,
sociales
et
éco-
nomiques
(je ne
prendrai
pas ici le
risque
de
juger
si
l'un
de ses
registres domine
les
autres
et
lequel
!)
auquel
la
culture musulmane
a
indéniablement participé.
On
s'offusque
souvent
de
telle
ou
telle
sourate, montrant
du
doigt
la
rudesse impardonnable
du
Coran,
montrant
à
quel point
la
dignité
des
femmes
y est
bafouée,
à
quel
point
les
châtiments
y
sont cruels,
les
mœurs intolérablement
guerrières
et
sauvages.
Faut-il
rappeler
que
l'assimilation incondi-
tionnelle
de la
religion
à de la
tendresse intégrale,
à un
intemporel
espace
de
dialogue
et de
tolérance,
ainsi
que la
présentent
les
raffi-
nements
du
dialogue interreligieux, relève d'un romantisme
contemporain aussi apparemment
naïf
qu'hypocrite. Nous tou-
chons
plutôt,
à
travers cette tolérance humaniste,
à une des
moda-
lités
du
religieux telles qu'il
se
repense
et se
restructure dans
la
modernité, modalité elle aussi socio-historiquement située avec
ses
nouveaux
enjeux
qui ne
sont
pas si
unilatéralement pacifiques
qu'ils
en ont
l'air.
105

REGARDSSURL'ISLAM,
L'islam
dans
1'axe
du
mal
L'islam
est, comme toute religion,
né
dans
un
contexte
social,
culturel
et
économique.
En
l'occurrence celui d'une société
originellement
bédouine
luttant
pour
sa
survie dans
des
conditions
très
rudes.
La
plupart
de ses
prétendus
traits
horrifiques
pourraient
d'ailleurs
plutôt pour l'époque
- sur une
échelle normée
par la
modernité
elle-même
-
être considérés comme
des
progrès
: le
fait
de
conférer
une
part successorale
aux
femmes
par
exemple, même
si
celle-ci
est
inférieure
à
celle
qui est
attribuée
aux
hommes,
revient
déjà
à
imposer
ce qui
était loin d'être acquis dans
le
contexte
des
tribus
arabes
du VIe
siècle
de
notre ère.
Si
nous abordons maintenant l'ontologie, l'essence
du
dogme,
en
dehors
des
péripéties historiques, alors
il me
semble
-
quitte
à
surprendre
au
mieux
et à au
pire
à
indigner
- que
l'islam
est le
plus
moderne
des
trois monothéismes, sans entendre
le mot
seule-
ment
dans l'acception
de «
récent
». La
définition
la
plus basique,
pour ainsi dire atomique,
de la
modernité
est en
effet
à
rechercher
chez
son
père
fondateur
le
plus cohérent,
Emmanuel
Kant,
dont
la
proposition centrale ressemble
fort
à
celle
de
l'islam
: on ne
peut
et
doit
pas
représenter l'absolu. Pour
Kant,
« il n'y a de
science
que des
phénomènes
» et les
phénomènes
ne
sont
(étymologique-
ment
et
fondamentalement) saisissables
que
parce qu'ils corres-
pondent
aux
catégories
de
notre entendement, nous
ne
pouvons
voir
du
réel
que ce que nos
catégories laissent passer, nous
ne
per-
cevons
toujours
de la
nature
que des
représentations.
Or,
l'absolu
ne
peut
pas se
réduire
à de
telles catégories
:
Dieu
ne
peut
faire
l'objet
d'aucune science parce qu'il
ne
peut
pas
être représenté.
Kant
critique
les
prétentions absurdes d'une raison pure
qui
cher-
cherait
à
connaître
le
divin
par
représentation
- ce
serait
la
qua-
drature
du
cercle
-,
prétention
qui est
encore pourtant patente
dans l'œuvre d'un Descartes
qui
croyait trouver dans
la
perfection
rationnelle
du
monde
une
sorte d'objectivité divine.
De ces
prolé-
gomènes épistémologiques kantiens découle
une
autre proposition
plus
sociopolitique
: le
divin
ne se
représente
pas à nos
sens
en
général
et, par
conséquent,
ne se
représente
pas non
plus
en
parti-
culier
comme
une
autorité politique. Personne
ne le
représente
sur
Terre.
Aucune autorité politique, aucun prince, aucun prêtre, n'est
absolument
légitime.
1061

REGARDS
SUR
riSLAM,
I
['islam
dans
ï'axe
du
mal
Islam
désigne
en
langue arabe
la
soumission, mais
la
sou-
mission
à un
absolu
qui ne se
représente pas, dont
personne
ne
détient
la
parole absolument légitime, même
si
cette parole
a été
appropriée
par des
factions
durant l'histoire concrète
des
civilisa-
tions musulmanes.
Qui
irait
dire
que
l'histoire
du
christianisme
est
un
exemple d'évangélisme appliqué
?
Cette soumission
est
somme
toute
assez
proche
- ou du
moins peut être interprétée
assez
faci-
lement
-
comme
la
soumission libératoire
à la
Raison législatrice
non
écrite
que
requiert
Kant.
Cet
appel permanent
à la
Raison
jamais
réduite
à une
Constitution,
à
l'intelligence d'un bien supra-
phénoménal s'imposant catégoriquement
aux
situations
les
plus
diverses
est
sans
cesse
rappelé dans
le
Coran
et
dans nombre
de
ses
courants
jurisprudentiels.
C'est
le
moteur même
de
Vijtihad,
effort
permanent d'interprétation, tentative
d'atteindre
l'esprit
au-
delà
de la
lettre,
de
juger chaque problème,
conflit,
délit, situation
sociale
et
individuelle
en
fonction
d'un impératif catégorique
(le
verbe
non
écrit,
non
représenté).
La
Shûra,
la
consultation, témoigne
que
l'islam
n'est
pas
étranger
non
plus
à la
démocratie
au
sens
procédural.
Les
modèles
institutionnels
possibles
peuvent varier
à
loisir puisque
ni le
Coran
ni
la
Sunna
(la
tradition
du
Prophète)
ne
font
référence
à un
quel-
conque gouvernement islamique.
Les
quelques vagues allusions
à
un
type d'autorité
ont
donné lieu
à une
multitude d'interprétations.
Certains,
s'appuyant
sur le
silence
du
prophète
en
cette matière,
peuvent même
affirmer
que
l'islam
ne
doit
pas
s'occuper
de
poli-
tique tout court. D'autres défendent
que
l'autorité politique, quelle
qu'elle soit, démocratique
ou
non, doit mettre
en
œuvre
la loi
divine
qui
serait comme
une loi
fondamentale
non
écrite,
une
Consti-
tution
non
représentée,
une
sorte
de
tribunal
de
Dieu
ou de la
Raison
si
l'on veut parler
en
langage kantien. D'autres, bien sûr,
considèrent
que le
califat
est
l'unique modèle politique légitime
puisqu'il
a été
choisi
par les
successeurs directs
du
Prophète.
Mais,
même dans
ce
cas,
il n'y a pas de
modèle
définitif
et
unique
de ce
qu'est
le
califat
: à ce
sujet
les
doctrines
les
plus diverses nour-
rissent
le
droit public musulman.
Les
juristes-théologiens
ont
d'ailleurs
développé
des
doctrines
du
califat
assez
différentes
de la
pratique
califale
concrète,
affirmant
un
droit
de
désobéissance
vis-
|!07

REGARDS
SUR
L'ISLAM,
I
L'islam
dans
1'axe
du mal
à-vis
de
l'imam,
du
sultan,
du
roi,
ou de
toute autorité quel
que
soit
son
nom,
si
celle-ci contrevient
à
l'islam,
c'est-à-dire
ne se
soumet plus
à
l'absolu,
à sa
puissance
non
représentable, mais
que
chacun reconnaît comme
une
Raison
suffisante,
une
raison
commune. L'institution
de la
Shûra,
consultation plus
ou
moins
élargie,
des
oulémas
ou
d'autres représentants
de la
communauté,
manifeste
ce
contre-pouvoir
«
raisonnable
». On ne
peut
pas
stricte-
ment
dans
ces
cas, bien sûr, parler
de
démocratie puisque l'ultime
législateur
reste Dieu
et non le
peuple. Pourtant
le
peuple tout
comme
l'«
opinion publique
»
sont
des
abstractions,
des
absolus
qui
supposent
des
modes
de
consultation
qui ne
sont, même
en
situation
de
démocratie moderne, jamais
parfaits,
ainsi qu'en
témoignent
les
débats sempiternels
sur le
plus
ou
moins grand
degré démocratique
des
modes
de
scrutin (1). Consulter
un
Dieu
non
représentable, comme consulter
un
peuple
toujours
essentiel-
lement absent, revient
dès
lors simplement
à
consulter
des
groupes
d'individus
plus larges
que
ceux
qui
détiennent
le
pouvoir actuel
et
effectif.
La
démocratie n'est plus ainsi réductible
à une
essence,
mais
à un
certain degré d'élargissement
de la
consultation,
que
l'on prétende
que
cette dernière consiste
à
interroger Dieu
ou le
peuple.
Dieu
et le
peuple sont
des
principes
qui ne
sont jamais
définitivement
appropriés, contre-pouvoirs permanents
car
prin-
cipes
de
soumission
de
toute autorité temporelle
à une
autorité
qui
la
dépasse
à
travers
des
procédures
de
consultation pouvant
aller
jusqu'à
un
élargissement
aux
catégories
les
plus diverses
de
la
population.
Toutes
les
adaptations
et
combinaisons sont donc
possibles.
À
partir
du
XIXe
siècle
ce
postulat
de
Dieu seul législateur n'em-
pêchera
pas les
islamistes d'adopter
des
schèmes étatiques
et
constitutionnels occidentaux, bien
que le
contrôle
de
conformité
des
lois
ne se
fasse
pas
relativement
à des
fondements constitu-
tionnels républicains mais relativement
à une Loi
divine tout aussi
universelle.
Le
modèle
de
constitution élaboré
par le
Conseil isla-
mique
d'Europe
en
1983
est à cet
égard éloquent
:
l'assemblée
consultative
(majlis
al-shûra)
rédige
les
lois civiles
et
fait
appel
à
l'«
opinion
du
conseil
des
docteurs
de la loi »
afin
de
vérifier
leur
conformité
avec
la loi
divine, l'imam exécute
les
décisions
de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%