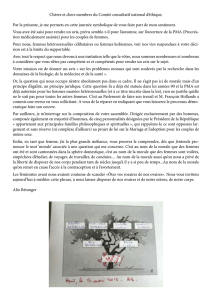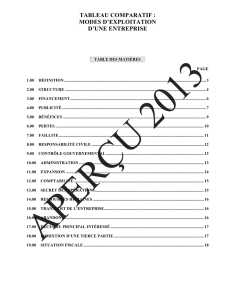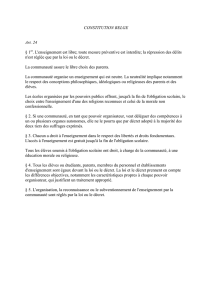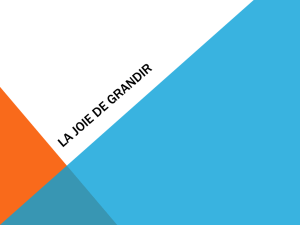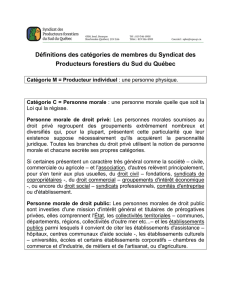la morale et la langue française - Académie des sciences morales et

LA MORALE ET LA LANGUE FRANÇAISE
Rapport de l’Académie
des Sciences morales et politiques
sous la direction de
Gérald Antoine
Rapporteur général : Jean-Paul Clément
Rapporteurs :
des origines à 1500 : Geneviève Hasenohr et Nathalie Koble
XVIe-XXIe siècles : Anne Auchatraire et Agnès Steuckardt
LE PRESENT RAPPORT A ETE EDITE PAR
LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
DANS LA COLLECTION DES CAHIERS DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
EN OCTOBRE 2004
RETOUR AU SOMMAIRE

Ont collaboré à cet ouvrage
Gérald Antoine, membre de l’Institut, agrégé de grammaire et docteur es lettres, a enseigné
l’histoire de la langue française en Sorbonne. Il a d’autre part créé l’Académie d’Orléans-Tours et
travaillé auprès du Ministre de l’Education nationale, puis du président de l’Assemblée nationale.
Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, président de la Société de Chateaubriand, directeur
de la Maison de Chateaubriand.
Anne Auchatraire, agrégée de philosophie, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure.
Geneviève Hasenohr, membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Nathalie Koble, agrégée de lettres modernes, archiviste paléographe, maître de conférences à
l’Ecole Normale Supérieure.
Agnès Steuckardt, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud, agrégée
de Lettres classiques, docteur en Sciences du langage, maître de conférences à l’université de
Provence.
RETOUR AU SOMMAIRE

AVERTISSEMENT
Deux difficultés se sont rencontrées sur notre route. Le lecteur risquant de les éprouver à
son tour, mieux vaut l'en prévenir dès le départ.
L'une tient aux circonstances : un premier tandem de chercheurs n'ayant pu, faute de
loisirs,, nous accompagner jusqu'au bout, un second dut prendre le relais. Il en résulte quelques
variations d'écriture, voire de contenu entre les chapitres. Mais au fait, en ces temps de
standardisation, la diversité peut être une source d'agrément.
L'autre difficulté, plus sérieuse, tient à l’organisation interne de l'ouvrage. Le refus de l' «
esprit de système » a peut-être été poussé trop loin, et la logique est loin de régner en maîtresse
absolue sur l'ordonnance des chapitres.
Vingt mots-clés du vocabulaire de la morale ont été retenus. Voici le schéma de
distribution qui a présidé à leur mise en place. Empirisme et rationalité s'y conjuguent :
I Un quatuor très uni : droiture, honneur, mérite vertu.
II Quatre couples de termes apparentés : morale-éthique ; droit-devoir ; justice-
équité ; confiance-fidélité.
III Deux couples antithétiques : tolérance-fanatisme ; mémoire (devoir de)-
opportunisme.
IV Une triade moins homogène : légitimité-responsabilité-sanction.
V Un moyen à toutes fins : ambition.
RETOUR AU SOMMAIRE

SCIENCES MORALES ET LANGUE FRANÇAISE
« Morale et langage sont des sciences particulières mais universelles »
Pascal, Pensées, n°613
Il est des sujets qui s'imposent à la fois parce qu'ils importent en eux-mêmes et parce qu'ils
occupent le premier rang sous les feux de l'actualité. Celui qui nous intéresse ici appartient sans nul
doute à cette catégorie privilégiée. Il lui appartient, et même triplement, par chacun de ses
composants. Qui n'est prêt à le reconnaître aujourd'hui, après une trop longue période d'incertitude :
si la survie de l'humanité au XXIe siècle exige la sauvegarde et la restauration de biens matériels
proprement élémentaires : air, eau, ressources minérales, végétales et animales, elle exige tout
autant, sinon d'abord, la sauvegarde et la restauration - voire l'inventive récréation de biens
moraux - de valeurs éthiques, comme on dit à présent : l'intégrité spirituelle de l'homme est pour le
moins aussi gravement menacée que son intégrité physique. Voilà pour le premier volet du
diptyque « sciences morales » ou « morale » tout court.
Quant à la « langue française », qui n'est pas seulement notre langue, il ne se passe pas de
semaine sans qu~un ou plusieurs livres, articles ou colloques soient consacres, cinq siècles après
Joachim du Bellay, à sa défense et à son illustration.
Cependant, il y a plus encore : par le fait, le thème du présent rapport ne comprend pas deux,
mais trois termes, le troisième fût-il réduit à une simple conjonction : « et ». Sous ses apparences de
« mot-outil » (comme l'appellent les linguistes) se cache la clé de l'ensemble des problèmes en
cause : « et » n'est sans doute qu'un « outil » - mais un outil de relation, et dans le cas présent
chargé de mettre en rapport morale et langue (française). Afin de rendre plus manifestes le poids
comme le sens de ce rapport, qu'il me soit permis d'inscrire côte à côte deux citations que sépare à
peu près un demi-millénaire. Elles sont d'une portée capitale et confèrent à notre entreprise sa
pleine légitimité.
Montaigne, dans l'Apologie de Raimond Sebond, hasarde cet aphorisme qui, de prime abord,
peut décontenancer : « La plus part des occasions des troubles du monde sont grammairiennes «. Le
poète Joë Bousquet, sur son lit de souffrances (la guerre de 1914-1918 l'avait à jamais blessé), ne
craint pas, pour sa part, de proposer cet axiome, lui aussi surprenant à la première lecture, mais on
ne peut plus pénétrant à la seconde : « le langage n'est pas contenu dans la conscience, il la
contient ».
« Donner un sens plus pur » aux mots de la morale
L'une et l'autre formules s'appliquent de manière flagrante au domaine des concepts et des
termes moraux. Chacun de ceux-ci, érodé par un trop long et fréquent usage, y a perdu de sa clarté
originaire et trop souvent suscité, pour reprendre les mots de Montaigne, des « occasions de
troubles ». Songeons par exemple au premier terme de la trinité morale sur quoi se fonde notre
République et relisons à son propos les inquiétantes analyses de Paul Valéry. Leur titre à soi seul
traduit l'essentiel : « Fluctuations sur la Liberté ». Et que dire des toutes premières lignes :
« Liberté : c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent
plus qu'ils ne parlent; qui demandent plus qu'ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les

métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de
Politique ; mots très bons pour la controverse... » (Valéry, Œuvres, Ed. Pléiade, t. II, p. 951-969 )
Face à la « liberté », périlleusement partagée en effet entre métaphysique, morale et
politique, et toujours à titre d'exemples (pris à demi hors de la liste retenue dans ce premier volume),
pourquoi ne pas ranger le couple « raison – justice » qu'ont choisi de faire voisiner, sur un mode
également incisif et cruel, La Fontaine et Pascal ? - Ce dernier, dans la même Pensée
(« Imagination »), nous invite à réfléchir sur l'authentique signification de cette plaisante raison
qu'un vent manie et à tous sens «, puis aussitôt après sur cette non moins « plaisante justice » que
les magistrats déguisent sous « leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmaillotent en chats
fourrés » : ah ! il en irait d'autre sorte, s'ils avaient la véritable justice ».
De manière étrangement parallèle, « le bon » La Fontaine, à coup sûr plus ami de la vérité
que de la bonté, n'a pas craint de faire voisiner ces deux distiques :
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure
et
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Le premier de ces deux constats désabusés non dépourvus de cynisme (comment peut-on
encore parler de la « morale » des Fables ?) ouvre un apologue qu'on nous fit apprendre dès notre
plus jeune âge. Le second sert de clausule aux « Animaux malades de la peste » : il nous enseigne
que la peste la plus mortelle dont nous sommes tous frappés est au bout du compte l'injure faite à la
morale véritable par la fausse justice des hommes. Rien depuis lors n'a changé : tel « jugement de
cour » tout récent s'applique à faire, en ses attendus, un soigneux départ entre deux registres
étrangers l'un à l'autre : le « moralement blâmable » et le « judiciairement punissable ». Tout se
passe dès lors comme si Justice et Morale devaient être disjointes avec grand soin.
Cette « morale » assidûment proposée par notre grand fabuliste, dont le temps présent a
rajeuni l'énoncé sans altérer son esprit, suffirait à nous inspirer une première démarche : pourquoi
ne point procéder à l'inventaire, au moins global, des modes d'emploi et des valeurs de ce terme
morale, envisagé non pas en soi mais dans le tissu des différents ordres de discours, dans la variété
des époques et des situations, en s'en tenant pour commencer à la langue française ? - Montaigne
encore, dans l'Apologie de Raimond Sebond déjà citée (Montaigne, Essais, Ed. Pléiade, p. 651 ), avait
formé ce souhait. Il se bornait (si l'on peut dire) à l'Antiquité grecque et romaine et aux ouvrages de
philosophie; il disait « mœurs » plutôt que « morale », mais l'insistance, la singulière ferveur en
même temps que la précision du propos sont telles qu'il peut nous servir de sûr garant :
« combien je desire que, pendant que je vis, ou quelque autre, ou Justinus Lipsius, le plus
sçavant homme qui nous reste (... ), eust et la volonté et la santé, et assez de repos pour ramasser
en un registre, selon leurs divisions et leurs classes, sincèrement et curieusement, autant que nous y
pouvons voir, les opinions de l'ancienne philosophie sur le sujet de notre estre et de nos mœurs,
leurs controverses (... ). Le bel ouvrage et utile que ce seroit ! »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
1
/
154
100%