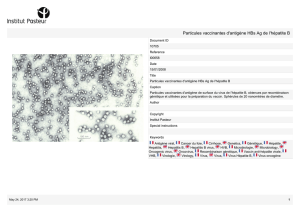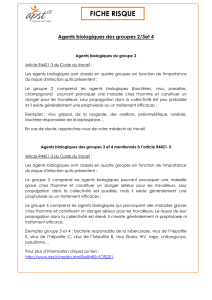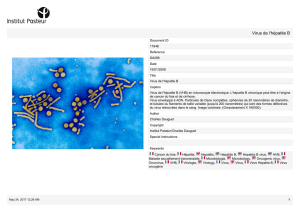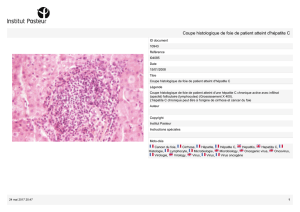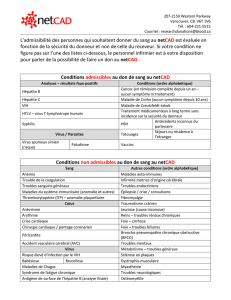Infection occulte par le virus de l`hépatite B

Mini-revue
Infection occulte
par le virus de l’hépatite B
Sophie Hillaire
Réseau Val de Seine, hôpital Foch, 40 rue Worth, 92150 Suresnes
L’infection occulte par le virus de l’hépatite B est définie par la
présence d’ADN du virus de l’hépatite B dans le sang détecté par
PCR chez des patients n’ayant pas d’Ag HBs circulant détectable.
Le plus souvent l’Ac anti HBc est présent dans le sérum. Il est
clairement établi que ces sujets peuvent transmettre le virus de
l’hépatite B lors de dons du sang ou d’organe. L’infection occulte
par le virus B joue probablement un rôle dans le développement du
carcinome hépatocellulaire. Par contre, la signification pathologi-
que de la persistance virale B reste à définir au cours des hépatites
chroniques dites cryptogénétiques, de la non-réponse au traitement
des hépatites chroniques C.
Mots clés : hépatite virale B, lymphocytes T spécifique, ac Hbs isolé, ADN virus B,
carcinome hépatocellulaire
On définit l’infection occulte par le virus de l’hépatite B par la
présence d’ADN du virus de l’hépatite B dans le sang, détecté
par PCR chez des patients n’ayant pas d’Ag HBs circulant
détectable. L’infection occulte est dite séropositive lorsqu’il existe un
marqueur sérique du virus B (le plus souvent un Ac HBc isolé ou Ac HBs et
Ac HBc positifs), séronégative lorsqu’aucun marqueur n’est présent (virus
mutant non détecté par les kits de dépistage habituels des anticorps
antiHBs ou antiHBc) [1].
Les concentrations d’ADN circulant sont le plus souvent faibles (< 10
5
copies/ml). Il se pose donc le problème chez les porteurs occultes du virus
B de la signification clinique de la présence virale (ou persistance virale)
et celui du degré de contagiosité chez des sujets immunocompétents.
Chez les patients immunodéprimés, le risque de transmission du virus B
par des porteurs occultes est bien démontré (greffe d’organes ou de
moelle, chimiothérapie). Lors des greffes hépatiques, en particulier, le
risque de transmettre le virus de l’hépatite B au receveur lorsque le
donneur est porteur d’un Ac HBc isolé est important.
Circonstances de découverte
La fréquence de l’infection occulte par le virus de l’hépatite B dépend
(tableau 1):
– de la fréquence de l’hépatite B dans une population donnée ;
– de l’existence ou non d’une maladie chronique du foie ;
– de la sensibilité des tests permettant de rechercher l’Ag HBs ou l’ADN
du virus B.
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006
Tirés à part : S. Hillaire
87
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Infections aiguës par le virus B
Au cours des hépatites aiguës de cause indéterminée,
on retrouve, dans0à41%descas, de l’ADN du virus
de l’hépatite B en PCR dans le sang ou dans le foie [2].
Après guérison d’une hépatite B aiguë (séroconversion
HBs, normalisation des transaminases), le virus reste
détectable par PCR chez 55 % des patients (10 à
30 ans après l’infection aiguë). Chez 14 patients gué-
ris d’une hépatite B, depuis en moyenne 4,2 années [1,
8, 9, 5], de faibles quantités d’ADN ont été retrouvées
dans le sang chez 3 patients (10
3
-10
4
/ml). Parmi eux,
9 patients ont eu une biopsie hépatique. Chez tous,
l’ADN du virus B était détectable dans le foie. Histolo-
giquement, ils présentaient une nécrose focale minime,
de même qu’une fibrose très modérée (1-3 ISHAK). Il
n’y avait pas ou peu d’inflammation et le degré
d’inflammation correspondait à l’intensité de la multi-
plication virale [2]. Les lésions n’étaient pas différentes
chez les patients ayant une consommation
d’alcool < 5 g/j que chez ceux consommant de 10 à
45 g/j. Un seul patient avait une histologie hépatique
considérée comme normale [3].
Quel rôle pourrait jouer la persistance virale chez des
malades guéris ?
En réponse à l’infection aiguë par le virus de l’hépatite B,
il se produit une réaction immunitaire avec stimulation
de la réponse des lymphocytes T cytotoxiques [4] :
– il existe une augmentation de l’expression des molé-
cules HLA de classe I capables de présenter l’antigène
HBs à la surface des hépatocytes infectés favorisant
leur destruction ;
– les lymphocytes T cytotoxiques synthétisent aussi des
cytokines pro-inflammatoires (IFN cet TNF a) inhibant
la réplication virale, donc la production de particules
virales limitant ainsi la destruction hépatocytaire.
Lors de la clairance virale, la persistance d’une faible
production virale pendant plusieurs années après la
« guérison » pourrait favoriser la stimulation du sys-
tème immunitaire et donc la production d’anticorps
protecteurs (évitant la réinfection).
Hépatites chroniques
Le portage occulte du virus B est plus fréquent chez les
patients ayant une maladie chronique du foie que chez
les donneurs de sang asymptomatiques [6]. Chez les
patients ayant une maladie chronique du foie « cryp-
togénétique », la présence occulte du virus de l’hépa-
tite B est retrouvée chez 8,5-14 % des patients ayant
une hépatite chronique et 7-33 % de ceux ayant une
cirrhose [6, 7]. Le rôle de la persistance du virus B avec
une faible multiplication virale en l’absence de mar-
queurs sériques n’est pas démontré dans l’inflamma-
tion et les lésions hépatiques. Dans le foie, l’Ag HBs,
l’AgHBe ne sont pas détectés, correspondant proba-
blement à la faible expression de ces protéines [7, 8].
Il est probable que la plupart des porteurs occultes du
virus B, se comportent comme des porteurs « sains » du
virus. Le virus pourrait agir comme cofacteur en asso-
ciation avec une consommation excessive d’alcool ou
une hépatite C.
• Rôle de l’infection occulte par le virus B
chez les porteurs du virus de l’hépatite C
Un tiers des patients ayant une hépatite chronique C
active sont porteurs occultes du virus B contre 14 % des
patients ayant une maladie hépatique chronique non liée
au virus C [6]
. Les porteurs chroniques du virus C ayant
une infection occulte B sont plus souvent cirrhotiques
(33 %) que les autres porteurs chroniques du virus C
(19 %) [6, 9]. La réponse au traitement antiviral C
pourrait être moins bonne chez les porteurs occultes du
B mais cette donnée reste à démontrer [6, 10].
• Rôle de l’infection occulte par le virus B
dans le développement du carcinome
hépatocellulaire
Le rôle de la présence occulte du virus B au cours du
carcinome hépatocellulaire est très discuté. Le virus de
l’hépatite B est un puissant carcinogène. Le risque de
développer un carcinome hépatocellulaire est multiplié
par 100 chez les porteurs du virus de l’hépatite B [11].
Les arguments cliniques, épidémiologiques et expéri-
mentaux allant dans ce sens sont nombreux. Après
vaccination contre le virus B, il a été démontré une
diminution de la fréquence du carcinome hépatocellu-
laire [12]. Comme au cours des hépatites chroniques
cryptogénétiques, le virus de l’hépatite B occulte est
retrouvé dans 5-55 % des cas de carcinome hépatocel-
lulaire. Le génome du virus B a été identifié dans des
tumeurs de patients n’ayant aucun marqueur sérique B
ou porteurs d’anticorps anti HBc isolés. Chez des
adultes ou des enfants développant des CHC sur foie
non cirrhotique, le génome du virus B est fréquemment
mis en évidence dans la tumeur avec une augmentation
à la fois de la forme libre du virus mais aussi de son
génome intégré dans les cellules tumorales. La conta-
mination périnatale, la présence d’une cirrhose et la
durée de l’infection par le virus de l’hépatite B sont des
facteurs de risque du développement d’un CHC chez
des porteurs de l’AgHBs ayant été séroconvertis dans
le système S mais porteurs occultes du virus de l’hépa-
tite B [13].
L’ADN du virus B a été retrouvé dans le foie de 62 %
des patients porteurs chroniques du virus C, dévelop-
pant un carcinome hépatocellulaire, et chez 67 % des
patients non contaminés par le virus de l’hépatite C
[14]. Le portage occulte du virus B pourrait aussi agir
comme un cofacteur chez les patients ayant une
consommation excessive d’alcool [15].
Mini-revue
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006
88
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Rôle de l’infection occulte
par le virus de l’hépatite B
chez les donneurs
de sang et d’organe
Le risque de transmission sanguine du virus de l’hépa-
tite B reste supérieur au risque de transmission du VHC
ou du virus VIH. La transmission est possible par des
donneurs Ag HBs négatifs, Ac HBc négatifs soit pen-
dant la fenêtre sérologique (en moyenne de 56 j au
cours de l’hépatite B, extrêmes 25 à 109 j), soit chez
des patients immunosilencieux ou ayant un virus
mutant, soit du fait d’une erreur technique. La fré-
quence du virus B occulte est plus élevée chez les
donneurs de sang séropositifs (présence de l’Ac HBc
+/- de l’AcHBs) que chez les patients séronégatifs
(7-38 % versus 0-17 %) [16, 17]. Il se pose alors le
problème de détecter l’ADN du virus B dans les dons
du sang qui est, plus sensible que les marqueurs viraux,
surtout dans les pays où l’endémie du virus est forte
[18].
Le risque d’hépatite B post-transfusionnelle en France
est de 1/450 000 (2 fois supérieure à celui de l’hépa-
tite C et 4 fois supérieure à celui du sida) est faible,
mais il reste plus élevé que celui de l’hépatite C
(1/760 000) ou du virus du sida (1,4/10
6
). Le risque
de transmission sanguine du virus B chez les patients
Ac HBc positifs est démontré depuis longtemps et ces
sujets sont exclus des dons depuis 1988 (AgHBs depuis
1971). De la même façon, il a été décrit des cas de
transmission de l’hépatite B chez le receveur, lors
d’un don d’organe à partir de donneurs ayant un
acHBc isolé. La persistance, même en faible quantité,
du virus B joue un rôle important dans cette situation.
En effet, du fait des traitements immunosuppresseurs
indispensables dans les suites de la transplantation, le
risque de réactivation virale B est majeur. En cas de
transplantation hépatique, il est contre-indiqué de
transplanter des foies de patients ayant des marqueurs
sériques du B. Pour les autres organes, des cas de
transmission du virus B ont été décrits chez des patients
transplantés à partir de donneurs HBc isolés. Ces dons
devraient donc être évités, sauf peut-être chez les
porteurs chroniques du virus B (en association avec des
immunoglobulines spécifiques) ou chez les sujets préa-
lablement vaccinés contre l’hépatite B [19, 20].
Rôle de l’infection occulte
par le virus B
chez les non-répondeurs
à la vaccination
Dans une étude récente, le portage occulte du virus B
explique dans 10 % des cas la non-réponse à la
vaccination contre l’hépatite B dans les pays de forte
endémie du virus [21].
Conclusion
Il existe probablement différents types d’infections
occultes par le virus de l’hépatite B comme il existe des
situations cliniques très variables chez les porteurs
chroniques du virus B.
Tableau 1.Fréquence de l’infection occulte par le virus B
Population étudiée Fréquence Référence
Témoin 2
Donneur de sang
Ac HBc + 2,4 % 16-17
Séronégatif 0-17 %
Hépatite aiguë cryptogénétique 0-41 % 2-3
Hépatite Chronique
HCV+ 19,5-33 % 6
HCV- 8,5-4 % 5; 6
Cirrhose 34 %
a
HCV+ 19 % 6
HCV- 33 % 6
Carcinome hépatocellulaire 16 % (USA)
61-67 % (recherche tissulaire) 14
Hémodialysé 3,8 %
b
a
Chan H, Tsang S, Leung N, Tse C, Phil M, et al. Occult HBV infection in cryptogenic liver cirrhosis in an area with high prevalence of HBV infection. Am J
Gastroenterol 2002 ; 97 : 1211-5.
b
Minuk G, Sin Df, Greenberg R, et al. Occult hepatitis B infection in north American adult hemodialysis patient population. Hepatology 2004 ; 40 : 1072-7.
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006 89
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

L’AgHBs peut ne pas être détecté du fait d’une mutation
[22] ou du fait d’une réplication virale insuffisante [13,
23-24].
La signification d’une réplication virale a minima n’a
probablement pas les mêmes conséquences chez un
patient ayant eu une infection aiguë par le virus B (elle
pourrait favoriser la mémoire immunitaire) et chez un
patient contaminé à la naissance, ayant de façon
tardive un AgHBs non détectable avec ou sans séro-
conversion dans le système S et avec une maladie
chronique hépatique. Dans ce cas, le risque de voir la
maladie continuer de s’aggraver existe (13,3 %), de
même que celui de développer un carcinome hépato-
cellulaire [13].
Même si le rôle exact de l’infection occulte par le virus
de l’hépatite B reste à confirmer, son existence ne fait
que rappeler l’intérêt majeur de la vaccination univer-
selle contre le virus de l’hépatite B.
Références
1
. Chaudhuri V, Tayal R, Nayak B, Kumar Acharya S, Kumar Panda S.
Occult hepatitis B virus infection in chronic liver disease : Full-length
genome and analysis of mutant surface promoter. Gastroenterology
2004 ; 127 : 1356-71.
2
. Brechot C, Thiers V, Kremsdorf D, Nalpas B, Pol S, Paterlini-Brechot P.
Persistent hepatitis B virus infection in subjects without hepatitis B surface
antigen : Clinically significant or purely occult? Hepatology 2001 ; 34 :
195-203.
3
. Yuki N, Nagaoka T, Yamashiro M, Mochizuki K, Kaneko A, Yamamoto
K, et al. Long term histologic and virologic outcomes of acute self limited
hepatitis B. Hepatology 2003 ; 37 : 1172-79.
4
. Chisari F. Viruses, immunity, and cancer : lessons from hepatitis B. Am
J Pathol 2000 ; 156 : 1117-32.
5
. Berasain C, Betes M, Panizo A, et al. Pathological and virological
finding in patients with persistent hypertransaminasaemia of unknown
aetiology. Gut 2000 ; 47 : 429-35.
6
. Cacciola I, Pollicino T, Squadrito G, Cerenzia G, Orlando M,
Raimondo G. Occult hepatitis B infection in patients with chronic hepatitis
C liver disease. N Engl J Med 1999 ; 431 : 22-6.
7
. Bréchot C, Trépo C, Ninova-Bradistilova D, Goudeau A, Degott C,
Maupas P, et al. Hepatitis B core antigen in hepatocytes of patients with
chronic active hepatitis. Dig Dis Sci 1980 ; 25 : 593-6.
8
. Han H, Hollinger F, Hooman C, Solomon H, Klinimalm G, Genta R,
et al. Southern-blot analysis and simultaneous in situ detection of hepatitis
B associated DNA and antigens in patients with end-stage liver disease.
Hepatology 1993 ; 18 : 1032-8.
9
. Villa E, Grottola A, Buttafoco P, Trande P, Merighi A, Fratti N, et al.
Evidence for hepatitis B virus infection in patients with chronic hepatitis C
with and without serological markers of hepatitis B. Dig Dis Sciences
1995 : 40 : 8-13.
10
. De Maria N, Colantoni A, Friedlander L, et al. The impact of pre-
vious HBV infection on the course of chronic hepatitis C. Am J Gastroen-
terol 2000 ; 95 : 3529-36.
11
. Yang HI, Lu SN, Liaw YF, You SL, Sun CA. Hepatitis B e antigen and
the risk of hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2002 ; 347 : 168-74.
12
. Huang K, Lin S. Nationwide vaccination : a success story in Taiwan.
Vaccine 2000 ; 18 : S35-S38.
13
. Ahn S, Park Y, Park J, Chang H, Lee J, Shin J, et al. Long term
clinical and histological outcomes in patients with spontaneous hepatitis B
surface antigen seroclearance. J Hepatol 2005 ; 42 : 188-94.
14
. Pollicino T, Squadrito G, Cerenzia G, Cacciola I, Raffa G, Crax A,
et al. Hepatitis B virus maintains its pro-oncogenic properties in the case
of occult HBV infection. Gastroenterology 2004, 126 ; 102-10.
15
. Yotsuyanagi H, Hashidume K, Suzuki M, Maeyama S, Takayama T,
Uchikoshi T. Role of hepatitis B in hepatocarcinogenesis in alcoholics.
Alcohol Clin Exp Res 2004 ; 28 : 181S-185S.
16
. Marusawa H, Uemoto S, Hijikata M, Ueda Y, Tanaka K,
Shimotohno K, et al. Latent hepatitis B virus infection in healthy indivi-
duals with antibodies to hepatitis B core antigen. Hepatology 2000 ; 31 :
488-95.
17
. Yotsuyanagi H, Yasuda K, Moriya K, Shintani Y, Fujie H, et al.
Frequent presence of HBV in the sera of HBsAg-negative, anti-HBc-
positive blood donors. Transfusion. 2001 ; 4 :1093-9.
18
. Liu C, Lo S, Kao J, Lai M, Ni Y, Yeh S, et al. Transmission of occult
hepatitis B virus by transfusion to adult and pediatric recipients in Taiwan.
J Hepatol 2006 ; 44 : 39-46.
19
. Roque-Afonso AM, Feray C, Samuel D, Simoneau D, Roche BS,
Emile JF, et al. Antibodies to hepatitis B surface antigen prevent viral
reactivation in recipients of liver grafts from anti-HBc positive donors. Gut
2002 ; 50 : 95-9.
20
. De Feo T, Poli F, Mozzi F, Moretti M, Scalamogna M, et al. Risk of
transmission of hepatitis B virus from anti-HBc positive cadaveric organ
donors : a collaborative study. Transplant. Proc. 2005 ; 37 : 1238-9.
21
. Yen Y, Chen C, Wang J, Lee C, Changchien C, Lu S. Study of hepa-
titis B (HB) Vaccine non-responsiveness among health care workers from
endemic aera. Liver Int 2005 ; 25 : 1162-8.
22
. Jeantet D, Chemin I, Mandrand B, Tran A, Zoulim F, Merle P, et al.
Cloning and expression of surface antigens from occult chronic hepatitis
B virus infections and their recognition by commercial detection assays. J
Med Virol 2004 ; 73 : 508-15.
23
. Guidotti LG, Rochford R, Chung J, Shapiro M, Purcell R, Chisari FV.
Viral clearance without destruction of infected cells during acute HBV
infection. Science 1999 ; 284 : 825-9.
En résumé
L’infection occulte par le virus de l’hépatite B se définit par la
présence d’ADN du virus de l’hépatite B dans le sang chez des
sujets n’ayant pas d’Ag HBs circulant détectable. L’infection
occulte est dite séropositive lorsqu’il existe un marqueur sérique
du virus B (le plus souvent un Ac HBc), séronégative lorsqu’aucun
marqueur n’est présent.
Les concentrations d’ADN du virus B circulant sont faibles (< 10
5
copies/ml), mais le risque de transmission du virus existe (greffes,
transfusions...).
Chez les porteurs occultes du virus B de la signification clinique
de la persistance virale peut être évoquée dans les circonstances
suivantes : développement du carcinome hépatocellulaire, sévé-
rité de l’infection par le virus de l’hépatite C ou non-réponse au
traitement, ou encore absence de réponse après une vaccination
contre le virus B.
Une réplication virale B a minima pourrait aussi, après sérocon-
version au décours d’une hépatite aiguë B, favoriser la mémoire
immunitaire et protéger contre le risque d’infection ultérieure.
Mini-revue
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006
90
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
4
100%