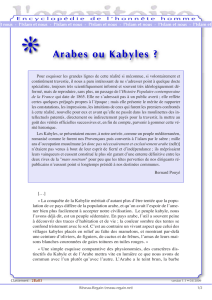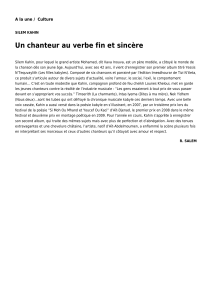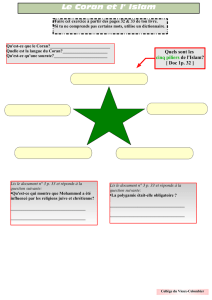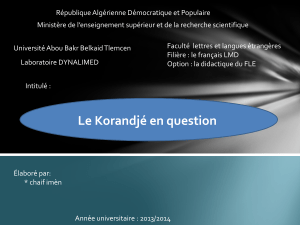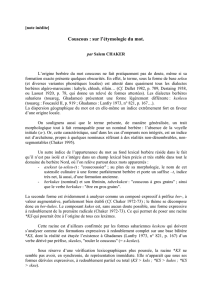Radiographie de trois traductions du Coran en kabyle

Études libres
Radiographie de trois traductions
du Coran en kabyle

232 / Kamel ChaChoua

Radiographie de trois traductions du Coran en kabyle / 233

234 / Kamel ChaChoua

Radiographie de trois traductions du Coran en kabyle / 235
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%