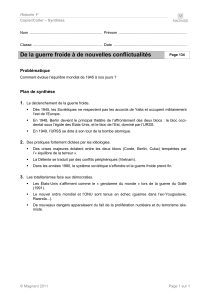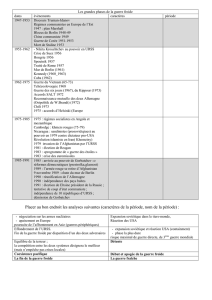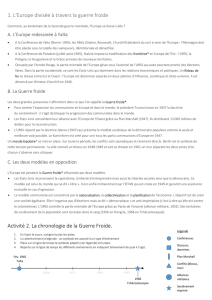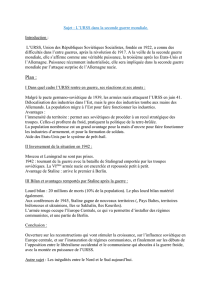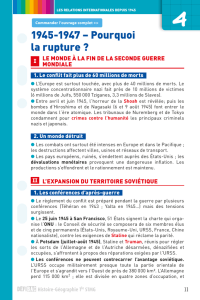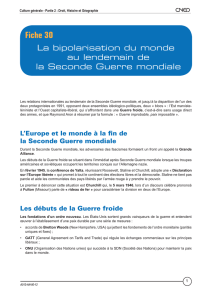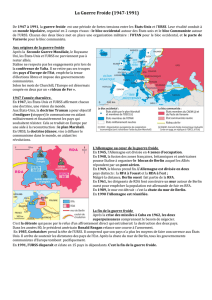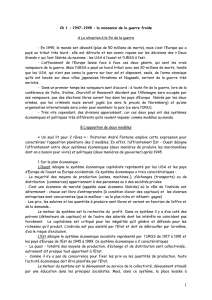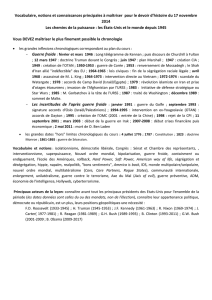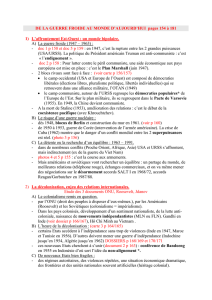ÉTATS-UNIS - U. R. S. S. (1945-1949) ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS - U. R. S. S. (1945-1949) ÉTATS-UNIS - U. R. S. S. (1945-1949)
Il ne peut y avoir aucun doute. Le texte du Pacte Atlantique, tel qu’il nous est connu, est
une machine de guerre dirigée contre l’Union soviétique et les démocraties populaires,
contre l’ONU, contre les peuples avides de paix et contre tout mouvement démocratique.
(...) Les domestiques zélés du souverain américain (...) ne pensent et ne vivent qu’en
fonction de la guerre des impérialistes yankees, ils ne pensent, ils ne vivent que pour mettre
nos villes et nos villages à l’heure américaine.
article d’André CARREL, L’Humanité, 19 mars 1949
«
De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le
continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d’Europe
centrales et orientale. (...) Toutes ces villes avec leurs populations se trouvent dans ce que
je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises d’une manière ou d’une autre
non seulement à l’influence soviétique, mais à un contrôle très étroit et parfois croissant de
Moscou ».
W. CHURCHILL, extraits du « Discours de Fulton » (aux ÉU), 5 mars 1946,
SUR NOTRE CARTE
: EN NOI
R
: Les pays de la zone atlantique.
EN GRISÉ : Zones de la « doctrine Truman » et zones soumises à l’influence
directe des États-Unis. L’Humanité, 19 mars 1949
«
Il ne faut pas oublie
r
: les Allemands ont envahi l’URSS [qui] a perdu près de dix-sept
millions de personnes (...) L’Union Soviétique ne peut oublier ces pertes. On se demande ce
qu’il peut y avoir d’étonnant dans le fait que l’Union Soviétique voulant garantir sa sécurité
dans l’avenir s’efforce d’obtenir que ces pays aient des gouvernements qui observent une
attitude loyale envers l’URSS ».
J. STALINE, article paru dans la Pravda, mars 1946,
Il ne peut y avoir aucun doute. Le texte du Pacte Atlantique, tel qu’il nous est connu, est
une machine de guerre dirigée contre l’Union soviétique et les démocraties populaires,
contre l’ONU, contre les peuples avides de paix et contre tout mouvement démocratique.
(...) Les domestiques zélés du souverain américain (...) ne pensent et ne vivent qu’en
fonction de la guerre des impérialistes yankees, ils ne pensent, ils ne vivent que pour mettre
nos villes et nos villages à l’heure américaine.
article d’André CARREL, L’Humanité, 19 mars 1949
« De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le
continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d’Europe
centrales et orientale. (...) Toutes ces villes avec leurs populations se trouvent dans ce que
je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises d’une manière ou d’une autre
non seulement à l’influence soviétique, mais à un contrôle très étroit et parfois croissant de
Moscou ».
W. CHURCHILL, extraits du « Discours de Fulton » (aux ÉU), 5 mars 1946,
SUR NOTRE CARTE : EN NOI
R
: Les pays de la zone atlantique.
EN GRISÉ : Zones de la « doctrine Truman » et zones soumises à l’influence
directe des États-Unis. L’Humanité, 19 mars 1949
« Il ne faut pas oublie
r
: les Allemands ont envahi l’URSS [qui] a perdu près de dix-sept
millions de personnes (...) L’Union Soviétique ne peut oublier ces pertes. On se demande ce
qu’il peut y avoir d’étonnant dans le fait que l’Union Soviétique voulant garantir sa sécurité
dans l’avenir s’efforce d’obtenir que ces pays aient des gouvernements qui observent une
attitude loyale envers l’URSS ».
J. STALINE, article paru dans la Pravda, mars 1946,

La « doctrine Jdanov », octobre 1947
Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus apparaissent
les deux directions principales de la politique internationale de
l’après-guerre , correspondant à deux camps : le camp anti-
impérialiste et démocratique et le camp impérialiste.
Les États-Unis en sont la principale force, soutenus par les pays
possesseurs de colonies.
L’Angleterre et la France sont unies aux États-Unis et marchent
comme des satellites en ce qui concerne les questions principales,
dans l’ornière de la politique impérialiste des États-Unis. Le camp
impérialiste est soutenu aussi par les États possesseurs de
colonies, tels que la Belgique ou la Hollande, et par les pays aux
régime réactionnaire antidémocratique, tels que la Turquie et la
Grèce, ainsi que par les pays dépendant politiquement et
économiquement des États-Unis, tels que ceux du Proche-Orient,
de l’Amérique du Sud et de la Chine.
Les forces anti-impérialistes et antifascistes froment l’autre
camp. L’URSS et les pays de démocratie nouvelle en sont le
fondement. Les pays qui ont rompu avec l’impérialisme et qui se
sont engagés résolument dans la voie du progrès démocratique,
tels que la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, en font partie. Au
camp anti-impérialiste adhèrent l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde.
L’Égypte et la Syrie lui apportent leur sympathie. Le camp anti-
impérialiste s’appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier
et démocratique, les partis communistes frères, sur les
combattants des mouvements de libération nationale dans les pays
coloniaux et dépendants, sur toutes les forces progressistes et
démocratiques qui existent dans chaque pays.
Extrait du communiqué publié le 5 octobre 1947 dans l’Humanité, à la suite de la
conférence de Szlarska Poreba (Poloqne) entre les dirigeants des partis communistes
européens.
La « doctrine Truman », 12 mars 1947
À ce point de l’histoire du monde, presque toutes les
nations doivent choisir entre deux modes de vie. Leur
choix, trop souvent , n’est pas un libre choix.
L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la
majorité et se caractérise par des institutions libres, un
gouvernement représentatif, des élections libres, des
garanties protégeant les libertés individuelles, la liberté
de parole et de religion et l’absence de toute oppression
politique. L’autre mode de vie est basé sur la volonté
d’une minorité imposée par la force à une majorité. Ce
mode de vie repose sur la terreur et l’oppression, une
presse et une radio censurées, des élections truquées et
la suppression de la liberté.
Je suis convaincu que les États-Unis doivent mener une
politique d’aide aux peuples libres qui résistent aux
manœuvres de certaines minorités armées ou à la
pression extérieure. Je suis convaincu que notre aide doit
être principalement une aide économique et financière,
essentielle pour assurer la stabilité économique et un
processus politique en bon ordre. […] En aidant les
nations libres et indépendantes à maintenir leur liberté,
les États-Unis mettront en œuvre les principes de la
charte des Nations unies. […]
Le germe des régimes totalitaires est nourri par la misère
et le besoin. Il s’étend et se développe dans la mauvaise
terre de la pauvreté et de la guerre civile. Il atteint son
plein développement lorsque tout espoir de vie
meilleures est mort dans un peuple. Nous devons garder
cet espoir vivant.
Harry S. Truman, Message to Congress, 12 mars 1947
La « doctrine Jdanov », octobre 1947
Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus apparaissent
les deux directions principales de la politique internationale de
l’après-guerre , correspondant à deux camps : le camp anti-
impérialiste et démocratique et le camp impérialiste.
Les États-Unis en sont la principale force, soutenus par les pays
possesseurs de colonies.
L’Angleterre et la France sont unies aux États-Unis et marchent
comme des satellites en ce qui concerne les questions principales,
dans l’ornière de la politique impérialiste des États-Unis. Le camp
impérialiste est soutenu aussi par les États possesseurs de
colonies, tels que la Belgique ou la Hollande, et par les pays aux
régime réactionnaire antidémocratique, tels que la Turquie et la
Grèce, ainsi que par les pays dépendant politiquement et
économiquement des États-Unis, tels que ceux du Proche-Orient,
de l’Amérique du Sud et de la Chine.
Les forces anti-impérialistes et antifascistes froment l’autre
camp. L’URSS et les pays de démocratie nouvelle en sont le
fondement. Les pays qui ont rompu avec l’impérialisme et qui se
sont engagés résolument dans la voie du progrès démocratique,
tels que la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, en font partie. Au
camp anti-impérialiste adhèrent l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde.
L’Égypte et la Syrie lui apportent leur sympathie. Le camp anti-
impérialiste s’appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier
et démocratique, les partis communistes frères, sur les
combattants des mouvements de libération nationale dans les pays
coloniaux et dépendants, sur toutes les forces progressistes et
démocratiques qui existent dans chaque pays.
Extrait du communiqué publié le 5 octobre 1947 dans l’Humanité, à la suite de la
conférence de Szlarska Poreba (Poloqne) entre les dirigeants des partis communistes
européens.
La « doctrine Truman », 12 mars 1947
À ce point de l’histoire du monde, presque toutes les
nations doivent choisir entre deux modes de vie. Leur
choix, trop souvent , n’est pas un libre choix.
L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la
majorité et se caractérise par des institutions libres, un
gouvernement représentatif, des élections libres, des
garanties protégeant les libertés individuelles, la liberté
de parole et de religion et l’absence de toute oppression
politique. L’autre mode de vie est basé sur la volonté
d’une minorité imposée par la force à une majorité. Ce
mode de vie repose sur la terreur et l’oppression, une
presse et une radio censurées, des élections truquées et
la suppression de la liberté.
Je suis convaincu que les États-Unis doivent mener une
politique d’aide aux peuples libres qui résistent aux
manœuvres de certaines minorités armées ou à la
pression extérieure. Je suis convaincu que notre aide doit
être principalement une aide économique et financière,
essentielle pour assurer la stabilité économique et un
processus politique en bon ordre. […] En aidant les
nations libres et indépendantes à maintenir leur liberté,
les États-Unis mettront en œuvre les principes de la
charte des Nations unies. […]
Le germe des régimes totalitaires est nourri par la misère
et le besoin. Il s’étend et se développe dans la mauvaise
terre de la pauvreté et de la guerre civile. Il atteint son
plein développement lorsque tout espoir de vie
meilleures est mort dans un peuple. Nous devons garder
cet espoir vivant.
Harry S. Truman, Message to Congress, 12 mars 1947

1
Les relations internationales
Les relations internationales
Les relations internationales concernent au premier chef les relations entre les nations. Elles peinent à intégrer les
nations qui n’existent pas encore (par exemple les peuples colonisés), ou encore des acteurs non nationaux
(organisations non gouvernementales (ONG), entreprises transnationales, réseaux « terroristes » ou mafieux…).
Les relations internationales s’organisent par la confrontation des intérêts des nations. Ces intérêts sont définis
(« dégagés ») dans des systèmes politiques et sociaux propres à chaque nation. Les représentations que l’on se fait du
monde, de soi et de l’autre, jouent dans la définition des intérêts d’une nation.
Il existe plusieurs systèmes de régulation entre nations, qui permettent d’organiser la majeure partie des relations
internationales : diplomatie (entre pays), organismes internationaux (ONU, OMC, etc.)…
Ces systèmes de régulations ne permettent pas toujours d’éviter les conflits ; la guerre étant, selon Clausewitz, « la
poursuite de la politique par d’autres moyens ». Les États disposent donc d’armements et d’armées pour se prémunir
et pour supporter cet aspect des relations internationales. Cela influe sur la représentation que se font les autres États
de la puissance et des intentions d’un pays.
confrontation des intérêts nationaux
=
Relations internationales
intérêts «
nationaux
»
systèmes de régulation
internationaux
représentations
du monde et
de l’« autre »
représentations de soi
définition de
« l’intérêt général »
du pays
systèmes politiques et
sociaux de chaque pays
armements
et armées
conflits
organismes
internationaux diplomaties
(entre pays)

2
De 1945 aux années 2000
La Seconde guerre mondiale s’achève avec deux grands
vainqueurs : L’Union des républiques socialistes soviétiques
(URSS) et les États-Unis d’Amérique. Ces deux vainqueurs se
retrouvent rapidement opposés l’un à l’autre, par une crainte
réciproque, les intérêts économiques et stratégiques, et les
références idéologiques.
Pendant quarante ans (jusqu’aux aux années 1980), le monde
s’organise par l’opposition de ces deux grandes puissances, qui se
créent des zones d’influence (les « blocs ») qu’elles dominent et
contrôlent plus ou moins étroitement. Cette opposition permet
une domination conjointe du monde : les deux grandes puissances
y sont donc autant partenaires qu’adversaires. On passe ainsi
d’une opposition frontale, que l’on appelle « guerre froide », à
une coexistence plus détendue.
L’effondrement d’un des deux partenaires (l’URSS) met fin au
système des blocs. Une seule très grande puissance (les É-U)
exerce alors un domination réelle mais contestée sur la planète.
La constitution progressive d’une Europe politique étendue à la
majeure partie du continent, l’émergence de nouvelles
puissances (Chine, Inde, Brésil) et le rétablissement progressif de
la Russie tempèrent peu à peu cette domination. Et l’avènement
d’acteurs non nationaux rend plus complexe le jeu des relations
internationales.
La période 1945-1949
À la sortie de la Seconde guerre mondiale, les anciennes
puissances européennes (Allemagne, Grande-Bretagne, France)
sont ruinées et détruites. L’URSS a le plus lourdement payé la
victoire contre les nazis (20 millions de morts, une partie du pays
totalement détruite), mais y a gagné une image très positive. Les
États-Unis, qui n’ont pas connu de destruction sur leur sol
continental, ont fait fonction d’atelier et de banquier du monde
libre (par opposition au monde sous domination nazie). Ces deux
grands vainqueurs sont alliés, mais, rapidement, leurs intérêts et
leurs craintes les opposent.
Dès 1946-47, chacune des deux puissance se taille une zone
d’influence qu’elle contrôle. Les territoires sur lesquels passe la
ligne de contact entre ces zones deviennent théâtres de tensions
de plus en plus fortes. Par référence à la situation en Europe, on
parle d’Est (influence soviétique) et Ouest (influence états-
unienne). S’ouvre alors une période de confrontation. Celle-ci se
déroule d’abord en Europe, surtout autour de la question
allemande. La guerre de Corée en marque le maximum. À partir
de 1953 (armistice de Pae Mu Jong et mort de Staline) la tension
retombe.
Le problème de l’Allemagne et la crise de Berlin
Intérêts économiques et peurs réciproques
En 1945, l’URSS craint les États-Unis, qui seuls
possèdent l’arme nucléaire. Marquée par
l’invasion allemande, elle tient à établir un glacis
protecteur contre une nouvelle invasion, en
interposant entre l’ennemi potentiel et son
territoire une distance suffisante pour être
protégée des attaques éclairs et aériennes. Elle
cherche aussi à être dédommagée des
destructions subies, en prélevant chez les vaincus
le matériel et les matières premières qui lui sont
nécessaires. Enfin, son système économique la
pousse à établir un espace de collaboration
cohérente entre productions, protégé des
économies concurrentes.
Les États-Unis craignent la puissante armée
soviétique, avec ses millions de soldats, et sa
forte mécanisation. Ils interprètent la
constitution d’un « glacis » comme une volonté
d’expansion, qui menace l’Europe et l’Asie, et
qu’ils tiennent à « contenir ». Leur puissance
industrielle, forgée pendant la guerre, exige
désormais un marché solvable extérieur (pour
éviter une crise de surproduction), et des
échanges commerciaux facilités. Leur puissance
militaire, qui est surtout navale et aérienne,
nécessite pour s’exprimer des bases hors de leur
continent. Ainsi, ces deux éléments de la
puissance États-Unienne reposent sur une
capacité de projection de l’autre côté des
océans. Ceci inquiète l’URSS, qui craint d’être
envahie ou soumise.
« Guerre froide »
L’expression « Guerre froide » a été inventée pour
décrire un conflit un peu spécial : les deux pays « en
guerre » (les États-Unis et l’URSS), ne se la faisaient
pas vraiment. Ils faisaient comme si ils étaient en
guerre (on dira qu’ils adoptaient une posture de
guerre), mais en même temps ils se parlaient
beaucoup, et évitaient soigneusement de se battre
l’un contre l’autre. Ils se rendaient même des
services… C’est donc le contraire d’une guerre qui
serait « chaude », c’est-à-dire dans laquelle on se
battrait vraiment. Bien sûr, ces deux pays très
puissant ne s’entendaient pas toujours, et se
bousculaient parfois. Il y a ainsi eu de nombreuses
« petites » guerres (« chaudes ») durant la Guerre
froide. Mais les deux pays n’étaient jamais
directement face-à-face. Ils faisaient même
attention à de pas se battre contre les amis de
l’adversaire. Et cela a duré de 1947 à 1990. Du coup,
on parle d’une période de la Guerre froide, parce
que, pendant 45 ans, les relations internationales ont
été organisées par cette fausse guerre. Pour que cela
dure autant, il fallait que les deux pays, et leurs
amis, aient intérêt à ce que cela dure. Et il fallait
que tous les autres pays croient que l’on était
presque en guerre (ou que l’on risquait d’y être
bientôt).

André Fontaine, “La Guerre froide”, dans Encyclopaedia Universalis (extraits)
1. La rupture de l’alliance
Le discours de Fulton
On a souvent dit que le coup d’envoi de la guerre froide avait
été donné par Winston Churchill dans son discours du 5 mars
1946 à Fulton (Missouri). Se déclarant convaincu que les
Russes « ne respectaient que la force », il invitait « les
peuples de langue anglaise à s’unir d’urgence pour enlever
toute tentation à l’ambition ou à l’aventure ». Bien qu’il ne
fût plus Premier ministre, il parlait avec l’autorité qui
s’attachait à son nom et avec le complet accord du président
Truman. Staline ne s’y trompa pas et répliqua peu après sur
le même ton. C’était la fin de la conception qui inspirait les
accords anglo-soviéto-américains de Yalta (11 février 1945) :
un monde vivant définitivement en paix, dans le cadre des
Nations unies, sous la surveillance des trois grandes
puissances ; une Allemagne administrée conjointement par
ses vainqueurs jusqu’au jour où elle se serait définitivement
reconvertie à la démocratie.
Les causes de cette détérioration sont multiples. Les
historiens soviétiques et, dans une plus ou moins grande
mesure, les « révisionnistes » américains en attribuent la
responsabilité essentielle à Truman. Celui-ci, devenu
président à la mort de Roosevelt (avril 1945), avait rompu, en
effet, avec la politique de bonne entente avec l’URSS suivie
par son prédécesseur. À ce changement, deux raisons
principales : la crainte du communisme — que rien selon eux
ne justifiait, Staline menant une politique nationale et non
idéologique — et la conviction, née de la possession de l’arme
atomique, que les États-Unis, débarrassés de l’Allemagne
comme du Japon et devenus la plus grande puissance de tous
les temps, n’avaient plus aucune raison de « faire des
cadeaux » aux Russes. Pour les dirigeants américains et leurs
alliés, c’est le refus de Staline d’appliquer l’accord de Yalta
sur le droit des peuples libérés à disposer d’eux-mêmes et la
menace qu’il faisait planer sur ses voisins qui sont à l’origine
de la guerre froide.
Les deux thèses sous-estiment la complexité d’une situation
qui rendait peut-être cette guerre froide inévitable. Les
alliances survivent d’ailleurs rarement à la disparition de la
menace qui les a suscitées. En un sens, on peut dire que c’est
l’ampleur même de sa victoire, conduisant à la capitulation
sans condition de ses communs adversaires et à l’occupation
totale de leurs territoires, qui a provoqué la dissolution de la
coalition antihitlérienne. Pendant la guerre, la nécessité du
combat faisait sinon taire, du moins passer au second plan les
désaccords entre alliés ; avant même la fin des hostilités,
cependant, la gravité de ces désaccords est apparue en
pleine lumière, à propos notamment de la Pologne.
L’accord oublié
Dès octobre 1944, Churchill avait montré le peu de confiance
qu’il faisait à la coopération future entre les Alliés, en se
rendant à Moscou pour négocier un accord secret sur le
partage des zones d’influence dans les Balkans. Pour obtenir
les mains libres en Grèce, où ses troupes intervinrent contre
la résistance de gauche, il laissa toute latitude à Staline en
Roumanie et en Bulgarie, pays que les troupes soviétiques
venaient d’ailleurs tout juste d’occuper. En Hongrie et en
Yougoslavie, il était convenu que l’influence des deux camps
fût partagée.
Staline a d’abord appliqué cet accord. Il a poussé les
communistes grecs à se soumettre aux autorités, il a insisté —
vainement — auprès de Tito pour qu’il rétablisse la
monarchie, il a laissé des élections à l’occidentale se
dérouler en Hongrie. Mais les États-Unis, hostiles à la
politique des zones d’influence, ont obtenu à Yalta, en 1945,
la signature de Staline au bas d’un accord permettant aux
peuples libérés de choisir librement leurs institutions et leurs
gouvernements.
Il paraît évident que, dans la conception des Soviétiques, les
élections tenues chez eux étaient « libres ». Ils ne
s’engageaient donc pas beaucoup. D’où un premier
malentendu : dès l’automne de 1945, les Américains
s’indignent de la façon dont se déroulent les élections — et
les épurations — en Roumanie et en Bulgarie. Moscou, de son
côté, voit dans les démarches et les protestations de
Washington une intrusion inadmissible dans la sphère
d’influence que lui a reconnue Churchill et en conclut que
l’accord d’octobre 1944 n’est plus valable.
Le Kremlin, du coup, soutient matériellement l’extrême
gauche qui déclenche un nouveau soulèvement en Grèce.
Cette initiative, faisant suite à de vives pressions sur la
Turquie pour qu’elle cède des bases à l’URSS et à la tentative
de celle-ci de conserver l’Azerbaïdjan d’Iran, occupé pendant
la guerre, provoque le premier engagement américain dans la
guerre froide : la « doctrine Truman » d’assistance
économique et militaire à la Grèce et à la Turquie (12 mars
1947).
Cette décision marque un véritable tournant dans l’histoire
des États-Unis, à qui le testament de Washington et la
doctrine de Monroe (1823) avaient prescrit de demeurer à
l’écart des querelles européennes. Roosevelt avait tendance
à préférer le « démocratisme » de l’URSS à l’« impérialisme »
de la Grande-Bretagne et à se poser en médiateur dans le
conflit qui, dès 1944-1945, se dessinait entre elles.
La relève de l’Angleterre
La situation change, non seulement parce que Truman,
prévenu contre l’URSS et excédé par son comportement,
rompt avec la politique de son prédécesseur, mais aussi parce
que la Grande-Bretagne, épuisée par sa victoire, est obligée
de se décharger sur l’Amérique d’un certain nombre de ses
responsabilités traditionnelles. Tel est le cas précisément de
la Grèce. Au début de 1947, le gouvernement travailliste
décide qu’il ne peut continuer à soutenir la monarchie
hellénique face à la guerre civile et il demande aux
Américains de le faire à sa place. En acceptant et en
engageant une action qui aboutira, en deux ans, à la victoire
des armées royalistes, les États-Unis accomplissent le
premier pas dans une évolution qui fera d’eux, très
rapidement, grâce à leur force intacte et à leur armement
atomique, le leader incontesté du « monde libre » ou
« atlantique ».
Le problème allemand
Malgré le désaccord sur l’Europe orientale, malgré des
malentendus avivés par la différence des idéologies,
l’entente des vainqueurs se serait peut-être maintenue si,
très vite, ils ne s’étaient pas opposés sur le sort de
l’Allemagne.
À Yalta, il avait été question de la démembrer, de rétablir
l’indépendance de la Bavière, de la Saxe, du Hanovre, etc.,
mais Staline y avait soudain renoncé. À Potsdam (juill. 1945),
il avait conclu avec Truman et Clement Attlee un accord
auquel le général de Gaulle devait s’associer par la suite sous
certaines réserves. Cet accord maintenait le principe de
l’unité allemande sous la souveraineté d’un conseil de
contrôle allié. Le territoire et la capitale étaient divisés en
quatre zones pour les besoins de l’occupation, mais
l’administration devait être quadripartie, les Alliés se
dessaisissant de leurs pouvoirs au profit des Allemands au fur
et à mesure que ceux-ci feraient la preuve qu’ils méritaient
leur confiance. L’ancien Reich serait définitivement
démilitarisé, et son industrie lourde démantelée. Il paierait
de lourdes réparations.
Pour l’URSS ravagée par la guerre, rien ne comptait
davantage que de rebâtir le plus vite possible son économie.
Les États-Unis lui refusant leur concours, la Grande-Bretagne
ne pouvant y songer, la tentation était forte pour elle de se
servir sur sa zone d’occupation, qui fut littéralement mise au
pillage. En même temps, elle y décrétait une réforme agraire
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%