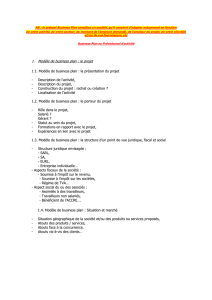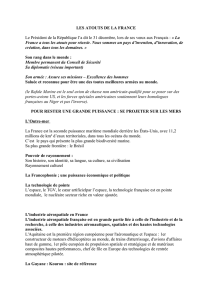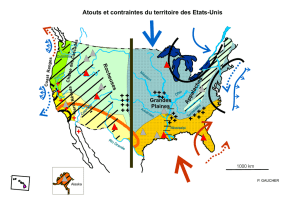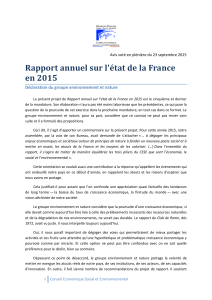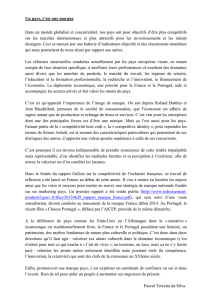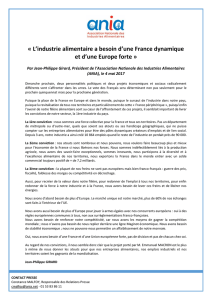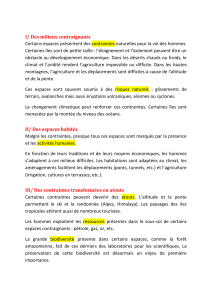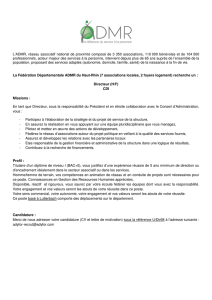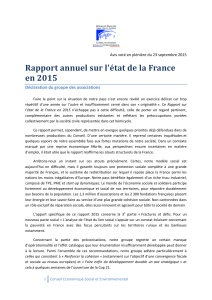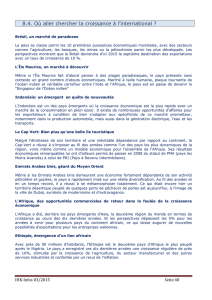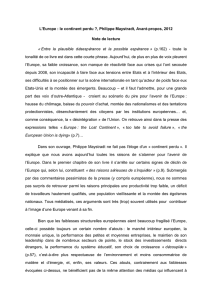Économie

É
Éc
co
on
no
om
mi
ie
e
Une composition sur un sujet se rapportant aux grands systèmes et doctrines
économiques ainsi qu’aux politiques économiques.
SUJET : Quels sont les atouts de l’économie française ?

Copie notée : 14/20
Depuis le début des années 2000, les discours défaitistes, voire déclinistes, se sont peu à
peu imposés dans le champ médiatique français. Les arguments et les bouc-émissaires
sont nombreux pour expliquer le « déclin français » : la mondialisation, l’Europe, les 35
heures, les impôts… Aux yeux de ces « déclinologues » - incarnés par l’éditorialiste
Nicolas Baverez (auteur de « Cette France qui tombe ») -, la France cumule trop de
fardeaux et de pesanteurs pour accélérer son rythme de croissance et maintenir son rang
de 5
ème
puissance économique mondiale.
Mais comment expliquer alors la vigueur de la natalité en France ? Comment analyser la
bonne tenue de l’économie française face à la crise (récession de 2,8% en 2009 contre
4,7% en Allemagne par exemple) et l’accélération de la croissance du PIB au premier
trimestre 2011 (+1,0% selon l’INSEE) ?
En vérité l’économie française compte de nombreux atouts qui lui permettent de générer
des richesses (I) tout en étant relativement bien protégée (des risques macro-
économiques) et protectrice (des individus) (II).
I/ L’économie française crée de la croissance grâce à sa structure, son niveau de
productivité et la dynamique de son marché intérieur
1) Une économie mixte, créatrice de croissance
L’économie française, héritière d’une histoire marquée par le royalisme et le Colbertisme,
se caractérise par une forte présence de l’Etat (près de 50% du PIB). Ce modèle
d’économie mixte s’oppose au modèle anglo-saxon dans lequel l’Etat a un rôle limité
dans l’économie. Mais le modèle français repose également sur un tissu d’entreprises
particulièrement développé (2 millions d’entreprises en France), principalement de
petites tailles (1 million de TPE). La France compte aussi un grand nombre de groupes
leaders mondiaux dans leur domaine : on peut citer l’Oréal et LVMH (luxe, cosmétique),
EDF, Areva et Total (énergie), PSA, Renault ET EADS (automobile, aéronautique), ou
encore Carrefour, numéro 2 de la grande distribution mondiale. Les grandes entreprises
françaises concentrent l’essentiel des exportations et la moitié de l’emploi salarié.
Cette structure diversifiée permet à l’économie française d’afficher des résultats
relativement positifs. Au-delà de la croissance (+2,1%) prévue pour 2011, l’économie
française suit les taux de croissance européens depuis 10 ans et fait mieux que
l’économie allemande sur 7 des 10 dernières années.
2) Une économie très productive et riche en capital
Alors que le marché du travail est morose depuis plusieurs décennies, la croissance
française est tirée par les importants gains de productivité qui font des français les
travailleurs les plus productifs au monde (en termes de productivité horaire). Cette
performance s’explique en partie par l’accélération des rythmes de travail liée au passage
aux 35 h, mais aussi et surtout aux fortes dotations en capital physique, financier et
humain dont jouit l’économie française. En effet, les investissements publics permettent
à la France de disposer d’infrastructures dont la qualité est largement reconnue. Le fort
niveau d’investissement privé des entreprises (près de 60% des bénéfices sont réinvestis
selon un rapport de l’INSEE remis au Président de la République en 2010 – Rapport sur le
partage de la valeur ajoutée) est également soutenu par des dispositifs tels que le CIR
(Crédit Impôt Recherche – 5 milliards d’euros en 2010 selon Valérie Pécresse, ministre
en charge de l’innovation). Les entreprises françaises sont enfin financées par les
Investissements Directs Étrangers, dont elles sont les premières destinataires en Europe,
ce qui témoigne de leur attractivité. La productivité des travailleurs français s’explique
également par l’effort public dans l’éducation : si l’enseignement secondaire et supérieur

sont en déficit de ressources comparativement aux autres pays de l’OCDE, le système
français offre cependant un niveau de diplôme élevé à une large base de la population.
3) Une croissance basée sur la consommation, en adéquation avec le modèle de
partage des revenus
Contrairement à d’autres pays tels que l’Allemagne, la France a fait le choix d’un modèle
de croissance basé sur la consommation des ménages. Ce choix impose une croissance
rapide et continue du revenu des ménages et une forte propension marginale à
consommer (0,8 en France en moyenne).
Le modèle de redistribution français, en redistribuant une partie des revenus des plus
riches vers les plus pauvres (fortes propensions marginales à consommer), soutient donc
ce modèle de croissance basé sur la consommation. La faiblesse relative des inégalités de
revenus en France (par rapport aux Etats-Unis notamment, comme le montrent les
travaux de Emmanuel Saez) rend ce modèle sain et soutenable : en effet, la société de
classes moyennes françaises (70% de la population selon l’INSEE) permet de dégager de
l’épargne au niveau agrégé, contrairement à l’économie américaine dont les ménages
sont endettés et surconsomment.
Ce modèle de croissance mixte, basé sur les gains de productivité et la consommation,
font de l’économie française une économie à la fois protégée et protectrice.
II/ Une économie protégée et protectrice
1) La protection sociale et les stabilisateurs automatiques
Outre son modèle de redistribution, l’économie française se distingue également des
économies anglosaxonnes par son pacte social, construit autour de la protection sociale
des risques de l’existence (emploi, maladie, pauvreté-exclusion, logement, vieillesse).
Inspirée du CNR et du rapport Laroque, la protection sociale « à la française » représente
environ 30% du PIB (500 milliards d’euros) et tend à couvrir tous les individus (avec la
CMU, le RSA, etc.) et non les seuls travailleurs cotisants. Si ce système pèse sur le coût
du travail, il permet également d’atténuer les chocs économiques par des dépenses
contra-cycliques (au premier rang desquelles l’assurance-chômage), qu’on appelle
« stabilisateurs automatiques ». Ces stabilisateurs prennent en charge une partie de la
perte de revenus des prestataires (liée à la maladie, au chômage, etc.) et assurent donc
un certain niveau de revenus à chacun. Olivier Blanchard, chef-économiste au FMI, ou
Paul Krugman, Prix Nobel d’économie 2008, soulignent régulièrement l’importance de ces
stabilisateurs économiques depuis le début de la crise. En effet, le système de protection
sociale a joué un rôle décisif dans la relative bonne tenue de l’économie française
pendant la crise (-2,8% du PIB en 2009, et +1,4 en 2010).
2) Une économie modérément ouverte au commerce international et protégée par
l’Euro
Le modèle de croissance basé sur la consommation offre à la France une protection vis-à-
vis des aléas du commerce international et du dumping fiscal et social. L’Allemagne, bien
plus dépendante du commerce extérieur que la France, a connu une récession de 4,8%
en 2009 largement imputable à l’érosion de ses exportations. D’ailleurs, le déficit
commercial français s’explique bien plus par un déficit vis-à-vis des autres pays
européens (où la compétitivité-coût joue peu) que par un déséquilibre avec les pays
émergents (balance commerciale à l’équilibre entre la France et la Chine en 2010) : en
effet ¾ du commerce français s’effectuent avec des partenaires de la zone euro.
L’euro, outre qu’il protège l’essentiel de nos exportations, allège également le poids de
l’inflation importée (liée à la montée des prix des matières premières et de l’énergie).

Dans cette période de retour de l’inflation, l’euro joue donc un rôle de protecteur des
économies de la zone, sans dégrader trop fortement le niveau d’exportation français,
faiblement exposé au dumping monétaire.
3) Une économie relativement protégée des risques financiers
La crise de 2008 a montré que la financiarisation pouvait coûter cher aux économies
quand leur secteur financier y était à la fois très important et dérégulé. Contrairement à
l’économie britannique par exemple (où la City représente 15% du PIB national),
l’économie française a pu essuyer les pertes de son secteur financier et participer à la
recapitalisation des banques sans trop d’encombres. Les banques françaises, mieux
régulées, étaient en effet moins exposées au risque des crédits subprimes. La crise de la
dette grecque (et le possible défaut ou rééchelonnement des obligations du Trésor
grecque) pourrait de nouveau fragiliser les banques françaises (exposées à hauteur de 50
milliards d’euros au risque grec). Mais quelle que soit l’issue de cette crise, elle ne pèsera
pas sur le point-clé des pensions de retraite comme ce fut le cas dans les systèmes par
capitalisation.
Enfin, bien que la situation financière de l’Etat et de la Sécurité sociale soit largement
déficitaire (-19,5 milliards d’euros pour la seule Sécurité sociale en 2011 selon ses
projections), tous les pays – exceptés 4 – envient la note AAA dont bénéficient les OAT
françaises, synonyme de faibles taux de financement.
L’économie française bénéficie de nombreux atouts, au premier rang desquels la forte
productivité horaire de ses travailleurs. Son modèle de croissance et son modèle social
protecteur sont également complémentaires. Enfin, l’économie française est relativement
mieux protégée que ses partenaires de part sa structure économique et financière,
comme la crise vient de le démontrer. Il reste cependant de nombreux enjeux à
affronter, comme le retour à une situation budgétaire soutenable (le Gouvernement
espère un déficit public inférieur à 3% en 2013, pour revenir dans les critères du Pacte
de Stabilité et de Croissance) ou le recul du chômage (qui devrait reculer à 9 % fin 2011
selon le ministre du travail Xavier Bertrand grâce aux 225 000 créations d’emplois que
prévoit l’INSEE).

Copie notée 11/20
En connaissant l’an passé une natalité digne du baby boom, la France serait aux yeux
d’Adam Smith titulaire de l’avantage le plus absolu en la matière au niveau européen.
Cependant si une forte croissance démographique présage d’un bon développement
économique, l’économie française ne peut aujourd’hui se nourrir de ce seul atout.
Le développement économique semble encore être le fruit de la juxtaposition, du cumul,
de l’agrégat de multiples facteurs non sans liens entre eux. Il parait ainsi risqué
d’attribuer les performances de l’économie française sur une seule donnée, sa
démographie, ou un seul fait, comme son intégration aux organisations inter
gouvernementales.
L’économie française connaît ainsi l’expansion ou la récession par le jeux de multiples
variables, d’où un fort intérêt de les connaître et de les réguler dans une perspective de
croissance économique. Smith avec ses avantages absolus, Ricardo et ses disciples avec
la théorie des avantages comparatifs, ont montré qu’il était nécessaire pour une
économie sous contraintes, extérieures comme la mondialisation, intérieures comme
l’endettement, de connaître ses points forts et ses points faibles afin de stabiliser ou
d’acquérir de nouvelles perspectives de croissance.
Or quels sont les atouts de l’économie française ?
Dresser une liste des points forts par secteur d’activités serait réducteur, il apparaît
préférable d’envisager une approche globale de l’économie française. La population, le
territoire, le système politique et administratif peuvent encore apparaître comme le
noyau dur de l’économie française, participant à la détermination des avantages de ce
système économique (IA). Système, certes structuré en secteurs d’activités, qui
apparaissent intégrés dans des ensembles plus vastes tout en s’appuyant sur le noyau
dur (IB).
Or l’émergence de nouvelles contraintes, comme la mondialisation, oblige de nombreux
acteurs à s’adapter afin à la fois de maintenir des atouts acquis et à la fois afin d’en
acquérir de nouveaux, que ce soit le noyau dur de l’économie française (IIA) que ses
secteurs d’activités (IIB).
I/ L’économie française laisse apparaître de solides atouts
A) Territoires, agents économiques et pouvoirs publics liés pour l’économie
A la différence d’un pays comme la Chine, la France apparaît comme un pays
démocratique dont le système économique est à dominante sociale démocrate de type
keynesienne, et a malgré son insertion au système économique et monétaire européen
qui lui préfère une approche plus néolibérale de l’économie. Forte de ses 63 millions
d’habitants, l’économie française dispose de l’un des plus grands territoires européens,
avec la plus grande bande côtière. Cet avantage territorial reste le moteur de son
attraction touristique, favorisant l’économie de services.
D’un point de vue démographique, la France dispose de ressources humaines
relativement jeunes, l’espérance de vie étant l’une des plus fortes au monde, favorisant
le maintien en activité de certaines populations, voire même participant à la création de
nouveaux services (aide à la personne) porteurs de nouvelles perspectives économiques
(dépendance).
Sa jeunesse dispose d’un haut niveau de qualification (malgré des effets pervers,
Boudon) qui depuis près de soixante ans favorise la salarisation des actifs (effet de
déversement) et sa nogemisation (Bourdieu). Le secteur tertiaire emploie la majorité des
actifs (près de 70%) malgré une productivité stable : 2% pour le tertiaire contre 5 à 10
% pour le secondaire. Les facilités d’innovation étant plus rares dans ce secteur d’activité
où les gains de productivité passe par une augmentation du capital humain. Le tissu
industriel français n’est donc pas mort, il participe encore à la vie économique et sociale
de certains territoires. Il opère certes des transformations structurelles et fonctionnelles
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%