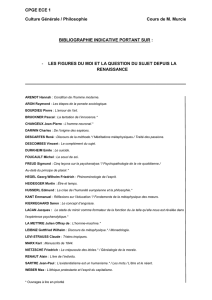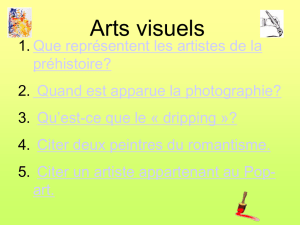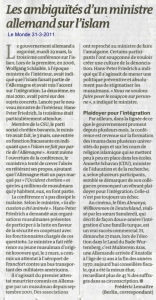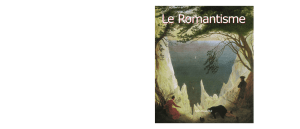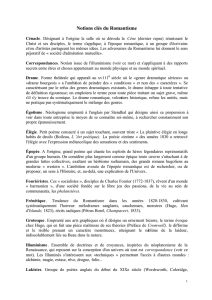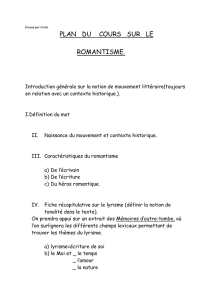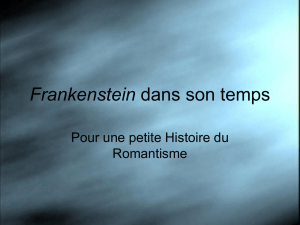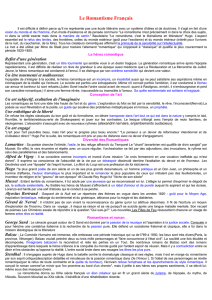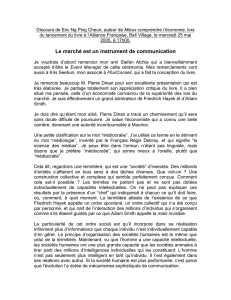Position de thèse - Université Paris

1
Université Paris Sorbonne (Paris IV)
École doctorale 5 : « Concepts et langages »
THESE DE DOCTORAT
DISCIPLINE : PHILOSOPHIE
En cotutelle avec la Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Présentée et soutenue par :
Laure CAHEN-MAUREL
Le 22 janvier 2014
L
’
ART DE ROMANTISER LE MONDE
CASPAR DAVID FRIEDRICH ET LA PHILOSOPHIE ROMANTIQUE
Sous la direction de :
Madame Jacqueline LICHTENSTEIN, professeur, Université Paris Sorbonne (Paris IV)
Monsieur Günter ZÖLLER, professeur, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Jury :
Madame Danièle COHN, professeur, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Madame Jacqueline LICHTENSTEIN, professeur, Université Paris Sorbonne (Paris IV)
Monsieur Ives RADRIZZANI, professeur, Académie bavaroise des sciences (Munich)
Monsieur Günter ZÖLLER, professeur, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

2
La peinture de Caspar David Friedrich (1774-1840), connue pour être une peinture
« métaphysique », ayant une forte charge symbolique, donne lieu à toutes sortes de
constructions idéologiques. C’est du moins ce que l’historien allemand Werner Busch
reprochait très vivement, en 2003, aux divers commentaires de cet art dans la préface de son
livre Caspar David Friedrich
.
Ästhetik und Religion
: ils se retrancheraient davantage sur des
interprétations allégoriques ou des montages de citations empruntées à la poétique romantique
que sur un véritable examen de fond de l’élaboration formelle des paysages friedriciens.
Il y a de cela dans la lecture exclusivement eschatologique des thèmes de cette
peinture par Helmut Börsch-Supan, l’auteur, en 1973, du premier catalogue raisonné de
l’Œuvre peint et graphique de Friedrich :
il s’agissait de montrer que l’artiste se servait de tout
un vocabulaire de formes pour peindre des idées et de s’opposer ainsi à l’hypothèse de
l’irrationalisme de cet art qui aurait permis sa récupération par le nazisme. Mais il y a de cela
encore dans les approches théologisantes du style et de la forme avancées plus récemment par
Werner Hofmann ou Johannes Grave. Hofmann proposait ainsi, en 2000, de regarder
Friedrich comme l’inventeur du « paysage-icône » et de ne voir dans ses paysages qu’une
seule structure, celle du triptyque, caché ou patent. Grave, dans un livre de 2011 intitulé À
l’œuvre. La théologie de l’image de Caspar David Friedrich, va quant à lui jusqu’à présenter
Friedrich comme un fervent adepte d’un luthéranisme orthodoxe ; ses tableaux de paysage
seraient alors une critique théologique de la figuration. Il y a de cela, enfin, dans le
rapprochement souvent fait entre la vacuité jusque là inédite de la représentation, à quoi vient
s’ajouter un traitement original de la surface picturale comme un champ sans profondeur, à la
planéité affichée, et le sublime postmoderne de l’expressionnisme abstrait des peintres
américains d’avant-garde. C’est là l’origine du débat majeur dont la peinture de Friedrich fait
l’objet dans la recherche : doit-on considérer la révolution qu’elle constitue comme régressive
— une résistance à la sécularisation de la peinture moderne — ou progressive — l’annonce
visionnaire de la peinture abstraite — et quel est son rapport au sublime ?
L’idée directrice de notre travail a été une réflexion, au travers de cet art et de ses
interprétations, sur la notion même de « romantisme ». Notre propos est de montrer qu’un
examen précis de la représentation que le romantisme allemand a de lui-même offre des
possibilités herméneutiques encore en partie inédites. C’est ce que nous avons tâché de faire
apparaître dans une approche philosophique qui associe présence au tableau comme objet
capable de produire lui-même son sens ; inscription dans le contexte des pensées contem-

3
poraines de cet art : le criticisme de Kant, le premier romantisme et l’idéalisme allemands
(Fichte et Hegel essentiellement), mais aussi la Klassik de Goethe ; et examen des résonances
de ce romantisme dans l’art d’aujourd’hui, celui d’Anish Kapoor notamment, qui se dit
l’héritier de Friedrich pour tenter de restituer à l’art son caractère et sa fonction
métaphysiques.
Le sujet n’est pas neuf, loin de là. Explicitement ou implicitement, la question de
savoir ce que signifie de dire de Friedrich qu’il est la quintessence du peintre romantique
guide toute étude qui lui est consacrée. Mais si le sujet est ancien, le débat est loin (là aussi)
d’être clos, tout le problème étant de déterminer et de définir le romantisme allemand, un
terme chargé de trop de connotations dans le discours commun : celles principalement
négatives d’irrationalisme, de mysticisme au sens d’exaltation (Schwärmerei), de
conservatisme sinon de régression, de nationalisme ou encore de kitsch, qui suscitent des
réactions de défiance ou de rejet.
A l’encontre d’interprétations réductrices notre conviction est que la nature du
romantisme allemand et son étude sont bien plus complexes. Il est d’ailleurs revenu à toute
une génération de philosophes des années 1970 de faire tomber quelques préjugés à son sujet.
Les travaux novateurs de Manfred Frank en Allemagne, de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-
Luc Nancy en France et de Frederick Beiser aux Etats-Unis ont reconnu l’existence d’une
philosophie romantique : aussi syncrétique soit-elle, elle porte l’influence d’un idéalisme
hérité de Kant et de Fichte, mais aussi de Platon.
L’un des enjeux de notre thèse est alors de clarifier le sens philosophique de l’exigence
romantique allemande, à entendre comme un idéal esthétique, donc comme un concept
normatif. Nous ne cherchons pas à montrer que Friedrich est un philosophe romantique, ni
même à dégager une prétendue philosophie de Friedrich. Ce à quoi nous nous employons
dans ce travail répond à un objectif précis : cerner ce qui, sous ce mot porteur aussi bien d’une
fausse évidence que de fausses certitudes, est vraiment conforme au concept du romantisme.
A ce titre, notre thèse n’est pas une monographie sur Friedrich, elle interroge, par son prisme,
la philosophie romantique.
Il ne s’est agi pour nous ni de discréditer ni de réhabiliter la philosophie romantique de
l’art, sans doute durablement marquée par l’interprétation polémique qu’en a faite le
philosophe analytique Jean-Marie Schaeffer. Dans L’art de l’âge moderne (1992) notamment,
J.-M. Schaeffer a en effet contribué à établir la mauvaise réputation de la poétique
romantique, théorie spéculative de l’Art qui sacraliserait son essence même et ne serait pas
directement concernée par la réalité effective des œuvres ; ainsi que du romantisme allemand,

4
de manière plus large, révolution « conservatrice », synonyme de réaction aux Lumières et au
criticisme de Kant.
Recentrant l’interprétation du romantisme allemand sur la pensée de Novalis, nous
avons, à la différence de J.-M. Schaeffer, suivi ce fil conducteur : la définition novalissienne
du romantisme comme concept opératoire, comme opération ou technique — « art de ». C’est
en effet Novalis qui a formulé le programme explicite de ce qu’il nomme lui-même la
« philosophie romantique » dans un fragment célèbre : « Le monde doit être romantisé. C’est
ainsi que l’on retrouvera le sens originel. Romantiser n’est rien d’autre qu’une potentialisation
qualitative. » Notre choix de mettre en valeur cet aspect particulier de la pensée de Novalis est
implicite dans le titre général de notre thèse « L’art de romantiser le monde ». Ce choix
permet d’opérer un déplacement d’accent dans l’approche de la peinture de paysage de
Friedrich, du contenu de ses œuvres, de leur « quoi », à leur « comment », à la manière dont
elles se présentent dans leur singularité et leur construction formelle. Si Friedrich est dans
tous les esprits indissociable des motifs du clair de lune, de la croix, des ruines, des tombes ou
des célèbres Rückenfiguren (figures peintes de dos), reste que le romantisme est autant une
approche de la réalité et une méthode de production d’un imaginaire qu’un style identifiable
par un répertoire de thèmes. Nous tenons ainsi compte des deux aspects à la fois, du contenu
et de la forme de la représentation.
Un de nos buts a aussi été de chercher à explorer dans la philosophie romantique de
l’art le thème à nos yeux négligé de la peinture comme art visuel. La référence à l’art
contenue dans le titre de cette thèse comporte ainsi un double sens, notre travail
d’interprétation étant destiné à examiner si, et dans quelle mesure, l’articulation entre un
discours sur l’idée même d’art et un discours sur un art particulier, la peinture, est ici possible.
Les recherches philosophiques sur le romantisme allemand ont certes mis en lumière le rôle
central de l’art pour les penseurs romantiques, mais la dimension de l’imaginaire et a fortiori
le statut de la peinture ont été relativement peu approfondis. On ne compte plus les
couvertures d’études sur le romantisme allemand qui convoquent l’univers de Caspar David
Friedrich. Une façon, sans doute, de jouer sur une préséance qui existerait déjà dans
l’imaginaire du lecteur. Mais si le peintre figure en couverture de ces études, il est ensuite
généralement absent de leurs analyses. Ce travail vise donc aussi à combler une lacune : il
met en lumière les idées originales de Novalis sur les arts plastiques en général, et la peinture
de paysage en particulier, en dépit du logocentrisme qui est le sien ; il justifie un
rapprochement entre la pratique picturale de Friedrich et la définition novalissienne du
romantisme, même si le terme de « romantisation » ou de « potentialisation », fil directeur de

5
notre étude, ne fait pas partie du vocabulaire de Friedrich et que leurs œuvres divergent aussi
à bien des égards.
La perspective adoptée dans les trois premiers chapitres de notre thèse est critique. En
articulant les principaux reproches faits à l’artiste, selon des arguments qui reviennent dans le
temps, nous interrogeons son identité de « peintre mystique » et le sens précis des faits
évoqués sous ce vocable. Nous décomposons la critique du mysticisme de son art en trois
aspects que nous présentons de façon successive pour les besoins de l’analyse, même s’ils
sont en réalité solidaires. Un premier chapitre examine le thème de la « religion de l’art » : les
arguments de la querelle qui a opposé publiquement, en 1808/09, le peintre au critique
d’obédience classique Basilius von Ramdohr sont ici discutés ; il en ressort que l’attaque de
Ramdohr a trait surtout à la définition de l’imagination (chapitre 1). Nous abordons ensuite la
question de l’hermétisme, conscient et voulu, du symbolisme propre à Friedrich ; nous
l’explorons notamment à travers le jugement porté par Hegel sur l’artiste dans son premier
cours d’esthétique à l’université de Berlin en 1820/21, jugement qui a été jusqu’ici peu
mentionné et examiné par la critique (chapitre 2). Hegel reproche à cette peinture
plastiquement froide, abstraite, et énigmatique quant au fond, sa fausse profondeur. Mais on
voit s’affronter ici deux positions contraires : Friedrich revendique, à l’encontre de la
conception hégélienne du sens d’une œuvre consistant en son contenu immanent, verrouillé
en soi et supposant seulement d’être expliqué en fonction de lois de structure, une
herméneutique de l’interprétation, entre dissimulation et révélation d’un sens débordant
l’arrangement interne de l’œuvre. Le troisième chapitre se penche enfin sur la dimension
proprement visuelle de ce mysticisme (chapitre 3). Dans cette perspective, nous montrons que
la peinture de Friedrich ne se situe pas seulement en rupture avec la tradition de la peinture de
paysage occidentale comme reproduction des apparences sensibles, mais qu’avec elle l’art
paysager bascule dans quelque chose d’inédit : elle ébranle la catégorie même du paysage,
habituellement conçu comme un découpage visuel, une partie de la nature cadrée et mise en
perspective par le regard. On distinguera ici trois causes de cet hermétisme visuel : la perte de
référence du lieu de l’origine du regard ; la perte du lieu géographique, soit de tout signe
visuel objectif de reconnaissance du pays ou du territoire comme fond du paysage ; la perte
enfin de l’horizon.
Les trois chapitres suivants nous font aller de la logique de l’image friedricienne à la
romantisation du monde dont Novalis fait une méthode d’universalisation. Nous nous
donnons pour tâche d’élucider le célèbre fragment 105 des Poéticismes de 1798 (« Le monde
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%