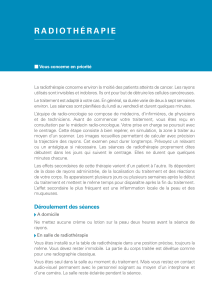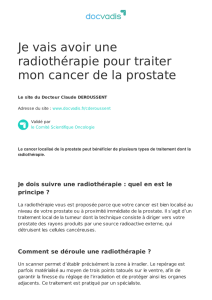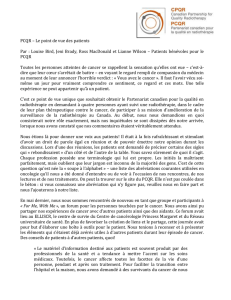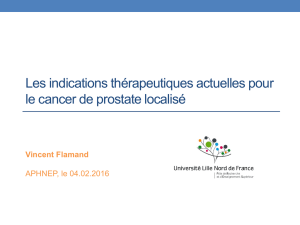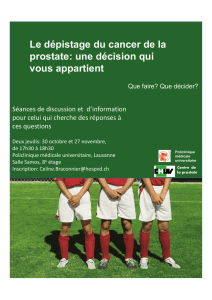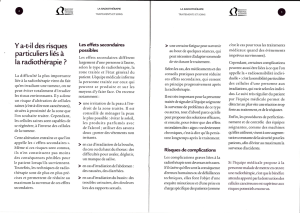techniques innovantes et tendances actuelles en radiothérapie

TECHNIQUES INNOVANTES
ET TENDANCES ACTUELLES
EN RADIOTHÉRAPIE: FOCUS
SUR LE CANCER DU SEIN
ET DE LA PROSTATE
HIRSLANDEN LAUSANNE
CLINIQUE BOIS-CERF
CLINIQUE CECIL
HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY
LA RADIOTHÉRAPIE A FAIT
D’ÉNORMES PROGRÈS AU COURS
DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES ET
IL EST AUJOURD’HUI POSSIBLE
DE MIEUX ÉPARGNER
LES TISSUS SAINS.

Dr Michael Betz
Spécialiste FMH en radio-oncologie,
responsable de l’Institut de radio-oncologie
Hirslanden Lausanne
Les cancers du sein et de la prostate sont les
deux cancers les plus fréquents, en Suisse et
dans le monde. Ce sont aussi ceux qui sont le
plus souvent traités par radiothérapie.
LE CANCER DU SEIN
SE GUÉRIT DE MIEUX EN MIEUX
C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes
et aussi celui qui tue le plus de Suissesses. Cette
maladie touche les femmes de tout âge, même si
elle affecte surtout les plus de 60 ans. Elle se
guérit toutefois de mieux en mieux, grâce aux
progrès effectués dans les domaines du
dépistage, des traitements, de la radiothérapie et
des connaissances sur la pathologie.
Les programmes de dépistage ont eu un grand
impact sur la survie. En témoigne une étude
australienne qui montre que, depuis leur
introduction dans ce pays en 1991, la mortalité a
chuté drastiquement.
Les traitements ont eux aussi évolué grâce à
l’apparition de nouveaux médicaments utilisés en
chimio et hormonothérapie. Par ailleurs,
l’amélioration des connaissances sur la maladie, et
notamment l’élaboration récente de tests géné-
tiques, permet de prescrire des thérapies mieux
adaptées à chaque tumeur et à chaque patiente.
La prise en charge d’une tumeur non
métastasique passe d’abord par l’ablation
chirurgicale de la tumeur. Il faut ensuite prévenir
les récidives locales et à distance. Il s’agit d’un
travail multidisciplinaire qui se pratique en
réseaux. Ces derniers impliquent des oncologues,
des pathologues, des radiologues, des radio-
oncologues, des gynécologues, des chirurgiens
plasticiens, mais aussi des cardiologues, des
médecins traitants, des psychologues, des
infirmières, des physiothérapeutes, des assistantes
sociales, des associations, etc. Il existe par ailleurs
un Réseau Lausannois du Sein, regroupant les
médecins de différentes cliniques ou installés en
ville, qui se réunit une fois par semaine pour
discuter de différents cas.
LA RADIOTHÉRAPIE
RÉDUIT LES RISQUES DE RÉCIDIVE
La radiothérapie a pour objectif de prévenir les
récidives «locales» (dans le sein) et «régionales»
(dans les ganglions avoisinants). Elle est utilisée
au cas par cas après une mastectomie (ablation
totale du sein). Mais elle est employée de manière
quasi-systématique après une chirurgie conser-
vatrice (qui n’enlève que la tumeur et préserve le
sein) dont elle constitue un complément
indispensable. Au point que les patientes qui ne
peuvent pas recevoir de rayons – comme certaines
femmes enceintes – doivent la plupart du temps
subir une mastectomie.
Après une chirurgie conservatrice, la radiothérapie
réduit le risque de récidive d’environ 50%. On
estime aussi qu’en prévenant quatre récidives, on
sauve une vie. Certes, on est amené à irradier de
nombreuses patientes, dont certaines n’en
auraient pas besoin. Malheureusement, on est
encore incapable d’identifier celles qui ont un
risque augmenté de récidive.
La radiothérapie peut entraîner des effets
secondaires, durant ou après le traitement. En
outre, ce dernier est long – en général, 5 à 6
semaines – et il nécessite des séances quotidien-
nes qui durent de 10 à 20 minutes. De manière
générale, le traitement est bien vécu. Toutefois,
l’expérience de ces séances, seule avec la machine,
peut s’avérer parfois éprouvante, notamment en rai-
son de préconceptions sur le mot «radiothérapie».
A L’INVITATION DU GROUPE HIRSLANDEN, LE DR MICHAEL BETZ, MÉDECIN RESPONSABLE DE
L’INSTITUT DE RADIO-ONCOLOGIE HIRSLANDEN LAUSANNE, CLINIQUE BOIS-CERF, A EXPOSÉ LES
DERNIÈRES AVANCÉES DE CES TECHNIQUES, EN SE FOCALISANT SUR LES TRAITEMENTS DES
CANCERS DU SEIN ET DE LA PROSTATE.
M. CHRISTIAN ANGLADA, DIRECTEUR ADJOINT DE LA LIGUE VAUDOISE CONTRE LE CANCER, A
ENSUITE PRÉSENTÉ LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE CETTE ASSOCIATION. LES NOMBREUSES
QUESTIONS QUI ONT SUIVI LES DEUX INTERVENTIONS TÉMOIGNENT DE L’INTÉRÊT DU PUBLIC QUI A
ASSISTÉ À CETTE CONFÉRENCE, LE 22 MAI 2013 À L’HÔTEL ALPHA-PALMIER.
LA RADIOTHÉRAPIE

EFFETS SECONDAIRES
Concrètement, lors de l’irradiation, la patiente est
couchée sur le dos, les bras au-dessus de la tête.
Elle reçoit des faisceaux de rayons X – invisibles et
indolores – qui arrivent de façon tangentielle sur
son sein, pendant une minute. On traite aussi avec
des techniques différentes certains ganglions qui se
trouvent derrière la clavicule ou le sternum et, très
rarement, ceux qui sont situés au creux de l’aisselle.
L’une des principales préoccupations des
patientes porte sur les effets secondaires du
traitement. A ce sujet, il faut d’abord souligner que
l’irradiation du sein ne fait pas perdre les cheveux et
qu’elle ne s’accompagne en général ni de nausées,
ni de douleurs. En revanche, elle peut être accompa-
gnée de fatigue, de rougeurs, de démangeaisons et
autres gênes au niveau de la peau. Ces effets
restent cependant relativement tolérables et
cessent rapidement à la fin du traitement.
La préoccupation majeure des radio-oncologues
et de leurs collaborateurs reste la prévention des
séquelles permanentes du traitement. Après
plusieurs années, une perte de souplesse du sein -
ou, plus rarement, un durcissement partiel - et des
modifications inesthétiques ou désagréables
peuvent se manifester. Dans des cas très rares, les
rayons peuvent provoquer des inflammations
pulmonaires, des problèmes cardiaques après
traitement du sein gauche ou encore un cancer
radio-induit.
RÉDUIRE LES SÉQUELLES
Les avancées techniques visent à diminuer ces
séquelles du traitement. Avant de procéder à la
radiothérapie, on fait un examen au scanner qui
servira de base pour planifier le traitement. On
obtient ainsi des coupes du corps qui permettent
de délimiter la zone du sein à irradier, ainsi que les
organes qu’il faudra au contraire protéger des
rayons, comme les poumons et le cœur. Cette
présentation virtuelle en trois dimensions sert
ensuite de modèle pour orienter les faisceaux et elle
permet d’élaborer un «plan de traitement» indivi-
dualisé durant la radiothérapie proprement dite.
Le sein n’ayant pas une forme régulière, on ne
peut pas irradier tout son volume avec des
faisceaux «bruts» de rayons X car, dans ce cas, les
parties extérieures recevraient une dose plus forte
que les parties profondes. Or, une surexposition
de certaines zones de la glande mammaire
entraîne un risque de développement d’une
fibrose tardive. Pour l’éviter, une des solutions
consiste à «moduler» les faisceaux à l’aide de
petites lames mobiles qui les bloquent
partiellement pendant le traitement et qui
permettent ainsi une irradiation plus homogène
du sein. La Clinique Bois-Cerf est le seul centre en
région lausannoise à proposer cette technique,
appelée «compensation électronique».
Lors du traitement du sein gauche, il faut veiller à
protéger le cœur qui se trouve juste derrière la
glande mammaire. L’irradiation de cet organe
peut en effet provoquer ultérieurement des
problèmes cardiaques, notamment des infarctus.
On peut donc, avoir recours à une technique dite
«d’inspiration bloquée»: durant le traitement, la
patiente gonfle ses poumons afin de reculer le
cœur de la paroi thoracique, ce qui permet aux
faisceaux de ne pas le toucher. A Lausanne, il
s’agit également d’une technique proposée
uniquement à la Clinique Bois-Cerf.
Lors du traitement du sein gauche,
la technique «d’aspiration bloquée»
permet de reculer le coeur de la
paroi thoracique et de le protéger
ainsi de l’irradiation.

NOUVELLES TENDANCES
Les discussions portent actuellement sur la possi-
bilité de réduire la durée des traitements. Des
études ont notamment été faites en Grande-
Bretagne et au Canada. Outre-Manche, dans cer-
taines régions du pays, la moitié des patientes
doivent attendre plus de 2 mois avant d’être trai-
tées, alors qu’en Suisse on considère qu’elles de-
vraient pouvoir bénéficier de la radiothérapie
dans les 4 à 6 semaines qui suivent la chirurgie,
ou dans les 3 semaines suivant la chimiothérapie.
Au Canada, le problème vient de l’étendue du
pays. Les distances sont telles qu’il est difficile
pour les patientes de se rendre quotidiennement,
pendant 5 ou 6 semaines, dans leur centre de ra-
diothérapie. Ces considérations, ainsi que
d’autres, ont amené ces pays à tester des traite-
ments plus courts, remplaçant une irradiation en 5
semaines par un traitement en 3 semaines.
Les résultats de ces études sont globalement ras-
surants tant au niveau de l’efficacité que des ef-
fets secondaires du traitement, du moins pour
certains sous-groupes de patientes. La commu-
nauté des radio-oncologues cherche actuellement à
définir de façon consensuelle la place de ces traite-
ments raccourcis dans la pratique quotidienne.
Un autre débat porte sur la possibilité de procé-
der à une irradiation partielle du sein et de ne trai-
ter que la cavité opératoire. Différentes tech-
niques sont en cours de validation, surtout pour
des tumeurs précoces. Elles ne sont pas encore
utilisées à Lausanne, mais elles pourraient l’être
dans les prochaines années.
Enfin, pour le futur, l’espoir serait de parvenir à
identifier, grâce à des analyses génétiques ou à
des analyses plus fines des tumeurs, les femmes
qui ont un plus grand risque de récidive, afin de
pouvoir éviter la radiothérapie à celles qui, au
contraire, n’ont qu’un faible risque. Pour l’instant,
c’est impossible.
CANCER DE LA PROSTATE:
MORTALITÉ EN CONSTANTE DIMINUTION
C’est le cancer le plus fréquent chez l’homme en
Suisse et le deuxième plus mortel après le cancer
du poumon. La maladie, qui atteint plutôt les
hommes âgés, peut souvent être guérie, ou du
moins bien traitée et son évolution durablement
ralentie.
Depuis une vingtaine d’années, la mortalité due au
cancer de la prostate est en constante diminution.
Cette baisse s’explique entre autres choses par la
systématisation du dépistage, qui suscite toutefois
des controverses. Les traitements peuvent en
effet engendrer des effets secondaires, parfois
très invalidants (comme les problèmes d’inconti-
nence ou de dysfonctionnement érectile), alors
que, compte-tenu de l’évolution souvent lente de
ce cancer, un traitement ne serait pas nécessaire
chez de nombreux hommes. Le dépistage permet
toutefois de sauver des vies. Il faut donc peser les
risques et les bénéfices des tests qui amènent à
traiter des personnes qui n’en auraient pas besoin.
Mais une fois encore, le problème vient du fait que
l’on est incapable d’identifier les patients chez qui
la maladie pourrait avoir de graves conséquences.
L’amélioration du pronostic est également due à
l’arrivée de nouveaux traitements et aux améliora-
tions des thérapies locales. Le choix de la prise en
charge de chaque patient nécessite une approche
multidisciplinaire. Il existe en effet différentes possi-
bilités: ne pas intervenir, tout en surveillant réguliè-
rement le taux de PSA, opérer ou procéder à une
irradiation, parfois associée à des traitements hor-
monaux qui durent de 6 mois à 3 ans.
Dans le traitement du cancer de la prostate, la ra-
diothérapie peut être proposée à la place de
l’ablation de la prostate (prostatectomie). Elle
peut aussi être utilisée juste après l’intervention
ou encore des années plus tard, lorsque le taux de
PSA augmente à nouveau.
Les inconvénients de la radiothérapie du cancer
de la prostate résident dans la longueur du traite-
ment (jusqu’à 8 semaines), ainsi que dans les ef-
fets secondaires et les séquelles potentielles, no-
tamment au niveau du rectum et de la vessie.

«SCULPTER» LA PROSTATE
Les techniques classiques irradient en effet non
seulement la prostate, mais aussi de façon impor-
tante les organes avoisinants, comme la vessie et
le rectum. Cela oblige à limiter les doses de
rayons, ce qui limite l’efficacité de la thérapie.
On peut toutefois améliorer le traitement en le
planifiant, comme on le fait dans le cadre du can-
cer du sein, grâce à un examen au scanner. Puis en
utilisant des techniques modernes employant des
faisceaux dont l’intensité est modulée par des
lames mobiles placées sur le trajet des rayons. On
utilise aussi parfois une machine qui tourne autour
du patient tout en l’irradiant sur 360 degrés. On
parvient ainsi à «sculpter» la forme de la prostate
et à exclure le rectum et la vessie de la zone forte-
ment irradiée. Grâce à ces stratégies, ainsi qu’à
des techniques d’imagerie permettant de replacer
les patients avant chaque séance et donc de
mieux cibler les rayons, il a été possible
d’augmenter les doses de rayons de plus de 10%
et, de ce fait, de diminuer le taux de récidives.
Dans ce domaine aussi, on cherche à réduire la
durée du traitement. Différents protocoles sont
actuellement en cours d’évaluation et l’on attend
leurs résultats à long terme. On peut aussi rempla-
cer les rayons irradiant le patient de l’extérieur par
des grains radioactifs placés dans sa prostate.
Cette technique, nommée curiethérapie, est utilisée
dans certains centres suisses alémaniques, mais ac-
tuellement, elle ne l’est pas en Suisse romande.
La tendance consiste enfin à utiliser de nouvelles
techniques d’imagerie qui permettent de mieux
cibler les rayons.
Au cours des deux dernières décennies, on a donc
assisté à une véritable révolution dans la thérapie
des cancers du sein et de la prostate. Cette évolu-
tion est le fruit d’un travail collectif impliquant non
seulement les médecins, physiciens et techniciens
travaillant en radio-oncologie, mais également les
fabricants de machines et les concepteurs de logi-
ciels qui, ensemble, ont reculé les limites du possible
dans une discipline en plein essor.
Les nouvelles techniques permettent de «sculpter» la prostate
et de réduire l’irradiation de la vessie et du rectum.
 6
6
1
/
6
100%