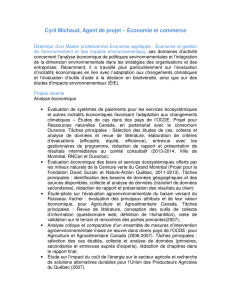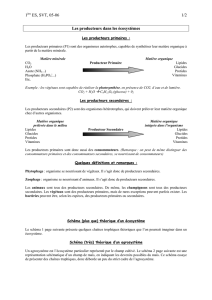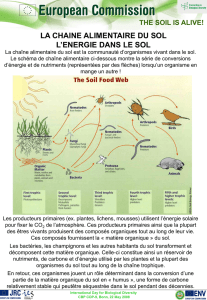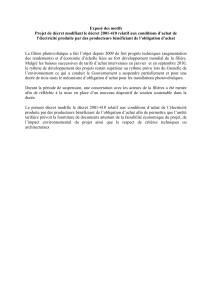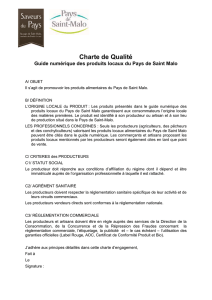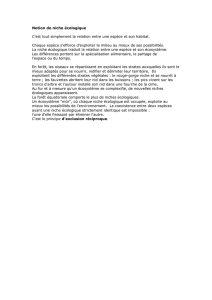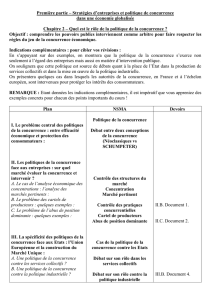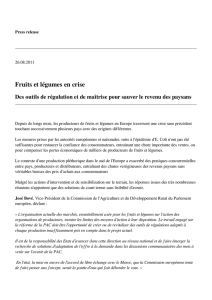Titre - UMR EPOC - Université de Bordeaux

Evolutions et biodiversités dans un écosystème global, une approche
théorique
Philippe BERTRAND, Université de Bordeaux, CNRS-INSU, UMR 5805, avenue des facultés, 33405
Talence Cedex, p.bertrand@epoc.u-bordeaux1.fr
23 mars 2009
Introduction:
L’un des piliers de la théorie de l’évolution1 est que la sélection naturelle s’exerce sur
une diversité d’êtres vivants dont les aptitudes sont différentes. Une évolution sélective
permanente implique le maintien de cette plasticité, c’est à dire l’émergence continue de
nouvelles souches biologiques. Or, on ne dispose pas d’une définition précise et unique de la
biodiversité au sens large ni, à quelques exceptions près comme la diversité spécifique2, de
méthodes quantitatives pour la mesurer. Il est donc difficile d’identifier les processus par
lesquels la sélection agit aux différents niveaux de la biodiversité (gènes, cellules, phénotypes,
espèces, populations), et d’évaluer leurs effets relatifs. Par ailleurs, la compréhension des
interactions entre l’évolution holistique du système Terre et l’évolution biologique des êtres
vivants, est encore aujourd’hui très parcellaire3. Dans un écosystème où le renouvellement des
ressources est limité par rapport au développement des populations (système malthusien3), la
sélection naturelle favorise peu à peu la descendance des individus qui tirent le meilleur parti
de l’utilisation de ces ressources pour se reproduire, tout en transmettant cette aptitude à leurs
descendants. Au travers de ce mécanisme, c’est une population d’individus, divers mais
possédant tous cette même aptitude trophique générale, qui est sélectionnée. Elle émerge des
mécanismes sélectifs s’exerçant aux niveaux sous-jacents de la biodiversité. Ce cadre
conceptuel, simplifié mais précis, permet d’étudier l’évolution théorique de la biodiversité des
populations trophiques par simulation numérique. Je montre ici que, dans un écosystème
malthusien, une part de la diversité des populations trophiques est fondamentalement stable
tandis qu’une autre part est transitoire. La première est issue de la colonisation progressive
des niches5 trophiques, tandis que la seconde résulte de la diversification à l’intérieur de
chaque niche. Ce résultat ouvre des perspectives intéressantes, non seulement pour
comprendre la longue histoire évolutive de la Terre3, mais aussi pour comprendre sa capacité
de régulation3,6 vis-à-vis d’aléas internes ou externes affectant la biodiversité à plus court
terme.
Méthodologie sommaire
Le schéma de principe du modèle numérique utilisé est présenté dans la figure 1. Une
explication détaillée de ce modèle est fournie dans l’annexe méthodologique à la fin de cet
article. Les populations biologiques et les réservoirs nutritifs minéraux se répartissent dans
différents réservoirs et sont exprimés dans la même unité de masse arbitraire. Les réservoirs
minéraux sont en permanence ajustés en fonction de l’évolution des populations biologiques
ce qui conduit à des contraintes malthusiennes qui se modifient au fur et à mesure que des
populations dont les aptitudes trophiques sont différentes émergent successivement. La
dynamique de chaque population est contrôlée par l’évolution de son réservoir trophique, qui
peut être l’un des réservoirs minéraux ou l’un des réservoirs biologiques.

réservoir
N2
de ressources
nutritives
minérales
disponibles
réservoir
N1
de ressources
nutritives
minérales
disponibles
populations de
producteurs
secondaires
de niveau 2
populations de
producteurs
secondaires
de niveau 1
populations de
producteurs
primaires
contrôles trophiques
contrôles trophiques
ajustements d des réservoirs
de ressources nutritives
minérales
en réponse à la dynamique
des populations biologiques
(d>0 ou d<0)
variations éventuelles
des ressources
globales
au travers de modifications
abiotiques
(taux de
recyclage volcanique
ou de recyclage érosif,
liés au climat et à l’activité
interne de la Terre)
contrôles trophiques
Figure 1 - Schéma de principe du modèle utilisé. Les réservoirs minéraux sont en permanence
ajustés en fonction de l’évolution des populations biologiques ce qui conduit à des contraintes malthusiennes qui
se modifient au fur et à mesure que des populations trophiques sélectionnées émergent successivement. La
dynamique de chaque population est contrôlée par l’évolution de son réservoir trophique, qui peut être l’un des
réservoirs minéraux ou l’un des réservoirs biologiques. Une perturbation abiotique hypothétique peut être
introduite en augmentant ou en réduisant la taille d’un réservoir minéral.
Résultats et discussion
La théorie de l’évolution, que ce soit dans sa version originale1 ou synthétique plus
récente7,8, est principalement fondée sur le mécanisme de la sélection naturelle des
descendants. Implicitement, il s’agit donc aussi d’une sélection naturelle des ancêtres. Après
un nombre suffisamment grand de générations, peu d’ancêtres sont sélectionnés. A la limite,
il n’en subsiste qu’un seul comme l’ont montré les études modernes de phylogénie
moléculaire9. Celles-ci ont en effet vérifié que tous les êtres vivants actuels dérivent
génétiquement d’un seul ancêtre (Last Common Ancestor). La théorie de l’évolution prédit
que beaucoup des êtres vivants d’aujourd’hui n’auront aucune descendance lointaine et que
les plus complexes n’ont pas vocation à être obligatoirement les ancêtres de demain. En effet,
la complexité ne confère a priori aucun avantage sélectif à long terme. Pour s’en convaincre,
il suffit de réaliser qu’un aléa majeur, modifiant brutalement les conditions écologiques,
éradique plus facilement de la surface de la terre une population d’éléphants qu’une
population de bactéries.
La sélection naturelle ne produit un effet évolutif que si elle s’exerce sur une diversité
d’êtres vivants dont les aptitudes sont différentes. L’évolution adaptative est donc nourrie de
l’émergence permanente de nouvelles souches dont certaines, en raison de meilleures
aptitudes, voient leur descendance favorisée. Sans cette émergence, la sélection réduit
rapidement la biodiversité au plus petit ensemble possible des populations les plus aptes à

utiliser les ressources environnementales au profit de leur survie et de leur reproduction.
Toutes choses égales par ailleurs, l’effectif de la population cesse alors d’évoluer et se place
dans une situation stationnaire, dite malthusienne en raison de la limitation des ressources4. Le
cas le plus simple est celui d’une seule population de producteurs primaires, c'est-à-dire
réalisant la synthèse de molécules organiques à partir des substrats minéraux (autotrophie),
ayant atteint un équilibre stationnaire avec son réservoir nutritif minéral (figure 2, a et c).
Lorsqu’une souche d’aptitude différente arrive dans l’écosystème (mutation, invasion…),
différents destins sont possibles. Si cette souche se nourrit sur le même réservoir que d’autres
populations déjà présentes (niche nutritive), elle ne se développe que si son aptitude à
l’utilisation des ressources au profit de sa descendance est supérieure à celle de la population
la plus apte déjà présente, ou si le système n’est pas encore en situation stationnaire
malthusienne (fig.2, b).
0
200
400
600
800
1000
1200
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
time (arbitray unit)
mass (arbitrary unit)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Shannon inde
x
abc
Figure 2 - Evolution de populations occupant une même niche trophique. En traits fins de
couleur, évolutions de 4 populations de producteurs primaires d’aptitude trophique croissante. En trait fin noir,
évolution du réservoir nutritif minéral. En trait orange épais, évolution de la biodiversité mesurée par l’indice de
Shannon8. Dans un tel système, la biodiversité est instable et temporaire (phase b). Sans l’émergence de
nouvelles souches d’aptitude supérieure, le système évolue vers un équilibre stationnaire malthusien entre le
réservoir nutritif et la population dont l’aptitude est la plus grande (fin de la phase a, et phase c).
Mais la nouvelle souche peut aussi introduire une innovation en utilisant un réservoir
nutritif encore inutilisé, et se développer ainsi en tant que population pionnière d’une
nouvelle niche nutritive (fig. 3, b et c). Ce développement se poursuit jusqu’à la situation
stationnaire malthusienne la plus simple (équilibre stationnaire entre la population innovante
et le nouveau réservoir nutritif), ou jusqu’à l’entrée en compétition d’une nouvelle souche,
plus apte à utiliser le nouveau réservoir nutritif. Le développement des populations
hétérotrophes, c'est-à-dire dont le réservoir nutritif est constitué par la biomasse d’autres
populations, peut naturellement être accéléré ou entravé selon que les populations
consommées sont en croissance ou en régression (fig. 3, c).

0
200
400
600
800
1000
1200
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
time (arbitrary unit)
mass (arbitrary unit)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Shannon inde
x
ab c
Figure 3 – Evolution de trois populations occupant successivement trois niches
trophiques différentes. a) développement d’une population de producteurs primaires (trait fin bleu)
utilisateurs d’un réservoir nutritif minéral (trait fin noir). b) développement d’une population de producteurs
secondaires (trait fin rouge) dont la niche nutritive est constitué par les producteurs primaires ; c) développement
d’une population de producteurs primaires (trait fin turquoise) utilisateurs d’un second réservoir nutritif minéral
(trait fin gris). Au cours de la phase c, le développement de la nouvelle population de producteurs primaires
induit un réajustement des autres populations. La population des producteurs secondaires s’accroît, ce qui a pour
conséquence de faire légèrement décroître celle des premiers producteurs primaires. L’évolution générale de la
biodiversité (trait épais orange) augmente par paliers stables au fur et à mesure que se structure l’écosystème.
Ainsi, au fur et à mesure que se structure le réseau des interactions trophiques, le
système devient plus complexe, mêlant des espèces autotrophes et des espèces hétérotrophes.
Nous montrons ici que la construction de cette complexité mêle une part de biodiversité
instable, de nature transitoire, et une part de biodiversité virtuellement stable qui structure
l’écosystème et le stabilise. En effet, une biodiversité constituée de plusieurs populations en
compétition sur le même réservoir nutritif est fondamentalement instable et transitoire (fig. 2).
Elle tient au fait que de nouvelles souches apparaissent en permanence dans la niche nutritive
en question. Si ces émergences cessent, la niche évolue inéluctablement vers un équilibre
stationnaire malthusien entre la population la plus apte et le réservoir nutritif (fig. 2, c), c'est-
à-dire vers une niche nutritive à une seule population. A l’inverse, un système contenant N
populations distribuées sur n réservoirs nutritifs (n entier >1), avec N>n, évolue vers une
situation stationnaire malthusienne à n populations (fig. 3c). Il contient donc virtuellement
une structure stable à n populations et son indice de Shannon10 mesuré à l’équilibre
stationnaire malthusien est supérieur à 0. En raison des changements permanents de
l’environnement et de l’émergence de nouvelles souches, les biomasses des populations
varient constamment. La biodiversité structurante, est donc une propriété réelle, évolutive,
mais non apparente du système. C’est le minimum stable de biodiversité qu’atteindrait le
système si aucun évènement nouveau ne se produisait.
Cette biodiversité virtuellement stable est un concept proche de celui de « stratégie
d’évolution stable » proposé par John Maynard Smith11 en utilisant la théorie des jeux (ESS :
Evolutionarily Stable Strategy). La différence tient au fait que la stabilité virtuelle est
envisagée ici à l’échelle de la globalité d’un système. A cette échelle, et lorsque le système est
entièrement colonisé, c’est la contrainte malthusienne pour l’accès aux ressources nutritives
qui exerce le contrôle sélectif dominant. Par ailleurs, le choix a été fait de ne pas utiliser le

terme de « stratégie » dans cet article car celui-ci laisse croire à une téléologie qui, bien sûr,
n’existe pas dans la dynamique évolutive.
La diversification des niches trophiques et des populations qui les occupent revient à
minimiser le risque qu’un aléa dévaste une grande part du système. Un effet holistique de
l’augmentation de la biodiversité d’un écosystème est donc de le rendre moins sensible aux
perturbations. Cette recherche non téléologique de stabilité se produit davantage dans un
système encore peu structuré (juvénile), où de nombreuses niches trophiques sont vierges.
Chaque nouvelle conquête de niche trophique démultiplie donc la plasticité offerte par la
biodiversité transitoire.
Dans un écosystème juvénile, les effets de la sélection naturelle optimisent l’utilisation
globale des ressources nutritives (fig. 3). Par l’émergence continue de souches nouvelles dans
les niches trophiques déjà occupées (fig. 3, d et e), des aptitudes plus grandes à l’utilisation
des nutriments peuvent être sélectionnées. Le concept d’aptitude doit ici être pris dans un sens
composite et très large. Il peut s’agir par exemple d’une aptitude physiologique à tirer parti de
faibles concentrations de nutriments dissous, ou d’une meilleure aptitude à la détection et à la
capture des proies. Mais, au sens global, il peut aussi s’agir d’une aptitude à tirer parti d’une
majorité d’environnements géographiques locaux où les ressources nutritives sont disponibles.
Une résistance au froid, aux environnements très agités, aux fortes salinités, ou à la vie hors
de l’eau contribue par exemple à cette aptitude générale. Bien entendu, le modèle présenté ici
est global et ne tient compte d’aucune spécificité locale des environnements ou des
populations.
La sélection naturelle aboutit aussi à l’occupation de nouvelles niches trophiques (fig.
4, b, c, et f) par le développement de populations innovantes (nouveaux métabolismes
biosynthétiques et respiratoires, prédation, super prédation, nécrophagie, parasitisme). Le
système se rapproche ainsi d’une autorégulation globale. Sans cette structuration, la biosphère
terrestre aurait sans doute disparu prématurément puisque des modifications biogéochimiques,
parfois défavorables aux populations en place, sont induites par le développement de ces
mêmes populations. Par exemple, l’un des métabolismes les plus anciens était à la fois
anaérobie et producteur d’oxygène (photosynthèse anaérobie productrice d’oxygène sous
forme O2). Or la présence d’oxygène O2 est létale pour les êtres vivants anaérobies. La vie se
serait donc empoisonnée elle-même, et aurait disparu, si elle n’avait pas sélectionné de
nouveaux métabolismes, permettant à la fois de vivre dans une ambiance oxygénée de réguler
l’oxygénation de l’environnement12,3. La respiration aérobie, qui utilise l’oxygène O2 et limite
ainsi son excès dans l’environnement, et l’un d’entre eux. Par ailleurs, des mécanismes intra
et intercellulaires ont été sélectionnés pour lutter contre les effets dévastateurs de O2 sur les
processus biochimiques et l’ADN. De nouveaux mécanismes respiratoires anaérobies ont été
sélectionnés pour utiliser des composés issus de l’oxydation par O2 dans les niches anaérobies
subsistantes (nitrates, sulfates). Enfin, de nouveaux mécanismes photosynthétiques aérobies
ont été sélectionnés pour utiliser ces mêmes sous-produits (nitrates, phosphates) dans les
nouvelles niches aérobies.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%