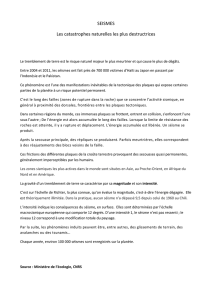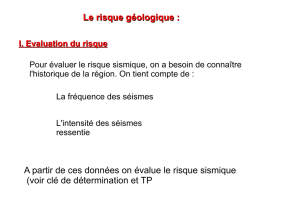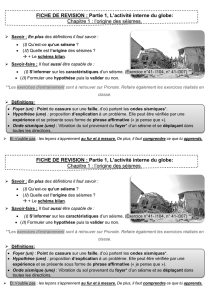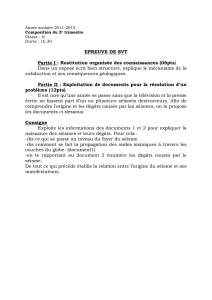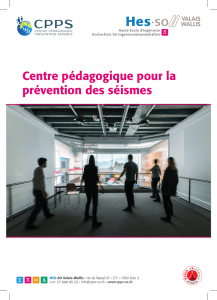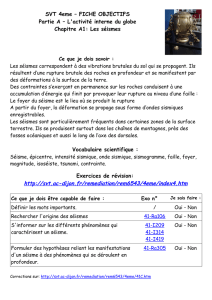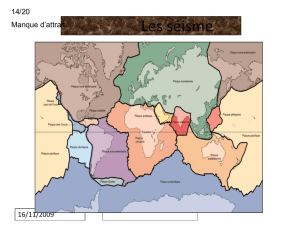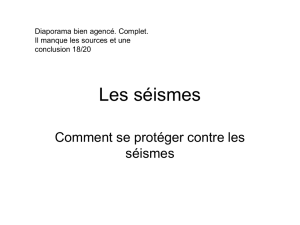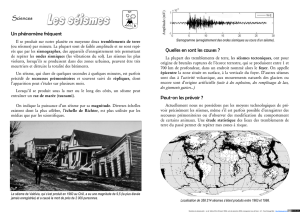Séismes - Le Plan Séisme

k
www.planseisme.fr
La Lettre du Plan Séisme – 2e trimestre 2014 1
Enregistrement du séisme du 7
avril 2014. (Source : BRGM)
Sismicité récente (Ubaye, Hautes-Pyrénées) – Arrêté
« multifluide » du 5 mars 2014 – Base de données BCSF
ZOOM : Catalogue de sismicité SI-HEX
DOSSIER : Séismes vus du ciel
Séisme de la vallée de l’Ubaye du 7 avril 2014 (Ml=5.3)
Les caractéristiques du séisme
Un important séisme est survenu le lundi 7 avril 2014 à 21h27 heure locale (19h27 heure
GMT) à la limite entre les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence,
au niveau de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, à une quinzaine de kilomètres au nord de
Barcelonnette. Relativement superficiel, ce séisme a
atteint une magnitude locale de 5,3 selon le
Laboratoire de Détection Géophysique (LDG) du CEA et
a été largement ressenti dans la région épicentrale ainsi
que dans tout le quart sud-est du pays, en
occasionnant uniquement des dégâts très mineurs dans
la zone épicentrale.
Il s’agit du séisme le plus important enregistré en
métropole depuis une dizaine d’années, et le plus
important dans les Alpes depuis le séisme d’Annecy du 15
juillet 1996, de magnitude comparable mais qui était
alors survenu dans une zone beaucoup plus peuplée. Depuis que les réseaux sismologiques
du CEA permettent de surveiller la sismicité française, soit depuis 1962, seule une dizaine de
séismes de magnitudes équivalentes ou supérieures a été enregistrée en Métropole.
Selon les témoignages internet recueillis par le Bureau Central Sismologique Français (BCSF),
des intensités préliminaires maximales de V sont relevées dans la zone épicentrale
1
.
Contrairement à ce qu’aurait pu laisser supposer la magnitude importante de l’événement,
les dommages induits par ce séisme demeurent très limités. On recense ainsi plusieurs
chutes de cheminées ainsi que des fissures dans certains bâtiments de communes proches
de l’épicentre. Cet important séisme a cependant généré une certaine inquiétude parmi la
population. En effet les centres de secours des départements proches de l’épicentre ont
reçu chacun plusieurs centaines d’appels.
A plus grande distance, et bien qu’atténuées, les vibrations générées par le séisme ont été
ressenties dans un rayon de près de 300 km autour de l’épicentre. Ainsi, les témoignages
recueillis par le BCSF indiquent-ils une aire de perception du séisme allant depuis Lyon au
nord, et jusqu’à Marseille au sud. Le séisme a par ailleurs été fortement ressenti en Italie
1
Ces intensités, issues de témoignages internet individuels, permettent une estimation préliminaire rapide de
la sévérité de la secousse au sol ; elles sont à distinguer des intensités communales évaluées par le BCSF à
partir des enquêtes macrosismiques et des analyses de terrain du Groupe d’intervention macrosismique (GIM).

k
www.planseisme.fr
La Lettre du Plan Séisme – 2e trimestre 2014 2
« Essaims de séismes » de la haute vallée
de l'Ubaye de 2003-2004 (en blanc), de
2012-2014 (en rose) et depuis le 7 avril
2014 (en rouge) (Source : SISMALP)
dans le Piémont et la Lombardie, jusqu’à Milan. En particulier, ce séisme a donné lieu à de
très nombreux témoignages le long de la Côte-d’Azur, avec des intensités variant de III à IV.
Ces témoignages mettent en évidence des effets de directivité et de propagation
préférentielle vers le sud similaires à ceux soulignés suite au séisme survenu en février 2012.
Un précédent récent : le séisme du 26 février 2012
Le 26 février 2012, un séisme de magnitude locale établie à 4.5 par le LDG était survenu au
même endroit. Egalement superficiel, ce séisme avait été largement ressenti dans la région
épicentrale, sans générer de dégâts notables. Ce séisme avait fait l’objet d’un article dans la
lettre du Plan Séisme du 2ème trimestre 2012.
Ce séisme du 26 février 2012 a marqué le début d’une intense activité sismique dans la
vallée de l’Ubaye qui a perduré jusqu’à l’événement majeur du 7 avril 2014. Ainsi le réseau
régional de surveillance sismique SISMALP a fait état de plusieurs milliers de séismes
détectés entre les deux événements, dont plusieurs dizaines ont été ressentis plus ou moins
fortement par la population.
Une crise sismique en essaim très surveillée
La région de l’Ubaye présente une sismicité
remarquable caractérisée par des crises
sismiques dites « en essaim » qui se traduisent
par une succession très localisée de séismes. Si
après la survenue d’un séisme il est très
fréquent d’observer pendant une période plus
ou moins longue une succession de secousses de
moindre importance dites « répliques », les
essaims de séismes se distinguent par le fait que
la magnitude des séismes observés ne suit
aucune évolution claire et que l’on ne sait pas,
au cours de la crise, si la magnitude maximale de
cette crise a été atteinte. Il est ainsi impossible
de prévoir précisément la manière dont va
évoluer la crise sismique en cours.
Afin d’obtenir une meilleure visibilité de cette
crise sismique, et dans le but de mieux
comprendre le phénomène de sismicité en
essaim, sept stations sismologiques temporaires
ont été déployées dans la région épicentrale
conjointement par les équipes de l’université de
Grenoble (SISMALP, ISTerre) et de GéoAzur.
Un retour d’expérience essentiel
Ce type d’événement étant relativement rare sur le territoire métropolitain, plusieurs
missions d’expertise complémentaires ont été organisées pour acquérir un retour

k
www.planseisme.fr
La Lettre du Plan Séisme – 2e trimestre 2014 3
d’expérience. En particulier une mission du BCSF a été conduite du 14 au 16 avril afin de
recenser précisément les effets du séisme et d’en fournir une carte d’intensité précise. Une
mission post-sismique de l’Association Française de Génie Parasismique (AFPS) a également
été menée sur place du 22 au 23 avril comme après chaque événement majeur pouvant
apporter des enseignements vis-à-vis de la connaissance du risque sismique en France : cette
mission s’est pour sa part concentrée sur le dégât à l’habitat individuel et au petit collectif.
Une démarche de retour d’expérience est menée à l’initiative de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région PACA, sur les
thématiques suivantes : le comportement des populations, l’information et la
communication, les traces du séisme sur le terrain (notamment mouvements de terrain), les
dommages et dysfonctionnements, les conséquences économiques et la gestion de crise. Un
exercice de crise sismique (exercice RICHTER-04) avait été organisé en octobre 2013 dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence par le Ministère de l’Intérieur et la Préfecture,
avec l’appui du BRGM. A cette occasion, les autorités avaient notamment eu à gérer les
conséquences d’un séisme présentant de fortes similitudes avec celui survenu le 7 avril
dernier, tant par sa localisation que par sa magnitude (cf. Infolettre du 4e trimestre 2013). La
démarche de REX permettra donc d’évaluer également l’apport des exercices de gestion de
crise de type RICHTER à la gestion opérationnelle de séismes.
Séisme de Lourdes (29/04/2014, Ml=4.7)
Le 29 avril 2014, un séisme de magnitude 4.7 selon le LDG est survenu dans le département
des Hautes-Pyrénées non loin de la ville de Lourdes. D’intensité épicentrale IV à V, ce séisme
a été largement ressenti dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour de l’épicentre,
et n’a généré que de très légers dégâts.
Arrêté « multifluide » du 5 mars 2014
L'arrêté du 5 mars 2014, définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, a été publié
au Journal officiel du 25 mars 2014.
Cet arrêté inclut, à ses articles 9 et 32, les règles parasismiques applicables aux tronçons de
canalisations de transport « à risque spécial » nouveaux et existants.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (à l'exception des dispositions relatives à la maîtrise
de l'urbanisation, entrées en vigueur le lendemain de la publication) et abrogera à cette date
le précédent arrêté "multifluide" (arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des
canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de
produits chimiques).
BD-MFC : base de données macrosismiques françaises
contemporaines du BCSF
Afin de permettre un accès facilité aux intensités macrosismiques évaluées pour tous les
séismes ayant affecté significativement le territoire national depuis 1996, le BCSF a

k
www.planseisme.fr
La Lettre du Plan Séisme – 2e trimestre 2014 4
récemment mis en ligne sa base de données macrosismique contemporaine. Dénommée BD-
MFC, celle-ci est accessible à l'adresse www.franceseisme.fr/donnees/BD-MFC et donne
accès à plus de 48.138 observations issues de 247 séismes. Consultable par recherche
géographique ou chronologique, BD-MFC permet à la fois la visualisation cartographique des
données et leur téléchargement.
Cette nouvelle base de données BD-MFC vient donc utilement compléter la base de données
SISFRANCE qui couvre pour sa part la période historique.

La Lettre du Plan Séisme – 2e trimestre 2014 5
k
www.planseisme.fr
Zoom sur...
SI-Hex : le catalogue BCSF-LDG de la sismicité
instrumentale de la France métropolitaine
Par Michel Cara
2
, Yves Cansi
3
et Antoine Schlupp2
Le catalogue de Sismicité Instrumentale de l’Hexagone 1962-2009 est le résultat principal du
projet collaboratif SI-Hex, conduit de 2009 à 2013, par le BCSF, agissant pour le compte de
sept Observatoires des Sciences de l’Univers (OSU CNRS/INSU – Universités), ainsi que par le
Laboratoire de Détection Géophysique (LDG) du CEA (CEA-DAM/DASE). Le projet SI-Hex a eu
pour objet de créer un catalogue unifié de la sismicité de la France métropolitaine sur la
période 1962-2009, proposant la meilleure information possible sur la localisation des
hypocentres et sur la magnitude. La période couverte débute donc en 1962, l’année où le
CEA a implanté le premier réseau sismique permanent sur le territoire métropolitain. Ce
catalogue BCSF-LDG version 2014 a vocation à être amélioré et complété au fur et à mesure
de l’apport de nouvelles informations, en le complétant notamment pour les séismes
postérieurs à 2009.
Trois questions ont été examinées avec un soin particulier lors du projet SI-Hex: celle de la
localisation précise des épicentres, celle de la discrimination entre séismes naturels et
séismes artificiels, et enfin celle de la réévaluation complète et harmonisée des magnitudes.
Localisation
L’objectif étant de fournir la meilleure localisation possible, le travail a porté sur deux axes
majeurs. D’une part, tous les évènements ont été relocalisés par une méthode unique à
partir de la fusion de tous les temps d’arrivées disponibles issus des observatoires français
(LDG, RéNaSS, Sismalp, OMP, Géo-Azur) et ceux des pays frontaliers via le CSEM (Centre
sismologique euro-méditerranéen) et l’ISC (International seismological centre). Ces
localisations portent le label « localisation SI-Hex ». Le calcul prend en compte le modèle 1D
de vitesses sismiques dit « Haslach simplifié » qui est utilisé par le BCSF-RéNaSS à l’EOST.
D’autre part, pour chaque séisme, la meilleure localisation a été sélectionnée parmi les
localisations disponibles (localisation SI-Hex ou celle réalisée par des observatoires ou issue
de travaux particuliers). Le catalogue précise l’auteur de chaque localisation.
Le catalogue BCSF-LDG présente ainsi les solutions les plus précises possibles pour tous les
évènements identifiés par le processus de fusion de données. En dehors des séismes anciens
relocalisés au LDG, les solutions préférentielles concernent la partie récente du catalogue, de
1980 à 2004 dans le domaine armoricain, depuis 1978 dans les Pyrénées, 1989 dans les
Alpes et 2001 dans la zone méditerranéenne. La même procédure sera appliquée à la région
nord-est à partir du catalogue régional EOST à la prochaine révision du catalogue BCSF-LDG.
2
EOST, Université de Strasbourg
3
CEA, DAM/Ile de France, Bruyères-le-Châtel
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%