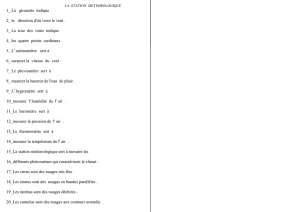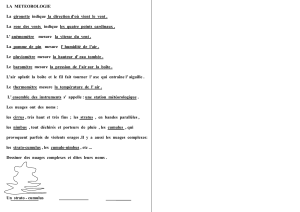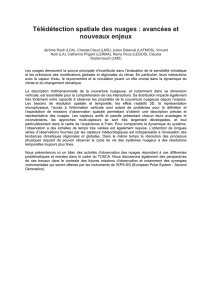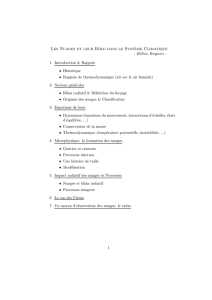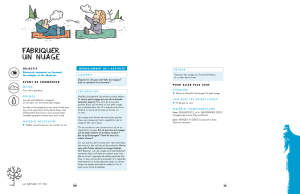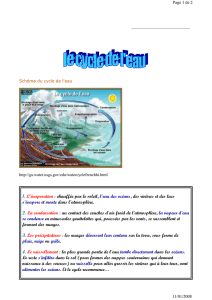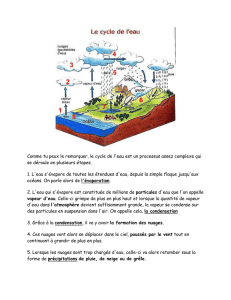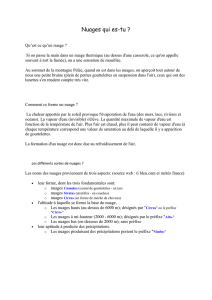Aspect des nuages

SOMMAIRE
Projet Météorologique
Station météorologique
Blaise Pascal
Les nuages et la troposphère
Aspect des nuages
Nom des nuages :
-les nuages hauts
- Les nuages à mi-hauteur
-Les nuages bas
- suite (nuages )
Point de rosée
Pression atmosphérique
Circulation atmosphérique
Girouette
Baromètre
Pluviomètre
Anémomètre
Capteur
thermo/hygro
Capteur solaire thermique
Satellites
météorologiques
Anticyclones

$
PROJET :
Station
météorologiq
ue

STATION METEOROLOGIQUE
Une station météorologique est un ensemble de capteurs qui enregistrent et fournissent des
mesures physiques et des paramètres météorologiques liés aux variations du climat[1]. Les
variables à mesurer sont la température, la pression, la vitesse et direction du vent,
l'hygrométrie, le point de rosée, la pluviométrie, la hauteur et le type des nuages, le type et
l'intensité des précipitations ainsi que la visibilité. Les stations peuvent comporter des capteurs
pour toutes ou une partie seulement de ces informations, selon leur type : agro-météorologique,
d’aéroport, météo routière, climatologique, etc. Les données qu'on en obtient peuvent être
envoyées directement comme rapport météorologique, dans le cas d'une station automatique,
ou faire partie des observations METAR émises par un observateur humain.

BLAISE PASCAL
Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand en
Auvergne. Son père,
Etienne Pascal, président à la Cour des Aides s'intéresse à la
science. Sa mère,
née Antoinette Begon meurt alors que le petit Blaise n'a que 3
ans. Très vite,
l'enfant fait montre d'un génie extraordinaire. A 12 ans, il
retrouve tout seul les
32 premières propositions d'Euclide. A 16 ans, il compose un
Traité des Sections Coniques.
A 19 ans, il construit une machine arithmétique, ancêtre de nos
modernes calculettes.
Blaise pascal

Les nuages et la troposphère
Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de
cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère
La troposphère est la partie de l'atmosphère terrestre située entre la surface du globe
et une altitude d'environ 8 à 15 kilomètres, selon la latitude et la saison. Elle est plus
épaisse à l'équateur qu'aux pôles. La frontière entre la troposphère et la stratosphère
s'appelle la tropopause.
Cette couche atmosphérique contient +/-80% de la masse totale de l'atmosphère, elle
est importante car on y trouve l'air qu'on respire.
En moyenne, la température diminue avec l'altitude, à peu près de 6,4 °C tous les
1000 mètres. On trouve dans cette couche la plupart des phénomènes
météorologiques. C'est donc dans cette couche que le cycle de l'eau peut se
développer, on y trouve une masse importante de vapeur d'eau (H2O).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%