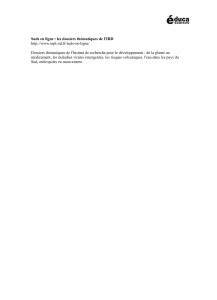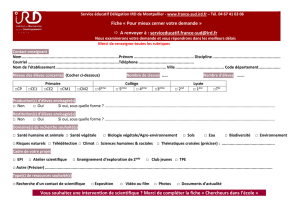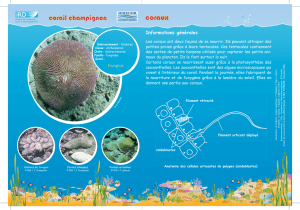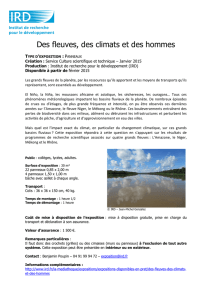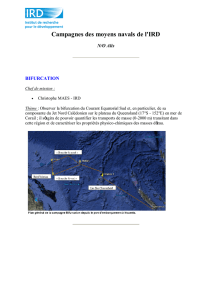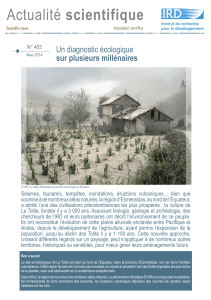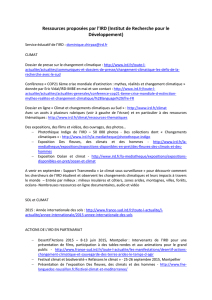Quand les espèces invasives s`invitent au Sud

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009
7
taux »
, révèle Fabien Leprieur. En
effet, des études ont montré qu’en
moyenne une espèce introduite sur
dix réussissait à s’établir, et que
seule une espèce établie sur dix était
susceptible de devenir envahissante.
C’est ce que l’on appelle
« la règle
des 10 % »
. Mais surtout, on observe
que les populations exotiques vien-
nent à proliférer dans des milieux
aquatiques préalablement dégradés
ou perturbés par les activités
humaines – aménagement du lit des
cours d’eau, pollution, construction
de barrages. Ainsi, elles ne feraient
que prendre une place laissée libre
par les poissons autochtones, et leur
prolifération serait une conséquence
de la dégradation de l’environnement
et de la perte de biodiversité locale.
Cela signifie aussi, qu’en maintenant
l’intégrité physique des habitas
aquatiques, en restaurant la qualité
des eaux et la connectivité des
habitats, on peut limiter l’invasion
par des espèces exotiques enva-
hissantes. Néanmoins,
«il
convient de
rester pru-
dent dans
La prolifération des
espèces exotiques de
poissons d’eau douce,
est plus souvent la
conséquence du déclin de la biodi-
versité, que sa cause »
, soutient
l’ichtyologue Fabien Leprieur1. L’in-
troduction par l’homme de poissons
dans les lacs et rivières est une pra-
tique fort ancienne, remontant au
Moyen-Âge, et qui a explosé à partir
du XXesiècle avec le développement
des transports et des échanges mon-
diaux.
« Dans les espaces insulaires,
les introductions ont un impact très
marqué sur la biodiversité »
,
explique le chercheur. Ces milieux
possèdent généralement une faune
aquatique constituée d’espèces
endémiques dépourvues de préda-
teurs naturels. L’arrivée de poissons
exotiques bouscule les équilibres, et
les nouveaux venus ont tôt fait de
supplanter les autochtones. Les
exemples ne manquent pas : le Black
bass, introduit en Nouvelle-Calé-
donie, met en péril
Galaxias neocale-
donicus
, une espèce endémique
aujourd’hui proche de l’extinction.
En Nouvelle-Zélande, l’espèce qui
menace la faune autochtone est la
truite ; à Madagascar, la
carpe commune et le tilapia.
« Mais c’est bien différent
dans les milieux continen-
la mesure où les espèces exotiques
envahissantes et les dégradations
environnementales pourraient conju-
guer leurs effets sur la biodiversité »
concède Fabien Leprieur.
L’enjeu actuel est de parvenir à
gérer efficacement la prolifération
des espèces exotiques et de mainte-
nir l’intégrité des habitats aqua-
tiques, particulièrement dans les
pays du Sud et dans les pays émer-
gents. Le développement de l’aqua-
culture, des aménagements fluviaux
et du commerce des poissons d’orne-
ment s’y accompagne en effet d’un
boom des espèces exotiques dans les
lacs et les cours d’eau.
●
1. IRD, UMR
Biologie des organismes et éco-
systèmes aquatiques
.
Contacts
thierry[email protected]
Les espèces exotiques envahissantes correspondent à la deuxième cause d’érosion
de la biodiversité à l’échelle mondiale selon l’Union internationale pour la
conservation de la nature. Si au Nord le sujet est désormais largement médiatisé,
le Sud est également confronté à ce phénomène dont la mondialisation est l’un des
accélérateurs. Au delà de l’enjeu environnemental, les impacts au plan économique
comme en matière de santé publique sont significatifs. Les questions posées sont
multiples et relèvent de nombreux champs disciplinaires. La compréhension
des facteurs à l’origine du succès des espèces invasives constitue l’un des défis
auquel l’IRD apporte ses compétences. Les travaux de recherche entrepris
devraient fournir des outils d’identification rapides des espèces invasives
et contribuer à la mise au point de méthodes de surveillance, de contrôle,
voire d’éradication de ces dernières, notamment dans les îles.
Recherches
Cause ou conséquence du déclin de la biodiversité
es moustiques, passagers
clandestins dans nos
avions de lignes ne sont
malheureusement pas les
seuls insectes à utiliser les moyens de
transports modernes pour envahir de
nouveaux territoires. Selon Jean-
François Silvain, Directeur de l’unité
de recherche Biodiversite et évolu-
tion des complexes plantes-insectes-
antagonistes il existe même
« une cor-
rélation entre l’accroissement des
échanges en provenance d’une région
et le nombre d’introduction d’insectes
en provenance de cette région »
. Si le
XXesiècle est marqué par des envahis-
seurs venus du continent américain –
le doryphore a envahi les campagnes
françaises dans les années 30 – l’Asie
prend le relais et dépasse aujourd’hui
l’Amérique du Nord comme source
d’introduction d’insectes en Europe.
Exemple emblématique, l’arrivée en
2006 dans le Sud-Ouest de la France
du frelon asiatique
Vespa velutina
Lepeletier. Prédateur de l’abeille
domestique et désormais établit dans
plus de vingt départements français, il
est probablement originaire de Chine
et plus précisément du Yunnan.
Mondialisation des échanges oblige, il
aurait profité d’un commerce de pote-
ries pour effectuer sa migration. Un
consortium de recherche associant le
MNHN, l’IRD, le CNRS et l’INRA s’efforce
d’identifier l’origine précise de cet
insecte et de comprendre les causes
de son succès écologique dans notre
pays.
Largement étudiées au Nord, les inva-
sions biologiques n’épargnent pas les
pays du Sud qui participent de plus en
plus au commerce international favori-
sant l’arrivé d’espèces exotiques. Si
l’installation du frelon asiatique est
une gêne pour un pays comme la
France,
« certaines espèces invasives
risquent d’avoir des effets catastro-
phiques pour les pays du Sud »
,
explique Jean-François Silvain.
Rhynchophorus ferrugineus
, le cha-
rançon rouge des palmiers en fournit
un exemple d’actualité. Ce coléoptère
originaire d’Asie a envahi depuis le
milieu des années 1980 le Moyen-
Orient, puis à partir de 1992 l’Égypte,
l’Espagne et la plupart des rivages
méditerranéens des pays d’Europe,
ainsi que de la Turquie. Originairement
connu comme ravageur du cocotier
Cocos nucifera
, le processus invasif
s’est accompagné d’un changement
d’hôte végétal, l’insecte devenant un
ravageur du palmier dattier ainsi que
de nombreux palmiers ornementaux.
Les larves se développant de manière
cryptique à l’intérieur du tronc du pal-
mier, l’invasion est difficile à détecter.
« Généralement, la présence du cha-
rançon n’est identifiée que quand le
stipe est déjà consommé de l’intérieur
et l’arbre impossible à soigner »
sou-
ligne Jean-François Silvain. Il incri-
mine le commerce de palmiers d’orne-
ment de favoriser la propagation de
l’insecte et rendre la traçabilité des
migrants difficile à établir. Que ce soit
en Égypte, où il est largement
implanté, ou au Moyen-Orient, l’arri-
vée de cet envahisseur n’impacte pas
que le commerce des plantes d’agré-
ment puisqu’il s’en prend au dattier,
une essence importante d’un point de
vue socio-économique. Décelé fin
2008 sur des palmiers ornementaux à
Tanger, au Maroc, Jean-François
Silvain estime que le charançon fait
courir un risque majeur aux palme-
raies du Maghreb.
Pour mieux évaluer les risques et
éventuellement trouver des parades à
ces envahisseurs, les chercheurs ten-
tent d’identifier le plus précisément
possible la population à l’origine de
l’invasion et son écosystème d’origine.
Des techniques utilisant des mar-
queurs moléculaires, ont permis de
montrer que la population de charan-
çons rouges présente en Arabie
Saoudite, en Égypte et sur la rive Nord
de la Méditerranée est génétiquement
différenciée des populations du
Moyen-Orient.
« Les insectes qui ont
colonisé ces deux zones géographiques
ne seraient probablement pas issus de
la même population source »
, explique
Jean-François Silvain supposant plu-
sieurs évènements d’introduction de
l’insecte. D’autres données sont en
cours d’analyse, et les premiers résul-
tats indiquent que les différentes popu-
lations présentes en Égypte et sur les
rives Nord de la Méditerranée (de la
Turquie à l’Espagne) ne sont pas dis-
cernables entre elles, ce qui devrait
rendre difficile l’identification de la
source de chacune d’entre elles.
●
Contact
UR
Biodiversité et évolution des com-
plexes plantes-insectes ravageurs-
antagonistes.
Quand les espèces invasives
s’invitent au Sud
Les insectes profitent
de la mondialisation
© IRD/JF.Silvain
Adulte du charançon rouge des palmiers Rhynchophorus ferrugineus, Égypte.
Le lac de retenue de Yaté, en Nouvelle Calédonie, où 19 spécimens de black-bass furent introduits en 1960.
Aujourd’hui répandus dans toute l’île, ces poissons sont probablement responsables de la disparition
d’une espèce endémique, le Galaxias neocaledonicus.
Black-bass.
© NJDEP - J. Abatamarco
© IRD/J. Bonvallot
qg

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009
8
etite mouche blanche
venue de la zone tropi-
cale,
Bemicia tabaci
a
récemment envahit tout
le Bassin méditerranéen. Cet
insecte encore appelé aleurode, est
un piqueur-suceur comme d’autres
ravageurs de l’ordre des hémi-
ptères tels que cochenilles, puce-
rons, psylles, punaises etc. Cette
espèce vorace est polyphage mais
apprécie particulièrement les
tomates. Outre les dégâts causés
directement aux cultures, l’aleu-
rode est vecteur de phytovirus très
virulents pour les cultures légu-
mières et ornementales sur tous les
continents. Ainsi son introduction
et son acclimatation ont favorisé
l’apparition, puis la dissémination
rapide de graves viroses sur les
cultures légumières. La tomate,
culture à forte valeur ajoutée, est la
plus fortement touchée, en particu-
lier par le
Tomato Yellow Leaf Curl
Virus
qui peut entrainer la perte
totale de récolte. Face à ce fléau,
un partenariat s’est développé
entre des chercheurs1du Centre de
biologie et de gestion des popula-
tions de Montpellier et une Jeune
équipe tunisienne (Bemigest) asso-
ciée à l’IRD pour s’attaquer à la
« Gestion du problème
Bemisia
Recherches
es invasions biologiques
d’espèces dites non indi-
gènes, ou exogènes, sont
désormais considérées
comme une des plus grandes menaces
pour la santé publique, écologique et
économique de la planète. Comme
souvent en biologie, la forme et la
taille des organismes les plus grands
donc les plus visibles conditionnent
les modes de pensée et les actions qui
en découlent. Les plus petits envahis-
seurs, que sont les microbes, les virus
et autres micro-organismes, occupent
pourtant une place essentielle, sinon
majeure, à l’heure d’envisager ces
processus.
Ainsi, certaines espèces invasives
véhiculent de nombreux agents res-
ponsables de maladies. Répertorié en
1953-54 en Afrique continentale, le
virus responsable du Chikungunya
s’est répandu en 2005-2006 à l’Île de
la Réunion en se servant du vecteur
Aedes albopictus
lui-même d’origine
extérieure à cette île. Parfois, des
oganismes vivants intentionnellement
importées pour l’agriculture, l’horti-
culture ou l’élevage de nouveaux
animaux de compagnie, ont pu
s’échapper vers des espaces naturels
déversant aussi des agents infectieux,
dont ils étaient les réservoirs, vers
des populations démunies de toute
résistance. L’histoire des introduc-
tions d’espèces en Amérique du Nord
regorge ainsi d’exemples démontrant
l’importance des parasites et autres
pathogènes invasifs dans la régu-
lation des faunes endémiques. La
colonisation de ce continent par les
Européens aura eu le même effet
sur l’extermination de populations
natives par les maladies qu’ils véhi-
culaient !
La mondialisation a engendré une
explosion des transports transconti-
nentaux, et cette mobilité accrue est
aussi vraie pour les animaux, les
plantes, et les nombreux passagers
clandestins dont ils peuvent être les
hôtes habituels. L’écologie des
maladies infectieuses se préoccupe
aujourd’hui de comprendre les consé-
quences des échanges planétaires de
biens et de personnes dans la ren-
es « ennemis » sont nom-
breux, sur terre comme
sur mer, végétal ou ani-
mal. En Nouvelle-Calé-
donie, ils se nomment cerfs rusa ou
cochons sauvages, tortues de Floride
ou encore merles des Moluques.
Mais les plantes ne sont pas en
reste, avec plus de 2 002 espèces de
plantes introduites sur cette île d’où
la mise en place d’une action sur les
espèces végétales exotiques enva-
hissantes, au laboratoire de bota-
nique et d’écologie végétale appli-
quées de l’IRD Nouméa.
« Avec 76 %
d’espèces végétales endémiques
,
rappelle Vanessa Hequet, en charge
de ce projet,
la Nouvelle-Calédonie
abrite une flore exceptionnelle,
aujourd’hui menacée par le dévelop-
pement de nombreuses espèces exo-
tiques envahissantes. »
C’est le cas de l’agave, qui
« fait par-
tie de nos jours du paysage calédo-
nien »
, alors qu’elle fut en réalité
introduite en 1866 comme plante à
fibres par Pancher, lors de l’exposi-
tion inter-coloniale de Melbourne.
Cette espèce, présente dans tous les
milieux dégradés sur terrains non
miniers, bloque la régénération
naturelle des autres plantes en for-
mant des tapis denses impéné-
trables. Elle colonise les terrains
ouverts et rocailleux de manière
agressive.
Autre exemple, le lantana, qui aurait
été importé d’Australie à Wagap
comme plante ornementale, puis
acclimaté à la mission de Saint-
Louis vers 1868. Cet arbuste épi-
neux peut atteindre une dizaine de
mètres de hauteur et reste malheu-
reusement apprécié pour ses fleurs
aux couleurs flamboyantes et
variées, allant du rouge au jaune.
« Et pourtant,
avertit Vanessa
Hequet,
le lantana est particulière-
ment envahissant dans les cultures
Les îles, ces écosystèmes fragiles
’outremer français avec
ses centaines d’îles
héberge une biodiversité
de première valeur mon-
diale. Mais ces milieux insulaires
présentent également une fragilité
écologique considérablement accrue
par rapport aux écosystèmes conti-
nentaux. Structures écologiques
incomplètes, comme par exemple,
l’absence de prédateurs pour cer-
taines espèces, tailles des popula-
tions et aires de distributions
réduites et faible connectivité biolo-
gique avec les écosystèmes voisins
en font des espaces particulièrement
vulnérables aux invasions biolo-
giques de toutes sortes.
Sciemment ou involontairement
introduites sur ces îles, de nom-
breuses espèces étrangères ont fait
souche et prospéré à l’excès, entraî-
nant de profonds bouleversements au
sein des écosystèmes et des popula-
tions d’origine peu « armés » face à
ces envahisseurs.
« Prédation sur les
espèces indigènes, dégradation du
couvert végétal, érosion des sols,
compétition pour l’espace et les res-
sources, transmission de parasites et
d’agents pathogènes, ou encore
modifications des interactions bio-
tiques, sont quelques-uns des effets
les plus délétères occasionnés par
ces espèces invasives »
, explique
Eric Vidal, spécialiste en biologie de
la conservation à Institut Méditer-
ranéen d’Écologie et de Paléo-
écologie. Sur les quatre derniers
siècles, les extinctions d’espèces ont
été soixante fois plus fréquentes au
sein des espaces d’outremer qu’en
métropole, et près de 1 000 taxons
terrestres présents sur les îles fran-
çaises d’outremer sont répertoriés
par la liste mondiale des espèces
menacées de l’
UICN
1. Pour Eric Vidal,
« la responsabilité de la France est
non seulement évidente mais incon-
tournable, ses îles concentrant une
part importante des espèces les plus
sérieusement menacées d’extinc-
tion »
. Ainsi, plus d’une quarantaine
d’espèces d’oiseaux, souvent endé-
miques, présentes sur les îles fran-
çaises d’outremer sont actuellement
considérées comme menacées d’ex-
tinction à court terme du fait de
l’impact exercé par des vertébrés
introduits.
« La situation qui prévaut en
Polynésie française où les taux d’en-
Histoire de nouvelles rencontres !
Haro
sur les tomates
Un enjeu pour
la biodiversité
calédonienne
contre de populations hôtes invasives
avec des agents pathogènes rési-
dents, ou d’agents pathogènes inva-
sifs avec des faunes ou des flores
endémiques.
Les invasions d’espèces sont aujour-
d’hui des phénomènes mondiaux,
mais elles apparaissent plus fré-
quemment dans les îles et les pénin-
sules conformément à deux théories
écologiques aujourd’hui anciennes.
La première théorie, dite insulaire,
décrite dans les années 60 par
MacArthur et Wilson indique, entre
autres, que de nombreuses niches
écologiques sont vacantes dans les
îles et les péninsules, et qu’une inva-
sion biologique, si elle réussit, pourra
bénéficier de cette absence. La
seconde, due à Elton au cours de la
décade précédente, précise que les
biomes riches en espèces sont moins
permissifs aux invasions biologiques ;
c’est peut être pour cette raison que
nous observons moins de succès
d’invasions dans les zones inter-
tropicales, mais cependant ce sont
aussi des régions pour lesquelles
nous possédons moins de données.
Comme dans l’exemple du Chikun-
gunya à la Réunion, assisterons-nous,
à l’avenir, à plus d’épidémies émer-
gentes dans les îles ? La théorie éco-
logique prédit que oui !
●
Contact
UMR
Génétique et Évolution des
Maladies Infectieuses
démisme atteignent des records est
des plus alarmantes »
, souligne Eric
Vidal, pour qui
« les situations d’ur-
gence liées aux espèces invasives foi-
sonnent »
. Il en appelle à
« intensifier
les actions de recherche et d’exper-
tise pour diagnostiquer ces situations
à risque, comprendre les méca-
nismes écologiques et démogra-
phiques en jeux et hiérarchiser les
priorités d’intervention »
. Ces inter-
Quand les espèces invas
Quand Felis silvestris catus, notre
chat domestique retourne à l’état
sauvage, il change non seulement
de nom pour s’appeler le chat
« haret », mais devient un préda-
teur dévastateur pour nombre d’es-
pèces indigènes. Une synthèse
mondiale à laquelle a participé l’IMEP
dresse un bilan complet des consé-
quences de son introduction sur les
risques d’extinction d’espèces indi-
gènes des îles de la planète. Notre
cher matou impacte plus de
150 espèces de vertébrés insulaires,
considérées comme sévèrement
menacées d’extinction globale. Sur
les 400 dernières années, le chat
haret serait impliqué dans l’ex-
tinction définitive d’au moins
32 espèces de vertébrés insulaires
endémiques, majoritairement des
oiseaux, notamment des passe-
reaux et des pétrels des îles du
Pacifique. ●
Espèce invasive : le chat !
ventions passent notamment par le
développement de programmes dits
de « biosécurité » pour détecter et
prévenir les invasions, ainsi que par
des opérations de restauration écolo-
gique et d’élimination ou de contrôle
des populations invasives. Elles sont
couplées à des actions complémen-
taires de conservation des espèces
menacées et associées à un suivi des
réactions de l’écosystème et des
populations cibles.
« L’établissement
de partenariats avec les acteurs
locaux de l’environnement est indis-
pensable pour garantir que les
recherches débouchent sur des
actions locales de préservation de la
biodiversité »
, souligne Eric Vidal. Le
chercheur insiste encore sur la
récente création du GOPS2, dont l’IRD
est un des partenaires, qui devrait
efficacement contribuer au dévelop-
pement des recherches consacrées
aux espèces invasives dans les îles
françaises du Pacifique Sud.
●
1. Liste rouge des espèces menacées, éditée
par l’Union Internationale pour la Conser-
vation de la Nature
2. Grand Observatoire de l’environnement
et de la biodiversité terrestre et marine du
Pacifique Sud
Contacts
UMR
Institut Méditerranéen d’Écolo-
gie et de Paléoécologie
en cultures légumières ». Sans
remettre en cause fondamentale-
ment l’utilisation des insecticides,
il s’agit de limiter l’impact de rava-
geur-vecteur sur la production de
tomates dans un contexte de viabi-
lité économique et de durabilité des
pratiques agricoles, conformément
aux exigences nouvelles de qualité
et de respect de l’environnement.
Concrètement, les recherches2sont
centrées sur la dynamique spatio-
temporelle des interactions
Bemisia
-
biodéfenseurs, la structuration
génétique (cette espèce possède
une grande diversité génétique) et
la biodémographie des populations
de
Bemisia
et des auxiliaires de
lutte, l’épidémiologie du couple
Bemisia-Tomato Yellow Leaf Curl
Virus
et enfin sur l’élaboration et
l’optimisation des stratégies de
protection biologique intégrée.
●
1. Génétique des populations, dynamique
des populations, épidémiologie.
2. Financées par un projet ANR intitulé
Bemisiarisk (2007-2009) et un financement
État-Région intitulé Climbiorisk (2008-
2010)
Contact
Olivier Bonato, UMR
Centre de biolo-
gie et de gestion des populations
,
olivier[email protected]
L'aleurode est une petite mouche
blanche de quelques millimètres
de long.
Todiramphus Gambieri en danger
critique d’extinction sur la liste
rouge de l’UICN. Il ne survit plus
qu’à Niau ayant disparu des
Gambier. Ses effectifs s’élèvent à
120 individus.
Agave.
Les biomes riches en espèces apparaissent moins
permissifs aux invasions biologiques par d’autres
espèces, mais aussi à celles d’agents pathogènes.
© SOP Manu - Anne Gouni
© IRD/O. Bonato
© IRD/ J. Orempuller
qg

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009
l’heure où la déforesta-
tion menace l’équilibre
global, des arbres peu-
vent se montrer extrê-
mement envahissants !
« Plusieurs
espèces ligneuses, endémiques ou
allochtones, arrivent à coloniser les
pâturages de façon incontrôlée »
,
explique Séraphine Grellier, éco-
hydrologiste1. Le phénomène est lié
au sylvopastoralisme, un mode
ancestral d’exploitation du milieu qui
tend à se répandre depuis une ving-
taine d’années. Cette pratique, asso-
ciant des arbres à un pâturage, pré-
sente bien des avantages lorsqu’elle
est choisie et contrôlée. Elle permet
d’accroître la productivité et la bio-
diversité, de maintenir le patrimoine
« sol », et de restreindre l’usage
d’engrais ; éléments favorables au
développement durable.
« Mais la
présence d’arbres dans le pâturage
peut ne pas être volontaire, et dans
ce cas, le moindre déséquilibre dans
la gestion agropastorale peut se tra-
duire par la prolifération d’une ou
plusieurs espèces de ligneux »
. Les
zones où la pression pastorale s’in-
tensifie – quand le nombre de bêtes
à l’hectare augmente par réduction
de la surface disponible – et où la
gestion des terres devient difficile,
sont particulièrement exposées. Ce
sont bien souvent les populations les
plus pauvres qui voient ainsi leurs
ressources compromises. Citant
l’exemple de la région sud-africaine
du Kwazulu-Natal, Jean-Louis
Janeau, pédologue1, explique com-
ment l’invasion par l’acacia modifie
la ressource en sol, herbe et eau et
met donc en péril la principale acti-
vité des Zoulous, à savoir l’élevage.
« Là où quarante ans auparavant on
ne voyait qu’herbe, les pâturages
Des arbres très envahissants
doivent être maintenus, car
« les
graines sont viables plus de dix ans
»
, souligne Vanessa Hequet, qui rap-
pelle que le miconia a ainsi couvert
«
60 % de la surface de Tahiti»
.
Une synthèse actualisée des espèces
végétales introduites en Nouvelle-
Calédonie ayant pour base la mise à
jour du catalogue des plantes intro-
duites de MacKee est en cours, ainsi
que la cartographie de ces espèces,
selon un maillage de 5 km pour les
sites côtiers fréquentés et acces-
sibles, de 10 km pour les sites de
l’intérieur de la chaîne. Un long tra-
vail de fourmi, car la reconnaissance
des espèces de plantes envahis-
santes et l’estimation de leur cou-
verture d’infestation exigent d’avoir
un œil exercé et sûr. Il est ainsi
important que ce soit « le même
observateur » qui se charge d’esti-
mer la densité d’infestation d’une
zone, pour éviter trop de variabilité
inter-opérateurs. Ces travaux visent
également à constituer à terme un
service opérationnel de veille et de
lutte permanente, pour détecter le
plus tôt possible tout nouveau cas
d’invasion biologique. Un groupe de
lutte contre les espèces exotiques
envahissantes a d’ores-et-déjà été
créé pour mettre en place une cam-
pagne de sensibilisation à cette thé-
matique.
●
Contacts
et les pâturages sur sols riches, où il
réduit la valeur agricole des terres »
.
En Australie, les services environne-
mentaux en sont venus à tester une
quarantaine d’agents biologiques
pour contrer ce fléau végétal, parmi
lesquels des hémyptères (famille des
cigalles, cochenilles et punaises).
Face à ces pestes invasives, les
mesures de restauration des milieux
s’affinent. La préservation d’une
forêt en Province Sud, menacée par
le miconia, a été entreprise récem-
ment par des actions médiatisées de
désinfestation par coupe ou empoi-
sonnement des plants. Cependant,
ces efforts de surveillance et de lutte
Recherches
ne souche asiatique de
trypanosome a été re-
trouvée dans des rats
collectés au Niger dans
des villages pourtant isolés.
Comment est-elle arrivée là ? Le rat
noir,
Rattus rattus
, originaire d’Asie,
s’est propagé à travers le monde
avec l’Homme, suivant ses migra-
tions, probablement transporté par
ses navires et ses camions. Bien que
le rongeur ait atteint tous les conti-
nents à l’exception des pôles, l’his-
toire de cette colonisation – en par-
ticulier l’invasion de l’Afrique –
reste mal connue.
Pourtant, le rat noir est susceptible
de voyager avec des hôtes peu dési-
rables puisqu’il est le réservoir de
nombreux pathogènes humains
comme les agents de la peste, des
différents typhus, de la leptospirose,
etc. Dans le cadre de travaux de
prospection sur la diversité des
faunes de rongeurs au Niger, des
Le rat,
la pirogue
et le trypanosome
sont aujourd’hui transformés en
savane de plus en plus arborée »
,
déplore-t-il.
L’enjeu des recherches sur le sylvo-
pastoralisme est de trouver des solu-
tions de gestion de l’environnement
permettant de préserver cette res-
9
© IRD/G. Dobigny
vasives s’invitent au Sud
Insectes ravageurs en Équateur
mportées d’Amérique
centrale et du Pérou il y a
30 ans, les teignes de la
pomme de terre ont colo-
nisé tout l’Équateur en seulement
quelques années. Ces petits papillons
gris, dont les larves se nourrissent de
la chair de leur hôte jusqu’à le trans-
former en amas de poussière, sévis-
sent tout au long de l’année. En effet,
les pommes de terre, au 5erang des
productions vivrières du pays, sont
cultivées en permanence du fait de la
faible saisonnalité. Transformés en
une mosaïque de champs de tuber-
cules à différents stades de matura-
tion, les paysages agraires de la
sierra constituent ainsi un terrain
particulièrement propice à la prolifé-
ration des ravageurs.
Aujourd’hui, trois espèces coexistent.
Et d’autres risquent d’envahir à leur
tour l’Équateur. Mais comment expli-
quer cette invasion biologique ?
Situés entre 2 200 et 3 700 m d’alti-
tude, les champs équatoriens offrent
une multiplicité d’habitats et de
microclimats.
« La faible compétition
entre les espèces permet à celles déjà
présentes de proliférer, mais aussi à
d’autres invasifs de s’implanter sur
ces territoires »
, explique Olivier
Dangles, chercheur à l’IRD et co-
auteur de l’étude1. De fait, l’équipe de
chercheurs2vient de montrer que
chacune des trois espèces de teignes
possède une tolérance spécifique au
froid et se répartit ainsi le long des
flancs montagneux en fonction de l’al-
titude.
« Avec le relief pentu, le fort
gradient de températures augmente
la ségrégation spatiale des espèces le
long de l’axe vertical »
, renchérit
l’écologue. Chacune occupe alors un
espace qui lui est propre.
Étroitement lié à la température, le
risque d’invasion évoluera probable-
ment avec les rapides changements
climatiques annoncés dans les
Andes. Dans ce contexte, le pro-
gramme international
Innovación
para el Manejo Integrado de Plagas
3,
mené par l’IRD, permettra de prévoir
la répartition géographique des
teignes, pour une meilleure gestion
de la menace liée à ces ravageurs.
À plus court terme, l’intense com-
merce de la pomme de terre dans la
région nord andine, en constante
augmentation, favorise le développe-
ment des envahisseurs.
« En l’ab-
sence de réelles mesures préven-
tives, comme c’est le cas en
Équateur, ces échanges commer-
ciaux constituent une source poten-
tielle de nouvelles espèces de rava-
geurs »
, s’inquiète le chercheur.
●
1. Dangles et al. (2008)
Ecological Appli-
cations
.
2. Ces travaux ont été réalisés par des cher-
cheurs de l’IRD et de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador (PUCE).
3. Ce programme, coordonné par l’IRD en
collaboration avec des partenaires équato-
riens, péruviens et boliviens, sera mis en
place à l’automne 2009.
Contact
olivier[email protected]
source, en tenant compte des
besoins et des traditions des popula-
tions concernées. Les pratiques cul-
turales, comme l’écobuage – les feux
de brousses –, et la pression du
bétail semblent en effet jouer un rôle
prépondérant dans le processus qui
conduit à l’invasion des pâturages
par les ligneux.
« Mais nous connais-
sons encore peu les conséquences
du sylvopastoralisme sur l’écologie
et l’hydrologie des pâturages »
,
constate nos scientifiques. Les
arbres, qui ont un accès à l’eau par-
ticulier grâce à leurs racines pro-
fondes, pourraient ainsi modifier les
bilans hydriques à l’échelle du bas-
sin versant. Ils ont aussi un impact
sur les propriétés du sol, en l’enri-
chissant en azote et en limitant l’éro-
sion hydrique. Le rôle précis des
arbres qui font partie de cet écosys-
tème à l’équilibre précaire, reste à
élucider.
●
1. IRD, Unité
Sols, usages des terres, dégra-
dation, réhabilitation
et UMR 7618
Biogéochimie et écologie des milieux conti-
nentaux
.
Contacts
chercheurs du Centre de Biologie et
de Gestion des Populations (CBGP)
ont piégé des rats noirs dans des vil-
lages du sud-ouest du pays, le long
du fleuve Niger où cette espèce
n’avait jamais été repérée. Compte
tenu du fait que le rat noir est stric-
tement commensal (inféodé aux ins-
tallations humaines) dans ces
régions et que ces villages sont mal
desservis par les routes, les scienti-
fiques soupçonnent que le trafic
piroguier joue un rôle important
dans la dissémination de ces
R. rattus
. Venue en renfort, une
équipe du CHU de Créteil* a analysé
les organes de ces rats et mis en
évidence la présence de trypano-
somes – agents pathogènes respon-
sables entre autres de la maladie du
sommeil – chez deux tiers des ani-
maux étudiés. L’identification spéci-
fique de ces protozoaires restant
très délicate, des analyses phylogé-
nétiques plus poussées ont montré
que les rats noirs du sud Niger sont
porteurs de
Trypanosoma lewisi
,
une souche connue pour être
typique des Rattus asiatiques. Plus
inquiétant, les séquences ADN des
souches nigériennes étaient iden-
tiques à celles des trypanosomes
isolés chez un patient sénégalais
décédé en 2008 suite à une infection
par
T. lewisi
. Autrement dit, ces
données, en cours de publication,
démontrent l’importation et la dissé-
mination en Afrique de l’Ouest de
trypanosomes exotiques et patho-
gènes pour l’homme
via
l’invasion
des rats noirs, elle-même stricte-
ment associée aux activités
humaines. Poussé par ces premiers
résultats, les chercheurs du CBGP et
plusieurs de leurs collaborateurs
ont décidé d’étendre leurs prospec-
tions à une gamme plus large de
pathogènes humains circulant
potentiellement sur les rongeurs
africains comme sur le rat noir.
●
* CHU Créteil, Faculté de Médecine,
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie
.
Contact
Gauthier[email protected]
UMR
Centre de Biologie et de Gestion
des Populations.
Dissection d’un rat noir
sur le terrain.
Femmes Zouloues ramassant du bois dans des pâturages.
Larve de
T. Solanivora.
© IRD /J-L Janeau
© IRD/V. Hequet
© IRD/O. Dangles
qg

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009
10
paux pays producteurs de cette
importante plante vivrière en
Afrique de l’ouest, Océanie, Asie,
Caraïbes et Amérique. Financé par
la fondation Bill et Melinda Gates, il
est réalisé en collaboration.
L’efficacité de différentes techniques
de cryoconservation est en cours de
comparaison au Centre IRD de
Montpellier pour la congélation de
bourgeons prélevés sur des plants
d’ignames maintenus en culture
in
vitro
. À l’état congelé, les processus
biologiques sont arrêtés, ce qui per-
met de conserver le matériel végétal
sans altération pour des périodes
théoriquement infinies. Une fois la
technique optimisée, elle sera trans-
férée à l’Institut international d’agri-
culture tropicale où, avant son appli-
cation à grande échelle, elle sera
testée sur une gamme de variétés
représentative de la diversité géné-
tique présente dans la collection.
Cette recherche sera prolongée dans
le cadre du projet Arcad (Agropolis
resource center for crop conserva-
tion, adaptation and diversity).
●
1.organisme dont la mission est de garan-
tir la conservation et la disponibilité de la
diversité des cultures pour la sécurité ali-
mentaire mondiale
2.sur financement de la fondation Bill et
Melinda Gates
3. palmier à huile, cocotier, palmier dat-
tier, manioc, igname, canne à sucre,
hévéa, agrumes, cotonnier
Contact
Comment conserver l’igname à long
terme ?
« Dans l’azote liquide à
– 196° C
, répond Florent Engelmann
chercheur à l’unité
Diversité et
adaptation des plantes cultivées.
L’igname est une espèce à reproduc-
tion asexuée, d’où l’impossibilité de
compter sur des banques de graines.
La cryoconservation est aujourd’hui
la seule option sûre et économique »
.
Cette technologie est au cœur d’un
programme de recherche mené par
l’IRD, en collaboration avec l’Institut
international d’agriculture tropicale
(Nigéria) qui est responsable de la
collection mondiale des ressources
génétiques d’ignames, à la demande
du Global Crop Diversity Trust
(Italie)1-2. Ayant développé des tech-
niques de congélation pour de nom-
breuses espèces tropicales3depuis
plus de 20 ans, l’IRD est aujourd’hui
l’un des leaders mondiaux dans ce
domaine. Le projet de cryoconserva-
tion de l’igname intéresse les princi-
Entre sauvage et cultivé,
les ignames
La réputation de Madagascar en
matière de biodiversité n’est plus à
faire. À l’image de celle des caféiers,
des baobabs ou des palmiers, la
richesse taxonomique des ignames
sauvages malgaches se révèle excep-
tionnelle, avec environ 10 % des
espèces du genre Dioscorea qui en
compte plus de 400.
« Or, les diffé-
rentes populations, arrivées tardive-
ment sur l’île avec le riz, le taro et
l’igname cultivée Dioscorea alata,
n’ont pas domestiqué les espèces
locales d’ignames, rapporte Serge
Tostain, chercheur à l’
IRD
. Pourtant
celles-ci sont toutes comestibles et
adaptées à la variété des niches écolo-
giques de la grande Ile »
. L’une des
explications vient sans doute du fait
que non seulement leur cueillette n’est
pas considérée comme une activité
noble, mais leur mise en culture elle-
même fait l’objet de tabous. En effet, si
l’exploitation des produits forestiers
non-ligneux est une activité saison-
nière ancestrale à Madagascar pen-
dant les périodes de soudure ou de
disette, ce sont principalement les
paysans pauvres qui collectent les
ignames sauvages. Les enquêtes
ethnobotaniques pratiquées de 2006 à
2009 dans le cadre du programme
« Oviala1» (littéralement tubercule
trouvé en forêt) ont permis de recen-
ser ces pratiques et d’inventorier les
espèces présentes dans le sud-ouest
malgache. L’inventaire a révélé une
vingtaine d’espèces endémiques, la
plupart endémiques. Certaines sont
encore mal décrites voire inconnues et
leurs aires de répartition approxima-
tives. Madagascar s’est séparé du
continent africain voilà des millions
d’années et malgré la proximité de la
côte ouest, cet éloignement suffit à
produire une divergence – appelée
spéciation – entre les espèces. À l’in-
térieur de l’île, ce même processus est
à l’œuvre lorsque des individus de
forêt se retrouvent séparés par des
zones de savane, l’isolement géogra-
phique entraîne une isolation géné-
tique. Les chercheurs ont fait appel à
des marqueurs nucléaires et cytoplas-
miques afin de démêler les parentés
entre les ignames locales. Les résul-
tats, obtenus au centre IRD de
Montpellier en collaboration avec le
Centre National de Recherche Appli-
quée au Développement Rural de
Madagascar, montrent une structure
génétique comportant plusieurs
groupes d’espèces, ce qui indique sans
doute qu’à la séparation d’avec
l’Afrique, plusieurs espèces se sont
retrouvées piégées sur l’île. Des ambi-
guïtés de détermination dues aux
noms vernaculaires ont pu être levées.
Par exemple les ignames appelées
Oviala dans le sud sont en fait deux
espèces différentes
Dioscorea maciba
et
D. alatipes
. Au contraire, des
Recherches
Environ 300 millions de personnes dépendent de la culture de l’igname
pour leur alimentation ou leurs revenus. Quelles adaptabilités au changement
climatique, quels moyens de conservation de cette plante à tubercules
dont Madagascar recèle une grande richesse de variétés ?
Des ignames dans l’azote Diversité
des ignames
malgaches
Plasticité ou sexualité ?
Après chaque récolte d’igname, les
paysans conservent des fragments
de tubercules à replanter dans leurs
champs. Cette technique agricole
n’est cependant possible qu’en rai-
son de la propriété de l’igname à se
reproduire par voie asexuée. Seul
hic, la reproduction sexuée – bras-
sage des patrimoines génétiques –
est considérée comme un des
moteurs de l’adaptation des orga-
nismes vivants. Comment ce type de
plante pourra-t-il alors s’adapter à
des changements importants comme
ceux liés au climat ? En prenant
comme modèle l’igname pour
répondre à cette question, Nora
Scarcelli a tout d’abord démontré
que la reproduction sexuée n’est pas
complètement absente chez cette
plante. Ainsi, les agriculteurs béni-
nois introduisent-ils de temps en
temps dans leurs champs des
ignames sauvages qui sont, elles,
issues de graines. Le recours à la
simulation informatique devrait per-
mettre d’en savoir plus. Cette
approche offre la possibilité de
quantifier l’impact de la reproduc-
tion sexuée sur la diversité et les
capacités adaptatives des ignames.
À la clef, de précieuses informations
sur la proportion entre ignames sau-
vages et cultivées à utiliser pour
obtenir les meilleures chances
d’adaptation, ou encore sur le
rythme optimal de renouvellement
du stock génétique.
Si les observations empiriques pay-
sannes suggèrent une « transforma-
tion » des ignames sauvages en
ignames cultivées une fois dans
leurs champs, faut-il encore le
démontrer scientifiquement…
«il
Parmi les espèces sauvages, ce sont
surtout les tubercules de l’espèce
D. maciba qui sont collectés puis ven-
dus sur les grands marchés hebdoma-
daires à la fin de la saison des pluies.
Cette activité entraîne aujourd’hui
une surexploitation de ces végétaux.
L’accroissement démographique et
le développement du commerce des
produits forestiers non-ligneux
pèsent sur la ressource : la question
de leur conservation et de la gestion
Tubercules de survie
durable des populations d’ignames
commence à se poser. Certaines pra-
tiques, comme le déterrage des
tubercules avant la fructification de
la plante menacent la survie de
certaines espèces. La culture d’es-
pèces domestiquées, la conservation
in situ en fôret et en lisière de fôret
ainsi que des essais de domestica-
tion pourraient diminuer la forte
pression anthropique sur les espèces
sauvages. ●
ignames nommées différemment à
l’est et au nord se révèlent génétique-
ment semblables. Cet imbroglio phylo-
génétique s’éclaircira lorsque l’étude
sera étendue à l’ensemble du pays et à
l’aide de nouveaux marqueurs géné-
tiques en cours de caractérisation. Les
chercheurs sont également très inté-
ressés par la comparaison du proces-
sus de spéciation des ignames avec
celui des caféiers à Madagascar et des
palmiers d’Amazonie. En effet, si ces
groupes végétaux ont en commun de
comporter de très nombreuses
espèces en un même lieu, les méca-
nismes qui en sont responsables
peuvent différer.
« Signe de synergie
entre scientifiques,
ONG
, décideurs
publics et bailleurs de fonds, le
Groupe d’étude et de valorisation des
ignames de Madagascar vient d’être
créé lors du colloque2organisé à
Toliara »
se félicite Serge Tostain.
●
1. En partenariat avec l’Université de
Toliara
2. Colloque « Les ignames malgaches, valo-
risation et conservation » (Toliara, Mada-
gascar ; 29-31 juillet 2009). Organisé
conjointement par l’Université de Toliara,
l’Université d’Antananarivo, le projet Crop
Wild Relatives/FOFIFA, et l’IRD avec l’appui
financier de l’IRD, de l’AUF et du
CWR/GEF/FOFIFA ;
http://www.mpl.ird.fr/ignames-madagascar/
Contact
nous reste à retracer le processus
qui conduit de l’une à l’autre et l’on
pourra alors parler de plasticité
morphologique »
, explique Nora
Scarcelli. Pour l’heure, le constat
révèle que les plants sauvages et
cultivés présentent des caractéris-
tiques morphologiques différentes.
« Les tubercules sauvages sont
ramifiés tandis qu’ils sont uniques
chez les ignames en champ ou
encore que la couronne de racines
épineuses protectrice n’existe plus
sur les ignames cultivées. »
En somme, tester si ces tubercules
sauvages sont réellement cultivables
et mesurer en quelles proportions les
deux mécanismes – sexualité et plas-
ticité – participent à l’adaptabilité
des ignames cultivées constituent
des enjeux forts de cette recherche.
À terme, les résultats auront des
implications sur la définition de stra-
tégies de conservation et d’utilisation
de la diversité de ces végétaux1.
●
1. atelier international sur l’agrobiodiver-
sité des ignames qui sera co-organisé par
l’IRD et le Cirad en novembre 2009 à
Montpellier.
Contact
© IRD/ A.Rival
© IRD/N.Scarcelli
© IRD/S. Tostain
© IRD/S.Tostain
Bourgeons d'ignames encapsulés après
cryoconservation dans l'azote liquide.
qg
1
/
4
100%