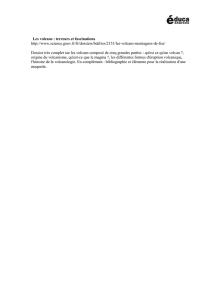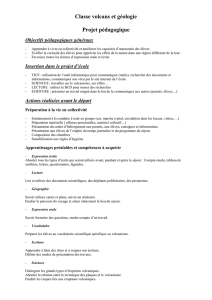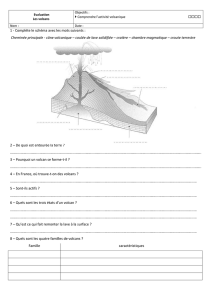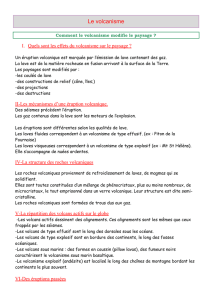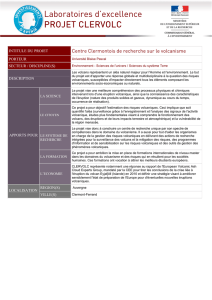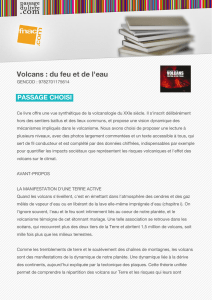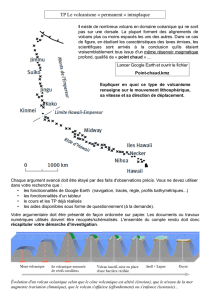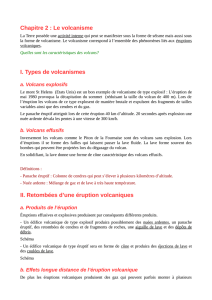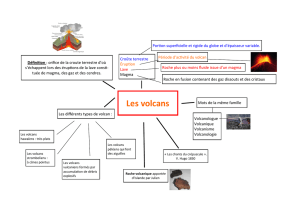Extrait du chapitre 12 "Les volcans extraterrestres" 12 pages (7.8Mo)

volcanologie
physique
volcanologie
physique
Michel Detay
Michel Detay Traité de
volcanologie physique
978-2-7430-2258-7
-:HSMHOD=UWWZ]\:
editions.lavoisier.fr
Traité de
Les volcans sont terre de paradoxes. Manifestation quasiment
négligeable de l’activité terrestre d’un point de vue thermo-
dynamique, ils n’en représentent pas moins un des phénomènes
naturels les plus fascinants, pouvant être tour à tour majestueux,
silencieux, instables, meurtriers, pourvoyeurs de terrains fertiles ou
perturbateurs du climat mondial. De tels objets naturels ne peuvent
être cernés que par une approche scientique multidisciplinaire
qui combine physique, chimie et géologie de terrain.
Traité de volcanologie physique propose une synthèse actualisée,
recadrant l’objet géologique « volcan » dans son contexte géo-
dynamique, mais aussi dans les problématiques contemporaines en
fournissant des éléments de quantication techniques, nanciers (ou
économiques) et sociétaux. Sont tour à tour abordées des probléma-
tiques volcanologiques essentielles telles que la plomberie mag-
matique, l’impact du volcanisme sur le climat, l’hydrovolcanologie,
les phénomènes para-volcaniques, la notion de risque volcanique
ainsi que le volcanisme paroxysmal, responsable des extinctions de
masse à l’origine de nombreuses ères géologiques, et le volcanisme
extraterrestre.
C’est un corpus de connaissances complet, richement illustré, que
propose Michel Detay aux étudiants en STU et SVT ainsi qu’aux can-
didats au CAPES et à l’Agrégation de SVT. Il apporte également un
éclairage scientique et technique aux enseignants de SVT et plus
généralement à tout public intéressé par un aspect particulier du
volcanisme, ou par le sujet dans sa globalité.
Michel Detay présente la double compétence d’être à la fois un universitaire
(géologue, docteur d’État) et un industriel (au sein du secteur privé - tant en France
qu’à l’international), ce qui lui permet une mise en perspective novatrice et pratique
de la volcanologie physique.
2258-Detay.indd Toutes les pages 09/01/2017 10:18

IMAGE DE IO, MONTRANT DEUX PANACHES : 140 km de hauteur au-dessus de Prometheus (en haut) et la seconde
dans la caldeira de Pillan Patera (au centre). Image mosaïque recomposée à partir d’une image prise par Galileo
le 17 novembre 1997 et d’images mosaiques provenant de plusieurs survols. © NASA/JPL/University of Arizona.

«Ce qui est admirable, ce n’est pas
que le champ des étoiles soit si vaste,
c’est que l’Homme l’ait mesuré.»
Anatole France, Le jardin d’Épicure, 1894.
LES VOLCANS
EXTRATERRESTRES
12

402
TRAITÉ DE VOLCANOLOGIE PHYSIQUE
Depuis la fi n du XXe siècle, l’exploration du Sys-
tème solaire nous a révélé que la Terre n’était pas
la seule planète possédant une activité volcanique.
L’objet volcan est ainsi passé d’un cadre local ter-
restre, à un phénomène général dans le Système
solaire. La volcanologie a largement profi té de ce
changement d’échelle. Ce phénomène est incom-
parablement plus riche qu’on ne le soupçonnait il y
a seulement quelques années. La volcanologie phy-
sique peut ainsi élargir son champ d’action.
L’activité volcanique et sa répartition témoignent
de l’évolution thermique des planètes (dynamique
interne). L’évolution thermique d’une planète, et par
conséquent le volcanisme, dépendent notamment
de sa capacité calorifi que totale et est fonction de la
taille du corps. Par exemple, vers 3Ga, les tempéra-
tures internes de la Lune ou de Mercure sont descen-
dues sous une température critique ne perme ant
plus la formation de liquide par fusion de l’intérieur
du corps. En revanche, les températures internes de
la Terre ou de Vénus sont encore très supérieures à
ce e température critique.
Comme nous l’avons vu, la plupart des roches
volcaniques terrestres trouvent leur origine dans le
manteau, plus rarement dans la fusion de la croûte.
La majorité des magmas terrestres est formée par
décompression adiabatique des roches, alors que
leur température décroît. Ce mécanisme est aus-
si probablement dominant sur d’autres planètes,
comme Vénus ou Mars. La fusion peut aussi se pro-
duire par changement de composition. L’eau, même
en très faible quantité, abaisse drastiquement la
température du solidus et joue un rôle majeur no-
tamment dans la production magmatique des zones
de subduction terrestres. La fusion par élévation de
température est le mécanisme le moins important,
quantitativement, en géologie terrestre, mais il peut
être conséquent pour d’autres objets volcaniques du
Système solaire comme Io, satellite de Jupiter, qui est
sujet à un volcanisme gravitationnel.
Vénus connaît un intense volcanisme avec plus
d’un million de volcans, Mars héberge l’Olympus
Mons, haut de 22,5 kilomètres, plus haut sommet du
Système solaire, la Lune est couverte par d’immenses
champs de basalte qui forment les mers lunaires.
Des édifi ces volcaniques ont été identifi és sur des
satellites de Jupiter et de Neptune, notamment Io et
Triton (cryovolcanisme), et les «geysers» d’Encelade,
satellite de Saturne.
1. LA LUNE
La Lune est l’unique satellite naturel de la Terre et
le cinquième plus grand satellite du Système solaire
avec un diamètre de 3474km. La distance moyenne
séparant la Terre de la Lune est de 385000km, c’est-à-
dire environ trente fois le diamètre terrestre.
À l’exception de Mercure et Vénus, toutes les pla-
nètes du Système solaire possèdent des satellites na-
turels qualifi és de lunes. Jupiter et Saturne, de leur
côté, en possèdent respectivement 63 et 60 de tailles
et de formes très variées. Dans les années 1970, on
connaissait 32 lunes dans le Système solaire, on en
distingue aujourd’hui plus de 140.
La Lune est composée de parties sombres (mers)
entourées de terrains plus clairs (terres ou continents).
Les terres criblées de cratères d’impact sont consti-
tuées d’anorthosites et de roches appelées KREEP parce
Figure 12.1. Plateau volcanique d’Aristarque (40 km
de diamètre), où l’on reconnaît de nombreuses formes
volcaniques (volcans, coulées de lave, tunnels de lave,
dépôts pyroclastiques...). © NASA (image by Lunar
Reconnaissance Orbiter) – JMARS.

CHAPITRE 12 | LES VOLCANS EXTRATERRESTRES
403
que riches en potassium (K), en terres rares (REE) et
en phosphore (P). Les mers lunaires sont constituées
d’épanchements basaltiques. Par rapport aux basaltes
terrestres, ils sont plus riches en fer et avaient une
viscosité plus faible. La majorité des éruptions basal-
tiques ont eu lieu entre 3,8 et 3,5Ga. Il semble cepen-
dant que certaines coulées pourraient être beaucoup
plus récentes (1Ga). Concomitamment à la mise en
place des basaltes, des éruptions siliciques ont éjecté
des matériaux pyroclastiques à des centaines de kilo-
mètres de distance du cratère d’origine, compliquant
ainsi la stratigraphie lunaire au-delà des phénomènes
d’impactisme qui n’ont cessé de la complexifi er.
Dans les deux cas, il s’agit de roches diff érenciées
qui ont environ 4,4Ga. Les mers, constituées de ba-
saltes plus jeunes (moins d’impacts météoritiques)
sont datées de 4 à 3,2Ga. Chimiquement, la Lune est
appauvrie en éléments volatils et est extrêmement
réduite. C’est un astre mort dont les dernières érup-
tions volcaniques sont vieilles de 3,2Ga.
1.1. Formation de la Lune
L’origine de la Lune est restée longtemps un sujet
de débat. Plusieurs hypothèses étaient classiquement
évoquées: la capture d’un astéroïde; la fi ssion d’une
partie de la terre par l’énergie centrifuge voire encore
la co-accrétion de la matière originelle du Système
solaire. Aujourd’hui, la communauté scientifi que s’ac-
corde à penser que l’origine de la Lune est la consé-
quence d’un impact structurant sur la proto-Terre par
un planétoïde de la taille de Mars (6500km de dia-
mètre) appelé Théia. Cet événement a éjecté un grand
nombre de débris de l’impacteur ainsi qu’une portion
du manteau terrestre dans l’espace.
Des simulations informatiques laissent entendre
que seulement une dizaine de pour cent de la masse
originelle de l’impacteur aurait produit un anneau de
débris en orbite. 90% de la masse de la Lune provien-
drait donc du manteau terrestre. Ces débris se seraient
accrétés en quelques dizaines d’années (voire une
centaine d’années au plus) pour donner naissance à
la Lune. Initialement, la distance Terre-Lune était plus
faible. La Lune s’est progressivement éloignée pour se
situer aujourd’hui à 385000km en moyenne.
Lors des six missions Apollo (1969-1972), 382kg de
matériaux lunaires ont été rapportés et leur analyse
a permis de confi rmer le caractère cogénétique des
deux planètes.
1.2. Une géochronologie lunaire basée
sur l’étude des cratères d’impact
L’étude des cratères lunaires met en évidence
que les impacts météoritiques furent intenses pen-
dant les premiers 500Ma de création de la Lune. La
chronologie comparée de la cratérisation lunaire,
couplée à la datation des roches ramenées des six vi-
sites par les missions Apollo, perme ent de se faire
une première idée de l’histoire géologique de la
Lune. Ce e étude a notamment mis en évidence une
phase de «grand bombardement tardif» (Late Heavy
Bombardment – LHB). Le LHB, tel que théorisé et mo-
délisé, semble aff ecter de manière globale toutes les
planètes du Système solaire. Sa durée estimée est de
50 à 150Ma, centrées sur 3,9Ga. Le taux de bombar-
dement est estimé à 20000 fois celui actuellement
observé sur Terre, ce qui correspond par exemple à
un impact d’un objet de plus de 1km tous les 20 ans
(sachant qu’un tel impact provoquerait aujourd’hui
sur Terre une extinction massive).
nDes tunnels de lave sur la Lune et Mars
Avant de pouvoir se rendre physiquement sur
la Lune, ou à l’aide d’engins spatiaux sur Mars, l’ob-
servation par télescope était le seul moyen d’appré-
hender la géologie extraterrestre. L’observation de
tunnels de lave eff ondrés sur la Lune a permis as-
sez tôt de comprendre que ces objets géologiques
étaient formés de nombreux champs de lave. Les
conditions de gravité de la Lune ont permis la
mise en place de tunnels de tailles plus impor-
tantes que sur Terre (Fig.12.1). Ils font, en général,
plusieurs centaines de mètres de large et plusieurs
centaines de mètres de profondeur et des dizaines
de kilomètres de longueur. Pendant les premières
phases de l’exploration spatiale, ces cavités ont été
considérées comme sites potentiels d’installation
de bases humaines pour les astronautes... ramenés
ainsi à l’âge des cavernes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%