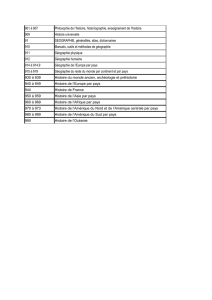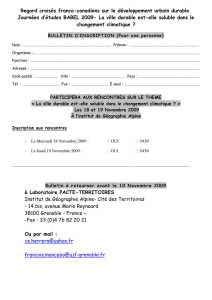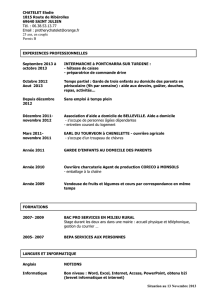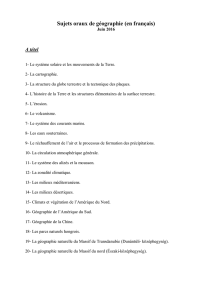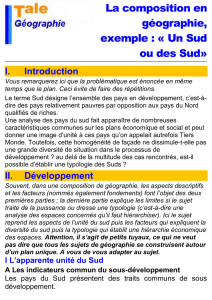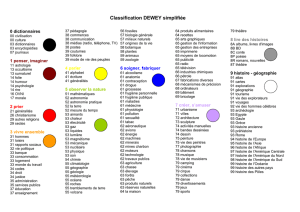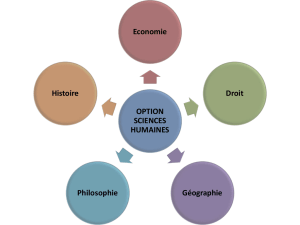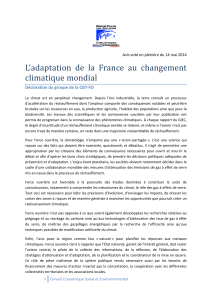Book chapter - Archive ouverte UNIGE

Book Chapter
Reference
L'environnement comme stratégie syndicale internationale : réflexions
sur la ‘géographie ouvrière' à partir du changement climatique
FELLI, Romain, RAMUZ, Raphaël
Abstract
Après des décennies durant lesquelles la chape de plomb de la pensée néolibérale a étouffé
la pensée critique, il semble que les théories alternatives (et critiques) fassent leur retour,
certes timide, dans le monde académique. Stimulées par les diverses contestations de l'ordre
établi, la littérature en sciences sociales, notamment en géographie, compte toujours plus de
recherches et de réflexions sur les alternatives politiques. Discuter de projets de transition,
notamment dans le cadre de la crise écologique (e.g.: vers une société post-carbone)
(re)devient possible. La contrepartie de ces contributions multiples est l'éclatement inévitable
des cadres d'analyse, ce qui introduit beaucoup de confusion. Pourtant, la poursuite d'un
projet politique qui inclut des dimensions analytiques et donc des pratiques scientifiques
suppose la clarification des concepts et des théories qu'il recouvre. Cet article découle d'une
recherche en cours sur les stratégies syndicales en matière de changement climatique.
Néanmoins, nous profitons de celle-ci pour traiter de problèmes conceptuels plus
fondamentaux. Le [...]
FELLI, Romain, RAMUZ, Raphaël. L'environnement comme stratégie syndicale internationale :
réflexions sur la ‘géographie ouvrière' à partir du changement climatique. In: Clerval, A., Fleury,
A., Rebotier, J. et Weber, S. Espace et Rapports de domination. Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2015. p. 367-376
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:55392
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
1 / 1

L’environnement comme stratégie syndicale internationale : réflexions
sur la ‘géographie ouvrière’ à partir du changement climatique.
Romain Felli, chercheur au Département de science politique et relations internationales,
Université de Genève
Raphaël Ramuz, chercheur à l’Observatoire Science, Politique, Société, Université de
Lausanne
4.10.2013
A paraître dans Clerval, Anne ; Fleury, Antoine ; Rebotier, Julien ; Weber, Serge, Espace et
rapports sociaux de domination : chantiers de recherche, Presses universitaires de Rennes, Rennes,
2014
Après des décennies durant lesquelles la chape de plomb de la pensée néolibérale a étouffé la
pensée critique, il semble que les théories alternatives (et critiques) fassent leur retour, certes timide,
dans le monde académique. Stimulées par les diverses contestations de l’ordre établi, la littérature
en sciences sociales, notamment en géographie, compte toujours plus de recherches et de réflexions
sur les alternatives politiques.
Discuter de projets de transition, notamment dans le cadre de la crise écologique (e.g.: vers
une société post-carbone) (re)devient possible. La contrepartie de ces contributions multiples est
l’éclatement inévitable des cadres d’analyse, ce qui introduit beaucoup de confusion. Pourtant, la
poursuite d’un projet politique qui inclut des dimensions analytiques et donc des pratiques
scientifiques suppose la clarification des concepts et des théories qu’il recouvre.
Cet article découle d’une recherche en cours sur les stratégies syndicales en matière de
changement climatique 1. Néanmoins, nous profitons de celle-ci pour traiter de problèmes
conceptuels plus fondamentaux. Le présent article tente d’évaluer les apports récents de la dite
« géographie ouvrière » (labor/labour geography), issue de la géographie radicale anglo-saxonne.
Nous nous reconnaissons dans cette riche tradition scientifique et dans son origine marxiste. Notre
propos est de contribuer à l’intégration et au développement de la théorie de la valeur dans la
géographie radicale.2 Nous commençons par présenter brièvement le champ de la géographie
ouvrière anglo-saxonne, et en soulignons des aspects problématiques ou contradictoires. Puis nous
proposons une conceptualisation alternative, fondée notamment sur l’approche stratégique-
relationnelle, que nous appliquons enfin aux stratégies syndicales internationales en matière de
changement climatique.
ENJEUX DE LA « LABOUR GEOGRAPHY »
En réponse aux débats sur ladite « globalisation », la géographie radicale anglophone connaît
un intéressant renouvellement théorique depuis une vingtaine d’années. En particulier, sous
l’impulsion d’Andrew Herod (2001), le concept de « géographie ouvrière » a été développé afin de
souligner le pouvoir des travailleur/euse-s, notamment dans et sur l’espace. Ces auteurs opposent à
la classique « géographie du travail » (geography of labour) qui tend à être descriptive et/ou
positiviste (localisation du travail comme facteur de production dans un cadre d’analyse
néoclassique) une « labour geography » qui part, elle, de la reconnaissance matérialiste du travail
1 Romain Felli remercie la School of Environment and Development de l’Université de Manchester qui l’a accueilli
pendant cette recherche, ainsi que le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) qui l’a financé au moyen
d’une bourse post-doctorale de jeune chercheur (n°134448).
2 Plus précisément, il s’agit d’une perspective partant de la forme-valeur (Reuten et Williams, 1989) pour analyser la
question écologique. Cette perspective se différencie de la théorie ricardienne de la valeur-travail que certains marxistes
adoptent. Pour une analyse de la crise écologique en terme de forme-valeur, voir Felli (2011).
1

comme classe fondamentale dans le capitalisme et qui, dans l’analyse comme dans l’action, se place
à ses côtés et/ou en son sein.3 Cette reconnaissance ne réduit pas l’analyse du capitalisme à celle du
processus de production au sens étroit, mais relève au contraire du « mode de sociétalisation
capitaliste » qui intègre, de manière contradictoire, l’ensemble des rapports sociaux. Ce
questionnement n’est pas complètement étranger à la géographie francophone. En réponse à un
ouvrage de Pierre George illustratif d’une géographie descriptive et régionaliste du travail, Jean-
Bernard Racine et Josiane Rouyre (1982) affirment la nécessité d’une analyse marxiste qui partirait
du rapport social capitaliste et intégrerait l’espace comme élément d’une analyse dialectique de ce
rapport plutôt que comme simple réceptacle des rapports sociaux.
Ce domaine de recherche foisonnant dans le monde anglophone dispose d’ores et déjà d’ouvrages
classiques (Herod 1998; Mitchell 1996), de manuels (Castree et al., 2004), et de nombreuses
rétrospectives (Castree, 2007). Coe et Jordhus-Lier (2011) ont produit un résumé des différentes
étapes de la géographie ouvrière dont on relève deux points. Premièrement, cette géographie visait à
contrer certains arguments produits dans les années 1990 lors des débats sur la globalisation et les
délocalisations, qui affirmaient unilatéralement le pouvoir de domination du capital. Plusieurs
auteurs ont alors insisté sur le caractère toujours territorialisé de l’investissement capitaliste, et donc
de la capacité différenciée des travailleur/euse-s et de leurs organisations syndicales de coordonner
à différentes échelles (du local à l’international), une résistance aux décisions industrielles.
Deuxièmement, il s’agissait d’affirmer une autonomie des travailleur/euse-s dans la production de
l’espace, par opposition à une tradition plus structuraliste où primait l’analyse de la domination du
capital. Les études produites alors visaient à montrer le pouvoir et/ou l’autonomie des
travailleur/euse-s dans la production du « paysage » (landscape) économique et socio-naturel. Cette
tradition concerne la géographie de la domination puisque, précisément, elle tente de replacer les
rapports sociaux dans une perspective dialectique en soulignant combien une vision unilatérale de la
domination par le capital serait erronée pour faire sens des dynamiques du capitalisme.
REFORMULATIONS ANALYTIQUES
Plus récemment s’est ouvert un débat central au sein de la géographie ouvrière sur la
catégorie de « capacité d’action » (agency). Les principaux enjeux de ce débat portent sur la
difficulté à déterminer empiriquement l’étendue de cette capacité et à l’accroître. Il s’agit d’une
limitation que nous voulons discuter, et à laquelle nous proposons une solution.
Quelques limites de la géographie ouvrière
Noel Castree identifie clairement le problème lorsqu’il écrit :
Néanmoins, et paradoxalement, la capacité d’action est à la fois sous-théorisée et sous-déterminée dans la
plupart des analyses que la géographie ouvrière en fait. A mon sens, le terme de « capacité d’action » (agency)
est devenu un fourre-tout utilisé dès lors que n’importe quel groupe de travailleurs entreprend une action en son
nom ou pour autrui. [...] l’absence de distinction entre les différents types de capacité d’action, ainsi que les
conditions qui les permettent ou les inhibent, empêche les analystes de dire quoi que ce soit d’intelligent sur les
stratégies des travailleurs, d’un point de vue normatif (Castree, 2007, p.858 ; notre traduction).
3 En ce sens là, notre traduction de l’adjectif « labour » par « ouvrière » ne peut pas être assimilée à une réduction de la
conception du prolétariat à sa frange industrielle (masculine, blanche, stable, etc.). Si nous pouvons faire nos adieux à
une telle compréhension de la classe ouvrière, nous nous refusons à jeter le bébé marxiste avec l’eau du bain structuro-
staliniste. Par ouvrier/ouvrière nous renvoyons à l’ensemble des « sujets de la valeur » (Dyer-Witheford, 2002) dont la
condition, dans le cadre du rapport de production capitaliste, est d’être séparés des moyens de production. Que, par
ailleurs, la classe ouvrière ne relève pas de l’unité des identités ou des situations est une évidence (cf. Thompson 1988).
Tout l’enjeu est justement de rendre compte de la « composition » de cette classe à partir des différences qui la
produisent et la divisent en même temps. En ce sens là, dans le cadre du mode de sociétalisation capitaliste, les luttes
féministes, anti-racistes, écologistes, etc. doivent être comprises comme participant de la (dé-/re-) composition de la
classe ouvrière.
2

Castree critique la géographie radicale pour son manque de théorisation ainsi que son absence
d’analyse systématique des formes de capacité d’action (forms of agency). Or la théorisation ne
relève pas d’un formalisme pédant. Elle est nécessaire pour situer les types d’action observés par le
chercheur. Sans une telle théorisation, les sciences sociales sont confrontées à deux écueils en
apparence opposés, mais qui ne sont que les deux faces d’une même pièce : le structuralisme et le
spontanéisme. Le structuralisme fournit la théorisation de ce qui est fixe, tandis que la « liberté »
d’agir est la variable résiduelle de l’équation. Indéterminée, cette liberté d’agir est associée à la pure
émergence de la créativité, une forme de spontanéité humaine, un surgissement, une création, dont
la science sociale serait impuissante à rendre compte.
Vers une approche stratégique-relationnelle
La question du rapport capacités d’action / structures est un enjeu récurrent en sciences
sociales. Il est crucial pour quiconque veut analyser le rapport capital – travail et les différentes
formes au travers desquelles il s’exprime. Penser la capacité d’action suppose de comprendre et
d’expliquer le processus qui inspire ces mots de Marx : « les hommes font leur propre histoire, mais
ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions
directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un
poids très lourd sur le cerveau des vivants ». Ainsi, penser les formes de capacité d’action requiert
une approche qui conçoit la dialectique structure / capacités d’action en tant que dialectique des
relations internes (Ollman, 2003) dans laquelle les structures sont la condition nécessaire de l’action
mais n’existent qu’en tant qu’elles sont (re)produites et transformées par l’action (Bhaskar, 1998).
L’« approche stratégique-relationnelle » (ASR) de Bob Jessop (2001) offre une solution
théorique particulièrement utile. L’ASR est une approche réaliste (critique) et relationnelle. Elle
analyse simultanément les structures en relation avec les actions et les actions en relation avec les
structures. Plus encore, elle permet de distinguer entre différents degrés de structuration et de
comprendre comment les capacités d’action s’articulent à ces degrés de structuration.
Cette dialectisation présente deux avancées. D’une part, elle permet de montrer la manière
dont les structures avantagent certains agents et leurs stratégies, notamment en étant congruentes
avec leurs horizons spatio-temporels. D’autre part, elle permet de voir la manière dont les agents
prennent en compte (ou non) cette asymétrie de marge de manœuvre générée par l’agencement
structurel lorsqu’ils analysent le contexte stratégique et agissent. C’est ainsi liés que les deux
éléments de la dialectique structures / capacités d’action sont conceptualisés. Le changement
structurel n’apparaît plus comme la seule conséquence inattendue de l’action de reproduction «
simple », mais également comme la résultante des multiples actions stratégiques des agents.
Dans cette terminologie, la sélectivité-stratégique structurellement-inscrite souligne que les
structures tendent à renforcer des formes d’actions et à en affaiblir d’autres. Le calcul stratégique
orienté structurellement montre la réflexion possible des agents, individuels ou collectifs, par
rapport aux sélectivités stratégiques inscrites dans les structures. Cela explique qu’ils orientent leurs
stratégies et tactiques dans les termes de leur compréhension de la conjoncture en cours, de manière
réflexive ou plus immédiatement.
Etant donné que l’ASR est un mode d’appréhension conceptuel très abstrait de tout
phénomène social, il doit être actualisé par le développement de concepts plus concrets et adéquats
aux types de processus sociaux analysés et rendre ainsi compte de la stratification ontologique
spécifique à une période historique. Dans le cadre de notre questionnement sur les concepts
développés par la géographie ouvrière, nous nous appuyons sur la conception marxienne du mode
de sociétalisation capitaliste. En son sein, nous proposons de distinguer le niveau des formes
sociales de celui des institutions (Hirsch, 1994 ; Ramuz, 2011). Les formes sociales constituent le
niveau le plus abstrait d’un type particulier de société et elles acquièrent une détermination concrète
dans des institutions particulières qui s’actualisent dans un processus de (re)production/
transformation par les actions humaines. Dans le cas de la société capitaliste, les formes sociales
fondamentales sont la forme-valeur et la forme-Etat (Tran 2003 ; Reuten et Williams, 1989). Ces
formes sociales ne se donnent pas à voir en tant que telles, elles ne sont que les déterminations
3

abstraites, simples et essentielles des sociétés capitalistes. Elles sont donc sous-déterminées et
n’existent que sous la forme d’institutions particulières telles que les régimes monétaires, les modes
de régulation du rapport salarial ou les régimes politiques. Ces institutions étant elles-mêmes enjeu
de lutte et constamment (re)produites/transformées par les actions humaines qui seules peuvent
rendre ces différentes strates structurelles actuelles.
Ce double niveau de structuration implique que les capacités d’action doivent être conçues en
rapport à la fois aux formes sociales et aux institutions. Ainsi, les effets de l’action peuvent être
paradoxaux : transformer les institutions et reproduire les formes sociales. Par exemple, la remise
en cause de politiques monétaires (keynésianisme vs monétarisme) remet en cause les institutions
de gestion monétaire tout en reproduisant la forme-monnaie en tant que telle.
Dès lors, dans l’analyse des stratégies syndicales, il importe de prendre en compte la manière
(explicite, ou implicite) dont les organisations analysées se représentent le contexte stratégiquement
sélectif au sein duquel elles interviennent, et comment elles en tirent des stratégies visant à agir au
sein de ce contexte et/ou à le transformer, et dans quel sens.
UN EXEMPLE : LES STRATEGIES ENVIRONNEMENTALES DES SYNDICATS
Depuis une quinzaine d’années les organisations syndicales internationales sont actives dans
le domaine du réchauffement climatique 4. Elles envoient des délégations aux négociations
internationales sur le climat (comme aux conférences annuelles des parties du protocole de Kyoto),
organisent des conférences, publient des rapports et des stratégies, ont des permanents spécialisés
sur ces questions. Cet activisme peut sembler étrange car le réchauffement climatique n’est
généralement pas identifié comme une priorité de l’action syndicale internationale.
Pour comprendre les raisons qui poussent ces organisations à dédier des ressources afin de
traiter de ce problème, il faut saisir le calcul stratégique auquel elles se livrent. L’étude de leurs
motivations peut nous renseigner sur la manière dont elles internalisent dans leurs stratégies leur
perception de l’environnement stratégiquement sélectif dans lequel elles se trouvent, et le degré
auquel elles sont prêtes à mettre en œuvre une stratégie politique de transformation de ce contexte,
ou au contraire d’adaptation. Ainsi face à un même contexte, et à partir d’une perception semblable
de celui-ci, deux organisations ont la capacité de faire des choix différents en fonction de leurs
analyses de la possibilité de transformation de ce contexte, à différentes échelles (soit de leur calcul
stratégique orienté structurellement).
Notre étude montre qu’au-delà d’un accord général sur la manière de traiter le problème du
réchauffement climatique, les organisations syndicales internationales développent des stratégies
relativement différentes qui s’expliquent notamment par une orientation politique d’ampleur et
d’échelle différenciée.
Premièrement, pourquoi les organisations syndicales internationales s’engagent-elles sur ce
sujet? Elles le font en réponse à la perception de deux risques. Le premier découle des
conséquences attendues du changement climatique qui seront dévastatrices pour les populations les
plus pauvres et les plus vulnérables à l’échelle de la planète. Les syndicats en tant qu’organisations
de solidarité des travailleurs/euse-s auraient un devoir moral d’être à la pointe du combat pour la
transition vers une économie à bas carbone. Deuxièmement, les organisations syndicales tentent de
répondre à un autre risque, celui de la régulation. L’imposition de réductions des émissions de gaz à
effet de serre, en l’absence de mesures compensatoires, touchera durement certains secteurs
fortement consommateurs d’énergies fossiles (transport routier notamment, industrie, etc.) ainsi que
les secteurs d’extraction et production énergétique. Les conséquences d’une transition énergétique
non planifiée seront vraisemblablement payées par les travailleurs de ces secteurs (fermeture de
sites, chômage). A l’exception partielle des quelques pays où un Etat social développé peut servir
4 Cette partie résume les analyses proposées dans Felli (2013). Par organisations syndicales internationales, nous
entendons la Confédération syndicale internationale (CSI-ITUC), confédération des confédérations syndicales
nationales, ainsi que la dizaine de secrétariats syndicaux internationaux qui fédère les fédérations syndicales nationales
implantées dans un domaine d’activité, par exemple l’Internationale des services publics (ISP).
4
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%