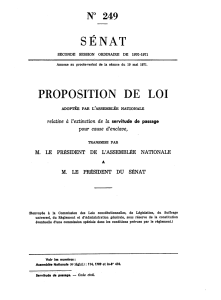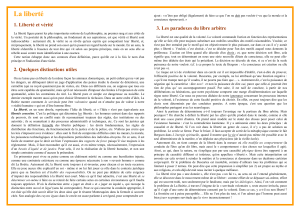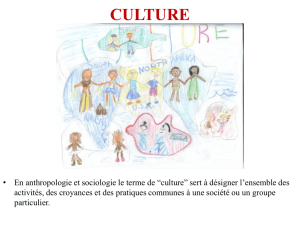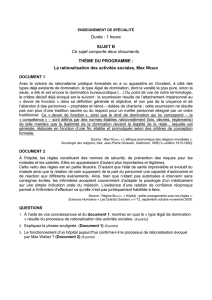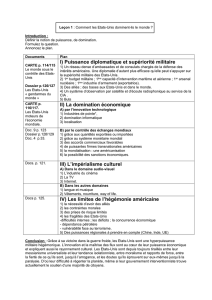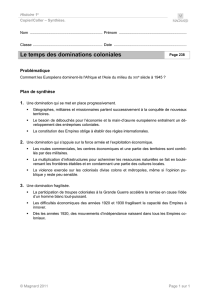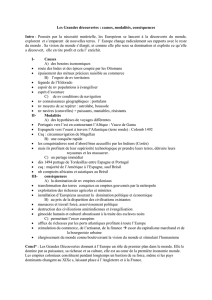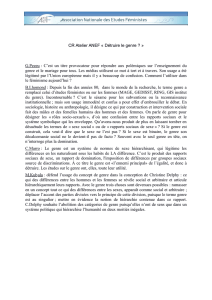SSA/Sociologie INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE POLITIQUE

SSA/Sociologie
Yolène Dilas-Rocherieux
Année 2010-2011, 2
ème
semestre (bureau 206 bat. D)
CM, lundi 13h30-15h30 yolene.dilas@wanadoo.fr
Amphi D1 (site personnel : dilroch)
INTRODUCTION A LA
SOCIOLOGIE POLITIQUE (HLSOG401) (411)
Chargées de TD : Audrey Célestine Lundi 10h30- 12h30 (D111)
Catherine Le Thomas Lundi 15h30-17h30 (N7)
Adèle Momméja Mardi 8h30-10h30 (D111)
Adèle Momméja Mardi 10h30-12h30 (D111)

2
Ce livret regroupe une série de textes qui seront soumis à l'analyse dans les TD sur la base de
cinq thèmes spécifiques. La lecture de la totalité de ces textes est obligatoire pour tous les étudiants.
La présence aux TD est obligatoire (11 TD de 2 heures).
En annexe sont proposés des tableaux destinés à fournir aux étudiants un support pour le
cours magistral. Le cours magistral s'organise sur 12 semaines à raison de 2 heures le lundi de 13h30
à 15h30 (amphi D1). Il a pour objet non seulement d'initier l'étudiant à la sociologie politique, mais
encore d'enrichir sa culture générale. Les cours de cette année privilégient les modalités de distribution
et de légitimation des fonctions de pouvoir et des statuts d'autorité dans les sociétés, ainsi que les
théories liées à cette discipline.
Lecture obligatoire : Catherine Kintzler, , Qu'est-ce que la laïcité, Paris, Vrin, 2008.
Le partiel de TD portera en partie sur cet ouvrage. Les notes de TD porteront à 50% sur les
textes, 50% sur l'ouvrage. L'examen d'amphi portera sur les cours (la note finale consiste en la
moyenne entre la note de TD et la note d'examen d'amphi).
Liste des textes étudiés en TD
I) Comment étudier un texte (p. 5)
- Pierre Bourdieu, "L'opinion publique n'existe pas", Les Temps modernes, janvier 1973
II) Distribution des statuts d'autorité et des fonctions de pouvoir entre tradition et modernité (p.
9)
- Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), Paris Quadridge/PUF, 1991.
- Norbert Elias, La dynamique de l'Occident (1939), Paris, Presses Pocket, 1975
- Hannah Arendt, La crise de la culture (1954), Paris, Idées/Gallimard, 1972.
III) Etat de nature/état de société (p. 13)
- Thomas Hobbes, Leviathan (1651), Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence,
1921.
- John Locke, Traité du gouvernement civil (1690), Paris, G.F. Flammarion, 1984.
- Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social (1762), Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
IV) Pouvoir, puissance, domination, (p. 17):
- Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire (1548), Paris, GF/Flammarion,
1983
- Pierre Birnbaum, "Sur les origines de la domination politique", Revue française de
science politique, n° 1 février 1977.
V) Pouvoir et légitimité, (p. 24)
- Dominique Schnapper, "En qui peut-on avoir confiance ?", Le Monde 15 juillet 2010
- "Monsieur le maire" est désormais un jeune retraité de la fonction publique, Le Monde
26/11/2010
Annexe: Tableaux (p. 28):
- 1: Etat de nature/état de société (Hobbes, Locke, Rousseau)
- 2: Schéma distinctif entre les démarches de Durkheim et de Weber
- 3: Les types de domination chez Max Weber
- 4: Karl Marx, le matérialisme historique et l'ordre des sociétés

3
- 5: Les concepts porteurs de Pierre Bourdieu
- 6: Légitimité et illégitimité dans le champ du politique, Pierre Bourdieu.
Plan du cours magistral (amphi)
I- Présentation du cours : qu'est-ce que la politique ?
II- Comment vivre avec les autres ?
1) Autorité, pouvoir, domination
a) Interdépendance, contraintes et règles sociales
b) L'exemple d'une configuration de joueurs
2) Communauté et société, statuts d'autorité et fonctions de pouvoir
a) Emile Durkheim, la division du travail comme source de morale, d'autorité et de
solidarité
b) Pierre Clastres, les sociétés sans Etat
c) Norbert Elias, la pacification de l'individu dans la société moderne
3) Modernité, responsabilité collective et individuelle
III- Aux origines du politique : état de nature/état de société
1) Thomas Hobbes
a) De l'homme naturel à l'homme social
b) L'homme artificiel, l'Etat-leviathan
2) Le gouvernement civil de John Locke
a) critique du pouvoir de droit divin
b) L'état de nature comme fondement de l'état de société
3) Le contrat social de Jacques Rousseau
a) L'homme dénaturé
b) Le contrat social
IV- Légitimité et processus de légitimation
1) De la servitude générale, Etienne de la Boétie
2) Légitimité légale et légitimité symbolique
3) Max Weber et la sociologie de la domination
a) Une méthode spécifique, l'individualisme méthodologique
b) les fondements de la domination politique et de sa légitimité
V- Comprendre Marx aujourd'hui
1) La formation d'une pensée et d'un engagement
a) Le poids de la philosophie d'Hegel sur la pensée de Marx
b) Les rencontres décisives
2) Les bases de la doctrine marxiste
a) La suprématie de l'économie dans la compréhension d'une société
b) la société capitaliste bourgeoise et l'Etat
3) Le mode de production capitaliste
a) Travail et capital
VI- La révolution moderne
1) Alexis de Tocqueville, penseur de la modernité
a) Les passions humaines comme moteur de l'histoire
b) Société traditionnelle et société moderne démocratique

4
c) La fin de l'hégémonie aristocratique
2) L'exemple américain
a) Liberté-égalité, le socle de la démocratie
b) Les faiblesses de la démocratie
VII- Formation et circulation des élites
1) La circulation des élites chez Pareto
a) les hiérarchies comme principe naturel à toute société
b) Théorie des résidus et circulation des élites
2) Pierre Bourdieu, la reproduction sociale
a) Sociologie de la domination
b) Légitimité et illégitimité en matière politique

5
PREMIER THEME
Comment étudier un texte
1- Pierre Bourdieu, "L'opinion publique n'existe pas", Les Temps modernes, janvier 1973
Je voudrais préciser d'abord que mon propos n'est pas de dénoncer de façon mécanique et
facile les sondages d'opinion, mais de procéder à une analyse rigoureuse de leur fonctionnement et de
leurs fonctions. Ce qui suppose que l'on mette en question les trois postulats qu'ils engagent
implicitement. Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion ; ou,
autrement dit, que la production d'une opinion est à la portée de tous. Quitte à heurter un sentiment
naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. Deuxième postulat : on suppose que
toutes les opinions se valent. Je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de
cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts
dépourvus de sens. Troisième postulat implicite : dans le simple fait de poser la même question à tout
le monde se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit qu'il
y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. Ces trois postulats impliquent, me semble-
t-il, toute une série de distorsions qui s'observent lors même que toutes les conditions de la rigueur
méthodologique sont remplies dans la recollection et l'analyse des données.
On fait très souvent aux sondages d'opinion des reproches techniques. Par exemple, on met
en question la représentativité des échantillons. Je pense que dans l'état actuel des moyens utilisés
par les offices de production de sondages, l'objection n'est guère fondée. On leur reproche aussi de
poser des questions biaisées ou plutôt de biaiser les questions dans leur formulation : cela est déjà
plus vrai et il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Ainsi,
par exemple, transgressant le précepte élémentaire de la construction d'un questionnaire qui exige
qu'on « laisse leurs chances » à toutes les réponses possibles, on omet fréquemment dans les
questions ou dans les réponses proposées une des options possibles, ou encore on propose plusieurs
fois la même option sous des formulations différentes. Il y a toutes sortes de biais de ce type et il serait
intéressant de s'interroger sur les conditions sociales d'apparition de ces biais. La plupart du temps ils
tiennent aux conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent les questionnaires. Mais ils
tiennent surtout au fait que les problématiques que fabriquent les instituts de sondages d'opinion sont
subordonnées à une demande d'un type particulier. Ainsi, ayant entrepris l'analyse d'une grande
enquête nationale sur l'opinion des Français concernant le système d'enseignement, nous avons
relevé, dans les archives d'un certain nombre de bureaux d'études, toutes les questions concernant
l'enseignement. Ceci nous a fait voir que plus de deux cents questions sur le système d'enseignement
ont été posées depuis Mai 1968, contre moins d'une vingtaine entre 1960 et 1968. Cela signifie que les
problématiques qui s'imposent à ce type d'organisme sont profondément liées à la conjoncture et
dominées par un certain type de demande sociale. La question de l'enseignement par exemple ne
peut être posée par un institut d'opinion publique que lorsqu'elle devient un problème politique. On voit
tout de suite la différence qui sépare ces institutions des centres de recherches qui engendrent leurs
problématiques, sinon dans un ciel pur, en tout cas avec une distance beaucoup plus grande à l'égard
de la demande sociale sous sa forme directe et immédiate. […]
Les problématiques qui sont proposées par les sondages d'opinion sont subordonnées à des
intérêts politiques, et cela commande très fortement à la fois la signification des réponses et la
signification qui est donnée à la publication des résultats. Le sondage d'opinion est, dans l'état actuel,
un instrument d'action politique ; sa fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion
qu'il existe une opinion publique comme sommation purement additive d'opinions individuelles ; à
imposer l'idée qu'il existe quelque chose qui serait comme la moyenne des opinions ou l'opinion
moyenne. L'« opinion publique » qui est manifestée dans les premières pages de journaux sous la
forme de pourcentages (60 % des Français sont favorables à...), cette opinion publique est un artefact
pur et simple dont la fonction est de dissimuler que l'état de l'opinion à un moment donné du temps est
un système de forces, de tensions et qu’il n’est rien de plus inadéquat pour représenter l'état de
l'opinion qu'un pourcentage.
On sait que tout exercice de la force s'accompagne d'un discours visant à légitimer la force de
celui qui l'exerce ; on peut même dire que le propre de tout rapport de force, c'est de n'avoir toute sa
force que dans la mesure où il se dissimule comme tel. Bref, pour parler simplement, l'homme
politique est celui qui dit : « Dieu est avec nous ». L'équivalent de « Dieu est avec nous », c'est
aujourd'hui « l'opinion publique est avec nous ». Tel est l'effet fondamental de l'enquête d'opinion :
constituer l'idée qu'il existe une opinion publique unanime, donc légitimer une politique et renforcer les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%