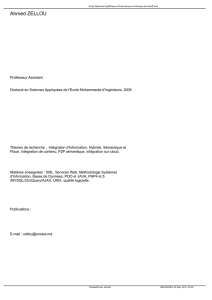Pour une sociologie politique des compétences Jean

Pour une sociologie politique des compétences
Jean-Louis Genard et Fabrizio Cantelli
Qu’est-ce une compétence ? Dans le sillage de Pierre Bourdieu, les travaux de Daniel Gaxie
(1978) ont exploré la compétence (politique) en l’articulant aux dynamiques de socialisation
des individus, ce geste étant lui-même répliqué et actualisé par d’autres enquêtes du même
auteur et d’autres sur les performances cognitives des étudiants français (Favre et Offerlé,
2002). La compétence a fait l’objet d’un numéro spécial de la revue française de science
politique (2007). Pourtant, que l’enquête se déploie par entretiens approfondis ou par
questionnaires, le lecteur reste largement sur sa faim : l’élucidation critique du domaine
propre de la compétence reste erratique, sinon faible. Ainsi, la compétence, pour mieux
l’expliquer, est fuie et tue, aussitôt enchâssée dans l’origine sociale, le sexe, ou la profession
des parents. Notre contribution déplacera la focale d’analyse et questionnera particulièrement
la compétence à partir de deux grands axes de réflexion : sous l’angle des théories de l’action,
via l’exploration des dimensions socio-anthropologiques de celle-ci ; sous l’angle politique,
via la mise en lumière des théories du gouvernement et du pouvoir sous-jacentes. Cette
contribution s’inscrit dans le fil d’enquêtes et de travaux ayant déjà ouvert la porte de la
compétence (Genard, 2007 ; Genard et Cantelli, 2008). Nous allons ici examiner le tissu
sociologique interne à la compétence, puis ce qu’elle fait, ce qu’elle désigne, les publics
qu’elle divise et classifie, les asymétries qu’elle creuse une fois qu’elle est déployée dans le
travail politique, dans les institutions, dans les interactions ; bref comment elle entre dans la
coordination de l’action et en modifie le cours, voilà l’intrigue principale. Il ne s’agit donc pas
d’un texte ayant une vocation uniquement descriptive sur la genèse d’une notion, même si la
capacité descriptive du concept de compétence1, ses ramifications, les notions qui voisinent
autour d’elle (capacité, employabilité, pédagogie, performance, gestes, etc.) seront suivies de
près. Nous essayerons de poser les jalons d’une sociologie politique de la capacité, en
s’ouvrant aux manières dont la compétence fait irruption dans plusieurs secteurs d’activités,
touchant à la fois les experts qui les diffusent, les publics qui les reçoivent, et évidemment, les
institutions qui les valident, même si ce schéma est trop statique et gomme la dynamique des
échanges et des ajustements.
Ce qu’est une « compétence »
Le terme « compétence », en même temps d’ailleurs que celui de « capacité », s’est
récemment imposé dans de nombreux domaines, qu’ils soient théoriques, comme c’est le cas
notamment de la, ou faudrait-il plutôt dire des, sociologie(s) pragmatique(s) ou liés à des
savoirs pratiques et opérationnels, comme c’est par exemple le cas du discours et des
pratiques pédagogiques (les seuils de compétences), des pratiques du travail social ou des
pratiques managériales. Plus largement, c’est là une des coordonnées importantes des
manières de gouverner aujourd’hui, dans des secteurs variés, déclinées selon des géométries
variables, donnant à voir un renouvellement des expertises, des vocabulaires et des
instruments des politiques publiques. En plus de faire signe vers un régime discursif d’un
nouveau type, la compétence, nous le verrons plus loin, ouvre à de nouvelles manières d’agir
sur tel ou tel public, tel ou tel problème. La compétence est ainsi un bon indicateur des
transformations actuelles traversant nos sociétés contemporaines et nos manières de
1 Si l’on s’en tient aux travaux des politistes français, il est étonnant de noter le peu de réflexivité et
d’historicisation de la notion même de compétence, à une ou deux exceptions près (Blondiaux, 2007).

gouverner. Ce type de vocabulaire prend place dans des programmes de politiques publiques,
appelle à une évaluation, donne lieu à des formations professionnelles variées, prend forme
tant sur les bancs de l’école, dans les entreprises privées qu’aux guichets des administrations
sociales.
Mais qu’est-ce d’abord qu’une compétence ? Répondre à cette question nous invite plutôt à
nous orienter vers les savoirs théoriques qui ont fait de ce concept un enjeu central. Dans
l’ouvrage qu’ils consacrent au vocabulaire de la sociologie de l’action, A. Ogien et L. Quéré
rappellent la paternité de Chomski par rapport à la mise en évidence du concept de
compétence, et cela au travers de la distinction qu’il opère entre compétence et performance,
une distinction qui, somme toute, chez Chomski, renvoie à l’articulation classique depuis la
philosophie aristotélicienne entre puissance et acte (Ogien, Quéré, 2005, 20s). La compétence
est donc un savoir ou un pouvoir faire qui se concrétise dans l’action. Elle est dispositionnelle
et n’est donc ni un faire ni un être, même si elle les appelle potentiellement. Ce rappel est
intéressant parce qu’il invite immédiatement à rapporter la notion de compétence à la
grammaire classique des distinctions modales dont usent les linguistes, en particulier ici entre
ce qu’ils appellent les modalisations actualisantes (savoir et pouvoir) et réalisantes (faire et
être) de l’action, les compétences, dans l’esprit de Chomski, renvoyant aux premières les
performances aux secondes. Nous mesurerons d’ailleurs plus loin à quel point les usages
actuellement dominants du concept de compétence tendent à tirer celle-ci – à l’inverse donc
de Chomski- au plus près du faire et de l’être et à l’éloigner d’autant de sa dimension
« potentielle » qui pourtant, aux yeux de Chomski, lui donne sens.
Dans les explicitations ultérieures qu’ils proposent du concept de compétences, Ogien et
Quéré suggèrent que les compétences désignent « certaines(s) capacité(s) à agir et à juger de
façon autonome et avisée » (Ogien, Quéré, 2005, 21). Comme on le voit, et comme cela arrive
d’ailleurs extrêmement souvent, la spécification du concept de compétence passe ici par une
référence à celui de capacité, comme à l’inverse, la spécification du concept de capacité
pourrait passer par celui de compétence. La référence aux dimensions modales que nous a
suggérée la distinction chomskienne entre compétence et performance nous suggère d’aller
plus avant. En effet, s’il y a bien une proximité modale entre compétence et capacité dans la
mesure où il s’agit dans les deux cas de dispositions modales autorisant de la part de l’acteur
la position d’actes, il nous semble pertinent d’éclairer la différence entre compétence et
capacité en se référant à celle entre les deux modalisations actualisantes que sont le savoir et
le pouvoir, la compétence accentuant la dimension modale du savoir comme l’illustreraient
les définitions à la fois récentes mais aussi passées du terme (le concept de compétence
occupe une place importante dans le vocabulaire juridique où il désigne l’aptitude d’un juge
ou d’un tribunal à connaître tel ou tel fait à juger), la capacité accentuant plutôt celle du
pouvoir. Et cela sans dénier le fait qu’à certains égards les termes « compétence » et
« capacité » sont de fait relativement interchangeables.
Parler de compétences et de capacités, et attribuer celles-ci à des acteurs n’est évidemment
pas sans implication sur le plan anthropologique. L’introduction de la terminologie des
compétences et des capacités au sein de la sociologie récente, en particulier la sociologie
pragmatique, est d’ailleurs éminemment significative, puisqu’elle constitue un élément
essentiel de la rupture avec ce qu’on nomme souvent le sociologisme, c’est-à-dire cette
propension de la sociologie – notamment bourdieusienne (Bourdieu, 1989) - à dénier
l’autonomie de l’acteur, et à renvoyer les mobiles de l’action à des déterminations ou à des
structures extérieures à l’individu, le déploiement des compétences dans l’action se trouvant à
chaque fois infiltré et déterminé par le milieu social, les catégories socioprofessionnelles, à

l’instar des travaux précédemment évoqués sur la compétence politique. La montée en
puissance du vocabulaire des capacités et des compétences participe donc clairement d’un
changement de perspective anthropologique au sein de la sociologie contemporaine et, en
l’occurrence, d’une réhabilitation, d’une interprétation responsabilisante de l’action (Genard,
1999), prêtant à l’acteur liberté, volonté, intention, tout en prenant donc ces concepts au
sérieux. Considérer les acteurs comme dotés de compétences variées, à saisir dans le vif de
l’action, se traduira par plusieurs stratégies de modélisation. Dans De la justification
(Boltanski et Thévenot, 1991), le modèle des cités/mondes esquisse un modèle du sens
ordinaire du juste, ancré et nourri aux grands textes de philosophie politique ; dans les travaux
de Laurent Thévenot (2006), le modèle des régimes d’engagement vise quant à lui à articuler
le domaine du proche et le domaine public ; les travaux de Nicolas Dodier (2005) explorent
les compétences et les pouvoirs des acteurs qui se révèlent lors des « épreuves ». Elles
partagent un « air de famille ». Mais de ces quelques lignes il ne faudrait pas laisser croire que
ce sont des sociologies politiques de l’hyper-compétence. Dans une belle thèse sur la
participation des citoyens ordinaires en Belgique (Berger, 2009), les défaillances, les erreurs,
les incompétences des acteurs ordinaires ont ainsi été examinées dans le détail.
Ce n’est toutefois pas à cette question relevant de l’épistémologie des sciences sociales –
question que nous avons abordée ailleurs (Genard, Cantelli, 2008) - que nous allons consacrer
les développements de cet article mais bien plutôt à la montée en puissance de la sémantique
des compétences et des capacités dans des domaines d’activités aussi différents a priori que
les politiques sociales, l’enseignement, le management ou la gestion des ressources humaines.
Ce que la compétence peut dire des acteurs
Considérer que les acteurs sont dotés de compétences et de capacités, avec ce que ces termes
portent à la fois de factualité et de potentialités, c’est tout d’abord et en même temps les
assigner à deux types de jugements évaluatifs. D’une part, selon qu’ils possèdent ou non ces
compétences et capacités, d’autre part selon que, les possédant, ils les exercent ou non, les
mettent en pratique ou non. Autrement dit, le vocabulaire de la compétence opère
potentiellement deux types de partages entre les individus. Il différencie d’abord ceux qui sont
capables et compétents de ceux qui ne le sont pas. Il distingue ensuite ceux qui, détenteurs de
capacités et de compétences, les mettent en œuvre de ceux qui s’y refusent, ne s’y emploient
pas, y renoncent, renvoyant donc par exemple à la problématique de la motivation et de ses
déficits, affaiblissement de la volonté, asthénie, atonie, apathie… ou encore à celle de la
mauvaise volonté, de celui qui est récalcitrant, réfractaire.
Comme on le voit, la sémantique de la capacité et de la compétence apparaît potentiellement
comme un formidable vecteur de partage des êtres, un opérateur de classement qui sera
d’autant plus efficient qu’il se trouvera opérationnalisé au travers d’une critériologie
d’indicateurs de compétences ou capacités. Le jugement qui reconnaîtra ou déniera
compétences et capacités ne sera donc pas seulement descriptif, il sera agissant, performatif, il
créera les conditions d’une reconfiguration de la situation envisagée, il modifiera le statut des
êtres ; et c’est bien sûr là, par excellence, que se justifiera la nécessité d’une sociologie
politique des compétences, cherchant à saisir dans l’action, dans les processus de
catégorisation, ce que la compétence fait faire à ceux qui en portent jugement, à ceux qui y
sont assignés.. Pour saisir, dans l’action, la portée de tels processus, le chercheur va ainsi
suivre les opérations critiques et le travail ordinaire de catégorisation des individus et des
situations. Ce jugement s’incarne et prend forme dans les politiques publiques, loin d’être
réductible à un discours, ou à des paroles vides. L’enquête de terrain menée par Isabelle

Lacourt dans les services sociaux bruxellois l’illustre bien, en plus de donner à voir comment
cela fait sens avec un protocole d’enquête, combinant analyse en groupe, entretiens et
observations non participantes des interactions au guichet. En suivant de près des travailleurs
sociaux plongés au cœur des nouvelles politiques d’activation, Isabelle Lacourt montre à quel
point et comment le jugement qui reconnait ou dénie la compétence ou la capacité – mais
aussi d’ailleurs la motivation - est agissant, et, plus que cela, à quel point et comment il est
politique en ce qu’il donne accès à certains droits, habilite ou non les usagers à recevoir
certaines allocations, ouvre la porte de formations en fonction du jugement porté par le
travailleur social sur les compétences des usagers (Lacourt, 2007). Bref, là apparaît avec
netteté en quoi la sémantique des compétences, précisément au travers de son aptitude à
qualifier individuellement les êtres, participe substantiellement de l’outillage des nouvelles
politiques sociales, en ce que précisément celles-ci s’appuient sur des processus
d’individualisation des prestations là où les dispositifs classiques de l’Etat social s’appuyaient
au contraire sur un principe d’octroi inconditionnel de droits. La conditionnalisation des
prestations sociales requiert en effet des opérateurs d’individualisation parmi lesquels la
sémantique des compétences et capacités joue aujourd’hui un rôle tout à fait central. Ce
partage des êtres auquel ouvre la sémantique des compétences est donc de part en part un
opérateur politique, en plus d’être porteur d’un horizon anthropologique. Et, si les
compétences agissent politiquement dans des domaines étendus, il est donc somme toute
logique qu’en retour se forme une sociologie politique capable d’en saisir les traductions dans
l’espace sociopolitique. Et cet article en donne un aperçu trop sommaire.
Par ailleurs, la référence à la compétence et à la capacité, à moins de présupposer leur
innéisme, renvoie très directement à la question de leur formation. Et là encore à deux
niveaux. A la fois à celui, pédagogique, des processus d’apprentissage qui conduisent à cette
formation. Mais aussi à celui, politique, de l’ « outillage » de l’environnement des acteurs, cet
outillage assurant aux acteurs leur capacitation, leur capabilities comme dit Sen, ou leur
« compétenciation ». Les institutions ne sont donc pas loin quand on traite des compétences et
capacités. En effet, construire des compétences ne se réalise pas hors du social, cela appelle
un travail politique, non seulement sur l’ampleur de la reconnaissance de ces dispositifs, ou
encore sur le rôle assigné aux experts et aux méthodes, mais aussi sur l’articulation avec des
logiques extérieures aux compétences ou avec les acteurs étrangers à ce langage. Par exemple,
dans notre enquête sur les politiques publiques de prévention du VIH/sida en Belgique
(Cantelli, 2007), nous avions noté la co-existence, parfois troublante, entre des associations
spécialisées qui pratiquent le travail de capacitation auprès d’usagers vulnérables (prostituées,
migrants, usagers de drogues, etc.) et des services de police qui agissent auprès du même
public à partir de leur logique propre, qui est celle de la lutte contre la criminalité, les trafics
de toute sorte et la délinquance. Mais ce tableau avec deux grandes entités est encore trop
simple et ne rend pas compte des ajustements et des coordinations exigées par ce travail de
capacitation : les associations composent avec le public et en fonction de la situation, mêlent
dans l’action même des équipements insistant tantôt sur les devoirs à respecter (ponctualité,
politesse, etc.), tantôt sur les pouvoirs et compétences à renforcer, tantôt sur la confiance en
soi. Un tel travail sur les compétences apparaît comme la stratégie s’enchâssant aisément avec
un public déjà compétent, mais qui, sans échouer toutefois, bute sur des publics plus
vulnérables qui ne donnent pas de prises et qui appellent davantage une politique
d’accompagnement et d’aide. Le lecteur aura compris la charge critique qui en ressort ; c’est
là une invite à se rappeler l’importance de penser le pluralisme2 (des publics, des dispositifs,
2 D’autres enquêtes (Périlleux et Cultiaux, 2007) sur le droit des patients montrent avec force comment
cohabitent des argumentaires en termes de responsabilisation des patients (contribution financière) et de
capacitation (au travers du renforcement de capacités d’action des patients). Il importe donc de ne pas réifier la

des types et des seuils de la capacitation) au sein même des stratégies politiques de
renforcement des compétences. Cet exemple montre aussi à quel point la sémantique des
compétences circule aujourd’hui, se trouve appropriée par de multiples acteurs et constitue un
enjeu d’interprétations et de disputes. A quel point aussi elle devient un enjeu politique dont il
ne faudrait pas non plus réduire a priori la portée à ses effets de domination. C’est aussi par
exemple au nom de compétences acquises dans des expériences quotidiennes que des citoyens
peuvent revendiquer et obtenir la mise en place de dispositifs participatifs et faire entendre
leur voix. Et, de la même façon, l’horizon des compétences peut aussi tout à fait participer des
équipements au travers desquels des enseignants peuvent être conduits à jeter un nouveau
regard sur leur pratique sans qu’il ne faille préjuger qu’aucune portée émancipatrice ne puisse
s’y faire jour. La reconnaissance des compétences est tout simplement devenue un enjeu de
luttes, ce qui une fois de plus plaide en faveur de l’ouverture à une sociologie politique qui les
prendrait pour objet.
On peut d’ailleurs rappeler que cette double dimension – pédagogique et politique- est au
cœur des discussions théoriques actuelles autour des pratiques de capacitation, notamment au
sein des politiques sociales, entre une conception à dominante socio-psychologique de la
capacitation (appelant prioritairement à de nouvelles pratiques de travail social) et une
conception à dominante politique (appelant à un renouvellement des dispositifs de l’Etat
social). C’est cette dernière dimension sur laquelle insistent Jean De Munck et Bénédicte
Zimmerman dans l’introduction qu’ils proposent du numéro de la revue Raisons pratiques
consacré à la notion de capacité et aux travaux de Sen (De Munck et Zimmerman, 2008, 15)
situant l’originalité de ses positions dans une conception normative des capacités, considérées
bien sûr comme des pouvoir faire, mais surtout – et c’est là l’originalité- associée à une
« devoir pouvoir » faire, renvoyant alors à des exigences politico-institutionnelles,
susceptibles d’ailleurs d’articuler – et non de renvoyer dos à dos - nouvelles pratiques du
travail social et nouveaux dispositifs de l’Etat social. On peut aussi s’étonner que peu de
chercheurs aient véritablement exploré cette double dimension, pédagogique et politique, à
partir des travaux de John Dewey, pourtant déjà discutés de manière critique sur les politiques
de la ville (Stavo-Debauge et Trom, 2004).
Il reste cependant que, à y regarder de près, l’essentiel des occurrences de la sémantique des
capacités et des compétences et ses effets empiriquement les plus tangibles aujourd’hui se
situent dans des domaines variés mais qui tous se caractérisent par l’asymétrie de leurs
interactions constitutives, le domaine de la pédagogie, celui des politiques sociales et donc du
rapport aux acteurs faibles et vulnérables, celui enfin du management, de la gestion des
ressources humaines et des relations de travail.
Ce que la compétence peut faire peser sur les acteurs faibles.
Comme on vient de le voir, la sémantique de la compétence et de la capacité porte en elle un
important potentiel de partage des êtres. A l’instar de ce que nous allons voir, elle paraît
également être un vecteur puissant de classification des éléments pertinents de l’action. Plus
globalement, le caractère « durable » et incrusté de la compétence constitue un élément
fondamental ; d’autres notions la renforcent, d’autres techniques la consolident, d’autres
dispositifs d’évaluation la valident constamment, autant de logiques faiblement saisies quand
on en reste, à l’instar de certains travaux de Michel Chauvière (2005), à une formule clivant
terme à terme compétence versus qualification. La compétence, son domaine de validité et les
compétence mais bien de la redéployer dans un arrière-plan pluraliste, capable d’en saisir les différentes formes
et politiques.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%