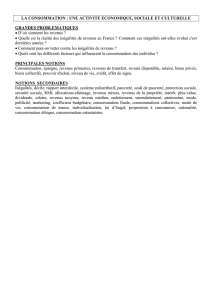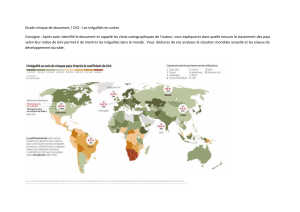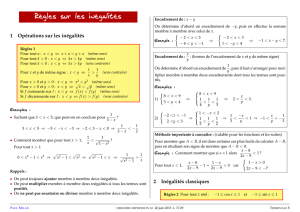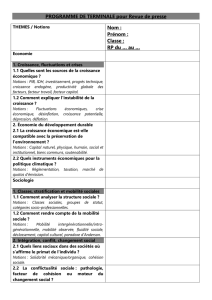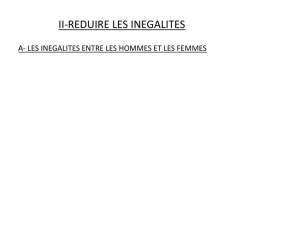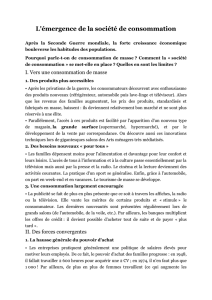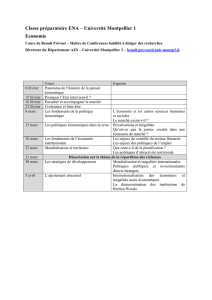Les multiples conceptions de la justice sociale

Les multiples conceptions de la justice
sociale
Igor Martinache
Alternatives Economiques
n° 336 - juin 2014
Si la justice sociale apparaît comme un
objectif politique
largement
partagé
dans les
programmes et les discours, elle demeure bien
délicate à définir
. Nombreux sont les
chercheurs qui se sont efforcés d'en préciser le sens, mais ils en proposent des
conceptions
différentes,
qui s'affrontent. Tour d'horizon.
1. L'égalité, mais de quoi ?
Pour Alexis de Tocqueville, auteur notamment de
De la démocratie en Amérique
(1835-1840), la démocratie ne désigne pas seulement un régime politique mais, plus
profondément, un état de la société dans lequel ses membres se considèrent d'égale
condition. Il s'agit d'un idéal dont la réalisation passe par un objectif de justice sociale. Or,
cet idéal est lui-même travaillé par plusieurs tensions. On distingue aujourd'hui en général
trois formes de justice sociale dans les sociétés démocratiques contemporaines selon le
type d'égalité qu'elles cherchent à instaurer.
La justice dite "commutative" ou universaliste vise l'égalité des droits. Il s'agit de veiller à ce
que les règles soient les mêmes pour tous, et donc à exclure toute forme de privilèges
propres aux sociétés d'ordres ou de castes. C'est elle que proclame la Déclaration
universelle des droits de l'homme du 26 août 1789 et la seule que reconnaissent les
libertariens (*) les plus ardents, comme l'économiste Friedrich Hayek ou le philosophe
Robert Nozick. Si le premier considère la justice sociale comme un
"
vocable vide de sens
"
, il
tient malgré tout le marché comme la seule instance impartiale capable de garantir que
chacun est récompensé suivant ses mérites. Dans cette perspective, les inégalités peuvent
être justes si elles découlent de procédures qui le sont, et elles sont même inévitables.
Chercher à les contrôler conduirait à ses yeux sur la
"route de la servitude"
d'un totalitarisme
socialiste.
Un système fiscal faiblement progressif ou franchement régressif ?
Cliquez pour agrandir l'image
Déjà promue par Aristote dans l'
Ethique à Nicomaque
, la justice distributive, ou
différentialiste, met, elle, l'accent sur l'égalité des chances, ce qui n'exclut pas des inégalités
de traitement, au moins temporaires, pour corriger des handicaps individuels ou collectifs.
Tel est le socle par exemple des politiques dites de "discrimination positive" mises en oeuvre
en Inde, aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud pour corriger les effets toujours sensibles
d'oppressions du passé. Là aussi, la justice réside d'abord dans les procédures et s'inscrit
dans une vision compétitive de la société s'accommodant de fortes inégalités de situations.
Seule la justice correctrice met en avant l'égalité des positions atteintes et non initiales.
Plusieurs sociologues s'en sont récemment faits les avocats face à la promotion du slogan
de l'égalité des chances
[1]
. Ils pointent ainsi la confusion entourant la définition du mérite,
entre talents "naturels" et efforts personnels, et l'impossibilité de l'isoler d'autres facteurs de
réussite arbitraires (héritages économiques ou culturels, environnement institutionnel,
chance, etc.). Plus encore, ils avancent qu'une méritocratie (*) n'est pas seulement
impossible mais qu'elle est aussi indésirable. Elle impose en effet à tous une certaine
conception de la réussite à l'exclusion d'autres et favorise les
"maladies de l'excellence"
(stress,
burn-out
ou dépression). Concédant au mérite un rôle d'aiguillon, Marie Duru-Bellat
plaide néanmoins pour que l'on reconnaisse ses multiples dimensions et le fait que
"
le
mérite n'est rien d'autre que ce que la société choisit de rémunérer pour orienter les actions
de ses membres
"
.
2. La justice comme équité
Faut-il dès lors prendre acte de la pluralité des conceptions de la justice et abandonner
l'idée de poser certains principes de portée universelle ? Non, selon John Rawls, qui a
développé à partir de la fin des années 1950 une théorie de la
"justice comme équité"
. Il
entend en particulier dépasser les approches utilitaristes (*) élaborées par des auteurs
divers comme Jeremy Bentham, James Mill ou Henry Sidgwick, qui considèrent qu'une
société juste est celle dont les institutions optimisent la somme des satisfactions
individuelles, quitte à sacrifier les libertés de quelques-uns.
Dans la lignée d'Emmanuel Kant et de Jean-Jacques Rousseau, Rawls défend au contraire
une approche contractualiste (*) de la société, où l'équité désigne la reconnaissance
mutuelle nécessaire entre des membres rationnels. Pour déterminer les principes
acceptables par tous, il propose de partir d'une situation fictive, la "position originelle", où
chacun serait placé derrière un voile d'ignorance, l'empêchant de connaître non seulement

sa place dans la société mais également ses capacités naturelles, son caractère
psychologique et sa propre conception du bien ou son projet de vie.
Dans une telle situation, chacun privilégierait nécessairement deux principes à tout autre,
utilitariste ou libéral notamment : le "principe de liberté" suivant lequel
"
chaque personne
doit
avoir un
droit égal au système le plus étendu de libertés de base égales pour tous qui soit
compatible avec le même système pour les autres
"
et un "principe de différence" qui pose
que
"
les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la
fois, (a) l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun
et (b) qu'elles soient attachées à des positions et des fonctions ouvertes à tous
"
.
Ces principes sont eux-mêmes organisés suivant un ordre de priorité absolue où le critère
suivant n'est examiné que si le précédent est satisfait. Le respect des libertés de base vient
ainsi avant l'égalité des chances, laquelle est elle-même devant le fait que toute inégalité de
position ne peut se justifier que si elle profite à tous, et en particulier aux plus défavorisés -
critère que les économistes qualifient de "maximin", une notion que Rawls conteste, mais
qu'il utilise malgré tout. Le concept de justice ainsi défini, s'appliquant à la structure de base
de la société, constitue le socle indispensable de toute démocratie - que Rawls prend aussi
soin de distinguer de la méritocratie -, sans empêcher le déploiement ensuite en leur sein de
conceptions particulières de la justice ou du bien.
Répartition du revenu global en France par tranche de niveaux de vie en 2011, en %
Cliquez pour agrandir l'image
Au début des années 1980, le juriste Ronald Dworkin va développer dans une série
d'articles une approche de l'union sociale quelque peu distincte de celle de Rawls. La justice
y réside dans le fait de réduire au maximum l'arbitraire, entendu comme tout ce qui ne
relève pas de choix individuels. Pour en esquisser les institutions, il imagine à son tour deux
dispositifs théoriques. Le premier est une vente aux enchères fictive, où seraient proposées
toutes les ressources désirables de l'existence et où chaque participant disposerait du
même pouvoir d'achat. A la fin, chacun doit préférer son propre panier à ceux de tous les
autres, ce que l'auteur qualifie de
"test de l'envie"
. Pour résoudre ensuite le problème de
l'inégale répartition des handicaps naturels, Dworkin propose un système d'assurances fictif.
Placé derrière un voile d'ignorance, chacun exprimerait le montant de la prime qu'il serait
prêt à verser s'il s'avérait affecté d'un tel désavantage, ce qui permet de déduire le montant
des primes à verser. Dans cette conception compensatrice de la justice, les inégalités
résultantes seraient toutes justes, dans la mesure où elles ne résulteraient que d'arbitrages
individuels, entre travail et loisirs, ou de prise de risque, par exemple, et non des
circonstances.
3. Une égale capacité à choisir notre destin
La théorie de Rawls a depuis 1971 connu de nombreux prolongements, discussions et
appropriations politiques contrastées
[2]
, rappelant que les idées n'ont pas un sens et une
force intrinsèques. On tend ainsi à exagérer l'opposition entre John Rawls et Amartya Sen.
S'il critique son insuffisante attention aux comportements concrets, Sen amende bien plus
qu'il ne réfute la théorie de Rawls. Envisagée comme un idéal vers lequel tendre, la justice
réside d'abord dans la résorption des
"injustices intolérables"
, comme l'esclavage, et dans
l'égalisation des "capabilités", c'est-à-dire l'accès à un ensemble d'états et d'aptitudes
(santé, éducation, logements!) qui lui permettent de réaliser son projet de vie. Il s'agit ainsi
d'aller au-delà des libertés formelles pour se préoccuper des libertés réelles.
Evolution du coefficient de Gini
Cliquez pour agrandir l'image
Bien que Rawls ou Sen se disent attentifs à la pluralité des valeurs, les auteurs regroupés
sous l'étiquette de "communautariens" comme Michael Sandel, Charles Taylor ou Alasdair
MacIntyre dénoncent l'individualisme sous-jacent à ces théories libérales. Ils font valoir que
nous sommes chacun déjà inscrits dans des groupes culturels différents au sein d'une
même nation qui nous transmettent un certain nombre de valeurs et de fins auxquelles il
s'agit de reconnaître une égale valeur, sous certaines conditions.
Le défi d'une justice globale
La plupart des réflexions sur la justice sociale s'inscrivent plus ou moins implicitement dans
le cadre la communauté nationale. Or, la mondialisation économique et culturelle comme la
montée des enjeux écologiques incitent aujourd'hui à élargir la focale au niveau planétaire.
Dans un récent ouvrage [1], Marie Duru-Bellat relaie ainsi les travaux de Branko Milanovic
qui pointent que les inégalités de revenus sont plus fortes à ce niveau qu'à l'intérieur des
Etats. En considérant le monde comme un seul pays, l'indice ou coefficient de Gini (*) y est
de 0,7, soit plus que celui des pays les plus inégalitaires, Brésil et Afrique du Sud (0,6). Plus
encore, il montre que pas moins de 60 % de notre revenu dépend du pays où l'on naît,
auxquels s'ajoutent 20 % tenant à l'origine sociale, soit une
"prime à la naissance"
qui
relativise fortement la croyance au mérite.

S'interroger sur la justice revient à se demander qui et quoi comparer, explique alors la
sociologue. La mise en oeuvre d'une justice globale est cependant loin de faire consensus.
Deux courants s'opposent : d'un côté, les "étatistes", pour lesquels le cadre national
demeure l'échelle pertinente de la solidarité, et les "cosmopolitistes", comme Amartya Sen
ou Thomas Pogge, qui considèrent que les principes de justice devant organiser la
distribution des libertés et des biens primordiaux doivent s'appliquer au niveau global.
Prenant aussi acte des diverses externalités des inégalités révélées par plusieurs travaux,
Marie Duru-Bellat appelle à prendre au sérieux la question de la décroissance, qui n'est
autre que celle de la finitude des ressources. Reste, enfin, la question cruciale des espaces
de délibération collective où puissent s'élaborer des règles concrétisant ces principes.
Au-delà des actuelles instances internationales laissant les Etats parler au nom de leurs
citoyens, et sans attendre la constitution d'un hypothétique Etat mondial.
[1]
Pour une planète équitable. L'urgence d'une justice globale
, La République des idées-Le
Seuil, 2014.
Dans
Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l'égalité,
publié en 1983, Michael
Walzer défend une approche qu'il qualifie de l'
"égalité complexe"
. Les biens sociaux à
répartir sont pour lui investis de significations et de modes de fonctionnement différents qui
renvoient à des sphères d'activité distinctes qui doivent être autonomes les unes des autres,
comme le marché, la politique ou la religion. Pour Walzer, une distribution inégale peut être
légitime dans certaines sphères, et l'injustice réside essentiellement dans la prétention à
convertir la valeur d'un bien d'une sphère à l'autre, par exemple son patrimoine économique
en influence politique. Ce faisant, il n'existe pas de critère unique pour classer les membres
de la société, ce qui tend aussi à pacifier leurs relations.
Les différentes approches communautariennes ont à leur tour été attaquées, notamment par
certains tenants du marxisme, pour avoir déplacé l'enjeu de la justice sociale du terrain
économique vers le culturel. En accompagnant les revendications à une égale
reconnaissance des identités collectives, nationalistes, "ethniques" ou sexuelles, elles
auraient éclipsé les luttes contre l'exploitation et pour une redistribution (*) plus juste des
ressources matérielles.
Pour Nancy Fraser, l'opposition entre politiques de reconnaissance et politiques de
redistribution est cependant un leurre, le véritable clivage passe en réalité entre politiques
correctrices, qui ne s'attaquent qu'aux symptômes, et politiques de transformation, qui visent
à modifier la structure sociale. Ainsi, il ne s'agit pas simplement, comme le préconisent les
tenants du multiculturalisme, de reconnaître une égale dignité à toutes les identités, mais au
contraire de les déconstruire pour éviter leur essentialisation en attribuant un statut égal à
leurs membres. La justice sociale réside d'abord, pour elle, dans la possibilité de chaque
membre de la société de participer à parts égales aux interactions qui la constituent, et en
particulier aux délibérations par lesquelles se détermine le bien commun. On retrouve ce
faisant l'accent que Rawls mettait sur les libertés politiques et le
"pluralisme raisonné"
promu
par Sen, pour qui l'approfondissement de la justice sociale est inséparable de celui de la
démocratie.
* Libertariens : penseurs qui ont en commun d'ériger la liberté individuelle en valeur
politique suprême et qui s'opposent notamment à l'existence de l'Etat.
* Méritocratie : société littéralement gouvernée par le mérite. Autrement dit dans
laquelle toutes les places et les biens seraient répartis en fonction du seul mérite de
ses membres.
* Utilitarisme : doctrine philosophico-économique qui se préoccupe avant tout des
conséquences des actions sur le bien-être des agents.
* Contractualisme : doctrine philosophique qui envisage la société comme un contrat
passé entre les différents individus qui la composent.
* Redistribution : dispositifs de prélèvements et de prestations qui modifient la
répartition primaire des revenus. On distingue la redistribution verticale, qui atténue les
inégalités de richesse, et la redistribution horizontale, qui s'exerce de catégories
épargnées par un risque vers celles qui le subissent (bien portants vers malades,
actifs vers retraités, etc.).
En savoir plus
"Les théories contemporaines de la
justice sociale
: une introduction",
par Bertrand
Guillarme,
Pouvoirs
n° 94, 2000, pp. 31-47.
Théorie de la justice
, par John Rawls, Le Seuil, 1997.
L'idée de justice
, par Amartya Sen, Flammarion, 2010.
Qu'est-ce que la
justice sociale
? Reconnaissance et
redistribution
,
par Nancy Fraser,
La Découverte, 2011.
Les théories de la justice, une introduction. Libéraux, utilitaristes, libertariens,
marxistes, communautariens, féministes...,
par Will Kymlicka, La Découverte, 1999.
Igor Martinache
Alternatives Economiques
n° 336 - juin 2014
Notes
(1)
Voir entre autres
Le mérite contre la justice
, par Marie Duru-Bellat, coll. Nouveaux
débats, Les Presses de Sciences-Po, 2009 et
Les places et les chances. Repenser la
justice sociale,
par François Dubet, La République des idées-Le Seuil, 2010.
(2)
Voir "Le "professeur Rawls" et le "Nobel des pauvres"", par Mathieu Hauchecorne,
Actes de la recherche en sciences sociales
nos 176-177, 2009, pp. 94-113.
AEWEB
© Alternatives Economiques. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle des pages publiées sur ce site à des fins professionnelles
ou commerciales est soumise à l’autorisation d'Alternatives Economiques (Tel : (33) 03 80 48 10 25 -
).
En cas de reprise à des fins strictement privées et non commerciales merci de bien vouloir mentionner la source, faire figurer notre logo et établir un
lien actif vers notre site internet
www.alternatives-economiques.fr
.

La protection
sociale :
quels débats ?
Quelles réformes ?
Cahiers français
n° 358
L’État-providence
en débat
32
L’État-providence
en débat
L’État-
providence : quel
équilibre entre
assurance et
assistance ?
La lente construction de l’État-providence
en France a paru tout d’abord hésiter entre
une approche assistancielle apportant
un secours aux personnes incapables
de satisfaire à leurs besoins élémentaires
et privées de la solidarité familiale, et
une logique assurantielle liant des droits
sociaux à la place occupée par les
individus dans le processus productif.
C’est ce second modèle, seul à même
de répondre à la précarité de la classe
ouvrière, qui va progressivement s’imposer
– 1945 marquera sa consécration avec la
création de la Sécurité sociale –, non sans
laisser pourtant à l’assistance une place
pour certaines catégories de la population
exclues du monde des actifs, personnes
âgées ou handicapés principalement.
Mais le développement d’un chômage de
masse a remis en question les dispositifs
de protection liés à l’activité, aussi à partir
des années 1980 assiste-t-on à un retour
de plus en plus prononcé, selon des visées
et des modalités renouvelées, des logiques
assistancielles. Robert Lafore explique qu’il
s’agit là d’un véritable renversement des
équilibres : les décloisonnements entre
assurance et assistance se multiplient, la
notion d’« assuré social » ne gardant tout
son sens que pour le noyau central des
actifs protégés, et celle d’« allocataire »
n’étant donc plus du tout circonscrite
à des catégories bien spécifiques.
C. F.
L’État-providence français est établi sur deux
fondements distincts : d’une part, puisant dans les
longues traditions de la charité et de la philanthropie
tout en voulant les dépasser, les lois d’assistance adoptées
pour l’essentiel entre 1889 et 1914 par les majorités
républicaines ; d’autre part, inspirées par les législations
bismarckiennes de la période 1883-1889, les assurances
sociales qui débouchent en 1945 sur l’institution phare
de notre protection sociale contemporaine, la Sécurité
sociale (1).
Ainsi, le système français articule deux logiques tant
du point de vue de leurs fondements conceptuels que des
techniques de mise en œuvre : l’assistance et l’assurance.
Chacune représente, lorsqu’on s’attache à en dégager
les traits caractéristiques, un modèle spécifique bâti
selon un agencement propre d’éléments qui constituent
une forme de « répertoire » (2) dans lequel sont liés
logiquement des principes fondateurs, des conceptions
relatives aux événements ou situations à prendre en
charge, des catégories de bénéficiaires, des formes de
droits à prestations et enfin des dispositifs organisationnels
habilités à les mettre en œuvre.
Si l’on veut bien entendre par « institution » un ensemble
cohérent qui relie des finalités et des valeurs, des visions
relatives aux problèmes à traiter et des organisations
articulant interventions et structures d’action, on peut
dire que deux univers institutionnels se partagent le
champ de la protection sociale française : l’assurantiel et
l’assistanciel.
Quelle place leur revient respectivement et quel est
l’équilibre établi entre eux de façon à conférer à cet
ensemble une certaine cohérence et par là une efficience
minimale ? Tel est l’objet des développements qui
suivent.
La réponse est complexe car loin des constructions
théoriques toujours élaborées a posteriori, les dispositifs
de la protection sociale ont été produits et ont évolué dans
des contextes historiques spécifiques, en réponse à des
problèmes concrets, et ont été établis à travers des nœuds
de contradictions obligeant à des accommodements et des
compromis. Bien plus donc que l’application de systèmes
préalablement pensés qu’il aurait suffi de mettre en œuvre,
les institutions sociales sont le résultat de tâtonnements
et d’expériences multiples, ce qui confère à chaque
dispositif son irréductible originalité et rend toute approche
systématique périlleuse. On peut cependant, au risque du
schématisme, tenter de démêler les parts de l’assurance
et celles de l’assistance dans la protection sociale puisque
d’un côté l’histoire nous a légué un héritage où chacun
des modèles s’est structuré à des périodes différentes et
que de l’autre ils empruntent des formes suffisamment
spécifiques pour que l’on puisse les distinguer et juger de
leurs rapports réciproques.
(1) Renard D. (1995), « Intervention de l’État et genèse de la protec-
tion sociale en France (1880-1940) », Lien social et politiques, RIAC,
n° 33, p. 13.
(2) Palier B. (2005), Gouverner la Sécurité sociale, Paris, PUF, not.
p. 21 et s.

La protection
sociale :
quels débats ?
Quelles réformes ?
Cahiers français
n° 358
L’État-providence
en débat
33
Le mouvement historique de l’institutionnalisation
de la protection sociale en France peut fournir un fil
conducteur.
Dans une première phase, la plus longue – de la fin
du XIXe siècle aux années 1970-1980 –, on assiste à la
progressive domination des assurances sociales dont la
victoire est scellée avec l’institution de la Sécurité sociale
en 1945 ; cette dernière renvoie l’assistance à un rôle de
complément, certes restructuré à compter des années
1950-1960, mais de portée limitée. Ces arrangements
entre assistance et assurance constituent naturellement
l’héritage dont il convient de partir si l’on veut apprécier
les mutations qui surviennent à compter de la décennie
1980-1990.
Mutations ouvrant la seconde phase, avec un ensemble de
recompositions entre assurance et assistance qui répondent
à des logiques adaptatives liées aux difficultés rencontrées
dans le cadre des équilibres antérieurs. Il convient d’en
prendre la mesure de façon à évaluer le potentiel de
changements plus profonds qu’elle renferme.
L’héritage : la domination
progressive du modèle
assurantiel
La protection sociale mit en France plusieurs décennies
à se stabiliser en un ensemble couvrant la plus grande
partie de la population, au contraire d’autres pays où les
éléments essentiels de ces politiques furent en place bien
plus précocement (3). Abstenons-nous ici d’examiner les
raisons complexes d’un tel retard qui renvoient à un certain
nombre de déterminations tant économiques que politiques
et idéologiques (4). Ce qui frappe l’observateur, c’est qu’un
des enjeux forts de la création de ces institutions concerna
le rôle à accorder à l’assistance et à l’assurance.
Malgré un renouvellement de ses
formes…
De la fin du XIXe siècle à 1930, date de création d’un
ensemble conséquent d’institutions assurantielles, on peut
lire l’histoire de l’État-providence à la française comme
une tension entre l’assistance et l’assurance : la première,
solidement établie sur un corpus de textes à partir de
1889, épousait la vision républicaine du social mais était
inefficace face aux problèmes sociaux émergeants ; la
seconde, malgré sa pertinence évidente pour affronter les
situations concrètes, se voyait contestée dans son principe
et ne put s’imposer que très difficilement (5).
Certes les lois d’assistance adoptées entre 1889
et 1914 (lois relatives aux « enfants maltraités et
moralement abandonnés » puis aux « enfants assistés », à
l’« assistance médicale gratuite », aux « vieillards, infirmes
et incurables » et enfin aux « femmes en couches » et aux
« familles nombreuses et nécessiteuses ») constituent une
rupture indéniable avec les formes antérieures d’aide et
de secours aux « indigents ». Elles reposent sur l’idée de
« droit à l’assistance » : une obligation juridique pèse sur
les collectivités publiques débitrices des aides qui doivent
en conséquence s’en acquitter à l’égard des personnes
entrant dans les conditions légales pour y prétendre.
Cela implique des prestations matérielles d’entretien et
l’accueil dans des établissements spécialisés (hospices,
orphelinats, asiles). Cette obligation doit être assurée dans
le cadre territorial le plus proche des bénéficiaires, d’où
à l’origine le choix de l’échelon communal. Mais cette
aide publique doit rester subsidiaire : elle ne peut que
suppléer à l’incapacité personnelle à satisfaire des besoins
matériels de base dûment constatés, et à l’incapacité des
alliés et membres de la famille à le faire dans le cadre des
obligations alimentaires civiles.
Le modèle assistanciel reste profondément ancré dans
un état et une vision de la société. Celui-là renvoie à une
économie encore fortement centrée sur la petite propriété
productive, alors même que le capitalisme industriel va
progressivement imposer ses formes de mise au travail
et remettre en cause la protection par le patrimoine ; et
celle-ci à une conception « familialiste » de la solidarité.
Seules les personnes légitimement déliées de l’obligation
du travail et ne disposant pas d’appuis familiaux sont
éligibles à l’aide publique (enfants, invalides, vieillards
et personnes en charge d’enfants). Les dimensions
modernistes des dispositifs originaires de l’assistance
ne doivent donc pas masquer deux faits : d’une part,
l’assistance publique prolonge la conception antérieure des
problèmes sociaux en termes de pauvreté, de « besoin »,
d’« impécuniosité », conçus comme la conséquence de
ratés des modes légitimes d’entretien et de solidarité que
l’État ne doit pallier que minimalement pour ne pas altérer
les obligations sociales de droit commun ; d’autre part,
l’assistance publique, bien que fille de la République et
de la citoyenneté politique, n’assume pas des objectifs de
lutte contre les inégalités, de redistribution massive des
richesses et par là de changement social ; elle s’ancre dans
des logiques tout à la fois libérales et conservatrices, dans
une recherche d’équilibre social et politique (6).
(3) V Merrien. F-X., Parchet R., Kernen A. (2005), L’État social : une
perspective internationale, Paris, A. Colin ; v. aussi, récemment réédité :
Durand P. (2005), La politique contemporaine de Sécurité sociale, Paris,
Dalloz, not. pp. 27-165.
(4) V. les trois volumes publiés par la MIRE : Mire, Rencontres et Re-
cherches, Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, vol.
1 Rencontres d’Oxford, 1995 ; vol. 2 Rencontres de Berlin, 1996 ; vol.
3 Rencontres de Florence, 1997 ; v. aussi, Revue française des affaires
sociales, n° 1, janv-mars 2002, Protection sociale aux États-Unis ; Rev.
franç. aff. sociales, n° 4, oct.-déc. 2003, L’État-providence nordique.
(5) Hesse P.-J., Le Crom J.-P. (2000), « Entre salariat, travail et besoin,
les fondements ambigus de la protection sociale au tournant des années
quarante », Revue française des affaires sociales, n° 3-4, p. 17.
(6) Donzelot J. (1984), L’invention du social, essai sur le déclin des
passions politiques, Paris, Fayard.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%