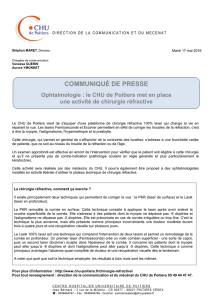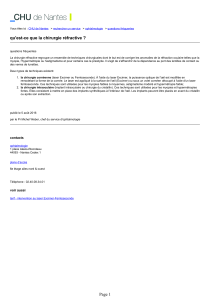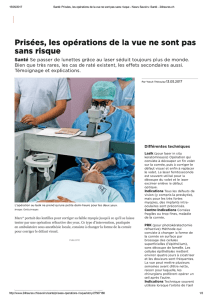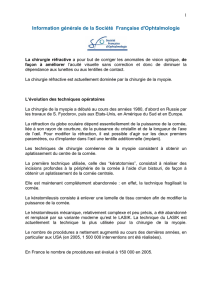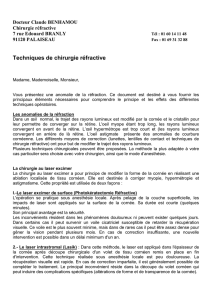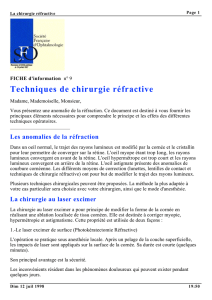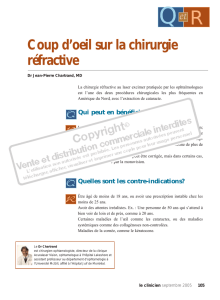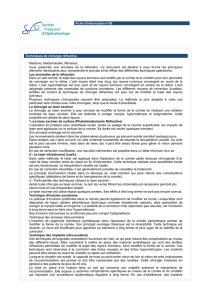Progrès effectués dans la chirurgie réfractive

Ophtalmologie
Conférences scientifiques
NOVEMBRE 2004
Volume 2, numéro 9
COMPTE RENDU DES CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES DU DÉPARTEMENT
D’OPHTALMOLOGIE ET
DES SCIENCES DE LA VISION,
FACULTÉ DE MÉDECINE,
UNIVERSITÉ DE TORONTO
Département d’ophtalmologie
et des sciences de la vision
Faculté de médecine
Université de Toronto
60 Murray St.
Bureau 1-003
Toronto (Ontario) M5G 1X5
Le contenu rédactionnel d’Ophtalmologie –
Conférences scientifiques est déterminé
exclusivement par le Département
d’ophtalmologie et des sciences de la vision,
Faculté de médicine, Université de Toronto.
Département d’ophtalmologie
et des sciences de la vision
Jeffrey Jay Hurwitz, M.D., Rédacteur
Professeur et président
Martin Steinbach, Ph.D.
Directeur de la recherche
The Hospital for Sick Children
Elise Heon, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Mount Sinai Hospital
Jeffrey J. Hurwitz, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Princess Margaret Hospital
(Clinique des tumeurs oculaires)
E. Rand Simpson, M.D.
Directeur, Service d’oncologie oculaire
St. Michael’s Hospital
Alan Berger, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre
William S. Dixon, M.D.
Ophtalmologiste en chef
The Toronto Hospital
(Toronto Western Division and
Toronto General Division)
Robert G. Devenyi, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Progrès effectués dans
la chirurgie réfractive
PAR RAYMOND M. STEIN, M.D., FRCSC
Au cours des dernières années, des progrès technologiques importants ont été
effectués en chirurgie réfractive grâce auxquels ces interventions offrent une plus grande
innocuité, prédictibilité et satisfaction de la part du patient. Dans le passé, l’objectif était
d’obtenir une acuité visuelle non corrigée qui était similaire à la meilleure acuité visuelle
obtenue avec correction optique par le port de lentilles de contact ou de lunettes.
Aujourd’hui, on a la possibilité d’améliorer la meilleure acuité visuelle corrigée ainsi que
la qualité globale de la vision. Sur une période de 20 ans, la chirurgie au laser excimer de
la cornée a évolué d’une série d’expériences sur des animaux à plus de 5 millions
d’interventions cliniques. Grâce aux progrès effectués dans la correction de la vision au
laser et à l’évolution d’autres interventions (p. ex. l’implantation de lentilles
intraoculaires phakiques, l’échange du cristallin à but réfractif), la plupart des patients
ont la possibilité de ne plus avoir à utiliser d’aides visuelles pour la vision de loin et des
innovations sont également mises au point actuellement pour corriger la vision de près.
Les patients qui subissent une intervention de chirurgie réfractive sont différents des
patients typiques qui nous consultent. Ce sont des personnes en bonne santé, actives et
qui travaillent, qui n’ont pas le temps ni le désir d’attendre dans une salle d’attente. Étant
donné que la correction de la vision au laser, l’implantation de lentilles intraoculaires
(LIO) phakiques et l’échange du cristallin à but réfractif sont des interventions électives,
ces patients ont donc le choix du chirurgien qui les réalisera. Le respect de leur temps et
de toute inquiétude qu’ils pourraient avoir au sujet des interventions de chirurgie
réfractive est essentiel au succès des professionnels des soins ophtalmologiques. Grâce à
la bonne gestion de l’expérience du patient par le cabinet d’ophtalmologie – du premier
appel téléphonique à la dernière visite de suivi – la chirurgie réfractive sera profitable
tant pour le patient que pour le praticien. Dans ce numéro d’Ophtalmologie – Conférences
scientifiques, nous explorons les innovations faites dans la chirurgie réfractive, la
sélection des patients et les soins postopératoires.
Indications
Les patients sélectionnés pour la chirurgie réfractive doivent être âgés ≥18 ans et
présenter un trouble réfractif stable. Il existe une exception à cette règle : si le patient
désire subir une intervention de chirurgie réfractive pour répondre à des obligations
professionnelles (p. ex. un pompier ou un agent de police), une légère modification de
la réfraction d’une année à l’autre n’a pas d’importance. Il ne sera congédié simplement
parce que plusieurs années après s’être qualifié pour son emploi, la réfraction se situe à
-1,00 dioptrie (D). Les interventions indiquées pour les troubles réfractifs sont le LASIK
(laser in situ keratomileusis), la photokératectomie réfractive (PKR) ou laser excimer de
surface, les interventions de la cornée visant une rétraction thermique du collagène, les LIO
phakiques et l’échange du cristallin à but réfractif (voir les tableaux 1 et 2).
Correction de la vision au laser
Bien que les chirurgiens spécialisés dans la chirurgie réfractive aient leurs propres limites
inférieure et supérieure, la gamme de correction pour le LASIK et la PKR est d’environ
+5,00 D à -10,00 D. L’astigmatisme entre 0,25 D et -6,00 D peut également être corrigé au
laser. Les options en ce qui concerne la correction de la vision au laser par le LASIK et la PKR
incluent l’ablation conventionnelle ou l’ablation personnalisée (figure 1). On obtient la
MC
Département
d’ophtalmologie et des
sciences de la vision
FACULTY OF MEDICINE
University of Toronto
Disponible sur Internet à : www.ophtalmologieconferences.ca

meilleure qualité de vision et la meilleure acuité visuelle
corrigée avec l’ablation personnalisée que l’on peut
réaliser par une ablation asphérique, une ablation
guidée par l’analyseur de front d’ondes ou par une abla-
tion guidée par topographie.
Une ablation asphérique utilise les mesures
obtenues par la kératométrie pour ajuster la fréquence à
laquelle le laser est appliqué sur la cornée semi-
périphérique, de façon à obtenir une courbure de la
cornée plus allongée1. Cette courbure ressemble à celle
de la cornée normale, qui est plus bombée au centre et
plus plate à la périphérie. Cela réduit l’induction d’une
aberration sphérique et améliore la qualité de la vision
nocturne.
Une ablation guidée par l’analyseur de front d’ondes
vise à réduire les aberrations d’ordre supérieur (coma,
trilobe et sphérique) qui peuvent affecter la qualité de la
vision2. En général, les patients présentant une faible
incidence d’aberrations d’ordre élevé obtiennent de
bons résultats avec une ablation sphérique, alors que
ceux qui présentent une incidence élevée d’aberrations
d’ordre élevé obtiennent un meilleur résultat avec l’ab-
lation guidée par l’analyseur de front d’ondes.
Une ablation guidée par topographie corrige les
cornées irrégulières et améliore la meilleure acuité
visuelle corrigée4. Contrairement à l’imagerie du front
d’ondes qui mesure 150 à 250 points réfractifs de l’œil,
un système topographique peut mesurer plus de 22 000
points sur la cornée. La transmission de ces données à
l’ordinateur du laser permet d’améliorer la meilleure
acuité visuelle corrigée par des lunettes chez les
patients atteints de kératocône, d’une forme fruste de
kératocône et d’autres formes d’astigmatisme irrégulier.
Récemment, on a obtenu de meilleurs résultats avec
la PKR (figure 2) grâce au développement du laser à
point lumineux mobile qui produit une ablation plus
lisse, de plus grandes zones optiques et de transition
permettant d’éviter le risque de formation de tissu cica-
triciel sur la cornée, aux techniques de refroidissement
(p. ex. la glace) qui réduisent l’inflammation5et aux
traitements pharmacologiques d’appoint (p. ex. mito-
mycine C topique6et vitamine C orale7) qui diminuent
le flou cornéen (haze).
Une technique Epi-LASIK, qui utilise un micro-
kératome dont la lame est émoussée pour créer un lam-
beau épithélial, est présentement mise au point8. Le
lambeau épithélial est soulevé, l’ablation au laser est
réalisée et le lambeau est remis en place sur la zone
traitée. Cette technique permet d’éviter les complica-
tions potentielles au niveau du lambeau associées au
LASIK (p. ex. un trou dans le lambeau, un lambeau
2
Tableau 1 : Interventions de chirurgie réfractive
myopique indiquées dans les troubles réfractifs
Échange du cristallin à but réfractif
0 -10 -2 -30 D
Photokératectomie réfractive ± mitomycine C
LASIK
LIO phakique
Tableau 2 : Interventions de chirurgie réfractive
hypermétropique indiquées dans les troubles
réfractifs
0 +5 +10 +20 D
Rétraction du collagène
Photokératectomie réfractive
LASIK
LIO phakique
Échange du cristallin à but réfractif
Figure 1 : La correction de la vision au laser
fournit aux patients l’option de réduire leur
dépendance aux lunettes ou aux lentilles
de contact
Figure 2 : Brosse rotative utilisée dans l’ablation
de surface au laser pour extraire l’épithélium
cornéen

plus de corriger les fortes myopies ou hypermétropies,
un autre cas à prendre en considération est le patient
âgé de plus de 60 ans dont le cristallin a perdu la quasi-
totalité de son pouvoir d’accommodation. S’il présente
des signes de cataracte précoce, le mieux pour le patient
est l’extraction du cristallin et l’insertion d’un implant,
au lieu d’une correction de la vision au laser. L’imagerie
du front d’ondes est en cours de développement et cette
modalité permettra de différencier les aberrations d’or-
dre élevé de la cornée et celles du cristallin. Si les aber-
rations sont sévères et proviennent principalement du
cristallin, un échange du cristallin à but réfractif est l’in-
tervention de choix.
Les innovations dans les implants intraoculaires
fournissent davantage d’options aux patients devant
subir un échange du cristallin à but réfractif. Des
implants pseudo-accommodatifs ou multifocaux sont
maintenant disponibles. La lentille qui est depuis le plus
longtemps sur le marché est l’implant Array qui
présente une série de zones concentriques sur la face
antérieure (Advanced Medical Optics). Elle permet aux
patients d’obtenir une bonne vision de loin et de près.
Les patients se plaignent souvent de la présence de
halos autour des points lumineux après l’opération,
mais ceux-ci diminuent généralement avec le temps14.
La lentille Restor (Alcon) utilise un principe différent qui
incorpore une optique de réfraction et une optique de
incomplet et une kératite lamellaire diffuse). Les résul-
tats cliniques initiaux démontrent que la récupération
visuelle est plus rapide comparativement à la PKR.
Les améliorations faites dans la technologie du
microkératome pour le LASIK ont entraîné une plus
grande innocuité et une plus grande prédictabilité de
l’épaisseur du lambeau. Le laser femtoseconde est main-
tenant une option pour la dissection d’un lambeau9.
Bien que les résultats cliniques avec le laser se soient
améliorés, il existe des rapports contradictoires sur la
technologie qui est supérieure : le microkératome
mécanique ou le kératome laser9,10. Le laser permet la
découpe du lambeau mince dans des couches superfi-
cielles de la cornée, ce qui accroît l’innocuité de l’inter-
vention. Il reste à savoir si cette technique permet
d’obtenir de meilleurs résultats que la PKR.
Implantation de LIO phakiques et échange
du cristallin à but réfractif
Pour les fortes myopies (supérieures à -10 D) ou
hypermétropies (supérieure à +5D), une intervention
intraoculaire doit être envisagée (p. ex. LIO phakique ou
échange du cristallin à but réfractif)11. La LIO phakique
est insérée dans la chambre antérieure et fixée à l’iris
(p. ex. lentille Verisyse, figure 3) ou derrière l’iris et en
avant du cristallin (p. ex. une lentille intraoculaire [LIO],
figure 4)12. Les avantages de la LIO phakique sont la
réversibilité et la conservation de l’accommodation. Les
contre-indications sont les grandes pupilles > 7 mm et
une profondeur de chambre intérieure < 3,2 mm13. De
nombreux patients atteints d’hypermétropie élevée ne
sont pas admissibles à l’implantation d’une LIO phaki-
que du fait que leur chambre antérieure est peu pro-
fonde. Le chirurgien commande un implant phakique
(puissance sphérique, astigmatisme, axe et diamètre) sur
la base de la réfraction, de la profondeur de la chambre
antérieure et du diamètre cornéen horizontal.
Un échange du cristallin à but réfractif consiste sim-
plement à extraire le cristallin et à insérer une LIO. L’in-
tervention est réalisée généralement sous anesthésie
topique par une incision cornéenne nette. Ni des points
de suture ni couvre-oeil sont nécessaires. L’astigmatisme
peut être traité en insérant un implant intraoculaire
torique et/ou par des incisions relaxantes limbiques. En
Ophtalmologie
Conférences scientifiques
3
Figure 3 : LIO phakique Verisyse fixée à l’iris
semi-périphérique
Figure 4 : Lentille intraoculaire
Figure 5 : La lentille Restor qui a une optique
centrale diffractive et une optique périphérique
réfractive

diffraction (figure 5)15. La zone centrale de l’optique de
3,5 mm est la partie diffractive. La lentille est conçue
avec une série de cercles concentriques dans sa partie
centrale dont la distance diminue en périphérie de
1,3 micron à 0,4 micron. La nuit, lorsque les pupilles
sont grandes, la plupart de l’énergie lumineuse est utili-
sée pour la focalisation à distance et par conséquent,
l’incidence de l’éblouissement et des halos est faible
(environ 15 %) et généralement de sévérité modérée. La
sélection et les attentes des patients sont essentielles
pour l’acceptation des lentilles multifocales. De plus,
l’exactitude des valeurs biométriques et une mise en
place précise de la lentille sur la partie centrale et dans
le sac capsulaire sont essentielles au succès de l’inter-
vention. Il est important que l’astigmatisme postopéra-
toire soit faible pour obtenir une acuité visuelle non
corrigée satisfaisante.
Un implant intraoculaire idéal fournit une excel-
lente vision à toutes les distances focales. De nombreux
travaux ont été effectués en vue de mettre au point une
lentille accommodative. La première lentille approuvée
aux États-Unis était la lentille Crystalens16, qui est un
implant intraoculaire qui possède une charnière con-
tiguë à l’optique pour permettre à cette dernière
d’avancer légèrement grâce à la contraction du muscle
ciliaire qui entraîne une pression accrue sur le corps
vitré, ce qui améliore la vision de près. L’optique de la
lentille est petite (4,5 mm). Une capsulotomie au moyen
d’un laser YAG ne diminue pas l’efficacité de la lentille.
Un autre implant accommodatif utilisé dans des essais
cliniques est le Visiogen Dual Optic Lens (deux optiques
reliées par un système haptique à ressort)17.
Les interventions intraoculaires sont généralement
associées à une cicatrisation minimale et à un rétablisse-
ment rapide de la vision. Le principal risque est l’infec-
tion ou l’endophtalmie, qui sont extrêmement rares,
survenant dans moins d’un œil sur 10 000 yeux. Chez
les patients souffrant d’une forte myopie, l’intervention
intraoculaire est associée à un risque accru de décolle-
ment de rétine15,19, mais l’implant phakique entraîne un
risque moins élevé que l’échange du cristallin à but
réfractif. Les examens préopératoires et postopératoires
du fond de l’œil avec dilatation de la pupille sont essen-
tiels pour détecter une déchirure de la rétine qui peut
être traitée.
Une LIO phakique ou un échange du cristallin à but
réfractif confère généralement une vision d’excellente
qualité. En présence d’un défaut réfractif résiduel, la cor-
rection de la vision au laser peut optimiser l’acuité
visuelle non corrigée. Cette intervention est générale-
ment réalisée au moins 2 à 4 mois après l’intervention
intraoculaire. La combinaison des interventions est
appelée une intervention bioptique.
Rétraction thermique du collagène
Des interventions de la cornée visant une rétrac-
tion thermique du collagène ont été mises au point
pour augmenter la courbure de la partie centrale de la
cornée, afin de corriger l’hypermétropie. Le laser à
holmium est utilisé pour créer de multiples brûlures
superficielles sur la cornée périphérique. Cependant, il
existe une incidence élevée de régression sur une péri-
ode de 1 à 2 ans après l’intervention et ce laser est
rarement utilisé aujourd’hui. Une nouvelle technolo-
gie mise au point par Refractec, appelée la « kératoplas-
tie conductive », consiste à appliquer un courant haute
fréquence dans le stroma semi-périphérique pour créer
de multiples brûlures profondes (80 % de profondeur).
Lorsqu’une série de 8 à 32 points de traitement sont
placés dans plus de 3 cercles à la périphérie cornéenne
(zones optiques de 6, 7 et 8 mm), des stries se forment
entre les points pour créer un anneau de resserrement.
Cela entraîne un cambrement du centre de la cornée
et corrige l’hypermétropie. Les données cliniques ont
démontré de meilleurs résultats qui sont généralement
limités à 2 D d’hypermétropie20. L’avantage de l’inter-
vention est qu’aucune incision n’est effectuée dans
la partie centrale de la cornée. Cependant, cette inter-
vention n’offre pas une aussi grande prédictabilité
et stabilité que la correction de la vision au laser. On
amontré un intérêt renouvelé dans l’utilisation
de cette intervention pour la correction de la presbytie
en induisant un degré de myopie pour permettre
la lecture.
Anneaux intracornéens
Cette intervention a été mise au point initialement
pour la correction des faibles myopies par l’implantation
de deux hémi-anneaux en polyméthylméthacrylate
(PMMA) dans le stroma cornéen semi-périphérique
(figure 6). Une petite incision verticale d’environ deux
tiers de l’épaisseur cornéenne, est effectuée sur le côté
supérieur. Un anneau de succion est ensuite placé sur la
sclère pour augmenter la pression oculaire et rendre la
cornée ferme. À l’aide d’un dissecteur circulaire en
métal, un sillon est créé de chaque côté de l’incision ini-
tiale. Les segments annulaires (qui existent en dif-
férentes épaisseurs) sont ensuite insérés dans la cornée.
En augmentant l’épaisseur de la cornée semi-
périphérique, le centre de la cornée est aplati. La nou-
velle courbure de la cornée recouvrant la pupille permet
de corriger les faibles myopies. Bien que l’intervention
soit attrayante en raison de sa réversibilité potentielle, la
correction du trouble réfractif n’est pas aussi bonne
qu’avec la correction de la vision au laser et cette tech-
nique ne permet pas de corriger l’astigmatisme ou l’hy-
permétropie. Elle est rarement réalisée à l’heure actuelle
4
Figure 6 : Segments annulaires intracornéens pour
corriger la myopie

pour la correction de la myopie, mais elle joue un rôle
important dans le traitement du kératocône et de la
kératectasie. Les segments annulaires peuvent aplatir la
cornée et retarder la nécessité d’une kératoplastie trans-
fixiante.
Sélection des patients
Il est extrêmement rare que la chirurgie réfractive
entraîne des complications graves. La « déception » des
patients est beaucoup plus fréquente et peut causer
davantage de problèmes pour le chirurgien spécialisé
dans la chirurgie réfractive qu’une perte de vision grave.
La déception peut être minimisée par la sélection
rigoureuse des patients (afin d’éliminer les types de per-
sonnalité inappropriés) et par la présentation des faits,
de façon à ne rien dire ni faire qui pourrait susciter des
attentes irréalistes. La mention d’une vision de 20/15 ou
d’une « vision parfaite » peut entraîner l’attente d’un tel
résultat. Il faut éviter de faire des promesses et faire
plutôt des commentaires tels qu’une « vision consid-
érablement améliorée » ou une « dépendance réduite
aux lunettes et aux verres de contact » qui suscitent des
attentes réalistes. Les outils de marketing et le personnel
en relation avec les patients doivent également suivre
cette ligne de conduite qui consiste à ne pas faire de
promesses excessives.
La sélection des patients ne peut pas être effectuée
sur la base de critères objectifs uniquement. Les perfec-
tionnistes, les personnes qui sont incapables de tolérer
de petites déceptions, et d’autres qui seraient probable-
ment terriblement contrariées si elles n’obtiennent pas
une vision de 20/20 ou une meilleure vision à la suite
de leur intervention doivent être exclus. Cependant, le
temps limité passé avec le patient permet difficilement
au chirurgien de repérer ces traits de la personnalité. La
collaboration avec un médecin qui connaît le patient
depuis des années et qui peut donc mieux juger de sa
personnalité, est un grand avantage.
Les meilleurs candidats à la chirurgie réfractive
sont ceux qui sont très désireux de ne plus porter des
lentilles correctrices (tableau 3), mais qui reconnaissent
que leur vision non corrigée après l’intervention peut
ne pas être tout à fait ce qu’elle était avec une correc-
tion avant l’intervention. Les bons candidats sont rela-
tivement accommodants et capables de tolérer de
légères déceptions. Le tableau 4 indique certaines atti-
tudes et troubles ophtalmiques qui font d’un patient un
mauvais candidat à la chirurgie. Il est essentiel de
reconnaître ces facteurs pour réduire les problèmes
postopératoires potentiels.
Pour les patients subissant une PKR, on ne doit pas
sous-estimer la possibilité d’une certaine gêne
postopératoire et d’un certain retard pour obtenir une
acuité visuelle optimale. Il vaut mieux souligner cette
possibilité plutôt que de laisser le patient dans l’igno-
rance. On ne rencontre pratiquement pas ce problème
avec le LASIK, où les patients n’éprouvent le plus sou-
vent aucune gêne après l’intervention et récupèrent très
vite leur meilleure acuité visuelle corrigée. Cependant,
dans de nombreux cas, un patient peut être un candidat
à la PKR, mais non au LASIK. La PKR est l’intervention
de choix dans les cas suivants :
• Dystrophie de la membrane basale épithéliale
entraînant un risque accru de prolifération de l’ép-
ithélium dans la chambre intérieure avec le LASIK.
• Zone centrale de la cornée relativement mince et
ainsi il resterait < 250 microns de tissu dans le lit
cornéen après l’ablation (le LASIK entraîne un risque
d’ectasie cornéenne).
• Fissures palpébrales étroites et/ou yeux profond
(ce qui rend difficile l’utilisation du microkératome).
• Kératocône ou forme fruste de kératocône (risque
d’ectasie cornéenne avec le LASIK)
• Cornée extrêmement plate (< 39 D, ce qui entraîn-
erait un lambeau d’un petit diamètre avec le LASIK), ou
cornée dont la courbure est importante (> 48 D, entraî-
nant un risque accru de trou dans le lambeau avec le
LASIK ou d’ectasie en présence d’une forme fruste de
kératocône).
Ophtalmologie
Conférences scientifiques
5
Tableau 3 : Bons candidats à la chirurgie réfractive
•Très insatisfaits de leur dépendance aux lentilles correctrices
•Pensent qu’ils ne sont pas de bons candidats aux lentilles
de contact
•Estiment que le port de lentilles correctrices les restreint
dans la pratique de sports ou d’activités similaires
•Pensent qu’ils auraient un meilleur aspect esthétique
sans lunettes
•Ils s’inquiètent de ce qu’ils deviendraient s’ils perdaient
ou cassaient leurs lunettes ou leurs lentilles de contact
•Préfèreraient simplement une vision fonctionnelle sans
correction pour obtenir une excellente vision avec des
lentilles correctrices
•Seraient satisfaits si leur acuité visuelle non corrigée
pouvait être améliorée dans une grande mesure, même
si des lentilles correctrices étaient encore nécessaires
•S’adaptent bien au changement
•Sont accommodants ; peuvent accepter d’être déçus
•Ne sont pas perfectionnistes
Tableau 4 : Mauvais candidats à la chirurgie
réfractive
•Âgés de moins de 18 ans
•Réfraction instable/myopie progressive
•Astigmatisme irrégulier avec perte de la meilleure acuité
visuelle corrigée
•Sécheresse oculaire, avec kératopathie ponctuée
ou filaments
•Cataracte
•Herpes simplex
•Maladie maculaire menaçant la vision
(p. ex. rétinopathie diabétique)
•Grossesse
•Attentes irréalistes
•Non désireux de se soumettre à un suivi
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%