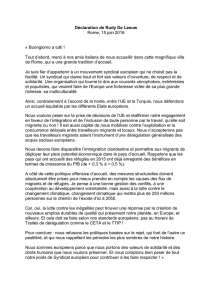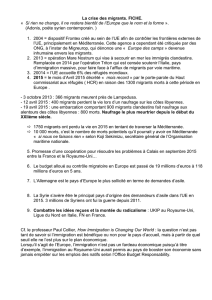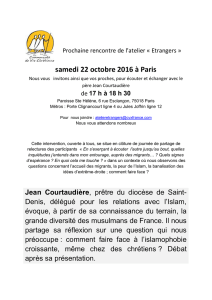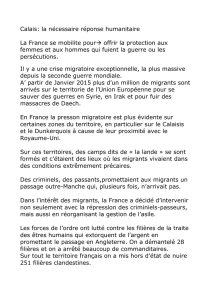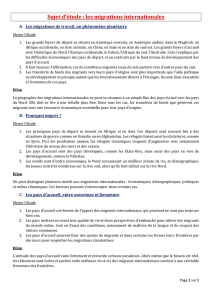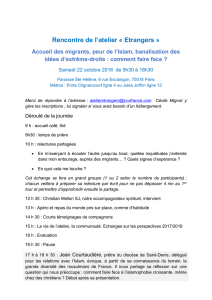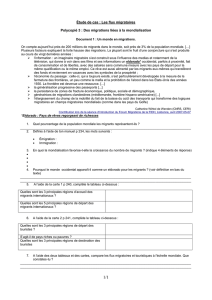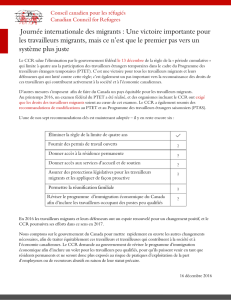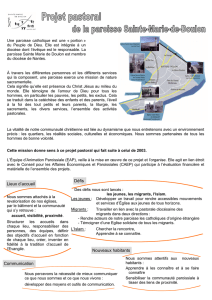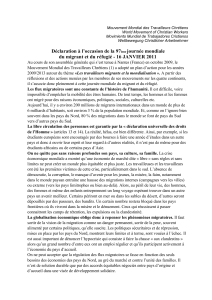Guide des politiques pour le bien-être de tous dans les sociétés

Les migrants et leurs descendants
Guide des politiques
pour le bien-être de tous
dans les sociétés plurielles
Editions du Conseil de l’Europe

Edition anglaise :
Migrants and their descendants – Guide to policies for the well-being of all in pluralist societies
ISBN 978-92-871-6853-5
Les vues exprimées dans cet ouvrage sont de la responsabilité des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la ligne
officielle du Conseil de l’Europe.
Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être traduit, reproduit ou transmis, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit – électronique (CD-Rom, internet, etc.), mécanique, photocopie, enre-
gistrement ou de toute autre manière – sans l’autorisation préalable écrite de la Division de l’information
publique, Direction de la communication (F-67075 Strasbourg Cedex ou publishing@coe.int).
Illustrations : Nicolas Wild
Couverture : Service de la production des documents et publications, Conseil de l’Europe
Mise en page : Jouve, Paris
Editions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
http://book.coe.int
ISBN 978-92-871-6832-0
© Conseil de l’Europe, mai 2011
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe

3
Table des maTières
Avant-propos 5
Introduction 7
Première ParTie – rePenser les PoliTiques envers les migranTs
eT leurs descendanTs 11
Chapitre 1 – Clarifier les discours et les concepts 13
1.1. Introduction aux concepts et aux discours en matière de migrations
et de migrants 13
1.2. Mobilité et migrations 19
1.3. Etrangers, immigrés, descendants 35
1.4. Identités, diversités, cultures 38
Chapitre 2 – Appréhender la logique des politiques et leurs effets 43
2.1. Introduction aux politiques envers les migrants et leurs descendants 43
2.2. Contrôles 52
2.3. Intégration 67
2.4. Bien-être de tous 83
Chapitre 3 – Reconstruire la cartographie des acteurs
et des responsabilités partagées 93
3.1. Introduction aux responsabilités des acteurs dans les processus migratoires 93
3.2. Dénationalisation des pouvoirs étatiques 97
3.3. Réarticulation des pouvoirs étatiques 105
3.4. Délégation des compétences étatiques 108
deuxième ParTie – analyser eT Transformer les sTéréoTyPes Préjudiciables
sur les migranTs eT leurs descendanTs 11 5
Chapitre 1 – Stéréotypes, préjugés et politiques d’immigration :
note méthodologique pour une stratégie d’interaction sociale 11 7
1.1. Stéréotypes et préjugés en tant que dispositifs cognitifs opérant
par réduction et généralisation 117
1.2. Stéréotypes préjudiciables en tant que véhicules d’exclusion sociale 118

4
Les migrants et leurs descendants
1.3. L’ « étranger » comme cible toute désignée de stéréotypes préjudiciables 121
1.4. Les migrants en tant que menace 123
1.5. Les migrants en tant que ressource 127
1.6. Une méthodologie pour l’analyse et la transformation des stéréotypes
préjudiciables 130
Chapitre 2 – Stéréotypes préjudiciables considérant les migrants
et leurs descendants comme une menace pour « notre » sécurité 137
Introduction 137
2.1. « Les migrants augmentent la criminalité » 140
2.2. « Les migrants amènent des maladies dans le pays » 154
Chapitre 3 – Stéréotypes préjudiciables considérant les migrants
et leurs descendants comme une menace pour « notre » bien-être 171
Introduction 171
3.1. « Les travailleurs migrants prennent nos emplois » 172
3.2. « Les travailleurs migrants font baisser nos salaires » 180
3.3. « Les migrants et leurs descendants sont moins formés que nous » 188
3.4. « Les migrants abusent de l’Etat social » 195
3.5. « Les migrants abusent du système de l’asile » 208
Chapitre 4 – Stéréotypes préjudiciables considérant les migrants et leurs descendants
comme une menace pour « notre » manière de vivre 225
Introduction 225
4.1. « Les migrants se croient chez eux » 229
4.2. « Les migrants construisent des sociétés parallèles » 235
4.3. « Les enfants des migrants baissent le niveau de nos écoles » 239
4.4. « Les femmes migrantes vivent en situation de minorité » 252
Chapitre 5 – Stéréotypes préjudiciables considérant les migrants et leurs descendants
comme une ressource pour « notre » compétitivité 265
Introduction 265
5.1. « Les migrants occupent les emplois dont les travailleurs autochtones
ne veulent plus » 266
5.2. « Les migrants vont payer nos retraites » 273
bibliograPhie 283

5
avanT-ProPos
« L’humanité ne peut évoluer sans douleur que si elle se considère elle-même comme ne faisant qu’une, comme une seule
famille, sans se diviser en nations hormis celles héritées de l’histoire et des traditions. »
Andreï Sakharov, Réflexions
Dans le monde d’aujourd’hui, il y a des immigrés dans toutes les sociétés. La migration, qui n’est certes pas un
phénomène nouveau, représente un thème de débat brûlant depuis quelques décennies. L’épineuse question
migratoire occupe désormais une place importante dans la politique et suscite, hélas, un sentiment de peur et
de rejet auprès de nombreux contemporains. La distinction entre « nous » – les ressortissants d’un pays – et
« eux » – les immigrés ou les étrangers – est devenue familière.
Comment ne pas s’inquiéter devant l’attitude de certains hommes politiques qui, pour accroître leur popularité,
multiplient les déclarations xénophobes et nationalistes et les mesures radicales de lutte contre l’immigration ?
Leurs propositions rencontrent un franc succès. Tout cela n’est pas sans conséquence. En effet, de plus en
plus, les immigrés font l’objet de stéréotypes préjudiciables qui compromettent leur intégration. Cela éloigne,
pour chacun de nous, la perspective d’une société dont tous les membres seraient traités sur un pied d’égalité,
où l’égalité des chances serait bien réelle et où chacun pourrait vraiment bénéficier de tout ce à quoi il peut
prétendre.
Le processus migratoire ne va pas s’arrêter, malgré tout ce qui est fait pour le ralentir ou l’empêcher. Il fait
partie intégrante de la mondialisation et de la réalité du XXIe siècle. Immigrés et autochtones vont continuer
à vivre côte à côte. Il est donc essentiel de faire en sorte que cette cohabitation soit bénéfique pour tous.
La solution pour promouvoir la tolérance envers les migrants consiste à favoriser la compréhension du phé-
nomène migratoire chez les responsables politiques et pour l’ensemble de la population. La connaissance est
essentielle pour surmonter les barrières artificielles créées entre ressortissants du pays d’accueil et immigrés.
Il convient de replacer les migrations dans leur contexte sociologique, historique et géographique, et de bien
comprendre que la décision d’émigrer résulte d’un ensemble de facteurs complexes qui ne se limitent pas à la
pauvreté. De leur côté, les autochtones ont tendance à s’inquiéter des conséquences d’une immigration mas-
sive pour la sécurité et le système de protection sociale de leur pays. Face à eux, les immigrés ont également
des motifs de préoccupation : regroupement familial, absence de statut juridique dans certains cas, difficultés
d’accès aux services sociaux, sécurité individuelle ou perte de repères.
Plutôt que de considérer les immigrés comme une « communauté », ce qui repose sur des stéréotypes et conduit
à des généralisations, nous devrions apprendre à voir dans chaque immigré un individu unique, un être humain
qui a sa propre histoire, son expérience, ses qualités et ses espoirs d’avenir. Essayer de comprendre les migrants
et d’en apprendre davantage sur les problèmes relatifs à la question migratoire paraît essentiel.
Quelle est l’image des migrations dans les sociétés actuelles ? Quels sont les parcours des migrants avant
d’arriver dans les pays d’accueil et une fois sur place ? Quelle différence pouvons-nous faire entre les concepts
d’immigré et d’étranger ? Comment les politiques d’immigration et d’intégration en vigueur sont-elles conçues ?
Quels sont leurs objectifs et leurs effets ? Quelles sont les parties prenantes aux stratégies migratoires ? Quels
sont les principaux stéréotypes sur les immigrés et comment en venir à bout ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
1
/
313
100%