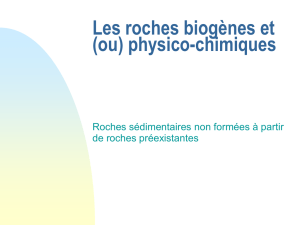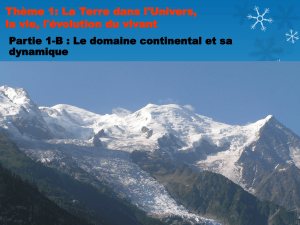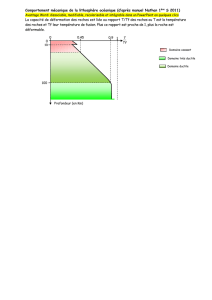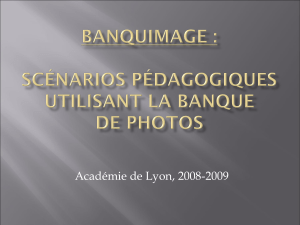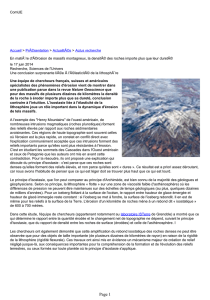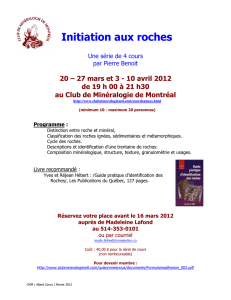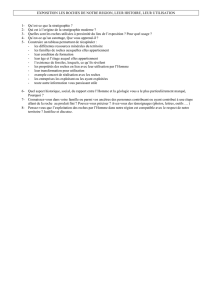TP 4 Isostasie et dynamique de la lithosphère continentale

• 28
TP 4 Isostasie et dynamique de la lithosphère continentale – Le modèle de PRATT
La caractérisation
du domaine
continental :
lithosphère
continentale,
reliefs et
épaisseur
crustale (1-B-1)
Problématique
scientifique
Dans la première moitié
du XVIIIe siècle, le géo-
physicien Pierre BOUGUER
(1698 – 1758) constate que
l’intensité de la pesanteur
qu’il mesure dans les zones
de montagnes est infé-
rieure à la valeur théorique
calculée pour ce genre de
région. Cette différence a
été qualiée d’anomalie
de Bouguer négative. Elle
conduit à l’idée que dans
les zones montagneuses,
le relief, qui constitue un
excédent de masse, serait
compensé en profondeur
par un décit de masse.
Cette compensation per-
mettrait aux roches de la
surface terrestre de reposer
en équilibre sur des roches
plus profondes. Comment
représenter cet équilibre à
l’aide d’un modèle ?
Mode opératoire
Avant le TP
Pendant le TP
Les anomalies gravimétriques mises en évidence par
P. BOUGUER ont conduit plus tard à deux modèles
différents illustrant l’équilibre entre lithosphère et
asthénosphère (NB : entités inconnues à l’époque) :
celui de PRATT (1854) et celui d’AIRY (1855).
On réalise à l’aide de la maquette le montage qui
correspond au modèle de PRATT. Le résultat est
représenté par un schéma légendé et commenté.
La maquette est notamment composée de plots
de couleur jaune de masse identique (55 g envi-
ron). Chaque plot comprend deux parties creuses
qui coulissent : on peut ainsi « étirer » un plot
sans changer sa masse, on fait alors varier la masse
volumique (ρ) du plot.
Exemple de consigne donnée aux élèves :
Utilisez le matériel fourni pour réaliser, à partir des
informations ci-dessous, le montage illustrant le
modèle formulé par PRATT. Le montage conçu sera
représenté par un schéma (ou une photographie)
légendé(e) et commenté(e).
Informations à exploiter :
L’isostasie implique qu’au-dessus d'une certaine
profondeur, appelée surface de compensation, la
masse des roches supercielles est partout la même
quelle que soit l'altitude des reliefs. En dessous du
niveau de compensation, il n'y a pas de variations
signicatives de densité. Le modèle de PRATT (1854)
suggère que les montagnes sont composées de
matériaux plus légers que celui des plaines (ou des
océans), ce qui explique le décit d'attraction. Le
modèle suppose qu’au-dessus d’un certain niveau
uniforme, les variations d’altitude s’expliquent par
des variations latérales de masse volumique. Plus
cette dernière est grande, plus la hauteur du relief
est faible et inversement.
Exemple de résultat (les plots utilisés ont la même masse mais ont été plus ou moins « étirés »).
28.indd 28 28/08/12 11:05

29 •
TP de Sciences de la Terre
Matériel nécessaire Ré-
fé-
Modèle de l’isostasie
sur mousse Réf. 507 059
Balance élève écono-
mique 200g / 0,1g
BL-202 Réf. 701 059
Retrouvez le TP
sur www.jeulin.fr
TS
le
TP 4 Isostasie et dynamique de la lithosphère continentale – Le modèle de PRATT
Résultats et exploitations
En résumé
Pour aller plus loin
Le modèle de PRATT prévoit l’existence, en
profondeur, d’une surface de compensation
horizontale. Les roches superficielles ter-
restres (« plots jaunes »), organisées en co-
lonnes, n’auraient alors pas toutes la même
densité : celles au cœur du relief seraient
moins denses que celles situées en plaine.
Elles reposeraient toutes sur des roches plus
denses en profondeur (« mousse noire »).
En poussant la réflexion plus loin, on peut
illustrer le modèle formulé par AIRY et
le confronter à celui de PRATT. Les roches
superficielles (représentées par des plots
jaunes) ont toutes la même densité et re-
posent sur des roches plus denses (repré-
sentées par des plots rouges, plus lourds).
Seul le modèle d’AIRY envisage une racine
profonde située sous le relief positif d’une
chaîne de montagnes.
Au relief positif qu'est la chaîne de mon-
tagnes, répond, en profondeur, une impor-
tante racine crustale. Le modèle de PRATT
ne rend pas compte de cela, contrairement
au modèle d’AIRY.
La maquette peut être à nouveau utilisée dans le cadre d’autres notions dont voici quelques
suggestions :
- La disparition des reliefs par érosion se traduit par une remontée de la racine de la chaîne
de montagnes (Thème 1-B-4 - La disparition des reliefs). Cet aspect peut aussi être traité
dans la cadre du rebond post-glaciaire observé en Scandinavie actuellement :
- Les dorsales constituent des zones de fort flux thermique, grâce à la présence du man-
teau de l’asthénosphère près de la surface (décompression adiabatique). Ce phénomène
s’observe aussi dans les zones de rift (Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains / Thème
2-A - Géothermie et propriétés thermiques de la Terre) et permet la fusion partielle des péri-
dotites de l’asthénosphère par décompression adiabatique du manteau.
Trucs et astuces
Afin de réaliser aisément un
schéma légendé à l’échelle
du montage réalisé, on peut
placer un transparent sur une
des façades de la maquette
et dessiner dessus à l’aide de
feutres adaptés.
28.indd 29 28/08/12 11:05
1
/
2
100%