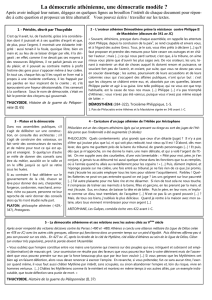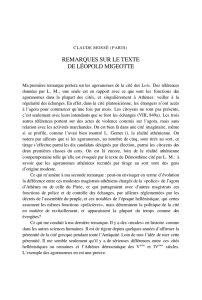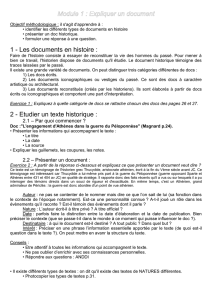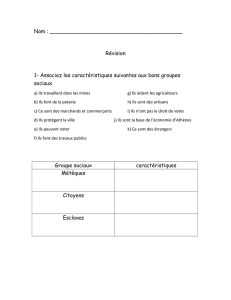T08 - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE DE LA GRÈCE
depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin de la génération
contemporaine d’Alexandre Le Grand
George Grote
traduction d’Alfred Sadous
HUITIÈME VOLUME

CHAPITRE I — DEPUIS LA TRÊVE DE TRENTE ANS, QUATORZE ANS
AVANT LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE, JUSQU’AU BLOCUS DE
POTIDÆA, L’ANNÉE QUI PRÉCÈDE CETTE GUERRE.
Les changements judiciaires effectués à Athènes par Periklês et Ephialtês, que
nous avons décrits dans le dernier chapitre du volume précédent, donnèrent à
une proportion considérable des citoyens les fonctions directes de jurés et un
intérêt actif dans la constitution, tels qu’ils n’en avarient jamais possédé
auparavant de pareils ; ce changement étant à la fois une marque du
développement antérieur du sentiment démocratique dans le temps passé et une
cause de son développement ultérieur dans l’avenir. Le peuple athénien était à
cette époque prêt à faire des efforts personnels dans toutes les directions. Le
service militaire sur terre ou sur mer n’était pas moins conforme à ses
dispositions que la présence fréquente à l’ekklêsia ou au dikasterion à l’intérieur.
Le service naval particulièrement fut suivi avec un degré d’assiduité qui opéra un
progrès continu en habileté et en efficacité ; en même temps les citoyens plus
pauvres, dont il était surtout composé, étaient plus exacts à obéir et à se
conformer à la discipline qu’aucune des personnes plus opulentes d’où l’on tirait
l’infanterie et la cavalerie1. La multitude maritime, outre la confiance en elle-
même et le courage, acquérait par cette éducation laborieuse une plus grande
habileté, qui chaque année plaçait de plus en plus la flotte athénienne au-dessus
du reste de la Grèce. Et la perfection de ces forces navales devenait d’autant plus
indispensable que l’empire athénien était alors limité de nouveau à la mer et aux
villes ports de nier ; les revers qui précèdent immédiatement la trêve de Trente
ans ayant détruit tout l’ascendant sur terre qu’Athènes exerçait sur Megara, la
Bœôtia et les autres territoires continentaux attenant à l’Attique.
La confédération maritime, — commencée dans l’origine à Dêlos, sous
l’hégémonie d’Athènes, mais avec une assemblée commune et une voix
délibérative appartenant à chaque membre, — s’était alors transformée en un
empire assuré appartenant à Athènes, sur les autres États comme dépendances
étrangères ; tous payant tribut, excepté Chios, Samos et Lesbos. Ces trois États
restaient encore sur leur pied primitif d’alliés autonomes, et conservaient leurs
forces armées, leurs vaisseaux et leurs fortifications, — avec l’obligation de
fournir des secours en soldats et en vaisseaux quand on les leur demandait, mais
non de payer un tribut. Toutefois la cessation de l’assemblée délibérative les
avait privés de leur ancienne garantie contre les empiétements d’Athènes. J’ai
déjà exposé en général les mesures (nous ne les connaissons pas en détail) au
moyen desquelles fut effectué cet important changement, par degrés et sans
aucune révolution violente, — car même la translation du trésor commun de
Dêlos à Athènes, qui était le signe et la preuve les plus palpables du
changement, ne fut pas un acte de violence athénienne, puisqu’il fut adopté sur
la proposition des Samiens. Dans le fait, le changement fut le résultat presque
inévitable des circonstances du cas et de l’ardente activité des Athéniens mise en
contraste avec la répugnance et l’aversion pour un service personnel de la part
des alliés. Nous devons nous rappeler que la confédération, même dans sa
structure originelle, était formée pour des objets permanents, et qu’elle liait
d’une manière permanente par le vote de sa majorité, à l’instar de la
1 Xénophon, Memorab., III, 5, 18.

confédération spartiate, chaque membre individuellement1. Elle était destinée à
éloigner la flotte persane et à faire la police de la mer Ægée. Conformément à,
ces objets, aucun membre individuel ne pouvait être autorisé à se retirer de la
confédération et à acquérir ainsi l’avantage d’une protection aux dépens des
autres : de sorte que quand Naxos et d’autres membres se séparèrent
réellement, cette démarche fut considérée comme une révolte, et Athènes ne fit
qu’accomplir son devoir de président de la confédération en les réduisant. Par
toute réduction pareille, aussi bien que par cet échange de service personnel
contre un payement en argent, que recherchèrent volontairement la plupart des
alliés, le pouvoir d’Athènes s’accrut, jusqu’à ce qu’enfin elle se trouvât avec une
flotte irrésistible au milieu de tributaires désarmés, dont aucun ne pouvait
échapper à l’étreinte de son pouvoir, — et maîtresse de la mer, dont l’usage leur
était indispensable. L’assemblée de Délos, même n’eût-elle pas auparavant été
partiellement abandonnée, devait avoir cessé à l’époque où le trésor fut
transporté à Athènes, — probablement vers 460 avant J.-C., ou peu de tempe
après.
Les relations entre Athènes et ses alliés changèrent ainsi considérablement, par
une série d’actes qui se déroulèrent graduellement et se succédèrent les uns aux
autres sans aucun plan préconçu. Elle devint cité reine ou despote ; gouvernant
un agrégat de sujets dépendants, tous sans leur concours actif, et dans bien des
cas sans doute contrairement à leur sentiment de droit politique. Il n’était pas
vraisemblable qu’ils conspireraient unanimement pour briser la confédération, et
qu’ils cesseraient la levée de la contribution fournie par chacun des membres ; et
il n’eût été nullement désirable qu’ils le fissent, car pendant que la Grèce en
général aurait beaucoup perdu par une telle conduite, les alliés eux-mêmes y
auraient perdu plus que personne, en ce qu’ils auraient été exposés sans défense
à la flotte persane et à la flotte phénicienne. Mais les Athéniens commirent la
faute capitale de prendre toute l’alliance dans leurs mains, et de traiter les alliés
purement comme des sujets ; sans chercher à se les attacher par aucune forme
d’incorporation politique ni d’assemblée et de discussion collectives. — sans
prendre aucune peine pour entretenir une communauté de sentiment ou d’idée
quant à la communauté d’intérêt, — sans admettre aucun contrôle, réel ou
même supposé, sur eux-mêmes comme administrateurs. S’ils avaient tenté de le
faire, ils auraient eu de la peine à y réussir, — tant étaient puissantes la force de
dissémination géographique, la tendance à une vie civique isolée et la
répugnance à toute obligation permanente en dehors de ses murs, dans toute
communauté grecque. Mais il ne parait pas qu’ils l’aient jamais essayé. Trouvant
Athènes élevée à l’empire par les circonstances et les alliés rabaissés à l’état de
sujets, l’homme d’État athénien embrassait l’élévation comme un objet d’orgueil
aussi bien que de profit2. Periklês lui-même, le plus prudent parmi eux et celui
qui voyait le plus loin, ne montra pas qu’il eût conscience qu’un empire sans le
ciment de quelque intérêt ou de quelque attachement qui dominât
universellement, ne fût-il pas oppressif dans la pratique, devait néanmoins avoir
une tendance naturelle à devenir de, plus en plus impopulaire, et finir par tomber
en pièces. Tel fut le cours des événements qui, si l’on eût suivi les judicieux
conseils de Periklês, aurait été ajourné, bien qu’il n’eût pu être détourné.
Au lieu d’essayer de favoriser ou de ranimer les sentiments d’une alliance égale,
Periklês la désavoua formellement. Il soutint qu’Athènes ne devait pas compte à
1 Thucydide, V, 30, au sujet de la confédération spartiate.
2 Thucydide, II, 63.

ses sujets alliés de l’argent qu’elle recevait d’eux tant qu’elle exécutait son
contrat en tenant l’ennemi persan éloigné et en maintenant la sécurité sur les
eaux de la mer Ægée1. Telle était, comme il le disait, l’obligation qu’Athènes
s’était imposée ; et pourvu qu’elle la remplît fidèlement, les alliés n’avaient pas
le droit de faire de questions ni d’exercer un contrôle. Qu’elle fût accomplie
fidèlement, personne ne pouvait le nier. On ne voyait jamais de vaisseau de
guerre, excepté ceux d’Athènes et de ses alliés, entre la côte orientale et la côte
occidentale de la mer Ægée. Une flotte athénienne de soixante trirèmes était
continuellement de service dans ces eaux, montée surtout par des citoyens
athéniens, et utile aussi bien par la protection qu’elle donnait au commerce que
parce qu’elle assurait aux marins une paye et un exercice constants2. Et la
surveillance maintenue effectivement fut telle que, dans la période désastreuse
qui précéda la trêve de Trente ans, quand Athènes perdit Megara et la Bœôtia, et
eut de la peine à recouvrer l’Eubœa, aucun de ses nombreux sujets maritimes
n’en prit occasion pour se révolter.
Le total de ces cités tributaires distinctes montait, dit-on, à mille, suivant un vers
d’Aristophane3, ce qui peut ne pas être au-dessous de la vérité, bien que cela
puisse être, et que ce soit probablement beaucoup au-dessus. Le tribut annuel
total levé au commencement de la guerre du Péloponnèse, et probablement
aussi pour les années précédentes, était, d’après Thucydide, d’environ six cents
talents. Toutefois, quant aux sommes payées par des États particuliers, nous
avons sur ce point peu ou pas de renseignements4. Il était placé sous la
1 Plutarque, Periklês, c. 12.
2 Plutarque, Periklês, c. 11.
3 Aristophane, Vesp., 707.
4 L’île de Kythêra fut conquise par les Athéniens sur Sparte en 425 avant J.-C., et le tribut annuel
qui lui fut imposé alors était de quatre talents (Thucydide, IV, 57). Dans l’inscription n° 143, ap.
Bœckh, Corp. inscr., nous trouvons énumérés quelques noms de villes tributaires avec le montant
du tribut en face de chacune ; mais la pierre est trop endommagée pour nous instruire beaucoup.
Tyrodiza, en Thrace, payait mille drachmes ; quelques autres villes, ou réunions de villes, qui ne
sont pas faciles à discerner, sont taxées à mille, à deux mille, à trois mille drachmes, à lui talent,
et même à dix talents. Cette inscription doit être antérieure à 413 avant J.-C., moment où le tribut
fut converti en un droit de 5 p. 100 sur les importations et sur les exportations ; V. Bœckh, Public
Econ. of Athens, et ses notes sur l’inscription mentionnée ci-dessus.
Athènes était dans l’habitude de ne pas toujours taxer chaque cité tributaire séparément, mais
quelquefois d’en réunir plusieurs dans une taxation collective, chacune d’elles étant probablement
responsable pour les autres. Ceci semble avoir provoqué à l’occasion des remontrances de la part
des alliés, pour quelques-unes desquelles on demanda au rhéteur. Antiphôn le discours que les
plaignants devaient prononcer devant le dikasterion : V. Antiphôn, ap. Harpocration, v. Άπόταξις —
Συντελεϊς. Il est bien à regretter que les discours composés par Antiphôn pour les Samothrakiens
et les Lindiens (ces derniers habitant l’une des trois villes séparées dans l’île de Rhodes) n’aient pas
été conservés.
Depuis ma première édition, M. Bœckh a publié une seconde édition de son Économie politique des
Athéniens, avec des additions et des augmentations importantes. Dans ces dernières sont
comprises plusieurs inscriptions (publiées aussi pour la plupart dans les Antiquités helléniques de
Rangabé) trouvées récemment à Athènes, et expliquant le tribut levé par l’ancienne Athènes sur
ses alliés sujets. M. Bœckh a consacré plus de la moitié de son second volume (de la page 369 à la
page 747) à un commentaire élaboré destiné à élucider ces documents.
Si nous avions eu la bonne fortune de recouvrer ces inscriptions complètes, nous aurions acquis
une connaissance importante et authentique relativement au système du tribut chez les Athéniens.
Mais on ne peut les lire que très imparfaitement, et elles exigent à chaque pas une restauration
aussi bien qu’une interprétation conjecturale. Pour en tirer une idée logique du système entier, M.
Bœckh a recours à plusieurs hypothèses, qui me paraissent plus ingénieuses que convaincantes.
Les pierres (ou du moins plusieurs d’entre elles) forment une série d’annales appartenant à des
années successives on à d’autres périodes, gravées par les trente Logistæ ou auditeurs (Bœckh, p.
584). Le moment où elles commencent ne peut être déterminé d’une manière positive. Rangabé

surveillance des Hellenotamiæ, officiers appartenant dans l’origine à la
confédération, mais maintenant transférés de Délos à Athènes, et agissant
entièrement comme conseil de finances athénien. La somme totale du revenu
athénien1, provenant de toutes sources, et comprenant ce tribut, au
commencement de la guerre du Péloponnèse, était, selon Xénophon, de mille
talents. Les douanes, les droits de port et de marché, les recettes des mines
d’argent à Laureion, les rentes des biens publics, les amendes résultant de
sentences judiciaires, une taxe par tète sur les esclaves, le payement annuel fait
par chaque metœkos, etc., tout cela peut avoir composé une somme dépassant
quatre cents talents, somme qui, ajoutée aux six cents talents de tribut, ferait le
total nommé par Xénophon. Mais un vers d’Aristophane2, pendant la neuvième
année de la guerre du Péloponnèse (422 av. J.-C.), porte le total général de cette
somme à près de deux mille talents ; c’est selon toute probabilité beaucoup au-
dessus de la vérité, bien que nous puissions raisonnablement croire que le
montant de l’argent levé en tribut sur les alliés avait été augmenté pendant
l’intervalle. Je pense que la duplication alléguée du tribut par Alkibiadês, que
Thucydide ne mentionne nulle part, n’est appuyée par aucune bonne preuve, et
je ne puis croire non plus qu’il soit jamais parvenu à la somme de douze cents
suppose que c’est dans l’Olymp. 82, 1 (452 avant tandis que Bœckh le place à une époque
postérieure, — Olymp., 83, 2, 447 avant J.-C. (p. 594-596). Elles vont, dans son opinion, jusqu’en
406 avant J.-C.
Quant au montant du tribut exigé des alliés ou payé par eux, collectivement ou individuellement,
ces inscriptions ne me paraissent fournir rien de certain ; elles varient d’une manière surprenante
(comme Bœckh le fait observer p. 615, 626, 628, 646) dans les sommes placées vis-à-vis du
même nom. Nous apprenons cependant quelque chose relativement à la classification des alliés
sujets. Ils étaient répartis sous cinq chefs généraux : — 1° Tribut karien. 2° Tribut ionien. 3° Tribut
insulaire. 4° Tribut hellespontique. 5. Tribut thrace. Sous le premier chef, karien, nous trouvons
spécifiés 62 noms de cités ; sous le second, ionien, 42 noms ; sous le troisième, insulaire, 41 ;
sous le quatrième, hellespontique, 50 ; sous le cinquième, thrace, 68. Le total de ces noms (en y
en ajoutant quatre indéchiffrables non réunis à l’une ou à l’autre des classes) forme 267 noms de
cités tributaires (Bœckh, p. 611). Indubitablement tous les noms de tributaires ne sont pas compris
ici. Bœckh supposé qu’on peut se rapprocher du total réel en ajoutant un cinquième en plus,
faisant en tout 334 tributaires (p. 663). Ceci offre un minimum probable, mais guère plus.
Il est fait allusion dans les inscriptions à certaines différences dans le mode de taxation. Quelques
villes se taxent elles-mêmes, d’autres sont inscrites par de simples particuliers sur le rôle du tribut
(p. 613-616). Ces deux chefs (qui se rencontrent dans trois inscriptions différentes) semblent
indiquer une date postérieure de peu au premier établissement du tribut. Il parait que les Klêruchi
athéniens ou citoyens résidant au dehors étaient comptés parmi les tributaires, et étaient imposés
(autant qu’on peut le reconnaître) à la taxe la plus haute (p. 631).
Il y a un petit nombre d’inscriptions dans lesquelles la somme placée en face du nom de chaque
cité est extrêmement élevée ; mais en général la comme consignée est si faible que, selon Bœckh,
elle ne représente pas tout le tribut imposé, mais seulement la petite fraction (suivant lui 120) qui
était payée comme cadeau casuel à la déesse Athênê. Son hypothèse à ce sujet ne repose pas, à
mon avis, sur une bonne preuve, et je ne puis m’imaginer que ces inscriptions nous aident à
découvrir l’agrégat réel du tribut levé. Il parle avec trop d’insistance du lourd fardeau dont ce tribut
chargeait les alliés. Rien dans Thucydide n’autorise cette croyance ; en outré, nous savons
distinctement par lui que jusqu’à l’année 413 avant J.-C., le tribut total était quelque chose de
moins élevé que 5 p. 100 sur les importations et sur les exportations (Thucydide, VII, 28). De
combien était-il au-dessous ? c’est ce que nous ignorons ; mais il n’atteignait certainement pas ce
point. Mitford semble frappé de la légèreté de la taxe (V. une note dans cette histoire, tom. X, ch.
5). Il est possible que les impositions très élevées, qui paraissent sur quelques-unes des pierres
annexées à quelques noms de tributaires insulaires, puissent se rapporter à une date postérieure à
413 avant J.-C. pendant les dernières années de la guerre, quand Athènes luttait au milieu des
maux et des dangers les plus sérieux. Bœckh, p. 547 sqq.
1 Xénophon, Anabase, VII, 1, 27 ; cf. Bœckh, Publ. Econ. of Athens, b. III, ch. 7, 15, 19.
2 Aristophane, Vesp., 660.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
1
/
184
100%