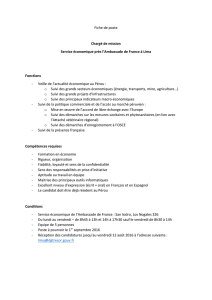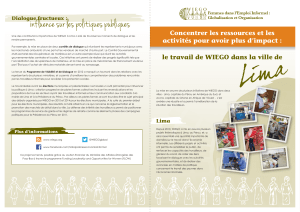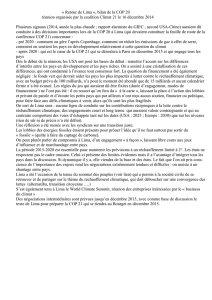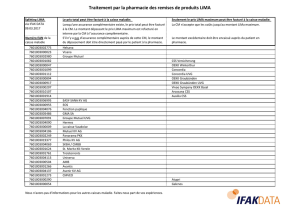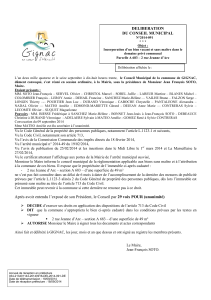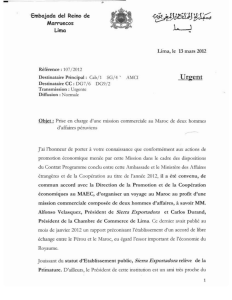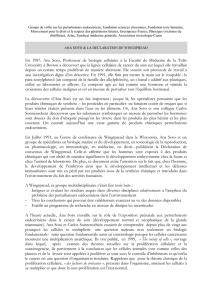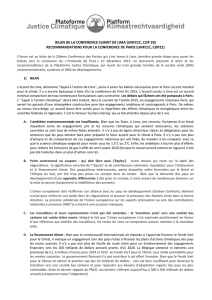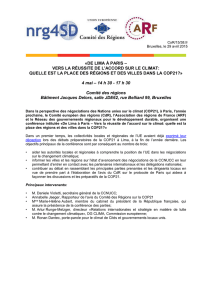activités informelles et développement urbain : une critique à

113
ACTIVITÉS INFORMELLES ET DÉVELOPPEMENT URBAIN :
UNE CRITIQUE À LA NOTION DE CAPITALISME POPULAIRE
À TRAVERS LE CAS DE LIMA
Émilie DORÉ
Docteure en sociologie
EHESS/CADIS, Paris
Résumé
L'économie informelle a fait l'objet de nombreux débats : on a souvent dénoncé ses
conséquences, ou affirmé son potentiel. A travers la critique de la notion de capitalisme
populaire, et en observant le cas de Lima, nous soulignerons un phénomène souvent oublié : la
multiplication des petites initiatives économiques provoque une trop forte concurrence et un effet
de saturation. Les inégalités territoriales et sociales, qui alimentent l'exode rural, entraînent le
renouvellement de la misère urbaine : seule la prise en compte de ces problèmes pourrait inverser
la tendance à la multiplication des petites activités peu rentables.
Resumen
Un intenso debate se ha formado en torno a la economía informal. Se denunció sus
consecuencias, o, al contrario, se afirmó sus potencialidades. A través de une crítica a la noción
de capitalismo popular, y observando el caso de Lima, enfatizaremos la existencia de un
fenómeno que pocas veces se menciona : la multiplicación de las pequeñas iniciativas
económicas provoca un efecto de saturación debido a la fuerte competencia. Las desigualdades
territoriales y sociales, a raíz del éxodo rural, perpetúan y renuevan la miseria urbana. Tomar en
cuenta estos problemas es imprescindible para frenar la tendencia a la multiplicación de
actividades poco rentables.
Abstract
Informal economy has been at the heart of many debates. While its consequences have often been
denounced, its potential has been asserted too. Through a criticism of the notion of popular
capitalism, and taking Lima as an example, this article aims at underscoring an underestimated
phenomenon: The proliferation of small economic activities leads to excessive competition, and
saturation. Territorial and social inequalities, which encourage rural exodus, perpetuate urban
poverty. Acknowledging these problems is essential in order to try and curb this increase in the
number of small enterprises that lack profitability.

114
Introduction
Le terme d'économie informelle est apparu dans les années 1970 pour désigner un phénomène
particulièrement présent dans les pays du Sud : l'existence d'une multitude d'activités
économiques, qui naissent le plus souvent dans les secteurs populaires, et qui émergent en dehors
du cadre législatif des pays concernés1. La notion d'« informalité » s'est répandue dans les
analyses des économistes, puis des sociologues et des anthropologues. Elle a acquis une place
importante dans les politiques publiques et de coopération : d'emblée, en effet, s'est posée la
question du traitement à donner à l'économie informelle. Faut-il l'encourager, la faire disparaître,
essayer de provoquer des changements en son sein, lesquels ? Peut-on s'appuyer sur elle pour
réduire la pauvreté ou créer des emplois ?
Depuis presque un demi-siècle, plusieurs réponses ont été données et ont influencé les politiques
nationales et internationales d'aide au développement.
L'économie informelle : une chance ou un handicap ?
En Amérique Latine, l'économie informelle représente en moyenne 57 % de l'emploi en milieu
urbain et plus de 70 % dans le cas du Pérou (Perry et al., 2007). La ville apparaît comme le lieu
d'émergence de tous les « petits boulots ». Une fois le constat posé, reste à savoir comment
considérer un tel phénomène.
Dans un premier temps, les observateurs ont mis en avant le fait que l'informalité d'un grand pan
des activités économiques était révélatrice d'un « dysfonctionnement » du système économique et
social. C'est souvent en terme de marginalité que se développe cette idée. Une série d'études
financée par le PREALC-OIT dans les années 1980 présentait l'existence d'un important secteur
informel comme le résultat d'un excédent structurel de force de travail provoqué par l'explosion
démographique, les migrations et la mécanisation du secteur « moderne » de l'économie. Selon
ces travaux, les migrants issus de l'exode rural se convertissent en informels en arrivant en ville,
car ils se voient obligés d'inventer des moyens d'obtenir des ressources pour survivre, et se
dirigent pour cela vers des branches où il y a une faible assignation de capital par individu. Dans
cette vision, souvent qualifiée de dualiste, les informels vivent en marge de l'économie moderne,
ils en sont structurellement exclus. Ils ne sont pas vus comme des moteurs de l'économie, et ce
sont les limitations de leurs activités économiques qui sont analysées et mises en avant (voir
notamment Perez-Sainz, 1991). Seule une petite frange de ces entreprises aurait vocation à
devenir plus rentable et à s'accroître.
Mais des visions plus positives apparaissent au cours des années 1980 : l'économie informelle
pourrait jouer un rôle efficace de substitution capable de compenser la perte d'emplois massive
qu'on observe alors dans les grandes et moyennes entreprises du secteur industriel notamment.
Mieux encore, l'économie informelle présenterait des caractéristiques très adaptées aux
1Le critère du non respect de la législation sur les entreprises est le plus souvent mis en avant pour définir les
entreprises informelles, mais certaines instances ajoutent aussi le critère de la taille ; le Bureau International du
Travail recommande de ne prendre en compte comme informelles que les unités regroupant moins de 10 personnes.
Au Pérou pourtant, les entreprises informelles recensées peuvent compter jusqu'à 49 travailleurs. Cependant, il est
clair que plus une entreprise croît, plus elle a des chances, statistiquement, d'être formelle. 75 % des micro-
entreprises (moins de 9 travailleurs au Pérou) sont informelles, et 63% des petites entreprises (de 9 à 49 personnes)
sont formelles (voir Ministerio del Trabajo del Peru, 2005).

115
évolutions de l'économie globale, puisqu'elle est composée en grande partie de micro-entreprises
aux coûts salariaux très faibles, qui sauraient, par leur flexibilité, faire face à la crise et aux aléas
de la conjoncture. Ce point de vue implique que la micro-entreprise informelle n'a pas forcément
vocation à grandir et à devenir une entreprise formelle, puisque c'est justement sa petite taille et
ses faibles coûts qui la garantiraient contre les difficultés ( Cornia, Jolly, Stewart, 1987).
On peut bien sûr objecter qu'une telle vision permet aux Etats de se défausser des problèmes
engendrés par les remous de l'économie en espérant que les chômeurs se débrouilleront seuls
pour se forger un emploi... Mais elle est surtout inopérante : les emplois créés dans l'économie
informelle ne remplacent pas les emplois perdus dans l'économie formelle. Ils ne se situent pas
dans les mêmes secteurs; la substitution ne serait faisable que dans le secteur de l'industrie légère,
et seule une proportion minime de l'emploi urbain pourrait être transféré de l'industrie formelle
aux micro-entreprises (Lautier, 1989).2
La question de la flexibilité des petites unités économiques informelles, censée garantir leur plus
grande compétitivité, est également battue en brêche par plusieurs facteurs : d'abord, il n'est pas
dit que les entreprises informelles soient réellement en concurrence avec les entreprises
formelles, puisqu'elles ne couvrent pas exactement les mêmes activités. Quand c'est le cas, par
exemple dans le secteur de l'industrie légère, les micro-entreprises souffrent souvent d'une
difficulté à faire des produits de qualité, par manque de compétences et d'investissement. De plus,
le faible poids des contraintes juridiques, en matière d'emploi notamment, ne garantit pas que les
patrons et surtout les salariés informels supportent très longtemps une baisse de rentabilité
(Lautier, 2004 : 28).
Si l'informalité et la petite taille des initiatives économiques des secteurs populaires ne leur
permettent pas, en tant que telles, de constituer une alternative viable pour les pays les plus
concernés, alors elles font figure de simples béquilles, qui permettent la survie des plus pauvres...
Certains auteurs ne se sont pas résolus à ce diagnostic pessimiste et ont tâché de découvrir la
pépinière d'opportunités qui se cache derrière l'informalité.
Si les micro-entreprises formées en marge de la législation peinent à être viables, il faut les aider
à croître, et cela passe par leur formalisation. Le dynamisme et l'esprit d'entreprise qui naissent
dans les secteurs les plus défavorisés ne devraient pas être gâchés par des conditions
défavorables : c'est à peu près en ces termes que se pose le problème pour les partisans de ce que
l'on appelle le capitalisme populaire.
Le capitalisme populaire
Hernando De Soto est un économiste péruvien, auteur d'un ouvrage qui, à la fin des années 1980
(De Soto, 1989), a eu un énorme retentissement en Amérique Latine, et a influencé les politiques
publiques au Pérou jusqu'à aujourd'hui. Cet ouvrage promeut la notion de capitalisme populaire.
L'argument de De Soto repose sur deux postulats principaux : les entrepreneurs informels
agissent de façon rationnelle en suivant leurs propres intérêts, ils visent à accroître la rentabilité
2Bruno Lautier montre également que, alors que l'industrie licencie des employés en moyenne assez qualifiés, dotés
d'un niveau de compétences notables, l'emploi informel créé est en majorité lié à un très faible investissement de
départ et à une très faible qualification; il n'absorbe donc que peu les populations qui ont perdu un emploi formel
(Lautier, 2004 : 25 et 95).

116
de leur entreprise ; mais par ailleurs, la législation complexe et pesante, et la bureaucratie en
général, rendent la formalisation de leur activité difficile.
De Soto n'idéalise pas l'informalité, car elle est source de nombreux obstacles pour les
entrepreneurs. Il attribue la lenteur de la consolidation des micro-entreprises à leur impossibilité à
faire valoir leurs droits et à utiliser certaines formules juridiques : par exemple, il note que les
informels ne peuvent pas faire crédit, ni non plus bénéficier d'un crédit, ou bien à taux d'usure, et
ne font pas de réparations ni ne donnent de garanties sur leurs produits. Ils ne disposent pas des
installations nécessaires à la commercialisation de produits sophistiqués, n'ont pas de magasins
adéquats ni de systèmes de sécurité, et tardent à décider de tels investissements à cause du
manque de sécurité dans lequel les plonge l'informalité: leurs biens peuvent être à tout moment
confisqués, et quand ils veulent s'assurer d'un lieu de vente fixe par invasion d'un terrain, les
coûts de cette invasion freinent durablement leurs possibilité d'investir plus directement dans leur
commerce3.
Parallèlement, De Soto croit en la capacité de ces mêmes entrepreneurs à consolider leurs
activités, s'ils avaient la possibilité de la formaliser. Il montre qu'avec le temps, les micro-
entreprises se stabilisent et augmentent leur volume d'activités. Souvent, les petits entrepreneurs
commencent par pratiquer un petit commerce ambulatoire itinérant. Ils achètent un petit chariot à
moindre prix et ils se déplacent avec. S'ils ne peuvent acquérir ce chariot, ils transportent
quelques bibelots dans une boîte qui, ouverte, servira de présentoir. Cette phase est, selon De
Soto, utile à l'observation: le commerçant ou la commerçante apprend à connaître la ville,
« observe quels produits se vendent », « voit d'autres ambulants apparemment plus prospères,
qui travaillent avec des chariots mais au même endroit chaque jour » (De Soto, 1989, p67). Il se
familiarise avec les fournisseurs, apprend de parents ou d'amis plus expérimentés. Il finit par
augmenter ses ventes en identifiant les lieux de passage de ses potentiels clients. L'échelle de ses
activités augmente au fil des années. La boîte devient un chariot, le chariot cède la place à un
kiosque ambulant, puis à un poste plus grand qui n'est plus réellement destiné à être changé de
place. Selon l'auteur, il aspire alors à la stabilité et à la sécurité.
Les commerçants cherchent à se sédentariser, soit en acquérant un bien immobilier, soit en
formant entre eux des contrats tacites d'invasion par lesquels ils s'emparent d'un terrain vague
pour y installer un marché. Ils s'organisent alors en associations de commerçants et sont prêts à
faire front ensemble si les pouvoirs publics tentent de les déloger.
L'hypothèse de De Soto est que sans les freins légaux qui les empêchent de se transformer en
entreprises légalement constituées, les petites initiatives économiques se consolideraient plus vite
et leurs créateurs deviendraient les promoteurs d'un capitalisme populaire à même d'impulser le
développement du pays. Il est donc partisan d'un formalisation des entreprises, mais pour y
parvenir, il préconise que soient grandement simplifiées les procédures d'enregistrement, que
soient allégées les charges fiscales et que la législation sur le travail soit considérablement
assouplie. La « forme imposée devient minimale et molle », comme le note Bruno Lautier
(Lautier, 2004, p101).
3Il est vrai que de façon générale, l'informalité est clairement liée à la pauvreté. Plus un département est pauvre, plus
il compte de travailleurs informels ; par ailleurs, les revenus mensuels d'un travailleur d'une petite entreprise formelle
sont 75% plus élevés que ceux d'une petite entreprise informelle ( voir Ministerio del Trabajo del Peru, 2005).

117
La théorie de De Soto fit de fervents adeptes parmi les libéraux, car elle préconise un accès
facilité à la propriété, un assouplissement des conditions de création d'une entreprise, des charges
et des conditions d'embauche, et une lutte contre la corruption d'Etat qui favoriserait les « groupes
d'intérêts corporatistes » (syndicats, corporations, représentants de salariés de secteurs
traditionnels de l'économie). En 1990, elle inspira la campagne du candidat Mario Vargas Llosa à
l'élection présidentielle au Pérou. De Soto devint ensuite conseiller du Président Alberto
Fujimori, qui lança une vague de déréglementation du droit du travail et travailla à la facilitation
du processus d'enregistrement des entreprises.
Plus de 20 ans après la publication de son ouvrage, c'est un constat d'échec qui doit être tiré.
Entre 1997 et 2003, le nombre de travailleurs informels a augmenté de 4.5 % au Pérou (Perry et
al, 2007, p 5). Les programmes de formalisation sont un échec, car ils n'ont touché qu'un nombre
restreint d'entreprises : celles qui étaient les plus viables, en général. La plupart des micro-
entreprises ne sont guère concernées car elles peinent à atteindre le stade de l'accumulation, et
même à embaucher. Par ailleurs, dans la seule capitale du pays, qui abrite un grand nombre
d'initiatives économiques informelles depuis des décennies, la pauvreté s'est accrue ces dernières
années (elle touchait 31,8 % de la population en 2001, contre 36,6 % en 2004 selon l'Institut
National de Statistiques INEI). Pourtant, le discours des décideurs face à l'informalité reste le
même depuis 20 ans : l'accès à la formalisation semble être la seule réponse, même si un manque
de conviction l'accompagne, et les quelques programmes d'aide économique, tels que les
programmes de micro-crédit, font plutôt l'effet d'un saupoudrage.
Se serait-on trompé de solution? Tout d'abord, s'il est vrai que la bureaucratie est un obstacle à la
formalisation, il est utile de souligner que l'absence de formalité est loin d'être le seul obstacle à
la prospérité des micro-entreprises. Nous souhaitons ici mettre l'accent sur une difficulté majeure
que rencontrent ces initiatives : la concurrence. La plupart des micro-entreprises ne font guère
concurrence aux grandes entreprises formelles, mais plutôt à leurs semblables (Lautier, 2004, p
64-65). Or cette concurrence est redoutable, car si les entreprises sont très petites, elles sont par
contre très nombreuses. Une logique d'imitation sous-tend la plupart des nouvelles initiatives. Le
marché apparaît comme un gâteau que l'on devrait partager en un nombre excessif de parts : il est
émietté à l'extrême.
Ce n'est donc sans doute pas sous l'angle de leur informalité que le problème se pose de façon la
plus aiguë pour les micro-entreprises.
Le problème des « filons »
Le cas des micro-entreprises de Lima illustre les questions que nous venons d'évoquer. Ces
initiatives économiques sont fragmentées, c'est-à-dire que dans la majorité des cas elles sont
individuelles, ou familiales4.
4La fragmentation peut être favorisée par la faiblesse des institutions publiques, par la perte d'identité et de repères
qui peut résulter de la migration, par la violence politique, et par des processus plus subtils qui bloquent la possibilité
de s'identifier à ses voisins, comme l'action de stigmates sociaux et raciaux qui se glissent même dans les relations
entre habitants d'un même quartier (Doré, 2009). Bruno Lautier note aussi qu'en rendant impossible
l'accomplissement des solidarités communautaires obligées (à cause de l'irrégularité et de la faiblesse des revenus),
l'infomalité de l'emploi contribue fortement aux phénomènes d'individualisation. (Lautier, 2004)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%