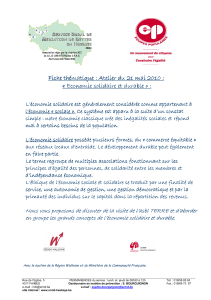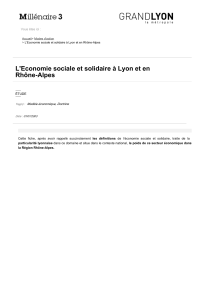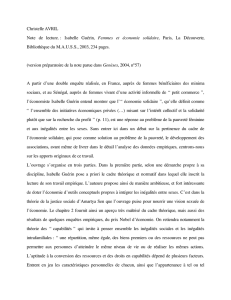économie solidaire et inégalités de genre: une approche en termes

40 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N°289
ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET INÉGALITÉS DE GENRE: UNE APPROCHE
EN TERMES DE JUSTICE SOCIALE
par Isabelle Guérin (*)
Dans quelle mesure l’économie solidaire peut-elle répondre à la délicate
question des inégalités de genre? En s’appuyant sur deux études de cas
empruntées à des contextes aussi variés que la France et le Sénégal, l’auteur
montre que l’économie solidaire, de par sa capacité à repenser l’articula-
tion entre famille, marché, autorités publiques et société civile, offre une
opportunité inédite pour penser la lutte contre les inégalités de genre. D’une
part, l’existence d’espaces intermédiaires permet de socialiser et de mutua-
liser la prise en charge de problèmes qui incombaient jusque-là à la sphère
privée, et donc essentiellement aux femmes. D’autrepart, en permettant
la formulation, l’expression et la revendication des difficultés rencontrées
par certaines catégories de population et en particulier les femmes, diffi-
cultés ignorées ou négligées par le marché ou l’Etat, ces espaces intermé-
diaires pallient les insuffisances d’une justice universaliste, insensible et
aveugle à certaines formes d’inégalités. En même temps, ces pratiques sont
d’une grande fragilité. Sila prudence est donc de mise, soutenir ce type
d’actions est pourtant primordial dans le but d’élaborer des choix collectifs
qui ne soient pas dictatoriaux, mais respectueux des préférences personnelles.
●
D
eplus en plus, à l’échelle mondiale, face aux carences de l’Etat et
du marché, le recours à l’économie solidaireapparaît comme la solu-
tion qui s’impose pour « réencastrer » l’économique dans le social
et dans le politique. Mais quels sont les enjeux de l’économie solidaire face
aux inégalités entre sexes? Curieusement, cette question pourtant cru-
ciale a été peu étudiée jusqu’à présent. Il devient urgent d’analyser la place
et le rôle des femmes dans ce mouvement en plein essor, les opportunités
et les perspectives offertes, mais aussi les dangers et les écueils possibles.
Commençons par un premier constat: au Nord comme au Sud, bon nombre
de pratiques d’économie solidaire sont animées par des femmes et desti-
nées à des femmes. Face à la délicate conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle, face à des responsabilités matérielles croissantes, face aux
difficultés d’accès à la propriété et au crédit, les femmes sont souvent les
premières à se mobiliser et à s’auto-organiser. C’est le cas notamment dans
les domaines de l’alimentation et de la nutrition (groupements d’achat,
épiceries sociales, restaurants, services de traiteur,cuisines collectives, banques
(*) Institut de recherche pour le
développement (laboratoire Popu-
lation, environnement, développe-
ment), université de Provence,
Marseille.

L
’économie sociale en mouvement
céréalières), de la couture et de l’entretien du linge (laverie, retouche, repas-
sage, magasin de mode), de la santé et des services de soins à autrui (garde
d’enfants, soins aux personnes âgées), des relations avec les administrations
et l’environnement institutionnel (services de médiation), du commerce,
de la production et de l’artisanat, de l’épargne, du crédit et de l’assurance,
de l’éducation et de la formation (alphabétisation, transferts de connais-
sances et de savoir-faire) et enfin de la culture et de la communication
(espaces d’expression politique et culturelle). Au-delà des spécificités natio-
nales et de la diversité des appellations, quoi de commun entre toutes ces
expériences et quelles perspectives offrent-elles? En nous appuyant sur des
observations empiriques approfondies menées en France et au Sénégal,
nous proposons les hypothèses suivantes. Ces différentes expériences se
présentent d’abord comme un moyen de soulager le quotidien des femmes
qui les animent, poussées avant tout par le besoin et la nécessité. L’allége-
ment de leurs obligations par leur mise en commun et l’amélioration du
quotidien sont un premier résultat en soi. Néanmoins, le véritable enjeu
nous semble résider au-delà, dans leur capacité à articuler l’économique au
politique en dépassant l’opposition entre espace privé-domestique et espace
public. Cette articulation – même si elle est délicate et encorebalbutiante –
offre une réponse aux défis actuels de la justice sociale.
●
L’économie solidairecomme mode de démocratisation
des pratiques économiques
L’économie solidaire a progressivement été définie de manière empirique,
àpartir des pratiques des acteurs. Au sens le plus large, elle désigne l’en-
semble des pratiques économiques contribuant à démocratiser l’économie
(Laville, 1999), et ce processus de démocratisation s’appuie sur deux méca-
nismes. Le premier concerne l’hybridation des ressources (marchandes, non
marchandes et non monétaires). Miser sur cette hybridation suppose de
reconnaître la pluralité des formes d’agir économique – échange marchand,
action publique via la redistribution et échange réciprocitaire – et d’accor-
der aux pratiques réciprocitaires et de soins à autrui un statut à part entière
ne les considérant ni comme un résidu de la tradition propre aux sociétés
exotiques ni comme une vertu féminine se déployant uniquement au sein
de l’espace domestique, mais comme une véritable forme d’agir économique.
Le second mécanisme réside dans la construction conjointe de l’offre et de
la demande à partir d’espaces publics de proximité permettent une réarti-
culation de l’économique au social et au politique (Eme et Laville, 1994).
Qu’une pratique économique soit solidaire implique donc nécessairement
un ancrage politique, même si celui-ci est plus ou moins explicite.
Pour une justice sociale pluraliste
Les renouvellements récents des théories de la justice sociale, en particulier
les travaux d’Amartya Sen, ont bien montré que la démocratisation des
41
N° 289 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Economie solidaire et inégalités de genre : une approche en termes de justice sociale
42 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N°289
pratiques économiques était le seul moyen d’avancer vers une société plus
juste tout en restant efficace(1).L’approche en termes de « capabilités » pro-
posée par Sen porte sur les inégalités d’aptitude à la conversion des droits
formels en liberté réelle : l’universalité des droits, en dépit de l’idée d’éga-
lité qui lui est attachée, peut se révéler foncièrement inégalitaire. Les femmes
souffrent particulièrement de cette forme d’inégalité : le poids des obliga-
tions familiales, dont les femmes ont principalement la charge quels que
soient les contextes, est un premier obstacle, sans pour autant être le seul.
Entre en jeu également la capacité des femmes à prendre conscience de
leurs droits et à les faire valoir. Or cette capacité s’exerce de manière très
disparate. Elle fait appel à des d’aptitudes cognitives, de plus en plus néces-
saires du fait d’un environnement institutionnel toujours plus complexe.
Elle fait aussi appel au jugement moral de chacune (« A quoi ai-je
droit ? »,« Dans quelle mesure suis-je responsable de ma situation ? »). Du
fait de cette disparité, comment faire en sorte que les personnes – hommes
ou femmes – soient en mesure de convertir leurs droits, pour reprendre
l’expression de Sen, et comment compenser le caractère inégalitaire d’une
justice universaliste, et donc aveugle aux difficultés éprouvées par certaines
personnes, en raison de particularités individuelles ou sociales, pour trans-
former leurs ressources et leurs droits en de réelles potentialités?
Face à ces différentes questions, un premier élément de réponse consiste à
admettrequ’il n’existe pas de critères objectifs de validité en matière de jus-
tice sociale. La définition du juste et de l’injuste et, plus globalement, celle
de l’intérêt général ne peuvent relever uniquement d’une harmonisation
spontanée entreintérêts individuels et collectifs ou d’une solution unique
imposée par une autorité supérieure. Ces définitions sont nécessairement
le fruit d’un processus pluraliste. Un pluralisme moral, au sens où il existe
une diversité de conceptions du « bien », y compris au sein de la commu-
nauté scientifique, dont l’objectivité absolue est un leurre. Un pluralisme
politique, au sens où c’est l’action collective, représentative des intérêts des
différents groupes sociaux, qui permet de respecter la diversité des valeurs.
Ce pluralisme n’est pas seulement une garantie de liberté individuelle : il
conditionne l’efficacité économique puisqu’il permet l’expression et la for-
mulation des besoins économiques, leur revendication et parfois leur réso-
lution. Processus démocratique et croissance économique sont donc
indissociables puisque les deux processus se nourrissent mutuellement.
Amorcée par la philosophie pragmatiste, longtemps évincée par une approche
positiviste préoccupée par la recherche d’une solution ultime et objective
– dont la théorie du bien-être représente l’apogée –, cette conception
pluraliste de la justice sociale tend aujourd’hui à être réhabilitée(2).
Comment mettre en œuvre une justice sociale pluraliste?
La réponse de l’économie solidaire
Sen ne se prononce pas, ou peu, sur les moyens de susciter un dialogue
social efficace. Il est conscient des difficultés, mais se contente d’évoquer
l’importance de l’action collective, le rôle du multipartisme et la nécessité
(2) Pour des travaux en langue
française, citons en particulier
J. Affichard et J.-B. de Foucault
(1995), S. Mesure et A. Renaut
(1999) et J.-M. Monnier (1999).
(1) Nous nous appuyons ici sur Sen,
1984, 1993 a,2000 a,2000 b.

L
’économie sociale en mouvement
d’une opposition organisée (Sen, 2000 b,p. 160 sqq.). Une première piste,
suggérée par Robert Salais (1998) lorsqu’il cherche à prolonger la théorie
des capabilités de Sen ainsi que par d’autres travaux qui reconnaissent les
limites d’une justice universaliste (3),consiste à faire appel à la décentrali-
sation et la déconcentration de l’offre publique de justice. Déjà à l’œuvre
dans plusieurs domaines, de manière inégale selon les pays en fonction du
degré de décentralisation, ce mode d’allocation des biens et des droits,
qualifiée par Jon Elster de « justice locale »,ne peut être que partiel et condi-
tionné à sa capacité à pallier les incomplétudes d’une justice redistribu-
tive globale, celle-ci étant chargée de veiller à d’éventuelles inégalités entre
les niveaux locaux et de limiter une trop forte souveraineté locale (Elster,
1992). Une seconde piste, complémentaire de la première et plus ambi-
tieuse, consiste à penser conjointement la démocratisation de l’écono-
mie que Sen appelle de ses vœux avec une démultiplication des formes de
protection sociale. Cela revient à parier simultanément sur une protec-
tion sociale plurielle et sur une économie plurielle, en misant sur une
répartition des responsabilités entre marché, autorités publiques et société
civile. L’idée n’est en fait pas complètement nouvelle : elle ne fait que
renouer avec la pensée associationniste de la findu XIXeet de la première
moitié du XXesiècle, développée aussi bien par la philosophie pragmatiste,
en particulier celle de John Dewey (Bazzoli, 1994 ; Chanial, 2001), que
par des socialistes comme Marcel Mauss ou des libéraux comme Alexis de
Tocqueville (Ferraton, 2002). Si elle apparaît en filigrane dans les travaux
de Sen, elle est beaucoup plus explicite chezles théoriciens de la justice
qui se réclament d’un «libéralisme communautaire » et dont Michaël Walzer
est le chef de file (Chanial, 2001). Cette idée de pluralisme et de démo-
cratisation de l’économique par la société civile est également au cœur des
pratiques se réclamant de l’économie solidaire. Une piste possible – c’est
du moins l’hypothèse défendue ici – consiste à dépasser les frontières
usuelles entre le privé-domestique et le public, entrele monétaire et le
non-monétaire, et à encourager la création d’espaces intermédiaires. L’éco-
nomie solidairepropose cette voie. Nul ne songe à contester la pertinence
d’une liberté exprimée en termes de droits formels. Si celle-ci est
incontournable et qu’il reste encore de nombreux efforts à faire pour
l’étendre, notamment au Sud, elle n’en reste pas moins insuffisante. Si
conquérir des droits reste un préliminaire incontournable, les faire vivre
doit être l’objectif à atteindre. A ne pas s’interroger sur leur mise en pra-
tique, on court le risque d’aboutir à une autonomie inachevée, voire
sans consistance. L’économie solidaire répond à plusieurs enjeux décisifs
pour l’égalité entre hommes et femmes.
Les enjeux de l’économie solidaire par rapport
aux inégalités de genre
T
out d’abord, elle participe à la revalorisation des comportements de soin
àautrui et de réciprocité ; reconnaître que ces comportements participent
au bien-être individuel et social et qu’ils sont un facteur d’épanouissement
43
N° 289 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
(3) Voir, par exemple, J. Affichard
et J.-B. de Foucault (1995),
J.-M. Monnier (1999).

Economie solidaire et inégalités de genre : une approche en termes de justice sociale
44 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N°289
personnel est vraisemblablement le seul moyen de parvenir à un partage
plus égalitaire des obligations familiales. Réduire le don à une prétendue
vertu féminine revient à leur assigner l’essentiel des obligations familiales,
or on sait bien que c’est dans la division sexuée du travail domestique que
réside le nœud des inégalités, l’épicentre de la domination masculine. En
outre, reconnaître la nécessité des pratiques réciprocitaires est aujourd’hui
le seul moyen de sortir du dualisme Etat-marché, dont on est bien
obligé d’admettre qu’il n’est plus à même de fournir des réponses à la mon-
tée des inégalités et aux difficultés d’intégration sociale. Au Nord, le cercle
vertueux de l’époque fordiste reposant sur la synergie Etat-marché n’est
plus qu’une parenthèse de l’histoire. Au Sud, cette synergie n’a jamais réel-
lement fonctionné. Pallier l’épuisement ou l’inexistence des ressources
publiques n’est pas le seul enjeu. Le don contre-don, Marcel Mauss l’a
remarquablement montré, est à la base du fonctionnement de toute société,
quelle qu’elle soit. Tout simplement parce que l’existence et la dignité de
chacun d’entre nous passent par cette triple capacité à donner, à recevoir
et à rendre et parce que la cohésion sociale repose sur l’aptitude des per-
sonnes à échanger sur la base de réciprocités.
Ensuite, les pratiques d’économie solidaire reposent sur la synergie entre
liberté économique et liberté politique et se présentent comme des
lieux de dialogue social. C’est en dépassant les frontières usuelles entre
espaces privés-domestiques et espaces publics que ce dialogue social est
possible. Hier, dans les sociétés dites modernes, l’espace public était le
lieu par excellence de la liberté, de l’égalité et du progrès. Il n’était donc
pas concerné par ce qui se jouait dans l’espace privé, par ses égoïsmes, ses
injustices ou même ses violences, négatrices de l’autonomie individuelle.
On assiste aujourd’hui à un brouillage des frontières. Que l’Etat de droit
se préoccupe des injustices intrafamiliales est déjà un premier pas. Mais
les personnes elles-mêmes ont besoin d’espaces intermédiaires, propices
àune forme d’autogestion collectivedes problèmes particuliers de cha-
cun ainsi qu’à l’expression et à la revendication des besoins. En facilitant
la lisibilité des inégalités et la reconnaissance de leur caractèremultidi-
mensionnel, ces espaces jouent en quelque sorte une justice de proximité,
au sens où ils adaptent les droits formels aux exigences locales, en répon-
dant à une triple finalité : évaluer l’autonomie réelle des personnes, les
aider à prendre conscience de leurs droits et à convertir ces droits en réelles
potentialités et enfin concilier la promotion de l’idéal d’autonomie avec
celle d’appartenance. La pertinence de l’économie solidaire consiste
précisément à articuler une justice de proximité avec une justice globale,
en participant – ou du moins en tentant de participer – à la transfor-
mation des politiques publiques. Cette articulation est l’une de ses spé-
cificités : c’est précisément parce qu’elle est ancrée dans le quotidien
des personnes qu’elle peut avoir un rôle d’interpellation des autorités
publiques qui réponde réellement aux besoins et aux attentes des per-
sonnes. Cette articulation est délicate ; elle peut difficilement être pro-
clamée et elle est souvent le fruit d’un lent cheminement, de compromis
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%