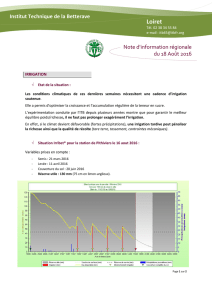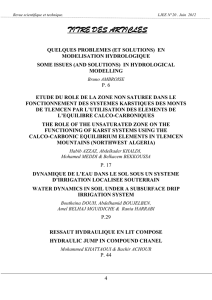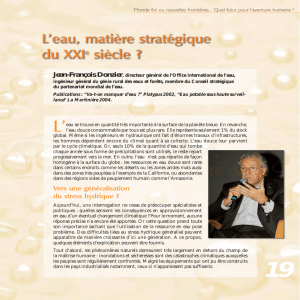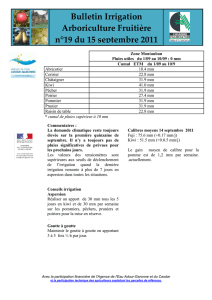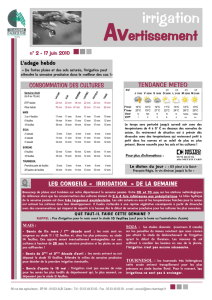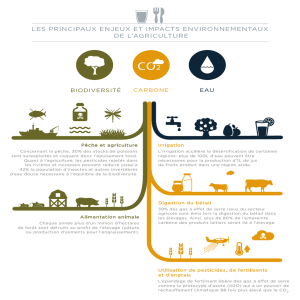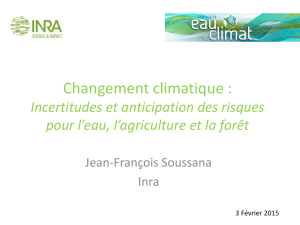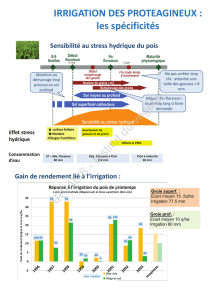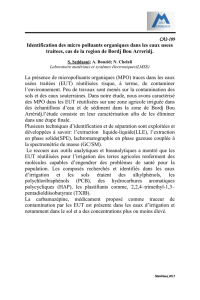APPUI POUR L `IRRIGATION ET LA GESTION DES SYSTEMES

Appui pour l'irrigation et la gestion des systemes hydrauliques
Lebdi F.
in
Lamaddalena N. (ed.), Lebdi F. (ed.), Todorovic M. (ed.), Bogliotti C. (ed.).
Irrigation systems performance
Bari : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches; n. 52
2005
pages 193-203
Article available on lin e / Article disponible en lign e à l’adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=5002259
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To cite th is article / Pou r citer cet article
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lebdi F. Appu i pour l' irrigation et la gestion des systemes h ydrau liqu es. In : Lamaddalena N.
(ed.), Lebdi F. (ed.), Todorovic M. (ed.), Bogliotti C. (ed.). Irrigation systems performance. Bari : CIHEAM,
2005. p. 193-203 (Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches; n. 52)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

Options méditerranéennes, Series B, n°52 Irrigation Systems Performance
203
APPUI POUR L’IRRIGATION ET LA GESTION DES SYSTEMES HYDRAULIQUES
F. Lebdi
Professor, INAT – Tunis, Tunisia
Résumé - La présente contribution concerne l’état des ressources en eau en Tunisie et leur gestion,
ainsi que les services nécessaires à une utilisation efficiente des systèmes hydrauliques. Il est
spécifié les contraintes physiques majeures dans la pratique de l’irrigation, les modes de gestion
dans les périmètres irrigués, en particulier le fonctionnement hydraulique à travers les associations
d’agriculteurs. Enfin, on introduit un ensemble de mesures et de recommandations afin de
promouvoir la gestion des réseaux hydrauliques collectifs et à la parcelle, d’un point de vue technique
et institutionnel.
Summary - The present contribution concerns the state of water resources in Tunisia, their
management and the necessary services for an efficient water use. The physical major constraints
are specified, for better irrigation practices in the field, water management modes, in particular with
regards to water users associations. Finally, some recommendations are introduced to promote
efficient management in collective and on farm hydraulic networks, both at the institutional and
technical levels.
Mots clés: Ressources en eau, Irrigation, Réseaux hydrauliques, Gestion, Efficience.
Key words: Water resources, Irrigation, Hydraulic Networks, Management, Efficiency.
LE BILAN DES RESSOURCES EN EAU EN TUNISIE
Le potentiel des ressources en eau en Tunisie
La Tunisie est un pays aride sur la majeure partie de son territoire. C’est le pays le moins doté en
ressources en eau souterraines dans le bassin de la méditerranée. Le volume d'eau disponible ( en
eau souterraine et de surface ) par an et par habitant est estimé à 450 m3 . Ce ratio sera de 315
m3/an/habitant en 2030 lorsque la population atteindra 13 millions d'habitants (INS, 1996).
La pluviométrie moyenne annuelle en Tunisie varie de moins de 100 mm dans l'extrême sud à
plus de 1200 mm dans l'extrême nord-ouest (sur une distance de 600 kilomètres). Le rapport entre
les précipitations maximales et minimales varie de 4,4 au Nord à 15,8 au Sud, démontrant ainsi
l'irrégularité temporelle et la variabilité d'une région à une autre (DG/RE, 2003).
Les ressources en eau conventionnelles potentielles de tout le pays sont de 4670 millions de
m3/an, dont 2700 millions de m3/an en moyenne en eau de surface (minimum observé de 780Mm3 en
1993/94) et 1970 millions de m3/an en eau souterraine. Les ressources potentielles non
conventionnelles, limitées aux eaux usées domestiques traitées, sont de 250 millions de m3 .
Du point de vue qualité, environ 72% du potentiel en eau de surface ont une salinité inférieure à
1,5 g/l.
Les ressources en eau souterraines sont estimées à 1970 millions de m3/an, réparties en 720
millions de m3 /an provenant de 212 nappes phréatiques et 1250 millions de m3/an, provenant de
267 nappes profondes, dont 650 millions de m3 /an sont non renouvelables et constituent des
réserves fossiles.
Les nappes phréatiques renferment seulement 8% des ressources possédant une salinité
acceptable, inférieure à 1.5 g/l. Pour le reste, ce potentiel souterrain se répartit entre 71% ayant une
salinité allant de 1.5 à 5 g/l, et le reste 21%, excède une salinité de 5g/l et devient de l’eau saumâtre,
relativement aux exigences qualitatives des cultures.

Options méditerranéennes, Series B, n°52 Irrigation Systems Performance
204
Concernant les nappes profondes, une partie formant 20% de la ressource a une salinité
acceptable inférieure à 1.5g/l et le reste, soit 80% de cette ressource, se distribue en 57% ayant une
salinité comprise entre 1.5 et 3g/l et 3% ayant une salinité supérieure à 3g/l (DG/ETH, 1998).
La demande en eau d'irrigation
L'irrigation en Tunisie consomme actuellement près de 83% des volumes distribués à tous les
secteurs.
Les superficies irrigables s'élèveront à 400 000 ha environ vers l’an 2010. La consommation en
eau pour le secteur irrigué, au cours de la même période, atteindra 2140 millions de m3, soit 80% du
total consommé par tous les secteurs économiques du pays.
Le bilan futur des ressources en eau
Les volumes d’eau (ressources conventionnelles) concédés par le secteur agricole au secteur
industriel, touristique ou écologique ne peuvent parvenir que d’une baisse de la consommation d'eau,
qui peut être due essentiellement aux facteurs suivants :
a) Valeur économique de l’eau
b) Baisse de la consommation à l’hectare et économie d’eau
c) Utilisation des eaux usées traitées
Le potentiel en eau est défini comme la moyenne annuelle des ressources totales en eau
conventionnelle (eau de surface et eau souterraine) et en eau non conventionnelle (Eaux usées et
eaux dessalées).
Contraintes physiques majeures dans la pratique de l’irrigation
Comme dans tous les pays du sud de la Méditerranée, la satisfaction totale de la demande en
eau, risque à moyen terme, d’être soumise à des situations de rupture, dues à une réduction des
volumes disponibles à la distribution, provoquant ainsi des pénuries d'eau plus ou moins graves.
Après l'an 2010, la Tunisie sera confrontée à une demande de plus en plus importante, dépassant
le volume de toutes les ressources en eau conventionnelles régularisables. Pour les ressources de
surface en particulier, l'envasement des retenues barrages constitue actuellement l'un des problèmes
les plus épineux, qui réduit le volume d'eau stocké. La pénurie d'eau si elle se produit, est amortie par
la mobilisation de nouvelles ressources en eau non conventionnelles, provenant essentiellement des
eaux usées traitées, des eaux saumâtres et enfin des eaux marines dont le coût reste
comparativement fort.
La sécheresse
Une année de sécheresse hydrologique est définit de 40% par rapport à l’apport pluviométrique
moyen : En cas de sécheresse généralisée, l’apport d’étiage est de 150Mm3 (DG/ETH, 1998).
La gestion de la sécheresse ne doit pas se limiter aux actions entreprises au moment de la
sécheresse mais il faut plutôt se préparer à la sécheresse et la gérer afin d’assurer la relance de la
campagne post sécheresse.
Salinité des eaux d’irrigation et salinisation
L’utilisation des eaux salées est un problème qui a suscité l'intérêt des chercheurs en Tunisie
depuis plus de 60 années. Les expérimentations du CRUESI (1970) constituent les références
tunisiennes en matière d’utilisation des eaux salées, et ont montré qu'il est possible d'utiliser des
eaux moyennement salines en irrigation, sans risque majeur, en respectant certaines règles de

Options méditerranéennes, Series B, n°52 Irrigation Systems Performance
205
gestion des eaux et du sol. Il n'en demeure pas moins que ces règles ne sont pas toujours
respectées par les agriculteurs.
Compte tenu de la rareté de l'eau et de sa qualité médiocre, les problèmes liés à la salinisation
des terres et l'engorgement des sols sont assez fréquents, surtout dans les périmètres irrigués de la
Vallée de la Mejerda et dans les oasis.
Dans la situation globalement endoréique de la Tunisie, la quantité totale de sels en mouvement
dans le paysage, augmente constamment avec le temps. Dans les zones irriguées, l’objectif est
d’éliminer les sels sans affecter les zones situées en aval où les nappes sous-jacentes Ennabli,
1995).
A l’échelle de la parcelle et dans le cas d’un drainage déficient, le phénomène de capillarité dans
le fonctionnement hydrique des cultures est un processus majeur de salinisation en Tunisie (oasis
d’El Hamma à Gabès).
La gravité croissante des problèmes liés à l’utilisation des eaux salées à la parcelle et à
l’évacuation des eaux en excès, incite à étudier l’évolution hydrique des terres irriguées à l’eau salée,
l’évaluation de la performance des réseaux de drainage et la détermination des bilans hydrique et
salin à l’échelle et de la parcelle, ainsi que
La réhabilitation des sols salés par drainage et irrigation intégrant les besoins de lessivage ;
Les conditions d’utilisation d’eaux salées de plus de 4 g/l selon le type de sol ;
La tolérances des plantes au sel et la sélection d'espèces et de variétés très tolérantes au sel et
présentant un intérêt économique ;
LA GESTION DE L’EAU A L’ECHELLE DU PERIMETRE IRRIGUE
Importance du quota destiné à l’irrigation
Si l’on considère l’usage de l’eau pour l’irrigation, l’exemple suivant montre qu’on a toujours affaire
à de gros volumes et de gros débits en irrigation (Ennabli et al., 1983). Pour un périmètre irrigué,
ayant les caractéristiques suivantes :
Surface irriguée : 1000 ha
Débit fictif continu : 0.8 l/s/ha
Durée de fonctionnement en pointe : 18 h/24
On obtient :
Débit d’équipement : 1.06 m3/s
Volume journalier en pointe = 70000 m3
Pour l’alimentation en eau potable d’une ville, si la consommation journalière est de 150 l/j/ha, le
volume journalier de prés de 70000m3 correspond à environ une population de 466000 habitants.
Néanmoins, c’est la meilleure qualité de l’eau qui est allouée à l’eau potable et généralement, que ce
soit l’eau souterraine, dont plus de 70% a une salinité supérieure à 1.5g/l ou la ressource de surface
dont prés de 30% a une salinité supérieure à 1.5g/l, la bonne qualité de l’eau est allouée aux usages
urbains (MARH, 1999). Nonobstant la salure de l’eau, l’agriculture reste le premier consommateur de
la ressource en eau, et de loin, le plus grand sinon le seul consommateur de l’eau de différentes
qualités.
La gestion des systèmes irrigués est organisée :
Autour des périmètres irrigués publics : ils représentent un peu plus de la moitié (=54%) de la
superficie irrigable. Ces périmètres fonctionnent autour du noyau de l’administration et y sont
l’émanation. C’est le commissariat régional au développement agricole (CRDA), qui en a la
responsabilité géographique, qui décide en concertation avec le Ministère de l’Agriculture :
de leur vocation culturale (c’est aussi un outil entre les mains des pouvoirs publics, permettant
de réguler un marché et de moduler les effets sociaux qui résultent de l’équation parfois brutale
de l’offre et de la demande),
du mode de gestion des réseaux et des ouvrages : à la demande, au tour d’eau ou sur demande

Options méditerranéennes, Series B, n°52 Irrigation Systems Performance
206
des subventions accordées pour leur entretien et fonctionnement.
Fonctionnement hydraulique des périmètres gérés par les agriculteurs au travers des GIC:
La gestion de l’eau, assurée au niveau d’un GIC, donne systématiquement droit à l’eau
d’irrigation, dont l’usage est tel, que le principe du tour d’eau est défini en fonction :
- de la superficie à irriguer,
- du débit disponible et de l’efficience du réseau d’irrigation.
Dans un tel cas, le droit d’eau donne lieu au paiement au GIC, d’une redevance fixe et d’une
redevance de consommation, représentant une contribution réelle au budget de fonctionnement et
d’entretien des infrastructures hydrauliques.
Les tours d’eau et les doses apportées à chaque arrosage, surtout pendant la période de pointe,
varient d’un périmètre à un autre en fonction de la disponibilité de la ressource.
Les pertes d’eau peuvent induire des tours d’eau et des temps d’arrosage à l’hectare assez longs.
Dans les périmètres du Nord et du centre du pays, les tours d’eau peuvent aller 3 à 7 jours en pointe
et dépasser les 15 jours dans les périmètres du sud.
- Les doses apportées et les besoins en eau sont aussi variables d’un périmètre à un
autre, selon :
- la région,
- la nature du sol,
- le nombre d’heures de fonctionnement journalier du réseau,
- la durée d’arrosage par hectare,
- la main d’eau allouée.
Dans certains périmètres non encore réhabilités, les pertes d’eau induisant une insuffisance de
débit disponible à l’entrée de la parcelle ou au niveau de la plante, se traduisent par des taux de mise
en valeur faibles et des tours d’eau importants, générant une certaine déficience du système et
parfois des doses n’assurant pas le lessivage des sels.
Il faut noter que certains GIC ont procédé à l’aménagement des exploitations en les dotant de
bassins individuels, remplis tour à tour et permettant de ce fait d’assouplir le tour d’eau. Les
exploitants gèrent les volumes comme ils le souhaitent. La gestion est passée de la disponibilité d’un
service (débit pression, temps) à un service de volume. Les volumes à l’entrée de l’exploitation sont
alors connus avec une meilleure précision. La maîtrise des volumes a eu pour conséquence une
considérable économie d’eau.
De même, les volumes connus règlent les conflits habituels entre les exploitants et l’aiguadier. La
responsabilité d’un service défaillant est précisée et localisée. Dés lors, il est possible à l’agriculteur
faisant partie d’un GIC de séparer ce qu’il paye comme volume disponible dans le bassin et sa
contribution dans la facture, aux différentes pertes qui s’opèrent entre la source d’eau et son bassin
individuel. C’est une comptabilité analytique de la desserte d’eau, depuis sa production jusqu’à son
usage. Ces bassins sont construits par l’initiative des irriguants.
Fonctionnement hydraulique des périmètres irrigués sur puits de surface
- L’appropriation de l’eau est collective, ainsi que sa gestion, sauf le cas des périmètres irrigués à
partir de puits de surface. Dans ce mode de gestion, l’eau fait partie intégrante et indissociable
de la terre qu’elle irrigue.
- C’est la propriété de la terre qui donne, après autorisation des services administratifs des
ressources en eau, l’accès à l’eau.
- De ce fait, la situation actuelle montre que l’utilisation des techniques d’économie d’eau est
relativement plus développée dans des périmètre irrigués à partir des puits de surface que dans
le reste des périmètres publics.
- En effet, dans ces périmètres sur puits de surface, les exploitants disposent librement de la
ressource et sont plus réceptifs l’égard des techniques d’économie d’eau. Ces périmètres
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%