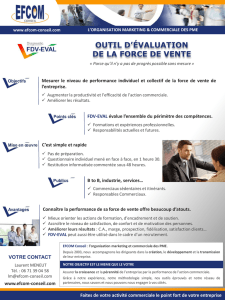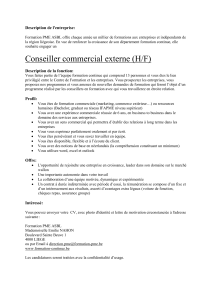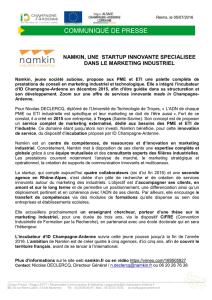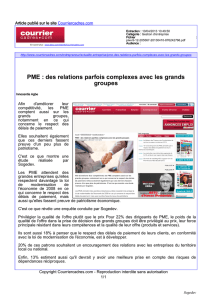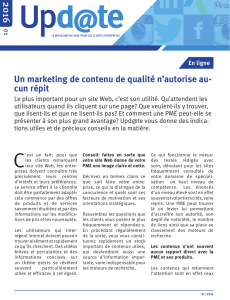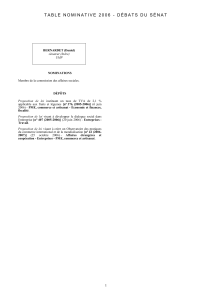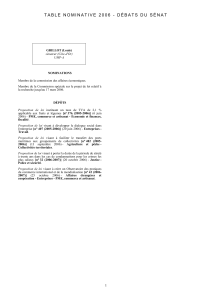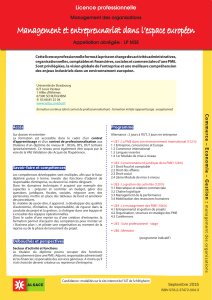`caché` des pme et des eti

Bpifrance Le Lab | PME ET ETI MANUFACTURIÈRES Ι Tribune d’Olivier TORRES
OCTOBRE 2014
| 1
PME ET ETI MANUFACTURIÈRES
STRATÉGIES DE REBOND FACE À LA CRISE
Olivier TORRES
Professeur à l’Université de Montpellier 1 et à Montpellier
Business School ;
Président d’Amarok, premier observatoire de la santé des
entrepreneurs
L’ÉCOSYSTEME ‘CACHÉ’ DES PME ET DES ETI
Les PME et les ETI représentent 99,8 % des entreprises françaises. Elles sont, de très loin, les
principales pourvoyeuses d’emplois et de valeur ajoutée en France. Leur contribution économique et
sociale est majeure, primordiale, essentielle. Ces performances devraient se traduire par une multitude
de travaux à leur endroit. Pourtant, c’est l’inverse qui se produit depuis des décennies et des décennies.
Les PME et ETI sont partout, en région et à Paris, partout en France comme dans n’importe quel pays
européen, partout en Europe comme dans n’importe quel autre continent. Elles sont partout… sauf dans
les théories.
Ce fait dommageable tient à plusieurs raisons parfois méthodologiques, souvent idéologiques. Les
historiens travaillent sur des archives, ce qui avantage naturellement les grands groupes qui disposent
parfois de plusieurs siècles d’existence (voir les travaux de Jean Pierre Daviet sur Saint Gobain, 1665-
1989, Une multinationale à la française). Le plus emblématique de tous les historiens d’affaires,
l’américain Alfred Chandler, va ainsi développer ses thèses à partir… des 200 plus grandes entreprises
américaines, anglaises et allemandes et dans scale and scope, il justifie la prédominance du capitalisme
managérial, c’est-à-dire celui qui est constitué de firmes composées d’une hiérarchie étoffée de
managers. De sortes que, quand l’historien économique Jacques Marseille regrette que « les historiens
ont tendance à privilégier les approches macro-économiques » et négligent « les rudes fantassins de
l’économie mondiale », par fantassin, il entend Pont à Mousson, Rhône Poulenc, Renault…
Les sociologues ont, quant à eux, pour habitude de découper le monde en classe, ce qui fragmente
l’écosystème PME-ETI et lui ôte son unité et donc sa lisibilité. Le monde de la PME et des ETI se
compose en grande partie de la classe moyenne, prise en tenaille entre la classe des prolétaires et celle
du grand capital. Les marxistes ont d’ailleurs toujours considéré que la petite production et la moyenne
industrie étaient vouées à subir le joug du grand jeu capitaliste. Le petit patron n’est « qu'un être hybride,
qu'une chose intermédiaire entre capitaliste et travailleur » (Marx, 1848). Chez Marx, la PME et l’ETI sont
soumises à la loi de la paupérisation croissante. En sociologie, le thème de la domination occupe une
place centrale. Dans ce contexte idéologique, la PME et l’ETI restent fortement attachées à la personne
de leurs dirigeants, et donc au patronat, ce qui explique que la sociologie a fourni très peu de travaux sur
les PME, à l’exception de quelques rares réflexions, toutefois en cohérence avec le paradigme de la
domination, comme les travaux de Bernard Zarca sur les artisans, gens de métier, gens de parole, ceux
de Michel Amiot sur les misères du patronat et plus récemment ceux d’Alina Surubaru sur la fragilité des
liens marchands, sociologie de la sous-traitance internationale. Dans sa sociologie des organisations

Bpifrance Le Lab | PME ET ETI MANUFACTURIÈRES Ι Tribune d’Olivier TORRES
OCTOBRE 2014
| 2
patronales, Offerlé écrit que « travailler sur le patronat pouvait être assimilé au mieux à une perte de
temps, au pire à une compromission douteuse avec ‘l’ennemi de classe’ ».
Quant aux économistes, a priori les plus prompts à faire de l’activité matérielle leur objet de recherche, ils
n’ont conféré aux PME et aux ETI qu’un rôle assez mineur. En effet, la PME dans la théorie libérale de la
concurrence pure et parfaite est condamnée à subir la loi du marché puisque le prix s’impose à elle,
tandis que dans la théorie marxiste, elle, subit la loi tendancielle de la concentration croissante. Dominée
soit par les forces de la ‘main invisible’ du marché, soit par les forces du grand capital, elle ne joue en
vérité qu’un rôle passif. Plus récemment, les théories keynésiennes ont davantage insisté sur le rôle
d’intervention de l’État. L’anglais Alfred Marshall est l’un des premiers à théoriser la PME, mais cette
dernière se fond dans une entité collective qu’il nomme ‘district industriel’. La PME n’est pas ici étudiée
en soi, mais comme un élément d’un tout qui fait système. Le concept de district industriel prendra
d’autres appellations comme le système productif local (SPL) de l’école grenobloise ou le cluster de
Michael Porter, lequel fait des petites organisations l’élément moteur. Mais dans ces conceptions, la PME
se fond dans un collectif fortement territorialisé. Ces théorisations concernent moins la PME que
l’aménagement, voire le management des territoires.
Même l’autrichien Joseph Schumpeter, souvent cité comme le père de l’entrepreneuriat, conclut sa
réflexion en considérant que l’entrepreneur va disparaître au profit des grandes entités industrielles. La
révolution managériale, mise en évidence en 1932 par Berle et Means, deux américains, semble avoir
tout emporté sur son passage et totalement préempté le cerveau des scientifiques. Les termes de
‘Fordisme’, puis de ‘Toyotisme’, montrent la prégnance mentale de la grande industrie sur les esprits.
En management, les travaux sur les PME et les ETI sont également ultra minoritaires. Le management
est une discipline qui se décline en grandes fonctions (finance, marketing, gestion des ressources
humaines, etc.), découpage fonctionnel qui correspond au modèle organisationnel des grandes
entreprises. Mais en PME, le dirigeant n’a pas de DRH, ni de directeur financier ou marketing. Quant aux
ETI, elles sont vues au mieux comme des formes hybrides, mais sans véritables spécificités.
De même, les théories des économies d’échelle, des économies de champ et des économies
d’apprentissage ont encore un fort pouvoir d’attraction sur les explications données, pour justifier la
course au gigantisme industriel et aux politiques de diversification. Les matrices stratégiques du Boston
Consulting Group, AD Little ou Mc Kinsey sont encore enseignées dans toutes les business schools,
même si leurs champs d’application portent exclusivement sur les très grandes entreprises diversifiées,
qui gèrent des portefeuilles d’activités dans le monde entier.
Les théories dominantes de l’Histoire, de la Sociologie, de l’Économie et du Management s’intéressent
davantage à la très grande entreprise plutôt qu’à la petite. Cet oubli, qu’il soit volontaire ou non, a pour
effet de produire ce que Pierre Yves Gomez appelle un effet Gulliver, c’est-à-dire une représentation du
monde à partir des géants. « En généralisant le cas particulier des géants économiques, l’image de
l’entreprise dans l’esprit du public mais aussi les analyses des spécialistes et les recommandations du
pouvoir politique sont faussées par un effet de taille ».
Ce biais de représentation théorique induit des lacunes concernant des grandes questions économiques
et stratégiques comme la dépendance économique des PME, les évolutions des relations bancaires, la
souffrance et la solitude patronale, le rôle et l’importance du patrimoine économique, la fonction de
propriétaire… Or, tous ces aspects sont évoqués dans le présent rapport, ce qui montre que dès lors que
l’on change de taille d’entreprises, les préoccupations ne sont plus les mêmes.
Dans ce rapport, et c’est heureux, ce sont au contraire les stratégies de spécialisation et de niches qui
sont mises de l’avant. Quant à la diversification dont il est traité ici, il serait aisé de montrer qu’il s’agit
d’une diversification de proximité où les synergies jouent à plein comme dans le cas HYTEC, étude de
cas qui alimente le séminaire que nous animons dans le cadre du CETIM depuis plusieurs années. Les

Bpifrance Le Lab | PME ET ETI MANUFACTURIÈRES Ι Tribune d’Olivier TORRES
OCTOBRE 2014
| 3
concepts « patrimoine, indépendance, croissance » (PIC) et « croissance, autonomie, pérennisation »
(CAP) dont il est aussi question, émanent des travaux de Michel Marchesnay, l’un des tout premiers
chercheurs français à avoir mis en évidence la spécificité de gestion stratégique des PME. Les auteurs
du rapport ne manquent pas non plus d’évoquer la question centrale de la formation des dirigeants de
PME et d’ETI à la stratégie, et le rôle déterminant que les consultants peuvent jouer sur ce point.
L’opération « Stratégie PME » mise en œuvre depuis plusieurs années par le CETIM dans le bassin
rhône-alpin offre la preuve de la pertinence d’un savant mixage entre les séminaires, qui apportent les
éléments fondamentaux de l’analyse stratégique en PME, et les séances pratiques et personnalisées
entre le dirigeant et son consultant attitré. C’est grâce à la multiplication de telles études et de tels
dispositifs que la France sortira enfin l’écosystème PME-ETI de son anonymat chronique, qui au regard
de sa contribution à l’économie réelle est une véritable injustice.
1
/
3
100%