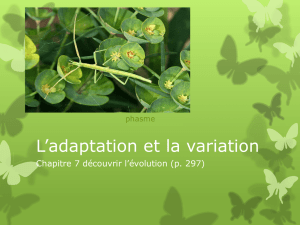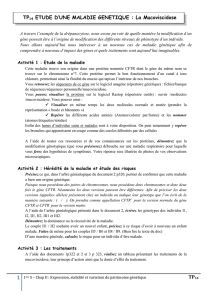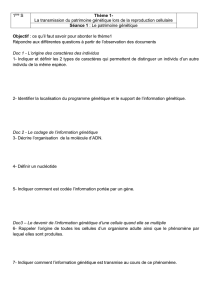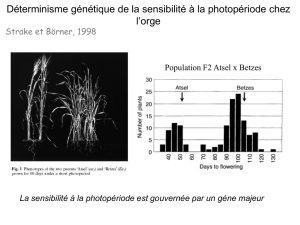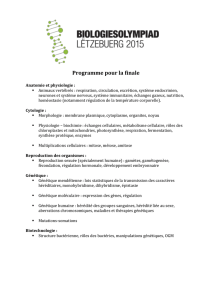Conseil génétique, éthique et aspects psychologiques Conseil

7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale – Bordeaux, 23, 30 et 31 janvier 2014 – Recueil Posters
7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale
162
Conseil génétique, éthique et aspects
psychologiques
C019/#355
Difficultés d’interprétation du génotype CFTR
après le dépistage néonatal de la
mucoviscidose : à propos de deux cas
Marie-Pierre REBOUL (1), Stéphanie BUI (2), Michael FAYON (2), Stéphane
DEBELLEIX (2), Marie-Hélène DEALBERT (1), Sylvie LABATUT (1), Corinne
THEZE (3), Benoît ARVEILER (1), Benoît ARVEILER (4), Didier LACOMBE (1),
Didier LACOMBE (4), Cécile ZORDAN (1), Patricia FERGELOT (1), Patricia
FERGELOT (4)
1. Service de Génétique Médicale, Groupe Hospitalier Pellegrin, Bordeaux,
France
2. CRCM pédiatrique, Groupe Hospitalier Pellegrin, Bordeaux, France
3. Laboratoire de Génétique Moléculaire, Université Montpellier 1,
MONTPELLIER, France
4. Maladies Rares : Génétique et Métabolisme (MRGM), EA 4576, Université
Bordeaux, Bordeaux, France
Auteur correspondant : REBOUL Marie-Pierre (marie-pierre.reboul@chu-
bordeaux.fr)
La stratégie de dépistage néonatal de la mucoviscidose choisie en
France combine le dosage de la trypsine immunoréactive chez tous
les nouveaux-nés avec une recherche de 30 mutations fréquentes
chez une sélection d’entre eux, avant de poser éventuellement le
diagnostic par dosage du chlorure sudoral. Cette procédure conduit
inévitablement d’une part à l’identification - non recherchée - de
porteurs sains hétérozygotes pour la maladie et d’autre part de
nouveaux-nés porteurs de formes modérées (ou frontières) de la
maladie, peu ou pas symptomatiques au moment du diagnostic et dont
le pronostic est difficile à établir.
1er cas
Actuellement, environ 2000 mutations du gène CFTR conduisant à la
mucoviscidose sont connues. Certaines de ces mutations sont décrites
comme « large spectre » dans les bases de données en particulier
UMD-CFTR-France. L’interprétation de leur analyse moléculaire doit
rester prudente et donc le conseil génétique délicat car il doit tenir
compte du caractère modéré de certains phénotypes associés. Nous
rapportons l’observation, issue du dépistage néonatal, d’un nourrisson
de 5 mois portant le génotype p.[Phe508del;Arg347His] après une
analyse exhaustive du gène CFTR. Ce nourrisson a des valeurs
intermédiaires pour le test sudoral, il est suffisant pancréatique mais
dès la première consultation il tousse et le score radiologique de
Brasfield n’est pas bon. S’agit-il d’une mucoviscidose, qui aura une
évolution classique, ou bien d’une pathologie associée au gène CFTR,
qui se révèlera plusieurs années plus tard ?
2ème cas
Nous rapportons l’observation d’un nourrisson de 7 mois (issu du
dépistage néonatal) portant le génotype
[p.Phe508del;(p.Leu1376Ser)]. Son test sudoral a des valeurs
intermédiaires, il est suffisant pancréatique, et au niveau pulmonaire
on note des opacités très discrètes. Le variant faux-sens
p.Leu1376Ser n’a jamais été décrit dans la littérature et est transmis
par la mère d’origine chinoise. Aussi seule l’analyse in silico avant une
éventuelle étude fonctionnelle peut apporter des arguments pour
interpréter ces résultats moléculaires Du fait de l’absence de données
cliniques disponibles à ce jour, il n’est pas possible de donner
d’éléments pronostiques associés à ce génotype.
Conclusion
Ces deux observations illustrent la difficulté d’interprétation de
résultats moléculaires chez des nourrissons peu symptomatiques
issus du dépistage néonatal, avec des valeurs intermédiaires pour le
test sudoral, et porteurs d’une mutation « large spectre » ou d’un
variant faux-sens jamais décrit. Ces situations ne sont pas rares et
imposent une grande prudence pour le conseil génétique. Au sein du
CRCM pédiatrique la prise en charge de ces nourrissons relève aussi
de la vigilance avec une consultation régulière, la mise en place d’une
kinésithérapie respiratoire préventive et parallèlement la répétition des
tests de la sueur.
Mots-clefs : gène CFTR, dépistage néonatal, conseil génétique
Conseil génétique, éthique et aspects
psychologiques
C020/#359
Paraparésie spastique dominante, importance
de l’examen morphologique pour orienter les
analyses moléculaires génétiques
Elodie Schaerer (1), Fanny Mochel (1), Bertrand Fontaine (2), Corinne
Magdelaine (3), Perrine Charles (4)
1. Département de Génétique et Cytogénétique, Groupe Hospitalier Pitié
Salpêtrière, Paris, France
2. Département de Neurologie, Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris,
France
3. UF de Génétique Moléculaire, CHU Limoges Hôpital Dupuytren, Limoges,
France
4. Département de Génétique et Cytogénétique; Département de Neurologie,
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris, France
Auteur correspondant : Schaerer Elodie (elodie[email protected]php.fr)
Un patient âgé de 53 ans est adressé à la consultation de génétique
pour avis diagnostique d’une paraparésie spastique.
Le patient se plaint de crampes fréquentes mais a un périmètre de
marche illimité. A l’examen la marche est ataxo spasmodique en
rapport avec un syndrome pyramidal des membres inférieurs avec un
signe de babinski bilatéral. Les pieds sont creux avec des orteils en
griffes. S’associe une ataxie proprioceptive avec une hypopallesthésie
au niveau des chevilles.
Le patient a bénéficié d’un large bilan étiologique en neurologie
associant IRM cérébrale, médullaire, EMG, PEV, PES, PEA, bilan
métabolique, l’ensemble étant négatif ou non contributif. Une analyse
moléculaire des gènes SPG4 / SPAST et SPG11 est revenue négative
en ce qui concerne les mutations et les réarrangements de ces gènes.
Une puce ADN avait également été réalisée et s’est avérée normale.
A l’interrogatoire les antécédents familiaux sont compatibles avec une
transmission dominante avec une notion de paraparésie spastique
sévère chez le père avec un début des symptômes vers 70 ans et une
évolution rapide puisque le patient est en fauteuil roulant après 10 ans
d’évolution.
En examinant le patient sur le plan morphologique, on remarque une
syndactylie bilatérale des 4è et 5è doigts de chaque main opérée à
gauche et un émail des dents grisé.
Le père du patient présente également une syndactylie bilatérale de
même que le grand père paternel.
Une analyse moléculaire du gène GJA1 a été réalisée et une mutation
hétérozygote a été mise en évidence (p.Phe2121Ile). Cette mutation
n’avait jamais été décrite mais touche un acide aminé très conservé de
la protéine. De plus elle ségrége avec le phénotype puisqu’elle a
également été retrouvée chez le père du patient ce qui est un
argument supplémentaire pour son caractère pathogène.
Nous avions précédemment rapporté deux autres familles avec des
mutations du gène GJA1 avec un syndrome ODD, une pénétrance
incomplète et une expressivité variable du phénotype en particulier
des anomalies orthopédiques et de la paraparésie spastique.
Conclusion : Il s’agit du seul patient adressé pour bilan diagnostique
d’une paraparésie spastique avec identification d’une mutation GJA1.
En effet les autres patients pour lesquels des mutations GJA1 ont été
identifiées présentaient un syndrome occulo dento digital.
Le conseil génétique pour les apparentés des patients avec mutations
identifiées dans GJA1 est difficile en raison de la pénétrance
incomplète et de l’expressivité variable&
Mots-clefs : paraparésie spastique, syndactylie 4-5, expressivité variable
1
/
1
100%