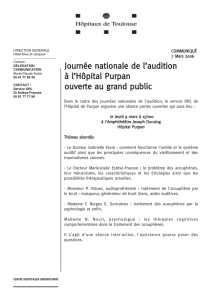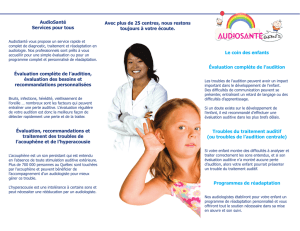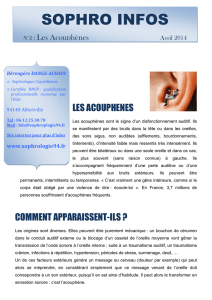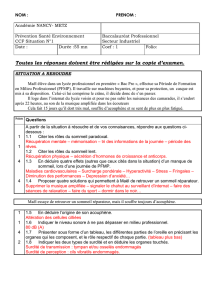voir le numéro - Société Française d`Audiologie

La revue SFA-News est éditée par la
Société Française d’Audiologie (SFA)
La SFA remercie le laboratoire Ipsen et la
société Siemens de leur soutien pour la
réalisation de ce numéro.
Neurophysiologie
de l’émotion
ThéodoreYvesNassé
L’émotion, comme les autres processus
affectifs, met en jeu un large ensemble
de systèmes neuronaux qui incluent
le système nerveux central, le système
nerveux autonome, l’axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien et les systèmes
endocriniens, qui régulent l’état homéo-
statique, les émotions et la réactivité de
l’organisme, le cortex somatosensoriel,
l’insula, le cortex cingulaire antérieur,
le cortex pré-frontal ventromédian et
l’amygdale cérébrale, le système de ré-
compense, le système dopaminergique
mésolimbique, mais aussi les processus
neuro-endocriniens et le système ner-
veux autonome.
Ce qui fait le charme de l’émotion, du
vrai et du beau: « L’émotion confère la
possibilité d’agir intelligemment sans
penser réellement ». De Spinoza à
Changeux et Damasio, c’est la théorie
de Laborit qui reste l’actualité la plus
ancienne et la plus subtile. Le raisonne-
ment effectue la même chose que ce
qu’accomplissent les émotions, mais de
manière consciente.
Nous pouvons affirmer que la faculté de
raisonnement dépend de plusieurs sys-
tèmes de neurones, œuvrant de concert
à de nombreux niveaux de l’organisation
cérébrale, et non pas d’un seul centre
cérébral. Du cortex préfrontal à l’hypo-
thalamus et au tronc cérébral, du haut et
du bas, ces zones jouent un rôle fonda-
mental.
1
É d i t o r i a l
Chers collègues, chers amis,
La présidence tournante de la Société
Française d’Audiologie étant effective
depuis quatre ans, c’est maintenant à
un ORL de succéder à François Le Her,
audioprothésiste, qui a animé avec effi-
cacité et disponibilité la société pen-
dant ces deux dernières années.
Je suis donc très honorée d’avoir été
désignée par les membres du Conseil
d’administration de la SFA pour assurer
la présidence de la Société Française d’Audiologie
pendant ces deux ans à venir.
La Société Française d’Audiologie, grâce à la grande compétence et à la pluridisci-
plinarité de ses membres fondateurs, représente une richesse considérable pour
l’audiologie. En effet, c’est à travers la diversité de chacun et de chacune que la SFA
puise ses ressources pour aller toujours plus loin dans les missions qu’elle s’est fixées.
L’audiologie est une science complexe qui fait appel au merveilleux sens de l’ouïe,
mais aussi à toutes les voies cognitives et neurologiques qui amènent au langage et
à la communication, essence même de l’individu. Ainsi, ses champs d’application
multiples relèvent de différentes disciplines, allant des spécialités de l’oto-rhino-
laryngologie et de la phoniatrie, à celles de l’audioprothèse et de l’orthophonie, et
dépendent également de la recherche fondamentale.
Le mandat de présidence confié par le Conseil d’administration m’amène à pour-
suivre l’œuvre de mes prédécesseurs à travers les commissions de travail et les
différents thèmes des congrès et colloques. Après l’élaboration des Guides des
bonnes pratiques en audiométrie de l’adulte, puis de l’enfant, des commissions de
travail ont décidé de se tourner vers la prévention et la validation des normes en
audiologie. C’est aussi à travers un site internet nouveau et attractif que la SFA a
décidé de s’investir pour être interactive, et pour mieux répondre aux besoins de la
société si diverse et évolutive. D’autres projets doivent également naître sur les
méthodes de l’audiométrie vocale pour affiner les diagnostics des troubles auditifs.
En 2010, les missions de la SFA doivent s’articuler autour des exigences de la néces-
sité de recommandations, des contingences de formations et d’enseignements
spécifiques, des travaux de recherche et de publications, des prescriptions des tutel-
les et des administrations. Doivent être pris en compte aussi, les besoins des patients,
exprimés à l’échelon individuel ou associatif.
Je souhaiterais donc maintenir et accentuer les orientations de travail de la SFA
dans l’esprit et le respect de la pluridisciplinarité, dont elle a toujours fait preuve.
Il me tient à cœur de développer les relations et collaborations avec les asso-
ciations et sociétés savantes liées à l’audiologie.
DrFrançoise Artières
Présidente de la SFA
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Le DrFrançoise Artières, ORL, succède à
François Le Her,
audioprothésiste.
FLASH SFA 10:SFA2 8p 5.0 29/11/10 12:21 Page1

Damasio pense que les niveaux infé-
rieurs de l’organisation neurale sous-
tendent l’émotion, ces niveaux sont les
mêmes que ceux qui contrôlent les pro-
cessus émotionnels et les fonctions cor-
porelles. Les perceptions d’émotions
nous donnent un aperçu instantané sur
l’organisme en pleine activité biolo-
gique; elles captent le reflet de la vie
elle-même grâce aux neurones et aux
neurones miroirs.
Les neurones miroirs désignent une
catégorie de neurones du cerveau qui
présentent une activité aussi bien lors-
qu’un individu (humain ou animal) exé-
cute une action, que lorsqu’il observe
un autre individu (en particulier de son
espèce) exécutant la même action, d’où
le terme miroir (Giacomo Rizzolatti est
l’inventeur de cette découverte).
En neurosciences cognitives, ces neu-
rones miroirs sont supposés jouer un
rôle dans des capacités cognitives liées
à la vie sociale — notamment dans l’ap-
prentissage par imitation —, mais aussi
dans les processus affectifs, tels que
l’empathie et l‘émotion.
Les neurones miroirs sont considérés
comme une découverte majeure en
neurosciences.
Si, pour certains chercheurs, ils consti-
tuent un élément central de la cog-
nition sociale (depuis le langage jusqu’à
l’art, en passant par les émotions et la
compréhension d’autrui), pour d’autres,
ces conclusions restent très hypothé-
tiques étant donnée l’absence de preu-
ves directes concernant le rôle de ces
neurones dans ces processus psycholo-
giques.
100 milliards de neurones
●●
Chaque neurone établit 10 000
connexions avec d’autres neurones.
●●
50 neurones peuvent être placés
à l’intérieur du point qui
termine cette phrase.
●●
Alignés côte à
côte, les 100 mil-
liards de neurones
fo rmera i e n t une
chaîne de 1 000 Km de
longueur.
●●
L’intelligence a un poids... d’environ
1,6kg pour l’encéphale de l’homme
adulte (cerveau, cervelet et tronc
cérébral) et 1,45 kg pour celui de la
femme. Le système limbique est le
centre de l’affectivité et de
l’émotion ou plutôt de la mémoire
à long terme.
« La mémoire à long terme est nécessai-
re pour savoir qu’une situation a déjà
été éprouvée antérieurement comme
agréable ou désagréable. La mémoire à
long terme va donc permettre la répéti-
tion de l’expérience agréable et la fuite
de l’expérience désagréable » (Damasio).
Selon Laborit, les expériences mémo-
risées le sont dans deux systèmes
distincts et en opposition:
●●
Le faisceau de la récompense et du
renforcement: c’est le medial for-
brain bundle (MFB);
●●
Le faisceau de la punition: le peri-
ventricular system (PVS).
Le cerveau est le chef d’orchestre phil-
harmonique le plus puissant au monde,
le plus joyeux, lumineux et inventif, pas-
sant de la mémoire immédiate à la
mémoire ancienne avec une rapidité
incroyable. Rien ne peut s’effacer dans
notre cerveau. Par contre, la perte de la
mémoire (de certains événements) peut
être la cause d’un stress, ou l’anxiété,
l’émotion forte ou malheureusement
due à une maladie plus grave.
Dans l’émotion et dans la dépression,
c’est la sérotonine qui commande les
bonnes et les mauvaises actions neuro-
chimiques, ensuite la dopamine et tous
les autres neurotransmetteurs.
Dans le traitement des acouphènes,
les médicaments et les différentes
méthodes donnent des résultats assez
médiocres, par contre la sophrothérapie
modifiée donne à ce jour les meilleurs
résultats dans le traitement de l’acou-
phène, en baissant le stress, l’angoisse
et les émotions, en agissant aussi sur la
dépressivité et la dépression réaction-
nelle de nos patients.
Les résultats sont de 67 %
à 75 % d’amélioration
dans les acouphènes.
Rôle de l’ORL au sein
d’une consultation
pluridisciplinaire
«acouphène»
DrMarie-JoséEstève-Fraysse
Notre consultation pluridisciplinaire
(CPD) au CHU de Toulouse, réunit
de façon hebdomadaire un ORL, une
psychologue, un audioprothésiste et
une sophrologue dans le but de voir
ensemble des patients acouphéniques
chroniques difficiles. Consulter ensem-
ble, avec d’autres acteurs de santé, est à
la fois compliqué et enrichissant.
Notre fil conducteur durant la consulta-
tion est toujours:
●●
L’évaluation clinique de l’acouphène,
●●
La recherche de l’orientation étio-
logique,
●●
L’évaluation du retentissement psy-
chologique,
●●
La décision de la prise en charge
avec explications et conseils au
patient.
Les deux derniers points sont discutés
et réalisés collégialement.
L’ORL va devoir trouver un équilibre
entre, d’une part, un patient anxieux et
souvent dépité qu’il faut traiter avec
empathie, et, d’autre part, la partici-
pation au bon moment des autres
acteurs de la CPD dans leur domaine,
en veillant toujours à ce que le patient
ne se sente pas considéré comme un
simple cas clinique.
ÉVALUATION CLINIQUE
L’évaluation clinique et paraclinique de
l’acouphène doit être complète
Interrogatoire
L’interrogatoire est un des temps essen-
tiels. Il doit, d’une part, chercher
à identifier la plainte (derrière l’acou-
phène se cache souvent d’autres symp-
tômes) et caractériser de façon très pré-
cise l’acouphène et, d’autre part, évaluer
la gêne, le retentissement sur le som-
meil, la vie sociale et professionnelle.
Pour bien cerner l’acouphène, on
recherche :
●●
Ses caractéristiques (aigu, grave,
uni- ou bilatéral, pulsatile ou non,
récent, ancien...);
2
FLASH SFA 10:SFA2 8p 5.0 29/11/10 12:21 Page2

●●
Les circonstances de survenue,
brutales ou non: événement trau-
matique, émotionnel, infectieux,
ototoxique ou autre, (capital pour
orienter le diagnostic);
●●
Les signes associés: surdité, hyper-
acousie, hypersensibilité au bruit,
plénitude de l’oreille. On fera
préciser, pour éviter la confusion
fréquente, la gêne occasionnée par
l’acouphène, celle due à la surdité
et la tolérance au bruit ;
●●
L’évolution dans le temps qui
dévoile souvent une inquiétude
quant à l’évolutivité.
Otoscopie microscopique
L’otoscopie microscopique permet la
recherche d’une pathologie conco-
mitante de l’oreille moyenne telle
qu’une otite séromuqueuse, une sé-
quelle otitique, un dysfonctionnement
tubaire...
C’est néanmoins devant les acouphènes
pulsatiles (pulsatilité parfois discrète et
à toujours rechercher) que l’otoscopie
est un moment capital :
●●
Un tympan clair pulsatile évoque
une malposition de la carotide
interne, l’acouphène est stoppé ou
diminué lors de la compression
carotidienne;
●●
Un tympan bleuté évoque une
procidence du golfe de la jugulaire,
l’acouphène est souvent augmenté
en décubitus;
●●
Un tympan rouge framboise
évoque une tumeur glomique
(rare) ;
●●
Un tympan inflammatoire évoque
une éventuelle pathologie de
l’oreille moyenne.
Dans tous les cas, le scanner des rochers
permettra d’objectiver soit la mal posi-
tion anatomique, soit la lésion inflam-
matoire, soit la lésion tumorale.
Tests auditifs
●●
L’audiométrie tonale chiffre la sur-
dité. Elle sera réalisée complète,
du 125 au 8000Hz, et avec soin,
en conduction aérienne et osseuse,
sans oublier les demi-octaves, 3000
et 6000 hertz. Une surdité mixte
ou transmissionnelle associée orien-
tera vers une possible cause locale
et vers une imagerie.
●●
L’audiométrie vocale chiffre l’intel-
ligibilité. Elle doit être systéma-
tique à la recherche d’un trouble de
l’intelligibilité s’il existe une surdité
associée.
●●
Les autres tests tels que l’audio-
métrie haute fréquence, les oto-
émissions acoustiques ou la recher-
che des zones mortes seront réali-
sés en fonction des patients.
Acouphénométrie
L’acouphénométrie fait partie intégran-
te du bilan du patient acouphénique.
Elle est basée sur l’étude comparative
d’un stimulus et de l’acouphène et
permet d’en estimer ses caractéristiques
psycho-acoustiques. On définira la hau-
teur, ou tonie, l’intensité, ou sonie, mais
également le timbre, la latéralisation et,
si possible, la masquabilité (la partici-
pation de l’audioprothésiste est néces-
saire).
FLASH SFA 10:SFA2 8p 5.0 29/11/10 12:21 Page3

Questionnaires
Les questionnaires constituent une éva-
luation semi-quantitative dont l’intérêt
est de chiffrer le caractère agressif (la
sévérité, le retentissement et la tolé-
rance de l’acouphène). Il s’agit d’auto-
questionnaires qui peuvent être remplis
en salle d’attente ; ils ont été validés par
des procédures statistiques ce qui per-
met de s’appuyer sur les résultats. Trois
questionnaires sont couramment utili-
sés: le STTS (traduit en français par sévé-
rité de l’acouphène), le TRQ (en français
détresse psychologique) et le THQ ou le
THI qui évaluent le handicap.
Échelles visuelles analogiques
Enfin, durant la consultation, nous uti-
lisons une échelle visuelle analogique
(EVA). Rapide et simple, elle permet,
comme les questionnaires, de chiffrer
l’acouphène et de suivre son évolution
dans le temps. Une étude par diffé-
rentes équipes de l’AFREPA a pour
but d’évaluer sur plus de 700 patients
l’existence d’une corrélation entre les
trois questionnaires de sévérité, dé-
tresse et handicap (Tinnitus Handicap
Inventory, THI) et deux échelles visuel-
les analogiques (EVA) de gêne et d’in-
tensité. Les résultats sont en cours
d’analyse.
ÉVALUATION
ÉTIOLOGIQUE
Au terme de ces deux étapes, interroga-
toire et évaluation clinique, on aborde
le temps de l’évaluation étiologique qui
découle des étapes précédentes.
Il convient ici d’analyser le caractère
vraisemblable ou non du lien entre les
antécédents et l‘acouphène. Cela orien-
4
te vers les éventuels avis ou examens
complémentaires à réaliser ultérieure-
ment.
À ce stade, intervient l’avis du psycho-
logue sur les éléments de stress, de
dépression, de problèmes personnels,
professionnels... ou de traits de caractè-
re pouvant interférer sur la gravité de
l’acouphène (intervention discrète qui
sera rediscutée par l’équipe ultérieure-
ment si nécessaire). Intervient égale-
ment à ce stade l’avis de l’audioprothé-
siste lorsque la surdité va nécessiter une
prise en charge correctrice par aide
auditive, notamment lorsque la surdité
sera compliquée (surdité sévère sans
intelligibilité, surdité profonde unilaté-
rale, surdité en pente de ski, avec
conservation des graves, dynamique
auditive étroite...).
Enfin, vient le temps de l’explication
Cas n° 2
Monsieur B, 49 ans, se plaint d’acouphènes bilatéraux depuis quinze ans associés
à une hypoacousie bilatérale progressive appareillée.
L’otoscopie montre des tympans normaux. L’audiométrie tonale met en éviden-
ce une hypoacousie bilatérale très légèrement prédominante à droite (Fig. 2a).
L’audiométrie vocale est légèrement asymétrique. L’IRM met en évidence un petit
neurinome intra-canalaire droit (Fig. 2b).
Cas n° 1
Monsieur S, 54 ans, sportif, se plaint d’a-
couphènes aggravés par les efforts phy-
siques ainsi que les bruits intenses. Il
ressent alors une discrète instabilité.
Les tympans sont normaux.
L’audiométrie tonale met en évidence
une hypoacousie bilatérale de type perceptif sur les
aigus et un élément transmissionnel à droite.
Il a déjà bénéficié indûment de la pose d’un drain trans-
tympanique qui n’a pas amélioré les symptômes.
Les PEMV montrent un abaissement du seuil à droite.
Le scanner du rocher confirme la déhiscence du canal
semi-circulaire supérieur (Fig. 1).
C’est ici le caractère unilatéral, la surdité mixte à tym-
pan normal, l’aggravation de l’acouphène par le bruit
intense ou les efforts qui font orienter le bilan explo-
ratoire et suspecter le diagnostic. L’intervention chi-
rurgicale a stabilisé l’audition et atténué à 80 % l’acou-
phène.
CAS CLINIQUES
1a
2b
2a
1b
FLASH SFA 10:SFA2 8p 5.0 29/11/10 12:21 Page4

5
par l’ORL au patient, des hypothèses
physiopathologiques de survenue, dans
son cas précis, de l’acouphène, et de
la décision de la prise en charge.
Ensuite, en fonction de la décision
thérapeutique, en aparté, les autres
intervenants vont détailler au patient les
différentes étapes de cette prise en
charge et organiser les rendez-vous.
Le rôle de l’ORL, lors de la consultation
pluridisciplinaire, est donc bien un rôle
médical.
Tous les patients ne seront pas systé-
matiquement orientés vers la TRT. Pour
preuve, nous avons choisi quelques cas
cliniques récents (cf. encadrés), vus au
sein de notre consultation, dont le signe
d’appel et le motif de consultation
étaient toujours un acouphène.
Conclusion
Prendre en charge les patients acou-
phèniques en consultation pluridisci-
plinaire est pour l’ORL enrichissant
et cela allège le poids de ces consul-
tations.
Chacun apporte sa compétence et la
prise en charge est simplifiée.
Pour les patients, il est rassurant de voir
les professionnels discuter et être d’ac-
cord, l’impact de la décision thérapeu-
tique en est grandement majoré.
Au terme de six ans de fonction-
nement, l’expérience est positive pour
tous.
L’ORL doit, dans tous les cas, rester vi-
gilant à la recherche de toute étiologie
otologique ou rétro-cochléaire.
Cas n° 3
Madame M, 75 ans, se plaint d’acouphènes bilatéraux anciens à type
de sifflement connus depuis plus de dix ans, bien tolérés, ainsi que
d’une surdité bilatérale progressive (Fig. 3a).
Depuis quelques mois, les acouphènes se sont modifiés, devenus plus
graves et très discrètement pulsatiles à gauche, pénibles et invali-
dants.
Le tympan est atypique à gauche faisant évoquer dans certaines posi-
tions de la tête une bulle liquidienne isolée, sans caractère inflam-
matoire associé.
Le tympanogramme est normal.
Le scanner des rochers montre la présence d’une très large brèche
ostéoméningée, le liquide céphalorachidien remplissant la mastoïde
et la caisse du tympan, expliquant l’aspect tympanique et la surdité
mixte (Fig. 3b et 3c).
Le bourdonnement a disparu après le traitement chirurgical de la
brèche.
3b
3a
4a
Cas n° 4
Madame C, 47 ans, a comme antécédent une otite moyenne aiguë,
avec labyrinthisation progressive et des acouphènes à type de siffle-
ments.
C’est 18 mois plus tard, à l’occasion d’un traumatisme crânien, que sur-
vient un acouphène pulsatile gauche, extrêmement invalidant, avec
tympan normal.
L’audiométrie tonale montre une atteinte modérée de type percep-
tif à droite (Fig. 4a).
La TDM des rochers montre une déhiscence du tour basal de la
cochlée au contact du canal carotidien (Fig. 4b).
3c
4b
FLASH SFA 10:SFA2 8p 5.0 29/11/10 12:21 Page5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%