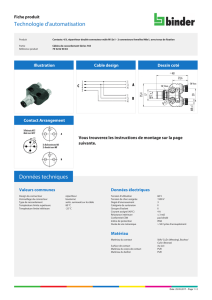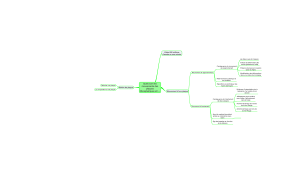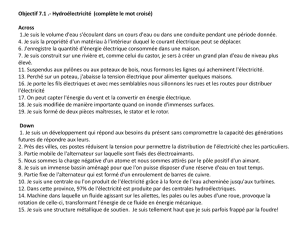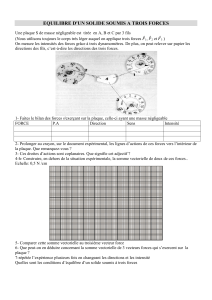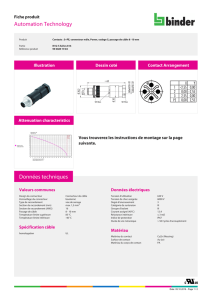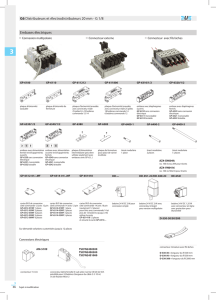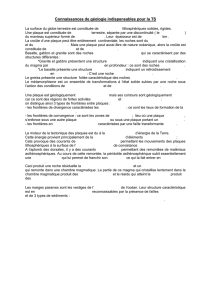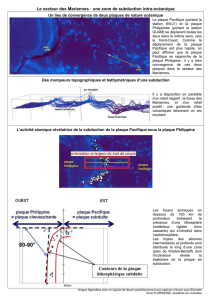Vers une procédure de contrôle des structures en verre trempé

1
Vers une procédure de contrôle des structures en verre trempé
Towards a control process for tempered glass structures
Fabrice Bernard1, Laurent Daudeville2,*, René Gy3
1Ecole des Mines de Douai, Département Génie Civil, 941 rue Charles Bourseul,
F-59508 Douai cedex, bernard@ensm-douai.fr
2Laboratoire Sols Solides Structures, Domaine Universitaire, F-38041 Grenoble
cedex 9, [email protected]
3Saint-Gobain Recherche, 39 quai Lucien Lefranc, F-93303 Aubervilliers cedex,
rene.gy@saint-gobain.com
*Correspondance et tirés à part

2
Vers une procédure de contrôle des structures en verre trempé
Résumé — Ce travail porte sur l’utilisation du verre comme véritable matériau de
structure et concerne plus particulièrement la proposition d’une méthode de
contrôle in-situ non destructif des structures en verre trempé thermiquement,
notamment dans les zones d’assemblage. Une méthode de dimensionnement de la
structure est proposée. Elle est fondée d’une part, sur un état limite ultime
garantissant la pérennité de la structure sur une longue durée de chargement, et
d’autre part, sur une prédiction, par la méthode des éléments finis, en tout point de
la structure, de l’état de contraintes, résiduelles dues au procédé de trempe
thermique ainsi que celles dues au chargement mécanique extérieur. La méthode
de contrôle consiste à comparer, durant la vie de la structure, des images issues
d’analyses photoélastiques sur la structure chargée, à des images obtenues par
calcul aux éléments finis pour l’état limite ultime ayant servi au
dimensionnement.
verre trempé / structures / mesures / contrôle in-situ / photoélasticité /
éléments finis / contraintes résiduelles / état limite ultime

3
Towards a control process for tempered glass structures
Abstract — This work deals with the use of glass as a real structural material, and
more particularly concerns a proposal of an in-situ non destructive control process
for tempered glass structures, especially in joint zones. A design method is
proposed. It is based on one hand, on a limit state ensuring the structure
perenniallity on long duration, and on another hand, on the finite element
prediction, on every point of the structure, of both residual stresses due to
tempering and stresses due to the mechanical loading. The control method
consists, during the life of the structure, in comparing images obtained from
photoelastic analyses of the loaded structure, to images obtained from finite
element analyses of the structure at the ultimate limit state used for the design.
tempered glass / structures / measurements / in-situ control / photoelasticity /
finite elements / residual stresses / ultimate limit state

4
Nomenclature
A vecteur analyseur
C constante photoélastique du verre
E vecteur champ électrique
E0 vecteur champ électrique émis
E1, E2 coordonnées du vecteur champ électrique
h épaisseur de matériau traversé par le rayon lumineux
I intensité de la lumière
I0 intensité de lumière émise
Id matrice identité
M opérateur d’intégration du champ électrique
n1, n2 indices optiques
T température du verre
x3 coordonnée selon l'épaisseur de la plaque de verre
∆ retard de phase
ϕ angle entre la première direction principale secondaire et l'axe
du polariseur
κ angle intermédiaire
λ longueur d'onde de la vibration lumineuse
σ1, σ2 contraintes principales secondaires
σ11, σ12, σ22 composantes dans le plan du tenseur des contraintes
ξ temps réduit

5
1. INTRODUCTION
L’emploi du verre pour les structures du Génie Civil est fortement pénalisé. En
effet, en dehors de qualités indéniables, comme une excellente durabilité ou une
résistance mécanique intrinsèque très élevée, le verre présente des inconvénients
certains : c’est d’abord un matériau fragile, très sensible à l’endommagement
mécanique de sa surface. La moindre fissuration superficielle, qu’elle qu’en soit
l’origine, fera chuter la résistance de plusieurs ordres de grandeur. C’est ensuite
un matériau présentant un phénomène de propagation sous-critique de fissure [1] ;
pour une valeur du facteur d’intensité des contraintes inférieure à la valeur
critique (la ténacité) et pour un chargement constant, une lente propagation des
défauts de surface a lieu (en raison d’une réaction chimique en pointe de fissure
entre le verre et l’humidité ambiante).
C’est pour ces raisons que les bureaux de contrôle pour la construction exigent
des coefficients partiels de sécurité relativement importants et des essais en vraie
grandeur pour toute structure en verre à réaliser. Les coefficients partiels de
sécurité proviennent :
– de coefficients intégrant les incertitudes sur les charges,
– de coefficients intégrant les incertitudes sur le comportement du matériau à
court et long terme.
Un coefficient partiel de sécurité de 2 est couramment utilisé pour la prise en
compte du comportement à long terme du verre, il provient de l’estimation de la
perte de résistance du verre sur des durées de vie de bâtiments (50 ans). La
diminution de la résistance pour de grandes durées de chargement est dû au
phénomène de fissuration sous-critique. Ce coefficient partiel de sécurité est très
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%