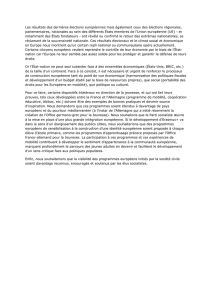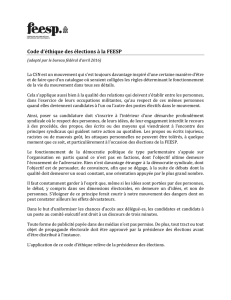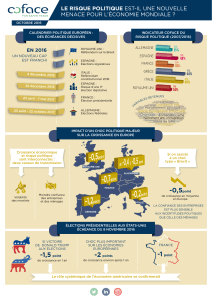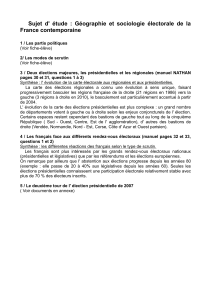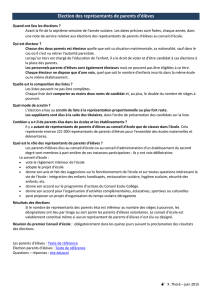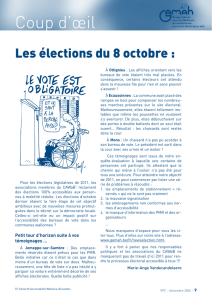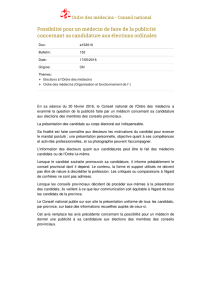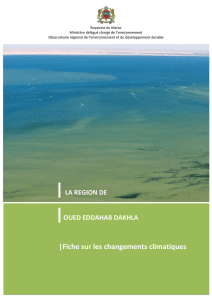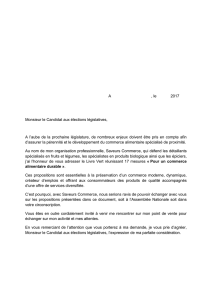Représentation et notabilité à Dakhla

1
ECPR, 14-19 avril 2005
Victoria Veguilla del Moral
Doctorante en Sciences Politiques
IEP Aix-en-Provence
Université de Grenade
Représentation et notabilité à Dakhla
Nous proposons une étude sur le système de représentation dans un espace local,
privilégiant une démarche analytique propre à l’anthropologie, et prenant comme site de
recherche les processus électoraux marocains 2002-2003. Nous estimons qu’en nous
plaçant dans une échelle analytique micro, ou en « jouant à changer l’échelle
d’analyse », nous pouvons saisir les logiques locales et les enjeux locaux des élections
passées, les registres de la représentation mobilisés et les rôles des représentants, du
point de vue des significations sociales. Nous proposons davantage une autre manière
d’approcher la « réalité sociale », nous permettant d’aborder « d’en bas » les processus
qui participent à la définition de la représentation légitime et que contribueraient
éventuellement à modeler les relations établies entre le centre et la périphérie1. Il s’agit
en outre de contribuer à cet effort, déjà initié, de discerner ce que nous apprennent les
processus électoraux inscrits dans un « territoire », à un moment précis. Ce faisant, nous
proposons une analyse dont le prisme est situé dans une échelle locale et c’est à ce
niveau d’analyse que nous saisirons d’autres processus sociaux et politiques nationaux,
voire internationaux. En privilégiant une démarche anthropologique, centrée sur le local
et plus spécifiquement sur l’action (interaction) des acteurs, dans toute leur complexité2,
nous espérons pouvoir rendre intelligible une autre réalité sociale3.
1 Plutôt que de configurer un cadre fournissant un exemple de « la hiérarchie réelle des pouvoirs dans la
société urbaine » (Abouhani p. 6) marocaine, cette étude cherche à saisir les significations cachées
derrière une conception de l’exercice du pouvoir qui « émane[rait] de points multiples » (Abouhani p. 7).
ABOUHANI Abdelghani, Pouvoir, villes et notabilités locales. Quant les notables font les villes, Rabat,
1999.
2 Compte tenu du contexte. Nous accordons à la notion de « contexte » une importance majeure. Elle a été
utilisée par les micro-historiens, puis par des anthropologues comme A. Bensa, pour qui « Les
comportements et les énoncés dont l’ethnologue prend note sont pourtant extraits du développement

2
Nos enquêtes à Dakhla nous ont permis de changer l’échelle d’analyse. Nous
avons étudié les processus électoraux du point de vue des significations données par les
acteurs locaux, des enjeux locaux, des rapports qui s’établissent entre candidats et
électeurs, puis entre représentants et représentés4. Cette manière d’aborder le moment
électoral a été révélatrice, entre autres, des critères de la notabilité, des critères de la
représentativité, des différentes conceptions des rôles des représentants. En d’autres
termes, elle a été révélatrice des « logiques » locales qui contribuent à la définition des
rôles joués par les élites locales et de là, à une conception de la représentation légitime
qui résulte des rapports sociaux, des actions et des interactions, inscrites dans un
« contexte ». Cependant, il faut bien s’éloigner de conclusions simples. Le système de la
représentation, tel que nous le montrerons, est davantage composite, complexe, son
étude devient un défi pour l’analyste dans une société marquée par des clivages
multiples, et faisant l’objet de dynamiques mouvantes, à de multiples niveaux, qui
conditionnent ses systèmes relationnels horizontaux et verticaux, à un moment donné et
dans le temps. Dans cette multiplicité complexe, nous avons remarqué un mode
d’interaction autre que la redistribution par des réseaux de clientèle, et c’est cette piste
que nous avons ici privilégiée, parce qu’elle nous est apparue tributaire des relations que
les acteurs locaux établissent avec le centre, au moment de nos recherches5. En ce sens,
nous rejetons l’idée d’un centre « tout-puissant », à côté d’espaces périphériques
écrasés6. Nous avançons en revanche qu’il existe une complexité de rapports sociaux,
continu des relations nouées de longue date entre les personnes qu’il observe et interroge ». BENSA
Alban, « De la micro-histoire vers une anthropologie critique » in REVEL Jacques (dir.), Jeux d’échelles.
La micro-analyse à l’expérience, Gallimard-Le Seuil, Paris, 1996, p. 44.
3 Vu « d’en bas », les élections au Maroc ne se réduisent pas « à des stratégies monarchiques de
cooptation successive d’une catégorie sociale à une autre ». BENNANI-CHAÏRIBI Mounia,
« Introduction » in BENNANI-CHRAÏBI Mounia, CATUSSE Myriam et SANTUCCI Jean-Claude (dir.),
Scènes et coulisses de l’élection au Maroc. Les législatives 2002, IREMAM-Karthala, 2004, p. 32.
4 Au sens large, car nous nous intéressons également aux énoncés, en dehors des processus électoraux,
des acteurs locaux se disant, par leurs discours, représentatifs de Dakhla.
5 Nous tenons compte de la temporalité des faits observés dans la mesure où « les catégories
anthropologiques soi-disant stables (tribus, ethnie) sont en fait changeantes et doivent, de toute manière,
être affinées au plus près de la réalité vécue au sein de laquelle elles sont bien sûr compliquées par
d’autres variables (politiques, économiques, psychologiques, individuelles, etc.) non moins prégnantes »
(Ahmed Salem, p. 205), et dans la mesure où les stratégies menées par l’Etat dans tous les domaines
locaux varient, par exemple, en fonction des conjonctures internationales autour de la résolution du
conflit. En ce sens, nous allons mettre l’accent moins sur « un trait structurel dominant et constant de
l’organisation politique ou de la « culture » locales » (Ahmed Salem, p.209), que sur des interactions
individuelles et contextualisées. AHMED SALEM Zekeria, « Sur la formation des élites politiques et la
mobilité sociale en Mauritanie » in BONTE Pierre et CLAUDOT-HAWAD Hélène, Elites du monde
nomade touareg et maure, Les Cahiers de l’IREMAM, nº 13/14, Aix-en-Provence, 2000.
6 Cette hypothèse nous renvoie à celle défendue par A. Signoles à propos de la Palestine et à celle
défendue par A. Abouhani dans le contexte marocain. SIGNOLES Aude, Municipalités et pouvoir local

3
politiques et économiques, dont il faut rendre compte dans les relations établies entre les
acteurs locaux et entre ceux-ci et les acteurs nationaux.
En partant « d’en bas », et sans prétendre épuiser ici le sujet, nous présenterons
au lecteur, dans un premier moment (1), les dynamiques historiques qui participent à la
définition des processus actuels, en privilégiant surtout la variable identitaire et la
variable économique. Cela va nous permettre de saisir l’historicité des énoncés que les
acteurs de la représentation mettent en avant lors des processus politiques électoraux, et
face aux situations de réussite sociale, économique ou/et politique individuelles. Dans
une seconde étape (2), nous aborderons l’analyse des élections législatives de 2002 et
des élections communales de 2003, à partir a) des énoncés des candidats (révélateurs
des stratégies mises en place, des registres de la représentation mobilisés et des clivages
socio-économiques, donc des enjeux locaux des élections), b) des candidatures
présentées ainsi que c) des résultats électoraux (ces deux derniers révélateurs des
critères de l’investiture). L’étude des élections législatives nous montre que les acteurs
ont mis en place des stratégies multiples au moment de demander le vote, ayant recours
à une multiplicité de registres de représentation qui mettent en exergue leurs
conceptions de la domination politique et économique, inscrite à Dakhla. Quant aux
critères de l’investiture, nous allons signaler leurs éléments de continuité et les
changements observables. Dans l’étude des élections communales, nous avons fait le
choix d’analyser deux circonscriptions : la municipalité de Dakhla et une commune
rurale. Si les élections à la municipalité de Dakhla nous renseignent sur une éventuelle
redéfinition des registres de la représentation, dans le sens d’un élargissement (la ville,
les autochtones), les élections de communes rurales se jouent entre des familles
appartenant à une même tribu, voir fraction de tribu. Dans ces circonstances, un
individu Sahraoui peut être considéré par les membres de sa tribu comme étant un
« étranger », nous le verrons, par rapport à la famille.
Dans une troisième phase (3), nous prenons le choix de réduire l’échelle
d’analyse et de nous focaliser sur les interactions entre individus, lors des échanges
électoraux (entre des candidats Sahraouis et certains électeurs également Sahraouis). Il
s’agit d’analyser les discours de la justification dans leur interaction avec les discours
abstentionnistes (ceux-ci étant aussi contextuels que les autres), et les influences
éventuelles que ces discours pourraient avoir sur les rôles des représentants et les
dans les Territoires palestiniens. Entre domination israélienne et Etat en formation (1993 – 2004), Thèse
de Doctorat en Sciences Politiques, Université Paris I, 2004, ABOUHANI A., op. cit.

4
critères de la notabilité. Pour conclure (4), nous formulerons des pistes de recherche sur
les motivations des candidats à occuper un poste politique.
1. La prise en compte nécessaire du contexte. Historicité des interactions sociales à
Dakhla
L’analyse micro des processus sociaux et politiques proposée a pour point de départ
l’individu et l’individu en interaction. Le système de relations qui résulte des actions
des acteurs doit être analysé dans un certain contexte, défini au gré des interactions
successives. La construction du contexte par l’analyste devient ainsi un travail
d’objectivation des enjeux locaux à un moment donné et de leur évolution dans le
temps. Il s’agit pour nous d’analyser les processus qui ont contribué à la configuration
de la structure sociale et économique observée lors des élections 2002-2003 à Dakhla,
toutes deux révélatrices des interactions entre acteurs pluriels et des enjeux locaux. Sans
prétendre épuiser le sujet, nous ferons connaître aux lecteurs les dynamiques sociales à
l’époque de la décolonisation espagnole du Sahara et les dynamiques économiques liées
au secteur de la pêche dans les années 90. Nous assumons le fait que notre étude va
consister à souligner deux moments historiques de la société étudiée. Mais nous
analysons ces deux moment historiques sous l’aspect de leur potentiel explicatif des
processus actuels. Les lignes qui suivent sont le résultat des enquêtes menées à Dakhla,
celles-ci nous ayant permis, à travers les énoncés des enquêtés, de saisir ce qui devient
aujourd’hui important et que nous ne pouvons comprendre que dans une perspective
historique. Nous utilisons le terme « Sahraoui » pour nous référer aux individus
originaires des tribus qui nomadisaient les régions qui furent colonisées par les
espagnoles, des tribus qui, depuis les années 60, se disent et sont considérées comme
« sahraouies ».
Des facteurs pluriels à l’origine de la structure sociale et économique observée
Il ne s’agit pas d’une sociologie de la genèse des structures observées. Ce que
nous proposons, ce sont des éléments nous permettant de comprendre les interactions
des acteurs lors des élections, les liens établis entre représentants et représentés, ainsi
que les différentes manières de concevoir la représentation légitime et le sujet passif de

5
la représentation (qui sont les représentés ?)7. Pour cela, il convient de faire le point sur
le moment qui marque le commencement de deux structures de pouvoir se disant toutes
deux Sahraouies. C. Barona Castañeda a travaillé8 sur la construction d’une identité
nationale au Sahara sous le Protectorat espagnol. Notre objectif ici demeure autre, à
savoir la description du scénario d’une déstructuration sociale et politique, ainsi que des
processus complexes de restructuration, individuels et collectifs. Cela nous intéresse
dans la mesure où les rapports sociaux et politiques entre des individus appartenant aux
élites politiques ou économiques (qui sont imbriquées dans une large mesure) et le reste
de la société habitant Dakhla, vont être conditionnés, entre autres, par ce processus de
déstructuration. L’élite locale, dans ses rapports avec la population, lors des élections ou
à un autre moment d’interaction, développera des stratégies discursives plurielles
révélatrices de critères de représentativité.
Durant les jours où la décolonisation du Sahara se « joue », de nombreux
Sahraouis fuient du territoire et s’installent sur le sol algérien, à un endroit connu
aujourd’hui comme « les camps de réfugiés de Tinduf ». Nous ne savons pas quelles
sont, au moment de la décolonisation, les motivations des individus qui décident de
rester. Nous nous contentons, du fait du manque d’études sur ce sujet, d’avancer une
thèse susceptible d’incorporer le degré de complexité observé, en postulant des
motivations plurielles, pas nécessairement idéologiques mais plutôt de l’ordre des
conjonctures individuelles ou familiales9. Quoi qu’il en soit, on ne peut analyser la
division en faisant une distinction entre des groupes. Elle concerne des individus
appartenant à des tribus et des fractions de tribu différentes, et aux membres d’une
7 La définition des « représentés » a été analysée par P. Bourdieu, qui écrit : « C’est parce que le
représentant existe, parce qu’il représente (action symbolique), que le groupe représenté, symbolisé,
existe, et qu’il fait exister, en retour, son représentant comme représentant d’un groupe » (p. 194).
L’analyse que nous développons ici se veut illustrative de ces propos dans le sens, nous le verrons, où la
définition du groupe de représentés fait l’objet à Dakhla d’un travail de redéfinition constant, influencé
par des facteurs multiples. Sachant cela, il convient ici d’analyser les facteurs pouvant éventuellement
participer à la configuration des représentations sociales locales du « bon représentant », ainsi que les
registres pluriels de la représentation mobilisés, à un moment d’interaction, par les individus qui font
partie de l’élite locale. BOURDIEU Pierre, Choses dites, Minuit, Paris, 1987.
8 BARONA CASTAÑEDA Claudia, Sahara al-Garbia 1958-1976. Estudios sobre la identidad nacional
saharaui, thèse de doctorat, Université Autonome de Madrid, 1998.
9 Plusieurs individus interrogés à ce sujet ont mis en avant le fait que certains membres de la famille
n’étaient pas à Dakhla au moment de prendre la décision, ou le fait qu’ils jouaient le rôle de gardiens des
biens familiaux. Nous n’avons cependant pas suffisamment analysé cette problématique pour avancer ici
des conclusions.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%