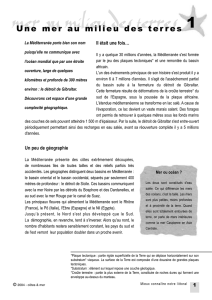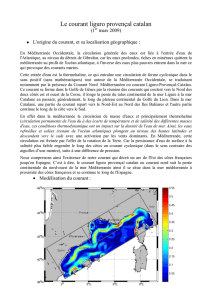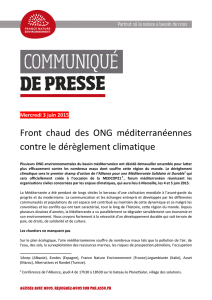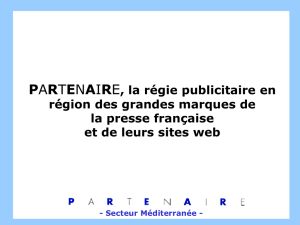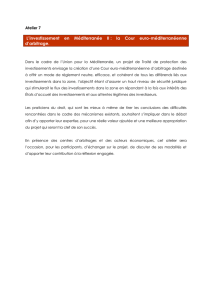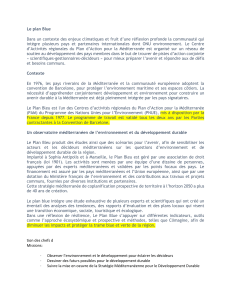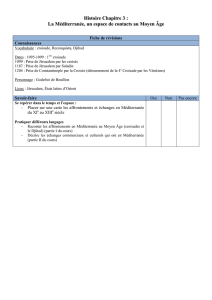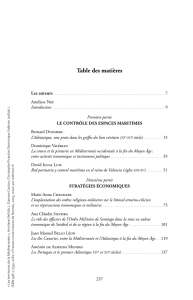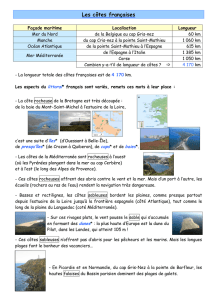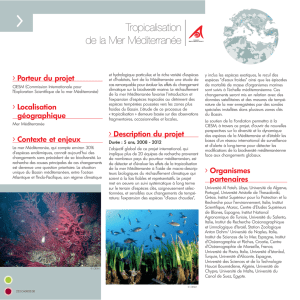1 les especes protegees de mediterranee

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 34
1 LES ESPECES PROTEGEES DE MEDITERRANEE
1.1 PREAMBULE
www.mnhn.fr/mnhn/bimm/protection/ fr/Especes/Fiches/Centrostephanuslongispinus.html
http://nature.ca/notebooks/francais/etorver.htm
Le manque d'équipement d'épuration efficace ainsi que l'émergence des villes côtières induisent
une augmentation des rejets à la mer des déchets ménagère mais aussi des déchets industriels
toxique.
De plus les grands fleuves qui se jettent dans la Méditerranée y charrient des métaux lourds
(cadmium, mercure, chrome, plomb, zinc), des pesticides et des désherbants provenant de notre
mode de vie.
A cela s'ajoutent les déchets solides du à un manque de civisme de l'individu, promeneur
occasionnel ou plongeur aguerrit.
La Méditerranée est aussi un axe de transport maritime qui sillonnée par des navires de
commerce accompagné par son lot de pollutions volontaire ou accidentelle.
Le facteur aggravant de ces menaces est le fait que la Méditerranée est considéré comme une
mer pratiquement fermé.
La durée de renouvellement des eaux est comprise entre 80 et 100 ans. Une goutte d'eau qui
rentre dans la mer Méditerranée met 80 à 100 ans pour en sortir.
A ces problèmes s'en ajoutent d'autres, dont l'homme est également responsable, qui relèvent
en particulier de la gestion du littoral et des ressources marines.
En 1989, un groupe de travail s'est réuni à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, pour
aborder les problèmes des espèces menacées de la Méditerranée. Parmi celles qui ont été
considérées comme le plus en danger et qui devraient, par conséquent, relever de mesures
urgentes de protection.
Dans le cadre de ce document, je vais citer les espèces portées à ma connaissance à ce jour.
Toutefois, pour connaître la liste exhaustive des espèces protégées, Il est nécessaire de se
renseigner auprès de autorité compétente.

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 35
1.2 LA FLORE
La Posidonie
Posidonia oceanica
La Posidonie est une phanérogame, c'est à dire une
plante à fleurs. Elle constitue des herbiers qui
produisent des quantités importantes d'oxygène et
qui offrent abri, frayère et source importante de
nourriture pour la faune ; ce sont d'extraordinaires
oasis de vie. La Posidonie (qui n'existe qu'en
Méditerranée) se rencontre depuis la surface jusqu'à
30-40 m de profondeur. Fragiles et vulnérables, les
herbiers de Posidonie régressent à cause de la
pollution, des aménagements portuaires, des
endigages et de l'action mécanique des ancres ou des
arts traînants de pêche. La vitesse de croissance des
Posidonies est très lente et leur régression est
irréversible à l'échelle humaine. lorsque les herbiers
diminuent, c'est toute la faune qui y a élu domicile qui
est menacée. Les actions de maîtrise de
l'assainissement et des aménagements, menées dans
notre région, ont permis de ralentir ce phénomène de
régression et parfois même de l'inverser. D'autres
phanérogames marines (Cymodocée, Zostère) forment
des herbiers ponctuels dans des petits fonds. Elles
jouent un rôle similaire à celui de la posidonie.
Protection :protection en France par arrêté du 19
juillet 1988.
La Cymodocée
Cymodocea nodosa
Plante à fleurs aquatique avec racines, tige et feuilles. Ces
dernières sont réunies en petits bouquets dont la base est
un fin rhizome ensablé. Le bord des feuilles est dentelé de
manière caractéristique. La cymodocée se développe dans
les eaux chaudes et peu agitées sur une couche de
sédiments.
Les feuilles mesurent jusqu'à 50 cm de longueur.

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 36
La zostère naine
Nanozosteria noltii
Comme la posidonie et la cymodocée, la zostère est une
plante à fleurs. Elle ressemble à du gazon très fin et se
rencontre le plus souvent sur des fonds alluvionnaires
des lagunes côtières ou en mer ouverte dans les baies
abritées ou à proximité estuaires. Les rhizomes se
développent sous le sédiment et peuvent pousser de
plusieurs dizaines de centimètres par an. Les fleurs
ressemblent à celles des graminées : de petites spathes
discrètes s'observent au printemps. Les minuscules
graines tombent sur le sol et ne germent que si la
salinité est nettement plus faible que celle de la mer. Il
existe aussi une autre zostère en Méditerranée qui ne
se trouve dans les lagunes où la salinité est faible. La
grande zostère,
Zostera marina,
très fréquente sur
les côtes de l'Atlantique est aussi protégée en
Méditerranée.
La Cystoseires Cystoseira amentacea
Genre d'algues plutôt répandues dans les eaux de surface, où
elles forment des populations très importantes le long des côtes
rocheuses les plus exposées à l'action des vagues et les mieux
éclairées. Selon les espèces, la coloration varie du noir presque
uni au brun, au jaune ou au doré. Quelques espèces atteignent 1
m de haut.
C'est une algues qui résiste au fort changement de température
du gel en hiver à l'insolation l'été.
Cette algue craint tous les polluants flottants qui l'atteignent et
disparaît dès qu'il y a une augmentation de nitrate dans l'eau.
C'est donc une espèce indicatrice de la pureté de l'eau.

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 37
1.3 LA FAUNE AQUATIQUE
Le corail rouge Corallium rubrum
Description Colonie arborescente dont les
ramifications s'orientent selon plusieurs plans.
La couleur dominante est le rouge, avec
diverses variantes allant du rouge très foncé,
presque noir, au blanc (très rare). Les polypes
sont blancs, avec 8 tentacules pennés. Le
squelette calcaire, dur mais fragile, est revêtu
d'une couche tissulaire molle.
Dimensions Peut dépasser 30 cm de hauteur.
Caractères distinctifs Structure
arborescente, ramifications sur plusieurs plans ;
consistance rigide ; polypes pennés, blancs.
Biologie Le corail a une reproduction sexuée, avec des larves qui, après une phase embryonnaire
d'environ un mois et quelques jours de vie planctonique, se fixent au substrat en fonction
d'exigences précises, portant notamment sur un éclairage restreint, une salinité constante et
une eau peu agitée. C'est ce qui explique pourquoi le corail est plus commun dans les grottes, où il
pousse vers le bas et n'est pas recouvert par des sédiments. Sa croissance est de 3-4 cm en dix
ans
L'oursin diadème Centrostephanus longispinus
Test rigide, rond, dont les plaques ambulacraires se
caractérisent par des séries régulières de 3 paires de
pores. Les piquants, très longs, très minces et creux,
sont entourés à la base d'une collerette de verticilles
écailleux. La partie dorsale porte des petites épines
claviformes de couleur rouge vif, très mobiles. Le test
est couvert d'un tégument brun violacé. Les piquants
sont rayés, en alternance, de bandes blanchâtres,
violacées ou noires.
le test est de couleur brun violacé assez foncé voire
noir. Les radioles sont annelés de blanc, jaune ou violet.
le diamètre maximal du corps est de 6 cm. Les piquants
primaires peuvent dépasser 70 mm de long alors que les
secondaires ont des longueurs comprises entre 5 et 30
mm.
Cet oursin, qui est l'unique représentant de la famille des diadématidés, est surtout commun dans
les eaux tropicales. C'est un animal plutôt nocturne, qui semble craindre la lumière ; toutefois, en
zone éclairée, ses piquants s'orientent automatiquement vers tout ce qui lui fait de l'ombre. Il se
nourrit d'éponges et sans doute aussi d'algues

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 38
Les hippocampe Hippocampus Hippocampus et Hippocampus ramulosus
Il existe deux espèces en France. L'une se trouve en
Méditerranée, et sur les côtes atlantiques jusqu'à la
Manche. Appelée "hippocampe à museau court" :
Hippocampus hippocampus
L'autre fréquente la Méditerranée et les côtes
atlantiques jusqu'en Bretagne: "l'hippocampe à long
bec" ou "hippocampe moucheté ". Hippocampus
ramulosus .
Si Hippocampus hippocampus atteint 7-10 cm, le mâle étant un peu plus grand que la femelle,
Hippocampus ramulosus .présente des tailles variables selon les populations : 12-14 cm à 16-18
cm.
Les deux espèces vivent dans des milieux semblables, constitués d'un fond sableux planté de
posidonies ou de zostères (plantes "supérieures"), mais aussi d'algues fixées sur le substrat. Ce
sont des animaux lents et majestueux voire sensuels.
Les hippocampes n'ont pas d'écaille. La nageoire anale est réduite, plus grande chez la femelle
que chez le mâle. Les branchies sont également réduites, et contenues dans une véritable cavité
qui ne s'ouvre que par une seule petite ouverture, à l'arrière de la tête.
Le corps est recouvert par une sorte de cuirasse osseuse (carène), sous-jacente à la peau, et qui
s'attache le long de la colonne vertébrale. Ce qui fait que la forme de l'animal reste toujours la
même, y compris hors de l'eau. Seuls les nageoires, l'anus et la bouche sortent de cette cuirasse
par des ouvertures étroites. La queue est aussi longue que le corps, et préhensile. Les
hippocampes l'utilisent pour s'accrocher aux plantes ou aux copains. Quand les hippocampes se
déplacent en pleine eau, ils enroulent leur queue en colimaçon. réduisant ainsi du tiers leur
longueur réelle. La tête, qui ressemble à celle d'un cheval, d'où son nom, est de loin la partie la
plus mobile chez les hippocampes, ce qui est un cas unique chez un poisson. Les yeux sont
également mobiles et placés au bout de pédoncules courts qui peuvent se déplacer
indépendamment les uns des autres comme chez les caméléons.
La coloration des deux espèces peut varier selon l'époque de l'année, l'âge, l'état physiologique
et l'excitation sexuelle. Les couleurs habituellement décrites dans la nature se retrouvent chez
les animaux placés dans de grands bacs.
Hippocampus hippocampus possède une série de fines stries de couleur bleu métallique, disposées
en rayons autour de l'oeil et des protubérances caractéristiques. En particulier sur le front et le
sommet de la tête. Le guttulatus, lui, est plus sombre, presque noir, tacheté de petits points
bleus métalliques. Ils possèdent en outre des excroissances en forme de filaments souvent
ramifiés, disposés en deux rangées de part et d'autre de la colonne vertébrale
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%